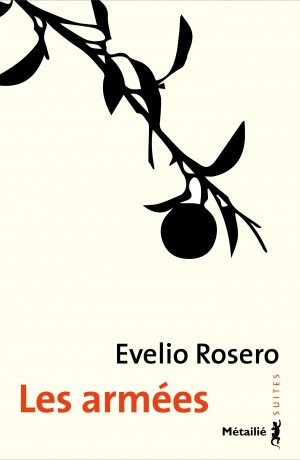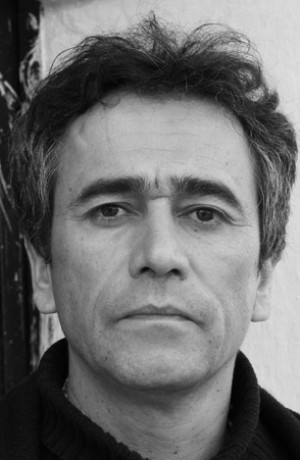Evelio Rosero a reçu le Prix national de littérature et pour ce dernier roman le Prix Tusquets 2006.
La vie pourrait sembler idyllique à San José, petite bourgade colombienne, où Ismael, un vieil instituteur à la retraite, coule des jours paisibles avec sa femme Otilia. A la grande honte de celle-ci, il passe ses journées à cueillir des oranges et à épier sa belle voisine qui se prélasse nue au soleil. Mais lorsque des bandes armées que rien ne distingue – paramilitaires, guérilleros, narcotrafiquants – font irruption, tout se déglingue. Des habitants sont sauvagement assassinés, d’autres enlevés, des rançons sont réclamées par les ravisseurs, la peur règne sur les esprits. Ismael commence à perdre la mémoire et la raison, il ne retrouve plus le chemin de la maison, ne reconnaît plus les visages, il s’égare dans ses souvenirs et dans les rues du village à la recherche de sa femme qui a disparu. Les habitants s’enfuient, mais il décide de rester au milieu des ruines pour attendre le retour d’Otilia, sa seule et dernière boussole.
Vieillard titubant, pathétique, bredouillant, mais révolté jusque dans son propre délire, Ismael est le narrateur de ce chaos sanglant où le village de San José apparaît comme un concentré chauffé à blanc d’une Colombie ravagée par la violence et les prises d’otages.
-
Le drame colombien trouve avec ce bref roman son expression la plus universelle. Une vraie découverte.
-
"Evelio Rosero nous fait vivre dans ce livre l'angoisse et la peur des villageois, et la descente aux enfers d'un village et d'un vieil homme.
Un livre touchant et marquant."
Hélène Salat
-
"Les Armées est un roman capital." Lire l'article ici
Véronique OvaldéLe Monde des livres -
, Arnaud LaporteFRANCE CULTURE Tout arrive
-
, Sophie LoubièreFRANCE INTER Parking de l'été
-
« Voici un roman étranger sur lequel il convient vraiment de s’attarder. Cet auteur colombien aborde ici la violence et la peur qui sévissent dans ce pays ensanglanté, mais sous un jour particulièrement original en choisissant tout simplement en vieil instituteur à la retraite comme narrateur. […] Ce roman a reçu le premier Prix Tusquets à Guadalajara en 2006, dont le jury était présidé par Alberti Manguel. »CARNETS DE SEL
-
« Sa plume dégage une force nouvelle, inédite, qui confère à ce court roman une beauté crépusculaire intense. »
Mickaël DemetsEVENE.FR -
Evelio Rosero laisse la parole au vieux prof. C’est la force de son récit : la guerre est là, tissée dans la vie des gens, opaque, tapie, prête à semer sa grenaille à l’aveugle. On ne la voit pas mais elle imprègne tous les gestes, la banalité de cette bourgade provinciale. Et nous la lisons à travers le regard de plus en plus flou d’un homme dont le monde vacille. »
Isabelle RüfLE TEMPS -
« Evelio Rosero nous montre le monde du point de vue du vieil instituteur dont la stabilité mentale s’effondre lorsque le village est dévasté, il nous donne à voir ce qu’est la violence arbitraire et irrationnelle exercée sur des otages anonymes par la guérilla colombienne. »
ESPACES LATINOS -
« Le vieil Ismael, qui aime passionnément la vie, le plaisir, l’intelligence, cède en quelques heures, face à la folie des hommes en armes qui surgissent… »
Daniel MartinLA MONTAGNE -
« L’écrivain colombien fait oeuvre originale en montrant la guerre du point de vue des civils soumis à l’arbitraire, au désordre, à l’imminence de la mort. Le tour de force est ici de mettre en résonance un monde instable, au bord du gouffre, et l’esprit d’un vieillard au bout du rouleau. »
Richard SourgnesLE REPUBLICAIN LORRAIN -
« Evelio Rosero nous offre une narration d’une intensité rare… mais aussi d’une noirceur inégalée… La descente aux enfers de San José et de ses habitants, si habilement décrite au travers du regard d’Ismael, devient le symbole d’une Colombie encore aujourd’hui ravagée par une violence arbitraire et irrationnelle, qui prend en otage des villages entiers, livrés aux mains de différents groupes armés. »
Joëlle Boneu MerckaertALTERMONDES -
« En choisissant un vieillard comme narrateur, l’auteur dépeint de façon tout à fait nouvelle le thème pourtant trop souvent abordé de la peur et des violences qui ravagent la Colombie. »
Victor DillingerL’AMATEUR DE CIGARE -
« Obsédant, le cri grossit et se multiplie « avec une force ascendante ». Le cri de l’horreur. Le cri de la Colombie. »
Françoise BarthélemyLE MONDE DIPLOMATIQUE -
« Né en 1958 à Bogota, Evelio Rosero est l’auteur de plusieurs romans, dont cet extraordinaire récit Les Armées, qui a obtenu en 2006 le prix Tusquets. »
Daniel WaltherLE MAGAZINE DES LIVRES -
« A travers le naufrage d’un vieillard, Rosero dépeint le sabordage de tout un pays et son roman est un jeu de massacre impitoyable, sur le brasero d’une écriture chauffée à blanc. Il nous tarde que les éditions Métailié traduisent au plus vite les autres livres du Colombien. »
André ClavelLIRE -
« Evelio Rosero offre dans Les Armées un texte subjectif aux contrastes terribles, où la brutalité éclate de façon scandaleuse, posant la question de sa maîtrise par le récit et de la possibilité de sa représentation. »
Etienne LeterrierLE MATRICULE DES ANGES -
« Evelio Rosero nous entraîne avec une sensibilité bouleversante dans le chaos d’une petite ville colombienne, harcelée indifféremment par les guérilleros, les paramilitaires, les militaires ou les narcotrafiquants. En épousant le point de vue d’un vieillard qui se laisse emporter par son imagination lubrique ou ses divagations séniles, Evelio Rosero sonde la perception, sans cesse vacillante, de la violente arbitraire exercée sue la population par ces différentes factions. »
B. ArvetLA SEMAINE -
« Est-il besoin de dire que Les Armées est l'un des romans latino-américains les plus importants de ces dernières années? »
Rafael LemusCOURRIER INTERNATIONAL -
« Les Armées, un roman où les oranges ont de drôles de pépins. Un livre qui explose. »
André RollinLE CANARD ENCHAINE -
« On avait commencé par lire un (très bon) roman sur la guerre civile colombienne, et l’on referme un livre bouleversant sur la capacité de la réalité à fracasser un être. »
Raphaëlle LeyrisLES INROCKUPTIBLES -
« On sent chez Rosero la tristesse et la rigueur […], pour ainsi dire sa pluie, que sèche une phrase tantôt brillante, tantôt mate, tombée indifféremment d’un oranger ou d’un fusil. »
Philippe LançonLIBERATION -
« La peur appartient d’abord à ceux qui se lèvent tôt. Dans ce village colombien, du moins. Des soldats sont là, on ne sait s’ils appartiennent à la guérilla ou aux paramilitaires. Ils vérifient les papiers de promeneurs matinaux, les emmènent. Vers où ? »
Philippe LançonLIBERATION
C’était comme ça : chez le Brésilien les perroquets riaient tout le temps, je les entendais du mur de mon verger, grimpé sur l’échelle où je cueillais des oranges que je jetais dans un grand panier de palme. De temps à autre je sentais dans mon dos les trois chats qui m’observaient, perchés dans les amandiers. Que me disaient-ils ? Rien, je ne les comprenais pas. Un peu plus loin, ma femme donnait à manger aux poissons du bassin, nous vieillissions ainsi, elle et moi, les poissons et les chats, mais ma femme et les poissons, que me disaient-ils ? Rien, je ne les comprenais pas.
Le soleil commençait à briller.
La femme du Brésilien, la svelte Geraldina, cherchait la chaleur sur sa terrasse, complètement nue, allongée à plat ventre sur un couvre-lit rouge à fleurs. Près d’elle, à l’ombre rafraîchissante d’un kapokier, les mains énormes du Brésilien effleuraient sagement sa guitare et sa voix se mêlait, placide et insistante, au doux gloussement des perroquets. Ainsi s’écoulaient les heures sur cette terrasse, au soleil et en musique.
Dans la cuisine, la belle petite cuisinière – on l’appelait la Gracielita – faisait la vaisselle, juchée sur un escabeau jaune. Je la voyais par la fenêtre sans vitre de la cuisine donnant sur le jardin. A son insu elle roulait des hanches en lavant les plats ; sous sa courte robe d’un blanc éclatant, chaque partie de son corps se dandinait au rythme frénétique et consciencieux de la besogne : assiettes et tasses étincelaient entre ses mains brunes, de temps en temps surgissait un couteau à dents, brillant et joyeux, mais comme ensanglanté. Moi aussi je souffrais, à cause de Gracielita, mais aussi de ce couteau ensanglanté. Le fils du Brésilien, Eusebito, l’épiait, et moi je l’épiais en train de l’épier, lui caché sous une table couverte d’ananas, elle baignant dans une innocence profonde, inconsciemment imbue d’elle-même. Pour lui, pâle et tremblant, c’était la découverte des premiers mystères, il était fasciné et tourmenté par la jolie petite culotte blanche qui s’insinuait entre les fesses généreuses de Gracielita, que je n’arrivais pas à voir de l’endroit où je me trouvais, mais – ce qui était mieux – que j’imaginais. Elle avait le même âge que lui, douze ans. Elle était potelée mais élancée, ses joues brunes s’éclairaient de touches rosées, ses cheveux crépus étaient noirs comme ses yeux, les deux petits fruits durs de sa poitrine se dressaient comme à la recherche du soleil. Prématurément orpheline, ses parents étaient morts au cours de la dernière attaque contre notre village par on ne sait toujours pas quelle armée, les paramilitaires ou la guérilla. Un bâton de dynamite avait explosé en pleine église, au moment de l’élévation, alors que la moitié des habitants s’y trouvaient rassemblés. C’était la première messe du Jeudi saint, il y avait eu quatorze morts et soixante-quatre blessés. Gracielita avait été épargnée par miracle : elle vendait des petits bonshommes en sucre à l’école. Grâce à la recommandation du père Albornoz, elle vivait et travaillait chez le Brésilien, depuis bientôt deux ans. Sous la houlette de Geraldina, elle avait appris à préparer toutes les recettes et en avait même inventé de nouvelles, si bien que depuis un an au moins Geraldina ne s’occupait plus de la cuisine. Ça, je le savais rien qu’à la regarder se dorer au soleil, boire du vin, s’allonger et s’étirer sans autre souci que le teint de sa peau et l’odeur de ses cheveux comme s’il s’agissait du teint et de la texture de son cœur. Ce n’était pas en vain que sa longue chevelure cuivrée faisait irruption telle une aile dans les rues de notre San José, village paisible, lors qu’elle nous faisait la grâce de s’y promener. La désirable et encore jeune Geraldina gardait l’argent gagné par Gracielita : “Quand tu auras quinze ans, l’avais-je entendue dire, je te remettrai religieusement ton argent, et beaucoup de cadeaux en plus. Tu pourras apprendre la couture, tu seras une femme bien, tu te marieras, nous serons les parrains de ton premier enfant et tu viendras nous voir tous les dimanches, qu’est-ce que tu en dis, Gracielita ?” Je l’entendais rire et Gracielita riait aussi. Dans cette maison elle avait sa chambre où l’attendaient tous les soirs son lit et ses poupées. Et nous, ses plus proches voisins, nous aurions pu jurer la main sur le cœur que Geraldina traitait la petite comme sa propre fille.
A tout moment de la journée, les deux enfants oubliaient le monde et jouaient dans le jardin grinçant de lumière. Je les voyais. Je les entendais. Ils se poursuivaient entre les arbres, roulaient emmêlés sur les molles buttes herbeuses autour de la maison, se laissaient tomber dans les creux et, après les jeux, après les mains qui se joignaient sans le vouloir, les cous et les jambes qui se frôlaient, les souffles qui se mêlaient, ils contemplaient fascinés les bonds d’une grenouille jaune ou la reptation inattendue d’un serpent parmi les fleurs qui les pétrifiait. Bientôt un cri était lancé de la terrasse : c’était Geraldina, plus nue que jamais, ondulante sous le soleil, qui de sa voix chaude, aiguë mais harmonieuse, s’écriait : “Gracielita, il faut balayer les couloirs !”
Ils abandonnaient leurs jeux et une espèce de tristesse boudeuse les ramenait dans le monde. Gracielita courait aussitôt reprendre le balai, traversait le jardin, son uniforme blanc ondoyait contre son nombril comme un drapeau, ceignant son jeune corps, sculptant son pubis, mais Eusebito la suivait et ne tardait pas à reprendre, involontairement, sans le comprendre, l’autre jeu essentiel, poussé à son paroxysme, par lequel il me ressemblait malgré son jeune âge, le jeu de la panique, le naissant mais subjuguant désir de la regarder à son insu, de l’épier avec délectation : de profil, les yeux comme innocents, embués d’on ne sait quels rêves, puis les mollets, les genoux ronds, les jambes, enfin ses cuisses et, avec un peu de chance, au-delà, encore plus haut.
–Vous grimpez tous les jours sur ce mur, professeur ? Vous ne vous ennuyez pas ?
–Non, je cueille mes oranges.
–Et un peu plus. Vous regardez ma femme.
Le Brésilien et moi nous nous dévisageâmes un instant.
–D’après ce que je vois, dit-il, vos oranges sont rondes, mais ma femme doit être encore plus ronde, non ?
Nous sourîmes. Nous ne pouvions faire autre chose.
–C’est vrai. Si vous le dites.
Je ne regardais pas sa femme à ce moment-là, mais Gracielita, pourtant je jetai malgré moi un coup d’œil sur la terrasse, où Geraldina allongée sur le ventre paraissait s’étirer. Elle offrait bras et jambes à tout vent. Je crus voir à sa place un insecte iridescent. Soudain elle se releva d’un bond, telle une magnifique sauterelle, pour redevenir aussitôt une simple femme nue lorsqu’elle se tourna vers nous et s’avança, sûre de sa lenteur féline, tantôt à l’ombre des gaïacs, frôlée par les bras centenaires du kapokier, tantôt comme consumée par le soleil qui, au lieu de l’éclairer, l’obscurcissait de pure lumière et semblait l’avaler. Nous la regardions s’approcher telle une ombre.
Eusebio Almida, le Brésilien, tenait à la main une baguette de bambou et la frappait doucement sur son épais pantalon de cheval kaki. Il rentrait de la chasse. Non loin, on entendait le piaffement de son cheval mêlé au rire sporadique des perroquets. Il regardait sa femme s’approcher nue, longeant le carrelage de la petite piscine ronde.
–Je sais très bien, dit-il avec un sourire sincère, que ça lui est égal. Je ne m’en fais pas pour ça. Mais je m’inquiète pour vous, professeur.
Vous n’avez pas le cœur fragile ? Quel âge avez-vous ?
–Tous les âges.
–En tout cas, vous ne manquez pas d’humour.
–Que voulez-vous ? Dis-je en levant les yeux au ciel. J’ai appris à lire à celui qui est aujourd’hui le maire, et au père Albornoz. Je leur ai tiré les oreilles et, vous voyez, je ne me suis pas trompé, on devrait encore les leur tirer.
–Vous me faites rire, professeur. Cette façon de changer de sujet.
–De sujet ?
Mais sa femme était déjà près de lui, et de moi, même si le mur et l’âge nous séparaient. La sueur brillait sur son front. Tout son corps souriait. Son rire montait de la toison clairsemée de sa fente rosée – que je devinais plus que je ne la voyais – jusqu’à sa bouche ouverte sur de petites dents, qui riait comme si elle pleurait.
–Voisin, me lança-t-elle joyeusement comme à son habitude chaque fois que nous nous rencontrions. Je meurs de soif. Vous m’offrez une orange ?
Ils étaient heureux, enlacés deux mètres au-dessous de moi. Leurs jeunes têtes levées et souriantes me surveillaient à leur tour. Je choisis la plus belle orange et entrepris moi-même de la peler, pendant qu’ils se câlinaient. Ni lui ni elle ne semblaient se soucier de la nudité. Ce qui n’était pas mon cas, mais je ne laissai paraître aucun signe de cette suprême et irrépressible émotion, comme si, au soir de ma vie, je n’avais jamais été troublé par la nudité d’une femme. Je me penchai et tendis une orange à Geraldina.
–Attention, professeur, ne tombez pas, fit le Brésilien. Lancez plutôt l’orange, je l’attrape.
Mais je restai penché en équilibre sur le mur : Geraldina n’avait qu’un pas à faire pour prendre l’orange. Elle entrouvrit la bouche, surprise, fit un pas en avant et prit le fruit en riant, ravie.
–Merci, dit-elle.
Des effluves amers et sucrés s’élevèrent de sa bouche rougie. Je sais que cette exhalaison aigre-douce nous surprit tous les deux.
–Comme vous voyez, dit le Brésilien, ça lui est indifférent de se promener toute nue devant vous.
–Elle a bien raison. A mon âge j’ai déjà tout vu.
Geraldina éclata de rire : on eût dit une bande de colombes jaillissant du mur. Mais elle m’observa aussi avec grande curiosité, comme si elle découvrait ma présence dans le monde. Ça m’était égal, il fallait bien qu’elle me découvre un jour. Elle rougit un bref instant, puis redevint normale, ou se détendit, ou éprouva de la compassion. Ma tête de vieux, de futur mort, ma sainte vieillesse, durent la rassurer. Elle ne percevait pas encore que mon nez et mon esprit tout entier se dilataient en absorbant les émanations de son corps, mélange de savon, de sueur, de peau et de replis secrets. Elle avait l’orange entre ses mains et l’ouvrait. Elle porta enfin un quartier à sa bouche, le suça et l’engloutit avec délectation. Elle le mordait et des gouttes brillantes glissaient de ses lèvres.
–Il n’est pas adorable, notre voisin ? demanda le Brésilien.
Elle avait l’air stupéfaite mais malgré tout maîtresse du monde.
Elle souriait au soleil.
–Il l’est, dit-elle, langoureuse, il l’est.
Et tous deux s’éloignèrent enlacés vers l’ombre, mais elle s’arrêta pour se retourner et m’observer, jambes ouvertes, le soleil convergeant vers son centre, et me lança – chant d’un oiseau rare:
–Merci pour l’orange, monsieur.
Elle n’avait pas dit voisin.
Elle avait pressenti en une fraction de seconde que je ne scrutais pas ses yeux. Tout à coup elle découvrait que, tel un tourbillon d’eau trouble, charriant on ne sait quelles forces – devait-elle penser, mes yeux souffrants regardaient fugacement vers le bas, son centre entrouvert, son autre bouche d’où sortait sa voix la plus intime : “Eh bien, regarde-moi”, s’écriait son autre bouche, et ce malgré ma vieillesse, ou plutôt à cause de ma vieillesse, “regarde-moi, si tu oses”.