Chargée d’écrire une préface pour l’extraordinaire journal que Marie Curie a tenu après la mort de Pierre Curie, Rosa Montero s’est vue prise dans un tourbillon de mots. Au fil de son récit du parcours extraordinaire et largement méconnu de cette femme hors normes, elle construit un livre à mi-chemin entre les souvenirs personnels et la mémoire collective, entre l’analyse de notre époque et l’évocation intime. Elle nous parle du dépassement de la douleur, de la perte de l’homme aimé qu’elle vient elle-même de vivre, du deuil, de la reconstruction de soi, des relations entre les hommes et les femmes, de la splendeur du sexe, de la bonne mort et de la belle vie, de la science et de l’ignorance, de la force salvatrice de la littérature et de la sagesse de ceux qui apprennent à jouir de l’existence avec plénitude et légèreté.
Vivant, libre, original, ce texte étonnant, plein de souvenirs, d’anecdotes et d’amitiés nous plonge dans le plaisir primaire qu’apporte une bonne histoire. Un récit sincère, émouvant, captivant dès ses premières pages. Le lecteur sent, comme toujours avec la vraie littérature, qu’il a été écrit pour lui.
« Rosa Montero aime le risque (…) et elle risque tout pour que nous nous remettions à croire dans les relations entre le langage et la réalité, dans le pouvoir des mots. »
Enrique Vila-Matas
-
Voici un texte magnifique, lumineux sur un sujet douloureux : la perte de l’être aimé. Quelques temps après avoir perdu son compagnon, Rosa Montero est chargée par son éditrice espagnole et amie d’écrire une préface au court journal que tint Marie Curie les mois qui suivirent le décès brutal et accidentel de son mari Pierre. Une oeuvre littéraire qui fut aussi un travail de reconstruction personnel pour Rosa Montero. A un siècle de distance, l’écrivaine confronte son expérience à celle de la femme de sciences, nous fait pénétrer dans l’intimité de ce couple si peu ordinaire que constituèrent les Curie. L’idée ridicule de ne jamais te revoir est également un très beau portrait de la femme passionnée et combative qu’était Marie Curie, qui dut toute sa vie lutter contre le machisme et la misogynie. Un livre pour tous et pour chacun, qui nous donne la chance de partager quelques heures d’intimité avec deux femmes magnifiques, chacune à sa manière.Yves Martin
-
"Surprenante Rosa Montero, qui vous donne envie de lire et de relire son texte tant il fourmille d'anecdotes de vie, d'humanité, d'authenticité et de culture littéraire. #UnSuperbeCadeau, à la fois personnel et universel, où chacun reconnaîtra la force de la littérature." in le magazine Page des libraires.Isabelle Theillet
-
"Quelle chance que certains livres croisent notre route. Ce n’est pas juste une biographie de Marie Curie, ni une véritable autobiographie, c’est bien plus éclairant que ça. C’est le corps tyrannique, l’ambition des êtres et de leur génie, la place des femmes et celle du deuil.
C’est très beau, sans le moindre effet stylistique, c’est d’une pureté et d’une simplicité sidérantes, d’une grande humanité.
Rosa Montero est comme une grande sœur qui vous prend par la main, son pas est sûr, sa main est ferme, elle sait, elle a tout compris, vous marchez dans ses pas, et vous avez grandi."Christelle Dierickx
-
Nos dix coups de cœur, le top de l'Obs : "le plus émouvant." Lire l'article iciDidier JacobLe Nouvel Observateur
-
"Une très belle réflexion." Lire l'article iciEmilie ThéveninTrends in Riviera
-
"Un émouvant et empathique hommage à ces disparus dont nous sommes les "reliquaires"." Lire l'article iciPierre SchaveyThe Lion
-
"Maestria pour maestros."Lire l'article iciLaurence DesbordesNotre Temps Suisse
-
Parcourir cette vie sous la plume de Rosa Montero, c'est un va-et-vient passionnant entre cette époque ancienne et la nôtre, un échange d'analyses sur les réactions et les sentiments intimes, sur la mort, le travail, la science, la littérature, et finalement, sur la puissance de la vie." Lire l'article iciVéronique HeurtinNouvelle vie
-
" Conquérir la légèreté, voilà l'acte essentiel qui sauve le monde, voilà à quoi ce livre sincère nous convie." Lire le portrait iciPortrait d'Isabelle PotelAir France Madame
-
"Rosa Montero construit des ponts avec sa propre histoire, convoque les poètes qu'elle aime et prend appui sur eux pour composer une méditation vibrante." Lire l'histoire d'un livre ici et la critique iciStéphanie DupaysLe Monde des livres
-
"Littéralement irradié de tendresse et de compassion, ce petit livre au fort tempérament est écrit sans larmoyer, avec des mots de braise." Lire l'article iciCoup de cœur de Dominique BonaVersion Femina
-
"Au détour des événements de la vie et des réactions de Marie Curie, Rosa Montero analyse et se livre avec parfois de beaux moments sur le souvenir de l’autre et des remarques plus communes sur le couple ou le sexisme. L’auteur mêle le romanesque de la vie de Marie Curie et le style plus brut de l’essai avec des réflexions personnelles [...] Ce livre ne doit pas être uniquement choisi pour la biographie de Marie Curie [...]mais pour l’effet miroir de deux peines. L’époque actuelle renonce aux rites funéraires, tend à cacher la mort. Rosa Montero veut en faire quelque chose, et c’est le pourquoi de ce livre." Lire l'article iciBlog Sur la route de Jostein
-
"C'est un livre fantasque, virevoltant, rageur et passionné, qui doit sûrement ressembler trait pour trait à celle qui l'a écrit." Ecouter l'émission iciKathleen EvinFrance Inter "L'Humeur vagabonde"
-
"Un livre hautement radioactif qui brûle d'une passion solaire et d'une admiration éperdue." Lire l'article iciDidier JacobLe Nouvel Observateur
-
"Un texte vivant, vibrant, une écriture sublime." Lire l'article iciDorothée et SabrinaL'Eveil de Lisieux-Côte
-
"Rosa Montero est un génie de conteuse. Un chef d'œuvre !" Ecouter la première chronique ici (à la 39è minute), et la seconde, avec l'interview de Rosa Montero, ici (à la minute 40’22’’)Coup de cœur de Clara Dupont-MonodFrance Inter "Si tu écoutes, j'annule tout"
-
"On a envie de serrer la romancière dans nos bras, de lui dire merci d'allumer ainsi cette petite lumière: au bout du compte, c'est toujours la vie qui gagne." Lire l'article iciChristilla Pelle-DouelPsychologies magazine
-
"L'Idée ridicule de ne plus jamais te revoir n'est pas une leçon de vie. Il n'y a pas de leçon mais la simple liberté d'écrire, de raconter." Lire l'article ici.François MontpezatDNA
-
"Un livre plein d'émotion et d'énergie vitale." Article à lire iciMarguerite BauxGrazia
-
"Un livre lumineux." Article et entretien à lire iciEsther SanchezQué tal París
L’Art de simuler la douleur
Comme je n’ai pas eu d’enfants, ce qui m’est arrivé de plus important dans la vie ce sont mes morts, et je veux dire par là la mort de mes êtres chers. Vous trouvez ça lugubre, peut-être même morbide ? Je ne le vois pas comme ça, bien au contraire : pour moi c’est tellement logique, tellement naturel, tellement vrai. C’est seulement lors des naissances et des morts que l’on sort du temps : la Terre stoppe sa rotation et les futilités pour lesquelles nous gaspillons nos journées tombent au sol comme des poussières colorées. Quand un enfant vient au monde ou qu’une personne meurt, le présent se fend en deux et vous laisse entrevoir un instant la faille de la vérité : monumentale, ardente et impassible. On ne se sent jamais aussi authentique que lorsqu’on frôle ces frontières biologiques : vous avez clairement conscience d’être en train de vivre quelque chose de très grand. Il y a bien des années, le journaliste Iñaki Gabilondo m’a dit dans une interview que le décès de sa première femme, morte très jeune des suites d’un cancer, avait été très dur, certes, mais également ce qu’il avait vécu de plus transcendant. Ses paroles m’avaient impressionnée : en fait, je m’en souviens encore, alors que j’ai une confuse mémoire de moustique. À l’époque, j’avais cru bien saisir ce qu’il voulait dire, mais après en avoir fait l’expérience, j’ai mieux compris. Tout n’est pas horrible dans la mort, bien que ce soit dur à croire (je m’étonne de m’entendre dire ça).
Mais ce livre n’est pas un livre sur la mort.
En réalité, je ne sais pas bien ce qu’il est, ou ce qu’il sera. Il est là maintenant au bout de mes doigts, à peine quelques lignes sur une tablette, un amas de cellules électroniques encore indéterminées qui pourraient très facilement avorter. Les livres naissent d’un germe infime, un œuf minuscule, une phrase, une image, une intuition, et ils grandissent comme des zygotes, organiquement, cellule après cellule, en se différenciant en tissus et en structures de plus en plus complexes, jusqu’à devenir une créature complète et souvent inattendue. Je vous avoue que j’ai une idée de ce que je veux faire avec ce texte, mais est-ce que le projet se maintiendra jusqu’au bout ou est-ce que quelque chose d’autre apparaîtra ? Je me sens comme le berger de cette vieille blague qui sculpte distraitement un morceau de bois avec son couteau, et qui, quand un passant lui demande : “Mais vous faites la figure de qui ?”, répond : “Eh bien, s’il a de la barbe saint Antoine, sinon la Sainte Vierge.”
Une image sacrée, dans tous les cas.
La sainte de ce livre est Marie Curie. J’ai toujours trouvé cette femme fascinante, comme pratiquement tout le monde d’ailleurs, car c’est un personnage hors norme et romantique qui semble plus grand que la vie. Une Polonaise spectaculaire qui a été capable de remporter deux prix Nobel, le Nobel de physique en 1903 avec son mari, Pierre Curie, et le Nobel de chimie en 1911, en solitaire. En fait, dans toute l’histoire des Nobel, seules trois autres personnes ont réussi à obtenir deux récompenses : Linus Pauling, Frederick Sanger et John Bardeen, et seul Pauling l’a fait dans deux catégories différentes, comme Marie. Mais Linus a remporté un prix de chimie et le Nobel de la paix, et il faut bien reconnaître que ce dernier a beaucoup moins de valeur (comme chacun sait, on l’a même donné à Kissinger). Autrement dit, Marie Curie reste imbattable.
De plus, Marie a découvert et mesuré la radioactivité, cette propriété effrayante de la Nature, de fulgurants rayons surhumains qui soignent et qui tuent, qui carbonisent les tumeurs cancéreuses dans la radiothérapie ou qui calcinent les corps après une déflagration atomique. C’est elle aussi qui a fait la découverte du polonium et du radium, deux éléments beaucoup plus actifs que l’uranium. Le polonium, qu’elle a découvert en premier (c’est pour ça qu’elle l’a baptisé du nom de son pays), s’est vite retrouvé éclipsé par l’importance du radium, bien qu’il soit revenu à la mode dernièrement comme une méthode d’assassinat très efficace : rappelons-nous la terrible mort de l’ex-espion russe Alexandre Litvinenko en 2006, à la suite d’une ingestion de polonium 210, ou le cas polémique d’Arafat (un autre Nobel de la paix hallucinant). C’est donc jusqu’à ces applications sinistres qu’est allée la blanche main de Marie Curie. Mais, en bien ou en mal, cette force dévastatrice se trouve au fondement même de la construction du xxe siècle et probablement aussi du xxie. Nous vivons des temps radioactifs.
L’envergure professionnelle de Mme Curie fut une bizarrerie absolue à une époque où les femmes n’étaient autorisées à presque rien. D’ailleurs, les femmes scientifiques sont encore relativement rares aujourd’hui, et bien sûr on leur attribue toujours les récompenses au compte-gouttes. Depuis le début des Nobel jusqu’en 2011, le prix a été remporté par 786 hommes contre 44 femmes seulement (un peu plus de 6 %), et l’immense majorité d’entre elles a été Nobel de la paix ou de littérature. Il n’y a que quatre lauréates en chimie et deux en physique (en comptant le doublé de Curie, qui élève pas mal le pourcentage). Sans parler des cas où on leur a purement et simplement volé le Nobel, comme c’est arrivé à Lise Meitner (1878-1968), qui avait participé de manière substantielle à la découverte de la fission nucléaire, alors que la récompense a été remportée en 1944 par l’Allemand Otto Hahn, qui ne la mentionna même pas, parce que en plus Lise était juive et que c’était l’époque nazie. Lise eut la chance de vivre suffisamment longtemps pour commencer à être reconnue et à recevoir quelques hommages dans sa vieillesse : je ne sais pas si ça peut compenser la blessure de toute une vie.
Ce qui est arrivé à Rosalind Franklin (1920-1958), une éminente scientifique britannique qui découvrit les fondements de la structure moléculaire de l’adn, est encore pire. Wilkins, un collègue de travail avec qui elle entretenait une relation conflictuelle (c’était un monde encore très machiste), s’empara des notes de Rosalind et d’une photographie très importante que la scientifique avait réussi à prendre de l’adn moyennant un processus complexe appelé la diffraction des rayons x et, sans qu’elle le sache ni ne l’autorise, il montra tout à deux copains à lui, Watson et Crick, qui travaillaient dans le même domaine et qui, après s’être illégalement approprié ces découvertes, les utilisèrent pour développer leur propre travail. On ignore si Rosalind a pu avoir connaissance du “vol” intellectuel dont elle avait fait l’objet : elle mourut très jeune, à trente-sept ans, d’un cancer des ovaires très probablement causé par l’exposition à ces rayons x qui lui avaient permis d’entrevoir les entrailles de l’adn. En 1962, quatre ans après le décès de Franklin, Watson, Crick et Wilkins décrochèrent le Nobel de médecine pour leur découverte sur l’adn. Comme on ne peut pas gagner le prix de manière posthume, jamais Rosalind n’aurait pu le remporter, alors qu’elle le méritait incontestablement. Mais le plus honteux, c’est que ni Watson ni Crick ne mentionnèrent Franklin ni ne reconnurent sa contribution. Enfin, c’est une histoire sale et triste. Mais qui, au moins, est connue. Je me demande combien d’autres affaires d’espionnage, d’appropriation indue et de parasitisme dans l’histoire de la science n’ont jamais été étalées au grand jour.
(Incroyable : pendant que je rédigeais ces lignes, une amie de ma page Facebook, Sandra Castellanos, m’a envoyé un message. Nous ne nous connaissons pas personnellement, je sais juste qu’elle vit au Canada et que c’est un bon écrivain débutant, parce que je l’ai lue. Nous nous étions peu parlé depuis des mois et, tout à coup, surgi de la crépitante immensité cybernétique, je reçois ce qui suit :
Coucou Rosa, j’ai vu ça et j’ai pensé que ça te plairait :
De For the Love of Physics, de Walter Lewin :
“Les défis des limites de notre équipement rendent encore plus surprenantes les réalisations d’Henrietta Swan Leavitt, une astronome brillante mais généralement méconnue. En 1908, Leavitt travaillait à un poste secondaire de l’Observatoire d’Harvard quand elle débuta son travail, qui permit d’accomplir un pas de géant dans la mesure de la distance des étoiles.
“Ce genre de choses s’est produit si fréquemment dans l’histoire de la science que le fait de minimiser le talent, l’intelligence et la contribution des femmes scientifiques devrait être considéré comme une erreur systémique.”
Et en pied de page :
“C’est arrivé à Lise Meitner, qui aida à découvrir la fission nucléaire ; à Rosalind Franklin, qui contribua à découvrir la structure de l’adn ; et à Jocelyn Bell, qui découvrit les pulsars et qui aurait dû partager en 1974 le prix Nobel qui fut donné à son superviseur, Anthony Hewish.”
Wouah ! Je ne savais rien sur Leavitt et Jocelyn Bell, mais ce qui m’a laissée sans voix, c’est cette syntonie spectaculaire entre le moment et le thème. Et plus inquiétant : ces #Coïncidences qui semblent magiques abondent dans le territoire littéraire. Mais nous en parlerons plus loin.)
J’étais en train d’écrire un autre roman. J’avais passé plus de deux ans à prendre des notes. À lire des livres proches du sujet. À laisser grandir le zygote dans ma tête. Je l’avais finalement commencé, autrement dit j’étais passée à l’acte, je m’étais assise devant l’ordinateur et mise à taper. C’était en novembre 2011. Toute l’intrigue se déroule dans la jungle, ce ventre végétal putréfié, étouffant, à rendre dingue. J’ai écrit les trois premiers chapitres. Et ils me plaisent. En plus, je sais tout ce qui va se passer ensuite. Et ça me plaît aussi, je crois que ça peut être émouvant pour moi d’écrire ça. Et pourtant, à la fin du mois de décembre, j’ai laissé tomber cette histoire peut-être pour toujours (j’espère que non). De toute ma vie je n’ai abandonné qu’un seul autre roman en cours d’écriture : c’était en 1984 et il faisait alors une centaine de pages. Je les ai jetées, sauf les cinq ou six premières, que j’ai publiées sous forme de nouvelle sous le titre “La vida fácil” dans mon livre Amantes y enemigos. Ce roman ne reviendra jamais. Je ne ressens plus les personnages, leurs péripéties ne m’intéressent plus, je me suis lassée du sujet. Pour pouvoir écrire un roman, pour endurer les très longues et fastidieuses séances de travail assis que ça implique, mois après mois, année après année, il faut que l’histoire garde des bulles de lumière dans votre tête. Des scènes qui sont des îles d’émotion brûlante. Et c’est à cause du désir d’en arriver à l’une de ces scènes qui, vous ne savez pas pourquoi, vous couvrent de frissons, que vous traversez peut-être des mois d’ennui royal et insoutenable au clavier. De sorte que le paysage que vous entrevoyez quand vous commencez une œuvre de fiction est pareil à un long collier d’obscurité éclairé de temps à autre par une grosse perle iridescente. Et vous avancez laborieusement sur ce fil d’ombres, d’une perle à l’autre, attiré comme les mites par leur éclat, jusqu’à atteindre la scène finale, qui est pour moi la dernière de ces îles de lumière, une explosion irradiante. Évidemment, chaque roman contient peu de perles : avec de la chance, avec beaucoup de chance, peut-être dix. Mais vous pouvez même vous débrouiller avec quatre ou cinq, si elles sont suffisamment puissantes pour vous, si elles sont enivrantes, si vous les sentez tellement grandes qu’elles ne vous tiennent pas dans la poitrine et que vous vous dites : moi, ça, il faut que je le raconte. Car, si vous ne le faisiez pas, vous soupçonnez que cette scène exploserait à l’intérieur de vous et que vous finiriez par souffler des jets de vapeur par le nez.
Et avec ce roman de 1984, les lampions de la fête se sont éteints. Le besoin, le tremblement et l’enchantement ont pris fin. Ce fut un vrai avortement, et en plus si tardif, disons métaphoriquement au cinquième mois environ, que ma santé littéraire s’en est ressentie : j’ai été prise par La Sécheresse, comme disait Donoso, et j’ai passé presque quatre ans sans pouvoir écrire. Un satané enfer, parce que en perdant l’écriture j’avais perdu le lien avec la vie. Je ressentais une atonie, une distance avec la réalité, une grisaille qui éteignait tout, comme si je n’étais pas capable de m’émouvoir de ce que je vivais si je ne l’élaborais pas mentalement à travers des mots. En y regardant bien, il est possible que Fernando Pessoa se rapporte à ça dans ses vers célèbres : “Feindre est le propre du poète. / Il feint si complètement / Qu’il arrive à feindre qu’est douleur / La douleur qu’il ressent vraiment.” Peut-être que l’écrivain est un type plus ou moins cinglé qui est incapable de ressentir sa propre douleur s’il ne feint pas ou ne la construit pas avec des mots. Avec ces mots qui collent les choses à leur place, qui complètent, qui consolent, qui calment, qui vous rendent conscients d’être vivant. Ça alors, tous ces termes me sont venus avec un c. Extraordinaire. Le carillon aveugle du cerveau.
Je ne crois pas que mon récit de la jungle soit aussi mort que celui de 1984 qui avait fini par me bloquer. Je veux penser que c’est un simple manque de syntonie entre ce thème et moi, que ce n’était pas ce que je voulais écrire maintenant, ou que j’avais besoin de raconter autre chose avant. Ce roman est apparu dans ma tête durant les mois de la maladie de mon mari. C’est l’intrigue la plus sombre, la plus désespérée et angoissante que j’aie jamais conçue. Et je ne m’y vois pas à présent. Je ne veux pas me fourrer là-dedans. Je n’ai pas envie de passer l’année prochaine coincée dans cette jungle écrasante.
J’en étais là lorsqu’un mail d’Elena Ramírez, éditrice chez Seix Barral, est arrivé. Elle me proposait de faire une préface pour Únicos, une collection de petits livres très courts. Le texte dont elle voulait que je parle était le journal de Marie Curie, guère plus d’une vingtaine de pages rédigées au cours de l’année qui a suivi la mort de son mari, décédé à quarante-sept ans écrasé par une voiture à cheval. Et cette sage, cette sorcière, cette fée d’Elena Ramírez disait : “J’ai pensé à toi parce que ça reflète avec un dépouillement cru le deuil lié à la perte de son mari. Je crois que si le texte te plaît tu pourrais faire quelque chose de formidable, sur le personnage ou sur le dépassement (si on peut appeler ça comme ça) du deuil en général. Je crois aussi que, selon comment tu te plongeras dans le livre et comment tu te sentiras en écrivant, ce pourrait être une préface ou bien le corps central du texte, et le journal de Curie un complément… Je laisse la porte ouverte à toutes surprises.”
J’ai lu le texte. Et il m’a impressionnée. Mieux : il m’a happée.
Mais ce livre n’est pas non plus un livre sur le deuil. Ou pas seulement.
J’ai acheté une demi-douzaine de biographies de Mme Curie, dont je savais déjà certaines choses auparavant, mais pas tant que ça. Et un truc informe a commencé à pousser dans ma tête. L’envie de raconter son histoire à ma façon. L’envie d’utiliser sa vie comme un mètre étalon pour comprendre la mienne, et je ne suis pas en train de parler de théories féministes, mais de tenter de démêler quelle est la #PlaceDeLaFemme dans cette société où les places traditionnelles ont été effacées (l’homme est perdu lui aussi, bien sûr, mais qu’un homme explore donc ce marécage). L’envie de fureter aux quatre coins du monde, de mon monde, et de réfléchir à une série de #Mots qui éveillent en moi des échos, des #Mots qui tournent dernièrement dans ma tête comme des chiens errants. L’envie d’écrire comme on respire. Avec naturel, avec #Légèreté.
Petite, j’ai attrapé la tuberculose. De mes cinq ans à mes neuf ans je ne suis pas allée à l’école et, d’après la légende familiale, j’ai été sauvée par un pédiatre appelé don Justo, qui était un médecin merveilleux et un grand monsieur et qui ne faisait pas payer quand il n’y avait pas d’argent. Je me souviens bien des nombreuses visites chez don Justo. Nous habitions loin, nous devions prendre l’autobus et j’arrivais toujours nauséeuse (en ce temps-là, quand presque personne n’avait de voiture à soi et que les gens voyageaient peu en véhicules à moteur, il était assez habituel d’être malade quand on montait dans une automobile). Au fond de son cabinet, don Justo avait une sorte de cagibi où se trouvait la machine à rayons x. À maintes et maintes reprises, chaque fois que je suis allée le voir pendant ma maladie et les visites de contrôle des années suivantes, don Justo me plaçait debout dans la machine, le torse nu parce qu’il venait de m’ausculter. Il me faisait me tenir bien droite, le dos collé au métal glacé, puis il approchait l’écran à rayons de ma poitrine, désagréablement froid lui aussi. J’appuyais le menton sur le bord supérieur : l’appareil avait un léger arôme semblable au fer, un relent que j’ai reconnu ensuite dans l’odeur du sang. Don Justo et ma mère s’installaient devant la machine sans aucune protection et, après avoir éteint la lumière, le spectacle commençait. Je me souviens de la pénombre du cabinet, et des visages du pédiatre et de ma mère éclairés par la lueur bleutée des rayons. “Vous voyez, doña Amalia ? disait don Justo en pointant son doigt vers un recoin de ma poitrine. Cette partie-là apparaît plus blanche parce que la lésion est en train de se calcifier.” Ils regardaient et ils bavardaient avec enthousiasme pendant un temps qui, à moi, me paraissait très long, fascinés par le spectacle de mes entrailles. Je me sentais importante, mais également gênée et inquiète : cette obscurité, cette lueur spectrale qui semblait les transformer en fantômes, sans parler de l’idée dégoûtante qu’ils puissent voir mes tripes. Je calcule aujourd’hui la quantité de radiations que nous avons tous dû recevoir et ça me glace le sang, bien qu’il soit rassurant de savoir que don Justo est décédé presque centenaire et que ma mère est toujours vivante et vaillante à quatre-vingt-onze ans. Tout ceci s’est passé à la fin des années 50, début des années 60 : Marie Curie était morte, détruite par le radium, un quart de siècle plus tôt. Je repense maintenant à cet éclat froid qui sortait de ma poitrine comme un ectoplasme et au bourdonnement de la machine, et je ressens une proximité profonde, une étrange intimité avec cette scientifique polonaise aux sourcils froncés. D’une certaine façon, son travail a aidé à me diagnostiquer et à me guérir. Sans parler du fait que la mère de Marie était morte de tuberculose. Et en plus, moi aussi j’ai vu cette lueur bleue que Mme Curie aimait tant ! Disons que j’ai été une enfant radioactive, et je suis maintenant une femme mûre d’âge avancé ou une jeune vieille qui, depuis quelques années, habite à deux pâtés de maisons de l’ancien cabinet de don Justo, c’est-à-dire à cent mètres de là où se trouvait cette ancienne machine à rayons x qui sentait pareil que le sang. L’appartement est désormais un cabinet de gynécologie. Parfois, j’ai l’impression que l’on se déplace dans la vie en passant et repassant toujours aux mêmes endroits, comme dans un jeu de l’oie déconcertant.
Marie Curie ne fut pas seulement la première femme à recevoir un prix Nobel et la seule à en recevoir deux, mais aussi la première à être diplômée en sciences à la Sorbonne, la première à obtenir un doctorat de sciences en France, la première à avoir une chaire… Elle fut la première sur tant de fronts qu’il est impossible de les énumérer. Une pionnière absolue. Un être différent. Elle fut aussi la première femme à être enterrée pour ses mérites personnels au Panthéon des Grands Hommes (sic) de Paris. On y a porté sa dépouille le 26 avril 1995 avec beaucoup de pompe et d’ostentation (à propos, au Panthéon se trouvent aussi Pierre Curie et Paul Langevin, l’époux et l’amant de Marie), et le discours du président Mitterrand, déjà très malade à ce moment-là, a encensé “la lutte exemplaire d’une femme” dans une société où “les fonctions intellectuelles et les responsabilités publiques étaient réservées aux hommes.” Étaient, a-t-il dit. Comme si ces inégalités étaient complètement révolues dans le monde contemporain. Marie Curie reste pourtant la seule femme enterrée au Panthéon, et le Panthéon s’appelle toujours – manquerait plus que ça – des Grands Hommes. Comment cette Polonaise sans soutien ni argent a-t-elle conquis tout ça, si tôt, si seule, si à contre-courant ? C’était une femme nouvelle. Une guerrière. Une #Mutante. Est-ce pour ça qu’elle était toujours si sérieuse, si triste ? Est-ce pour ça qu’elle avait cette expression si tragique sur toutes ses photos ? Même sur les instantanés d’avant son veuvage. Je repense maintenant à cette vieille blague du berger qui sculptait un bout de bois et je me dis que ce qui surgira de ce livre sera peut-être un hybride, et qu’il fallait que Marie soit à la fois saint Antoine et la Très Sainte Vierge pour réussir à faire tout ce qu’elle a fait.
l’idée ridicule de ne plus jamais te revoir
La douleur véritable est indicible. Si vous pouvez parler de ce qui vous angoisse, vous avez de la chance : ça veut dire que ça n’est pas si important. Parce que, quand la douleur s’abat sur vous sans palliatifs, ce qu’elle vous arrache en premier c’est les #Mots. Il est probable que vous reconnaissiez ce que je dis : vous l’avez peut-être vécu, car la souffrance est une chose très commune dans toutes les vies (comme la joie). Je parle de cette douleur qui est tellement grande qu’elle ne semble même pas naître à l’intérieur de vous, c’est plutôt comme si vous aviez été enseveli par une avalanche. Voilà comment vous vous trouvez. Tellement enterré sous des tonnes de tristesse rocheuse que vous ne pouvez même pas parler. Vous êtes sûr et certain que personne ne va vous entendre.
En cela, quand on y pense, ça ressemble beaucoup à la folie. Dans mon adolescence et ma prime jeunesse, j’ai fait plusieurs crises d’angoisse. C’étaient des attaques subites de panique, des vertiges, une sensation aiguë de perte de la réalité, la terreur d’être en train de devenir folle. C’est précisément pour ça que j’ai étudié la psychologie à l’Université Complutense (j’ai laissé tomber en quatrième année) : je pensais être folle. En réalité, je crois que c’est la raison pour laquelle 99 % des professionnels du secteur ont fait des études de psychologie ou de psychiatrie (les 1 % restants sont des enfants de psychologues ou de psychiatres et ceux-là vont encore plus mal). Et notez bien que ça ne me pose pas de problème : aborder la pratique thérapeutique en ayant connu ce qu’est le déséquilibre mental peut vous donner plus de compréhension, plus d’empathie. Pour ma part, ces crises angoissantes ont élargi ma connaissance du monde. Je me félicite aujourd’hui de les avoir eues : j’ai su comme ça ce qu’était la douleur psychique, qui est dévastatrice dans ce qu’elle a d’ineffable. Car la caractéristique essentielle de ce que nous appelons la folie, c’est la solitude, mais une solitude monumentale. Une solitude tellement grande qu’elle ne rentre pas dans le mot solitude et que vous ne pouvez même pas arriver à l’imaginer si vous n’y avez jamais mis les pieds. C’est sentir que vous vous êtes déconnecté du monde, qu’on ne va pas pouvoir vous comprendre, que vous n’avez pas de #Mots pour vous exprimer. C’est comme parler une langue que personne d’autre ne connaît. C’est être un astronaute flottant à la dérive dans l’immensité noire et vide de l’espace intersidéral. Je parle d’une solitude de cette grandeur-là. Et il se trouve que dans la douleur véritable, dans cette douleur-avalanche, quelque chose de semblable se produit. La sensation de déconnexion n’est pas aussi extrême, mais vous ne pouvez pas non plus partager ni expliquer votre souffrance. La sagesse populaire le dit bien : Untel est devenu fou de douleur. La peine aiguë est une aliénation. Vous vous taisez et vous vous renfermez.
C’est ce qu’a fait Marie Curie quand on lui a apporté le cadavre de Pierre : s’enfermer dans le mutisme, dans le silence, dans une apparente froideur de marbre. Ils étaient mariés depuis onze ans et ils avaient deux filles, la plus jeune de quatorze mois. Pierre était sorti comme toujours ce matin-là pour aller au travail, il avait déjeuné avec des collègues et, en retournant au laboratoire, il avait glissé et était tombé devant un lourd attelage de transport de marchandises. Les chevaux l’évitèrent, mais une roue arrière lui broya le crâne. Il mourut sur le coup.
J’entre dans le salon. On me dit : “Il est mort.” Peut-on comprendre des paroles pareilles ? Pierre est mort, lui que j’ai vu partir bien portant ce matin, lui que je comptais serrer dans mes bras le soir, je ne le reverrai que mort et c’est fini à jamais[1].
Jamais, toujours, des mots absolus que nous ne pouvons pas comprendre, nous qui sommes des petites créatures piégées dans notre petit temps. Avez-vous déjà joué, enfant, à essayer d’imaginer l’éternité ? L’infini se déployant devant vous comme un ruban bleu vertigineux et interminable ? C’est la première chose qui vous frappe dans un deuil : l’incapacité de le penser et de l’admettre. L’idée ne vous tient tout simplement pas dans la tête. Mais comment est-il possible qu’il ne soit pas là ? Cette personne qui occupait tant d’espace dans le monde, où est-elle passée ? Le cerveau ne peut pas comprendre qu’elle a disparu pour toujours. Et toujours, c’est quoi, bon sang ? C’est un concept inhumain. Je veux dire que c’est au-delà de notre capacité d’entendement. Mais comment ça, je ne vais plus jamais le revoir ? Ni aujourd’hui, ni demain, ni après-demain, ni dans un an ? C’est une réalité inconcevable que l’esprit rejette : ne plus jamais le revoir est une mauvaise blague, une idée ridicule.
Quelquefois [j’ai] l’idée absurde que tout cela est une illusion et que tu vas rentrer. N’ai-je pas eu hier en entendant fermer la porte d’entrée l’idée absurde que c’était toi.
Après la mort de Pablo, je me suis moi aussi surprise à penser pendant des semaines : “Bon, voyons un peu s’il arrête de faire l’imbécile et s’il revient une bonne fois pour toutes”, comme si son absence était une blague qu’il était en train de me faire pour m’agacer, comme ça lui arrivait parfois. Comprenez-moi bien : il ne s’agissait pas d’une pensée véritable et complètement assumée, mais d’une de ces idées à moitié formées qui ondulent au bord de la conscience, comme des poissons nerveux et glissants. De la même façon, tout le monde sait que beaucoup de gens croient voir dans la rue l’être aimé qu’ils viennent de perdre (moi, ça ne m’est jamais arrivé). Ursula K. Le Guin raconte ça très bien dans un poème sobre intitulé “On Hemlock Street” (dans la rue Ciguë) :
I see broad shoulders, (Je vois de larges épaules,
a silver head, une tête argentée,
and I think : John ! et je pense : John !
And I think : dead. Et je pense : mort.)
J’ai eu l’immense chance et le privilège de nouer une certaine amitié avec Ursula K. Le Guin, qui est l’un des écrivains dont je reconnais consciemment le rôle de mentor sur mon œuvre (l’autre est Nabokov). Quand je lui ai écrit il y a quelques mois en racontant que je voulais faire un livre sur Mme Curie, elle a répondu :
J’ai lu une biographie de Marie Curie quand j’avais quinze ou seize ans. Elle incluait pas mal de citations de son journal. J’avais été impressionnée, émerveillée et effrayée. Peut-être que ma mémoire me joue des tours, mais ce dont je me souviens, c’est qu’après la mort de Pierre dans la rue, elle avait gardé un mouchoir avec lequel elle avait tenté de nettoyer son visage. Une partie de son sang et de sa cervelle était restée dans le tissu, et elle l’avait gardé, caché de tous, jusqu’à ce qu’elle doive le brûler. Cette image m’a hantée de façon angoissante pendant toutes ces années.
Sapristi, me suis-je dit, ce détail, je ne l’ai vu dans aucune des biographies que j’ai utilisées. Compte tenu de l’âge d’Ursula (elle est née en 1929), j’ai pensé qu’il s’agissait peut-être du livre que la deuxième fille de Marie, Ève, avait écrit sur sa mère en 1937. Au moment où j’ai reçu le mail de Le Guin je n’avais pas encore lu cet ouvrage épuisé dont j’ai dû suivre la trace à travers toute la planète avant d’obtenir un exemplaire d’occasion en anglais. De sorte que les mots d’Ursula m’ont fait relire avec attention le court journal de Mme Curie, et j’ai découvert un paragraphe qui, à la lumière de cette sinistre explication, avait un sens très révélateur :
Avec ma sœur nous brûlons tes vêtements du jour de la catastrophe. Dans un grand feu je jette découpés les lambeaux d’étoffe avec les caillots de sang et les débris de cervelle. Horreur et misère, je baise ce qui reste de toi sur tout cela.
À ma première lecture, j’avais présumé qu’elles avaient brûlé ce costume peu après l’accident et j’avais pris ce “je baise ce qui reste de toi” pour une métaphore, mais je craignais désormais le pire. J’ai attendu avec impatience l’arrivée du livre d’Ève et, effectivement, je suis tombée sur une scène brutale. Presque deux mois après la mort de Pierre, la veille du jour où la sœur de Marie, Bronya, repartait en Pologne, Mme Curie lui demanda de l’accompagner dans sa chambre et, après avoir soigneusement refermé la porte, elle sortit de l’armoire un gros paquet enveloppé de papier imperméable : c’étaient les haillons des habits de Pierre, avec des caillots de sang et des grumeaux de cerveau agglutinés. Elle avait secrètement gardé cette cochonnerie auprès d’elle. “Il faut que tu m’aides à le faire”, implora-t-elle Bronya. Et elle se mit à découper le tissu avec des ciseaux et à jeter les lambeaux au feu. Mais quand elle arriva aux restes de substance organique, elle fut incapable de poursuivre : elle les embrassa et les caressa devant sa sœur horrifiée, qui lui arracha les habits des mains et acheva la sinistre besogne. Ça ne m’étonne pas que l’image soit restée gravée dans l’esprit de la petite Ursula. La souffrance aiguë, je vous le dis, est comme un accès de folie. Vue de l’extérieur, Marie déconcerta par sa retenue émotionnelle : “Cette femme glaciale, calme, endeuillée, l’automate qu’était devenue Marie”, dit sa fille Ève. Mais, à l’intérieur, c’était la démence pure de la peine qui brûlait.
Jamais je n’en suis arrivée là, bien sûr. Au contraire, j’ai voulu “bien me comporter” dans mon deuil et j’ai pris mon courage à deux mains : je me suis immédiatement débarrassée de tous ses habits, j’ai rangé ses affaires sous clef, j’ai fait retapisser son fauteuil préféré, celui dans lequel il s’asseyait toujours. J’ai poussé le bouchon trop loin. Quand le tapissier est venu pour emporter le fauteuil, je me suis assise dedans, désespérée. Je voulais me repaître de la transpiration imprégnée dans l’étoffe, de la vieille empreinte de son corps. Je regrettais d’avoir appelé l’artisan, mais je n’ai pas eu assez de courage ou de conviction pour lui dire que je ne voulais plus le faire. Il a emporté le fauteuil. Le voilà maintenant recouvert d’un joyeux et banal tissu à rayures. Plus jamais je ne l’ai utilisé.
“Bien se comporter” dans le deuil. #FaireCeQu’IlFaut. Nous vivons dans une telle aliénation par rapport à la mort que nous ne savons pas comment agir. Nous avons un foutoir énorme dans la tête. Ce qui s’est passé dans mon cas, c’est que j’ai pris mon deuil pour une maladie dont il fallait guérir le plus tôt possible. C’est une erreur assez commune, je crois, parce que la mort est perçue comme une anomalie dans notre société, et le deuil, comme une pathologie : “Nous parlons constamment de morts évitables, comme si la mort pouvait être empêchée, plutôt que reportée”, dit la docteure Iona Heath dans son livre Matters of life and death. Et Thomas Lynch, ce curieux écrivain américain qui dirige depuis trente ans une entreprise de pompes funèbres, explique dans The Undertaking : “Nous sommes toujours en train de mourir de défaillances, d’anomalies, d’insuffisances, de dysfonctionnements, d’arrêts, d’accidents. Ils sont chroniques ou aigus. Le langage des certificats de décès – celui de Milo dit défaillance cardio-respiratoire – est comme le langage de la faiblesse. De même, on dira de Mme Hornsby, dans son chagrin, qu’elle est abattue, détruite ou en miettes, comme s’il y avait quelque chose de structurellement incorrect en elle. C’est comme si la mort et la douleur ne faisaient pas partie de l’Ordre des Choses, comme si la défaillance de Milo et les pleurs de sa veuve étaient, ou devaient être, source de honte.”
Et, en effet, je ne voulais pas avoir honte de ma douleur. Je suis de ce genre de personnes qui essaient toujours de #FaireCeQu’IlFaut, c’est pour ça que j’ai eu tant de mentions très bien au lycée. Alors j’ai tenté de me plier à ce que je croyais que la société attendait de moi après la mort de Pablo. Les premiers jours, les gens vous disent : “Pleure, pleure, c’est très bon”, et c’est comme s’ils disaient : “Il faut crever l’abcès et appuyer dessus pour faire sortir le pus.” Et c’est justement dans les premiers moments que vous avez le moins envie de pleurer, parce que vous êtes en état de choc, exténué et en dehors du monde. Mais après, tout de suite, très vite, juste quand vous commencez à trouver le flot apparemment inépuisable de vos pleurs, votre entourage se met à vous réclamer un effort de vitalité et d’optimisme, d’espérance en l’avenir, de rétablissement de votre peine. Parce que ça se dit précisément comme ça : Untel ne s’est pas encore rétabli de la mort d’Unetelle. Comme s’il s’agissait d’une hépatite (mais vous ne vous rétablissez jamais, voilà l’erreur : on ne se rétablit pas, on se réinvente). Je ne cherche pas à critiquer qui que ce soit en racontant ça : moi aussi j’ai agi de la même manière, avant de savoir ! Moi aussi j’ai dit : pleure, pleure. Et trois mois plus tard : allez, c’est fini, ressaisis-toi, secoue-toi. Avec la meilleure des intentions et le pire des résultats, certainement.
Je ne veux pas dire par là que les proches doivent passer deux ans habillés en noir, enfermés chez eux, à sangloter du matin au soir, comme on le faisait autrefois. Oh non, le deuil et la vie n’ont rien à voir avec ça. En fait, la vie est si tenace, si belle, si puissante, que même dès les premiers moments de la peine elle vous permet de savourer des instants de joie : le plaisir d’un bel après-midi, un rire, une musique, la complicité d’un ami. La vie se fraie un chemin avec la même opiniâtreté qu’une plante minuscule capable de fendre un sol en béton pour sortir sa tête. Mais, en même temps, la peine suit aussi son cours. Et c’est ce que notre société ne gère pas bien : aussitôt nous cachons ou nous interdisons tacitement la souffrance.
11 mai 1906 matin
Mon Pierre, je me lève après avoir assez bien dormi, relativement calme, et il y a à peine un quart d’heure de cela, et voici que j’ai de nouveau envie de hurler comme une bête sauvage.
Marie disait ces choses-là dans son journal.
Le frisson de l’impudeur.
Marie Curie s’est probablement sauvée de l’anéantissement grâce à la rédaction de ces pages. Qui sont d’une sincérité, d’un déchirement et d’une sobriété frappants. C’est un journal intime : il n’était pas conçu pour être publié. Mais, d’un autre côté, elle ne l’a pas détruit. Elle l’a conservé. Il s’agissait bien sûr d’une lettre personnelle adressée à Pierre. Un dernier lien de #Mots. Une sorte d’ultime cordon ombilical avec son mort. Ça ne m’étonne pas que Marie ait été incapable de se séparer de ces notes éplorées.
J’avoue que, pendant bien des années, j’ai considéré que faire un usage artistique de sa douleur personnelle était une indécence. J’ai déploré qu’Eric Clapton ait composé Tears in Heaven (Larmes dans le Ciel), la chanson dédiée à son fils Conor, décédé à l’âge de quatre ans d’une chute du 53e étage à New York, et je me suis sentie mal à l’aise qu’Isabel Allende publie Paula, le roman autobiographique sur la mort de sa fille. Pour moi, c’était comme si quelque part ils étaient en train de traficoter avec ces douleurs qui auraient dû être pures. Mais ensuite, avec le temps, j’ai changé d’avis. J’en suis venue à la conclusion qu’en réalité c’est quelque chose que nous faisons tous : même si, dans mes romans, je fuis l’autobiographie avec une véhémence particulière, symboliquement je suis toujours en train de lécher mes blessures les plus profondes. À l’origine de la créativité se trouve la souffrance, la sienne et celle des autres. La douleur véritable est ineffable, elle nous rend sourds et muets, elle est au-delà de toute description et de toute consolation. La douleur véritable est une baleine trop grande pour être harponnée. Et pourtant, malgré ça, les écrivains s’efforcent de poser des #Mots sur le néant. Nous jetons des #Mots comme on jette des cailloux dans un puits radioactif jusqu’à le combler.
Pour ma part, je sais maintenant que j’écris pour essayer d’attribuer au Mal et à la Douleur un sens dont je sais en réalité qu’ils ne l’ont pas. Clapton et Allende ont utilisé le seul recours qu’ils connaissaient pour pouvoir supporter ce qui s’était passé.
L’art est une blessure qui devient lumière, disait Georges Braque. Nous avons besoin de cette lumière, pas seulement nous qui écrivons ou peignons ou composons de la musique, mais également nous qui lisons et contemplons des tableaux et écoutons un concert. Nous avons tous besoin de beauté pour que la vie soit supportable. Fernando Pessoa l’a très bien exprimé : “La littérature, comme toute forme d’art, est l’aveu que la vie ne suffit pas.” Elle ne suffit pas, non. C’est pour ça que je suis en train d’écrire ce livre. C’est pour ça que vous êtes en train de le lire.
[1] Tous les extraits du journal de Marie Curie et de sa biographie de Pierre Curie sont tirés de Pierre Curie, paru chez Odile Jacob en 1996. (Toutes les notes sont de la traductrice.)
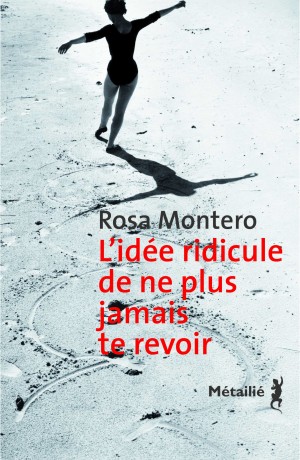











-100x150.jpg)

