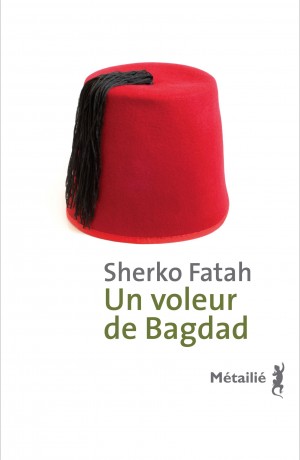Bagdad, 1930. Le jeune Anouar rêve de belles maisons, de voyages et peut-être un peu de la sœur de son ami juif. Il rêve de devenir quelqu’un, mais il n’est qu’un petit voleur dont le talent se résume à sa grande habileté à escalader les façades des maisons pour les dévaliser et voir la ville depuis leurs terrasses.
Pris dans le tourbillon du déclenchement de la guerre il tombe dans les réseaux de l’organisation des Chemises noires irakiennes. Ce qui lui vaudra de devenir factotum du grand mufti de Jérusalem réfugié à Bagdad et allié aux nazis pour combattre les Anglais en Palestine. Il fait partie de sa suite à Berlin en 1941. Là il sera enrôlé dans une légion musulmane des Waffen-ss chargée de la répression des résistants en Biélorussie et à Varsovie.
Anouar reviendra brisé et défiguré à Bagdad, où il reconnaîtra à l’hôpital où il travaille un médecin SS rencontré sur le front de l’Est.
Avec cet incroyable roman d’aventures, à l’écriture prenante, dense, dépouillée, Sherko Fatah nous fait découvrir une histoire dont les répercussions nous ouvrent les yeux sur le présent du Moyen-Orient.
-
" Porté par un puissant souffle épique, Un voleur de Bagdad est un magnifique roman d'aventure qui nous fait découvrir cette page d'histoire sous un autre angle et montre les liens du Moyen-Orient et de l'Allemagne, à commencer par l'alliance entre le grand mufti de Jérusalem et Hitler. Brillant et captivant !"Sarah Gastel (librairie Terre de livres)
-
Un beau roman d’apprentissage : la vie d’un jeune garçon qui va faire les mauvais choix sur fond de seconde guerre mondiale. Une belle réflexion profonde et juste sur le destin. Passionnant.Françoise Chapon
-
"Un roman riche et captivant, une plongée dans cette histoire méconnue de l’Irak. Une écriture à vous couper le souffle. C’est le genre de roman dans lequel on sait que la fiction ne sert qu’à vous emporter dans une page de l’Histoire. Un de ces romans si incroyable qu’il est impossible de le refermer une fois commencé."Letizia
-
"Cette matière brûlante est traitée avec une très légère distance, un ton dépourvu de passion, qui installe une vision contemporaine où l'historien rejoint le fabulateur." Lire l'article iciTimour MuhidineLe Monde diplomatique
-
"L'auteur nous entraîne dans les espaces intermédiaires où les cultures se mêlent." Lire l'article iciJean-Luc TiessetLa Quinzaine littéraire
-
"D'un rythme effréné, le livre captive par ses rebondissements romanesques comme par son contexte historique (la Seconde Guerre mondiale vue à travers regards et aspirations orientaux), que S. Fatah ressuscite superbement grâce à la force de son écriture, à sa connaissance du pays." Article à lire iciMarie GoudotEtudes
-
"Le roman le plus captivant, le plus trépidant que j'aie lu depuis longtemps." Chronique à écouter iciSébastien Le FolFrance Culture "Ce qui nous arrive avec"
-
" (...) l'auteur s'est aventuré sur un terrain vierge et néanmoins extrêmement sensible pour la mémoire collective." Article à lire iciFrançois ZabbalQantara
-
"Un de ces romans, lorsqu’enfin tout va s’éclairer dans les dernières pages, que vous laissez, pour vous donner encore un peu de temps. Parce que, quand vous saurez, eh bien la lecture sera finie et que vous voulez reculer ce moment…" Article à lire iciVéronique PoirsonBlog L'Express Les 8 plumes
-
"Un voleur de Bagdad, c'est le roman de l'irrésistible et non moins périlleuse odyssée d'un jeune Bagdadi, de son apprentissage de la vie, l'amour, la guerre (... ), et qui jette sur le conflit au Moyen-Orient un éclairage édifiant." Article à lire iciCatherine LorenteTransfuge
-
"Un flamboyant roman plein de couleurs, saveurs, parfums, bruits. Sherko Fatah est un formidable conteur." Article à lire iciPierre DeshussesLe Monde des livres
-
"On est hypnotisés par la fougue de son écriture, capable de nous entraîner avec autant de facilité des toits ensoleillés d’une Bagdad en ébullition aux étendues glacées d’une l’Europe de l’Est ravagée. Du grand art." Article à lire iciMikaël DemetsSite L'Accoudoir
L’Allemand solitaire I
1
Je suis assis là et je t’observe comme si tu étais un étranger. Mais je te connais. Je ne te le dirai peut-être jamais : je te connais, je te connais bien. Cela remonte à quelques années. Cela remonte à une éternité. Suffisamment pour que tu ne me remettes plus. Mais de toute façon tu ne me regardes pas, tu ne regardes jamais personne en face. Tu es l’éminent docteur venu de la lointaine Allemagne. Et moi, que suis-je donc ? Le coursier dont tu n’as pas besoin, celui qui t’importune. Mais si tu tournais les yeux vers moi, tu le saurais immédiatement. Nous avons jadis été aussi proches que deux chiens apeurés et enfermés, nous avions la même boue dans la gueule et au creux de cette nuit froide et lointaine notre peur ne faisait qu’une, nous étions un animal craintif à deux têtes. Nous avons vu la mort avancer en chair et en os sur la terre boueuse. Ses bottes sales se décollaient du sol trempé avec un bruit de succion. Elle avait la silhouette fine, une grande tête et le front haut. Elle parlait ta langue. Tu ne l’as certainement pas oubliée. Personne ne le peut. Mais peut-être, simplement, ne veux-tu la revoir à aucun prix, fût-ce en souvenir, à travers le visage d’un survivant de cette époque. Je te comprends, je te comprends bien, homme éminent que tu es.
Et pourtant, les voies de Dieu sont impénétrables, tu es venu ici. Tu aurais pu aller n’importe où après la guerre. Mais non, tu es ici, devant mes yeux, et ta vue suffit à faire remonter en moi cette vieille peur qui nous enserra jadis comme un poing.
Je me laissai glisser dans la pièce sur le siège en bois que le docteur avait mis à ma disposition le premier jour. Sans un mot, sans me saluer ni manifester quelque émotion que ce soit, cet homme de haute stature, à l’allure nerveuse, régla l’affaire lui-même. Il me planta simplement dans l’infirmerie, moi, le coursier, et revint peu après avec le siège. Il le posa près de la fenêtre. Quand il repassa devant moi, il se contenta de faire un signe vers l’arrière.
Je le suivis du regard lorsqu’il quitta la salle. Nous n’avions pas échangé le moindre mot, et pourtant nous nous étions compris. J’avais cru que le Dr Stein était familier des mœurs locales. L’autorité naturelle avec laquelle il se déplaçait et donnait de brèves instructions en anglais, la tranquillité avec laquelle il levait les mains avant d’attendre, comme un chef d’orchestre immobilisé, qu’un membre du personnel lui ôte ses gants en caoutchouc, tout cela ne m’aurait jamais inspiré le moindre doute sur la compétence du médecin. Mais pour le reste cet homme n’entendait rien à rien. Au lieu de m’envoyer avec le morceau de papier où figurait la liste de ce dont il avait besoin, il se rendit lui-même au bazar. Je fus étonné de le voir revenir avec ces petits paquets, s’approcher prudemment de moi et me tendre ces affaires comme s’il s’agissait de cadeaux. Mais c’était seulement pour que je les garde jusqu’à ce que le docteur rentre chez lui, en début de soirée.
Ce n’était pas juste. C’était offensant. Je lui en voulais. Après tout, cet homme était un étranger ici. Il ne pouvait pas savoir que n’importe quel étranger, surtout aussi éminent que lui, avait droit à ce que quelqu’un lui fasse ses courses, lui apporte ou lui emporte son courrier, ou le guide chez les gens auxquels il voulait rendre visite. Il aurait pu l’apprendre si seulement il avait posé la question. Mais dans ce cas, me dis-je en dodelinant du chef, il en aurait peut-être aussi appris plus que ce qu’il souhaitait savoir. Il m’aurait reconnu et tout ce que nous avions vu aurait surgi à cet instant même et aurait empli l’espace entre nous deux.
Mais les choses étant ce qu’elles étaient, je restais bon an mal an assis sur ma chaise près de la fenêtre, le regard fixé vers la salle ou vers la cour de l’hôpital, et j’attendais. À chaque fois que le docteur faisait une apparition, je sursautais et me redressais, m’attendant à ce que l’on fît appel à moi. Et à chaque fois que cela ne se produisait pas, c’était une petite déception.
Parfois, au cours de ces longs après-midi, je me demandais si je ne me trompais pas tout de même. Si je ne voulais pas, tout simplement, reconnaître dans ce médecin venu d’Europe l’homme que j’avais fréquenté autrefois. Rares étaient ceux à qui j’avais parlé de ce que j’avais vu et vécu. Lorsque j’étais revenu, ma capacité de faire un rapport, et a fortiori un récit, était réduite à néant. Et puis à qui aurais-je raconté comment un monde était tombé en ruine alors qu’ici, dans mon pays, tout était resté comme autrefois ? Les ruelles et les rues familières, la chaleur et la lenteur habituelles, rien n’avait changé. Personne ne m’aurait cru si j’avais dit ce que j’avais vu. Je le sus à l’instant même où je posai le pied sur le sol de ma patrie. Bien que j’eusse encore senti la fournaise sur les joues et le front, quelque chose me sauta au cou lorsque je pus enfin recommencer à parler dans ma langue, oui, c’est exactement ce que je ressentis. Quoi que ce fût, cela m’étranglait lorsque je voulais parler. Et puis mes mots ne manquaient à personne. Il se serait seulement agi de ceux du messager Anouar, des mots qui ne pouvaient rien ajouter à tout ce qui semblait certain : pas de doute, pas d’informations importantes, rien.
Je fus soulagé lorsque je compris que dans ce nouveau rôle je n’avais plus à feindre le mutisme, mais que je conservais ce rôle sans difficulté, même quand je parlais. Pendant la guerre encore, j’avais cru que, pour cette raison aussi, j’allais errer à travers les rues sans fin et les villes détruites afin de pouvoir raconter tout cela à quelqu’un une fois revenu dans ma patrie. Je pensais que tout en moi était prêt pour cette rencontre. Mais ensuite, lorsque le moment fut venu, je ne dis pratiquement rien.
Tout se passe comme si l’on cherchait un homme auprès duquel on peut épancher son cœur, alors qu’en vérité c’est Dieu que l’on attend. Que sont quelques mots associés en une phrase, que peuvent-ils être aux oreilles d’un étranger ? Non, ce dont j’avais besoin, c’était d’un confident. Ce devait être quelqu’un qui ne comprendrait pas seulement les mots, mais les capterait et les éveillerait à la vie. Quelqu’un qui, entendant un fredonnement, percevrait la musique. Seul un homme comme celui-là m’aurait permis de parler, et peut-être ai-je secrètement attendu le moment où je le rencontrerais tout de même. Or voilà qu’il semblait se tenir devant moi.
Parfois le docteur entrait dans la pièce et me jetait un coup d’œil comme s’il projetait de me confier une nouvelle mission mais n’était pas encore sûr de le faire. À chaque fois, je levais légèrement la tête et j’attendais. À un moment, la fenêtre derrière moi se retrouva ouverte. Le vent brûlant soufflait à l’intérieur du sable et des brins d’herbe desséchés. La salle abritait trois lits, mais ils étaient vides et défaits, les rideaux blancs ramenés vers l’intérieur. Le vent faisait trembler les voiles comme la blouse du médecin et la pile d’essuie-mains sur la table en métal qui se trouvait à côté de lui. Le souffle brossa même le pelage d’un chat qui s’était soudain glissé là depuis le corridor et qui s’y attarda en rentrant la tête comme s’il s’était égaré dans la chambre. Il portait dans la gueule le reste d’un placenta volé dans la salle d’accouchement.
Une brise chaude me fit inspirer profondément. C’est lui, me dis-je tout d’un coup, aucune hallucination ne pourrait me tromper à ce point. Il a déjà beaucoup de cheveux gris et marche un peu courbé. Son visage ne paraît pas âgé, mais sérieux et rébarbatif. Et pourtant c’est lui. Et lui non plus, je crus subitement le savoir, n’avait pas trouvé son confident, depuis tout ce temps.
Le médecin se dirigea vers moi, fit précautionneusement le tour de la chaise, s’étira en gémissant et ferma la fenêtre. Je ne bougeai pas avant qu’il ait terminé. Je l’aurais aidé si j’avais su ce qu’il voulait. Je suivis donc des yeux le chat qui s’enfuyait de la pièce avec son butin et m’époussetai les épaules sans vraiment savoir quoi faire.
Le soir, je me levai et m’étirai à mon tour comme si j’avais accompli ma besogne. J’aurais volontiers dit au docteur qu’il était temps pour moi de rentrer, mais je n’osai pas partir à sa recherche. Je préférai sortir de la pièce pour passer dans le couloir obscur, longer les murs tachés jusqu’à la porte tambour en verre et sortir dans la vaste cour par les portes d’entrée. L’hôpital était un bâtiment neuf, mais la poussière avait déjà assombri les murs et tout ce qu’ils entouraient semblait remonter à l’Antiquité.
Personne ne m’avait vu partir. Le docteur fut même probablement soulagé lorsqu’il découvrit la chaise vide, tard dans la soirée. Je glissai les mains dans la poche de ma veste et descendis la colline pour rejoindre la rue qui menait à la ville. Je me demandais si j’étais moi aussi soulagé de m’éloigner de cet homme que j’avais reconnu. Je devrais l’être, me dis-je, je devrais le fuir comme les animaux fuient le feu. Je m’arrêtai devant un tas de gravats où poussaient des buissons desséchés.
La nuit était claire, le ciel étoilé. Devant moi, la rue disparaissait dans une cuvette sombre et ne réapparaissait, étroite et vide, que sous les rares lumières de la ville qui brillaient encore. Cet homme, me dis-je, fait partie de tout ce que je veux oublier.
Je repris mon chemin. Qui sait, me dis-je, peut-être des pensées tout à fait analogues lui passent-elles par la tête. Il y a en tout cas une chose que je sais de lui : il ne laisserait en aucune circonstance transparaître son désarroi. C’est la différence entre un homme avisé et un homme simple comme moi.
Comme toujours, je me faufilais dans les ruelles obscures. Ne pas se faire remarquer, ça faisait partie de mon métier. Un messager est un moyen de transport. Ce qu’il propose, c’est la fiabilité. Même quand je ne suis pas en fonction et que je marche comme n’importe qui d’autre, je me comporte en coursier, je me presse, je suis consciencieux et pourtant retenu. Ce dont je suis fier est bien chétif.
Je marchais dans le noir d’un pas rapide. L’indifférence du docteur, qui me forçait à passer mes journées assis sur cette chaise d’hôpital, m’échauffait de nouveau les sangs. Tous ceux qui entraient dans la salle me considéraient, moi, le coursier, comme une personne importante ou du moins un malade, jusqu’au moment où ils comprenaient qui j’étais réellement et s’appliquaient à faire comme si je n’existais pas.
La lumière de quelques maisons tombait parfois dans les ruelles. J’atteignis la grande place des bâtiments administratifs, je parcourus un bref tronçon à la lueur de réverbères installés tout récemment et arrivai finalement dans la petite rue où se trouvait ma maison. De l’autre côté s’étalait le grand marché aux légumes. Ici, les paysans de la région arrivaient tôt le matin pour décharger leurs charrettes. Il régnait à présent dans ce lieu un silence inquiétant. Des tas de sacs en tissu vides reposaient dans l’obscurité comme des ânes morts.
Cette place n’existait pas depuis longtemps. Le bazar ne cessait de grandir et commençait à encercler ma maison jadis isolée. D’abord il s’était seulement agi de marchands et de visiteurs qui peuplaient la ruelle pendant la journée. Mais ensuite, les boutiques avaient fait tache d’huile. Des maisons situées à proximité furent réaménagées ou tout simplement rasées, et les toits de tôle ondulée s’ajoutèrent les uns aux autres, plongeant dans le noir les rues où les gens se tenaient autrefois. Je voulus y voir un bon présage : la guerre en Europe, avec toutes ses conséquences qui s’étaient fait sentir jusqu’à Bagdad, était terminée depuis longtemps, la situation s’était apaisée et les gens se livraient à un commerce animé. Mais en vérité, les gens pauvres étaient de plus en plus nombreux à affluer dans la ville et lui imposaient une métamorphose si rapide que j’avais du mal à suivre.
La place du marché était comme morte. Je me faufilai dans le minuscule passage qui menait au portail de la maison, ou à ce qu’il en restait. Des mouches se posaient sur mon visage, une sensation particulièrement désagréable dans l’obscurité. Et pourtant, me disais-je souvent quand je passais ici, laisser aux gérants du caravansérail ce bâtiment qui, au début, était tout en longueur, avait été une bonne idée. Ils avaient aménagé des écuries pour les mulets des paysans, juste en face du nouveau mur du jardin. À présent, en pleine nuit, on n’y trouvait aucun animal. Seule l’odeur trahissait leur présence du petit matin jusqu’au soir, lorsque les paysans les y laissaient pour aller faire leur commerce.
J’ouvris le portail haut et étroit, je passai par une galerie qui, avant le réaménagement, avait été un corridor, et entrai dans le jardin. Les feuilles du figuier bruissèrent mystérieusement. Je m’immobilisai un bref instant et inspirai profondément. Il fallut que je sois arrivé ici, coupé du monde extérieur, pour que je remarque quelle belle nuit m’entourait et sente que le vent, s’il ne rafraîchissait pas encore la peau, l’effleurait tout de même déjà. Il chassait jusqu’aux mouches. Je regardai en direction de la maison : toutes les fenêtres étaient sombres.
Je montai par l’étroit escalier extérieur et entrai dans l’appartement. Bien que le jardin et le figuier m’aient déjà fait pressentir le calme, c’est alors, seulement, que je me sentis tout à fait chez moi. C’était un état auquel j’aspirais toujours et que je redoutais pourtant.
J’allumai la lampe à pétrole, la portai de l’autre côté, vers le banc rembourré, m’assis et ôtai mes chaussures. J’étais à la maison. Tout était silencieux autour de moi. La lampe ne se contentait pas d’éclairer la pièce, elle la réchauffait aussi de sa lumière vacillante. Mon amante secrète, la veuve, dormait probablement depuis des heures. Elle m’avait préparé le repas dans la cuisine. J’ôtai le tissu qui protégeait le pot, m’y servis à plusieurs reprises et mangeai debout. Ensuite, j’allai me laver dans la petite annexe, à côté de la cuisine. Pendant tout le temps où je puisai de l’eau avec une louche dans le grand baquet et la déversai sur moi, je me réjouis à l’idée de pouvoir me glisser dans le lit auprès de la veuve.
Les instants qui précédaient celui-là attisaient mon excitation. Il m’arrivait de faire exprès de rentrer tard à la maison pour éprouver tout ce que je ressentais ce soir-là, précisément : d’abord le silence, puis l’abandon dans ma maison, puis la proximité de la femme.
Trempé comme je l’étais, la serviette éponge nouée autour de moi, je revins au plat qu’elle m’avait préparé et avalai quelques bouchées. C’était une nuit chaude et pourtant je sentais l’air frais sur ma peau. Je regardai la chambre et constatai qu’une autre chose se mêlait à mon excitation. Je savais ce que c’était, mais je ne voulais pas y penser. J’étais agité, il m’était arrivé quelque chose d’important, une rencontre que je n’assumais pas. J’ôtai totalement le torchon du pot et le recouvris d’un couvercle.
J’éteignis la lumière dans la pièce et me faufilai par le couloir obscur et étroit qui menait à la chambre. C’était exactement comme je l’avais attendu : elle dormait profondément lorsque je m’allongeai à son côté, et le drap était tellement serré autour de son corps qu’il était presque impossible de l’en défaire. Elle se réveilla, et plus je tirais sur le drap, plus il s’enroulait solidement autour d’elle. Je défis sa chevelure brune et lui embrassai la nuque. Je ne parvins à dénuder son dos que sur quelques centimètres, elle tirait le drap toujours plus fort. Je savais ce qu’elle voulait. Je connaissais son excitante pruderie. À chaque fois, comme lors de notre première nuit, elle se cachait lorsque je la désirais. C’était, depuis, devenu un rituel, et la mince couverture dans laquelle elle se recroquevillait me donnait le temps dont j’avais besoin. Elle ne se dérobait pas à moi ; la plante de ses pieds caressait même les miens, comme si de rien n’était. Mais elle voulait être prise. Il m’arrivait de souhaiter qu’il en aille autrement, et pourtant cela m’excitait. Finalement je tirai le drap par en bas, la libérai et la pénétrai par-derrière. Elle se cambra et gémit, aussi discrètement que si ses enfants étaient dans la pièce. J’eus tout juste le temps de lui écarter, d’une caresse, les cheveux du visage. Elle m’attrapa la main, me suça le bout des doigts, et ce fut fini.
J’aimais toujours rester encore un moment auprès d’elle avant de rejoindre ma pièce. Je regardai le plafond, le souffle lourd, et eus de nouveau ce sentiment d’oppression. Comme si j’avais perdu quelqu’un, me dis-je. La veuve se tourna vers moi et posa le front contre mon épaule.
– Tu as un nouveau voisin, dit-elle sans transition.
Il me fallait quelque chose pour arriver à m’extraire de mes réflexions.
– Qui ? demandai-je.
– C’est ce médecin venu d’Europe, celui pour lequel tu travailles.
Je fus aussitôt parfaitement éveillé.
– Qu’est-ce que tu dis ? lui lançai-je.
– Ils ont apporté ses meubles, aujourd’hui. J’ai vu ça depuis le toit. Il loge dans la maison près des écuries. Pas particulièrement chic, mais spacieux.
Je fus incapable de rester au lit. Je me forçai à rester calme et à marcher lentement lorsque je passai dans le couloir, pieds nus, et me dirigeai vers la porte d’entrée en traversant la pièce obscure. Je me demandai un bref instant si je devais mettre mes chaussures. Mais je n’avais pas même assez de patience pour cela.
Je marchai à grands pas dans l’air froid de la nuit, le long de la balustrade, jusqu’à l’échelle de bois qui menait sur le toit. Arrivé en haut, je remarquai que j’avais le buste nu et me courbai malgré moi. Pourtant, je vis déjà la grande fenêtre éclairée dans la maison située de l’autre côté de la ruelle. Je reconnus le docteur que je croyais avoir abandonné pour le reste de cette journée. Il était là-bas, il venait manifestement de rentrer. Une fois de plus, la soirée avait été longue à l’hôpital. Il était debout au milieu de son nouveau salon, les mains plantées sur les flancs, et regardait autour de lui comme s’il cherchait quelque chose.
Je m’accroupis sur le toit en tôle et croisai les bras devant moi. À cet instant, face à ces retrouvailles tellement inattendues, je compris que je ne me débarrasserais pas de cet homme, qu’il me poursuivrait, lui et tout ce qu’il avait apporté.
Un mulet avait dû rester quelque part dans les écuries, en face ; manifestement, il errait à l’aveuglette et se cognait contre les murs en bois. Je sentis la sueur sur ma peau et je frissonnai. J’étais assis là comme un saint indien, tandis que le docteur commençait à vider ses caisses. Il faisait cela hâtivement, posait quelque part dans la pièce, parfois même par terre, tous les petits objets qu’il pêchait dans la sciure, avant de les sortir de leur emballage papier.
Voilà, tu es arrivé, me dis-je. Te voilà qui t’installes à l’étranger. Je défis les bras croisés sur ma poitrine. La vue de cet homme au corps maigre comme un clou me fit de nouveau douter. C’était un vieux monsieur et un médecin venu d’Europe, mais cela ne prouvait rien. Ce sont tes souvenirs qui te trompent, me dis-je. Le seul fait que tu n’aies plus vu d’Européen depuis longtemps te fait croire que celui-ci a un rapport avec cette époque. Soudain, je me sentis faible et abattu. Toute la tension de ces dernières heures se dissipa. Je me levai et tournai les talons. À demi nu, comme l’homme qui me faisait face à la fenêtre, je restai sur place un bref instant avant de redescendre.
2
Les jours suivants, je ne vins plus m’asseoir sur la chaise dans la salle de l’hôpital. Je me contentais d’entrer brièvement sans dire à aucun membre du personnel que j’étais présent. Puis j’attendais que l’on m’appelle, sur la place poussiéreuse qui se trouvait devant l’établissement.
Assis à côté de l’entrée, à l’ombre de l’appentis, je jetais des cailloux dans le sable. Mon rôle de coursier m’avait habitué aux temps morts, et ce lieu, devant l’hôpital, ne me semblait pas être le pire. Il m’était arrivé d’attendre en pleine rue, dans le grouillement de la foule, en veillant par-dessus le marché à ne pas rater mon commanditaire quand il sortirait de la maison. Ici, au contraire, j’étais tranquille et je pouvais me consacrer tranquillement à mes réflexions. La seule chose qui me tourmentait était que celles-ci tournaient toutes autour de ce médecin. Plus j’y réfléchissais, plus mon besoin de certitude se changeait en urgence. Je devais savoir si je me trompais à propos de cet homme. Je me passai la main sur le front et dépoussiérai ma vieille veste. L’inquiétude s’empara de moi. La paix laborieusement acquise n’était plus qu’un souvenir, je me sentis de nouveau, comme jadis, dans les lointains glacés, enivré par le schnaps, comme ils disaient, et par l’angoisse permanente.
Par l’une de ces longues journées retentirent depuis la rue des bruits de moteur et des voix sonores. Je reculai, effrayé. On ouvrit le portail et un poids lourd couvert de sable brun clair entra à l’intérieur. À côté couraient des femmes et des enfants qui criaient. Soudain la cour fut emplie par le vacarme. Le camion s’arrêta devant l’entrée de l’hôpital, le chauffeur et son accompagnateur descendirent et se frayèrent un chemin à travers la foule. Il fallut un moment avant que ces hommes, les enfants traînant dans leurs jambes et les femmes tiraillant leurs vêtements, parviennent à atteindre l’arrière du camion et à ouvrir la ridelle.
Je m’approchai et demandai à l’une des femmes ce qui s’était passé. Un accident avait eu lieu sur le chantier de travaux publics aux portes de la ville. Quatre ouvriers avaient été écrasés par un poids lourd alors qu’ils étaient assis et faisaient une pause au bord de la route. Dans un instant d’inattention, le chauffeur leur avait roulé sur les jambes et leur avait broyé les os.
À peine la ridelle ouverte, les cris s’amplifièrent encore. On entendait aussi, désormais, les gémissements des victimes. Le médecin arriva en courant, suivi de près par d’autres docteurs, plus jeunes, que je n’avais encore jamais vus. Je reculai, sans quitter le médecin des yeux. Je remarquai aussitôt le léger tremblement, que l’on discernait seulement lorsqu’il se déplaçait rapidement. Cela pourrait être lui, me dis-je malgré moi.
Pour mieux voir, je courus en décrivant un large arc de cercle autour du camion. Les quatre blessés geignaient et criaient chacun à leur tour, un mince filet de sang coulait de la plate-forme du camion et tombait goutte à goutte dans le sable. Le médecin eut du mal à couvrir le bruit de la foule lorsqu’il donna ses instructions. On avait entre-temps apporté des civières et le docteur ordonna aux plus jeunes de monter sur le camion et d’en faire descendre les hommes. Chacune des victimes hurla lorsqu’on la souleva pour la tenir de biais en l’air et la remettre aux mains tendues depuis le bas. Les jambes des hommes, grièvement blessés, pendaient de manière grotesque depuis leur tronc. On ne voyait pratiquement pas de sang sur leurs corps. Il me sembla que les gens voulaient faire taire leurs cris de douleur en leur posant la main sur la bouche.
Les femmes des blessés se jetèrent sur les civières et furent emmenées plus loin par les auxiliaires, qui gesticulaient furieusement. Lorsque je vis ces femmes essuyer leur morve et leurs larmes dans le coin de leurs foulards, lorsque je regardai leur visage enflé, je reculai en titubant et me mis à bonne distance. Je respirais par la bouche, j’entendais battre mon cœur.
On déposa la dernière des victimes avec tant de maladresse que ses jambes pendaient au sol, inanimées, quand on souleva la civière. Ses souffrances devaient être insupportables ; le médecin eut la présence d’esprit d’intervenir. Je le vis mettre le blessé en position de sécurité avant d’envoyer les brancardiers vers l’hôpital. Pendant un moment, il suivit son patient des yeux, puis observa le camion et les gens qui m’entouraient. Soudain, il s’attrapa le cou avec la main droite, d’un geste fugitif, juste avant de suivre les brancardiers. Mais cette vision se grava en moi. Était-ce une détresse respiratoire, ou bien quelque chose avait-il aussi sauté à la gorge du médecin, quelque chose qui l’étranglait ?
J’étais déjà loin et je respirais de nouveau d’un souffle tranquille et régulier. Lorsque l’un des jeunes médecins me vit debout sur le côté et me fit signe, je traversai la rue au trot comme si je n’étais pas concerné et me postai entre les deux hommes qui gardaient l’entrée avec des balais tenus en biais. J’observai les visages des gens qui se pressaient. On en voyait toujours comme ceux-là lorsqu’il y avait du désordre, ils pleuraient et criaient comme s’ils étaient eux-mêmes concernés, mais en vérité ils ne faisaient que jouir du bruit qu’ils produisaient. Je repoussai ceux qui pénétraient trop en profondeur dans l’hôpital, en visant leurs visages, j’entendis les prières et les plaintes, les malédictions et les menaces – mais je ne sentis rien. C’est comme autrefois, je n’ai pas changé, me dis-je en écartant la tête d’un petit garçon. Lorsqu’il émergea de nouveau, furieux, et me regarda dans les yeux, il recula.
J’avais beau avoir fort à faire, je lançai un rapide coup d’œil à la ronde. Il me sembla que j’avais senti quelque chose au moment où j’avais tourné la tête. Et le docteur se trouvait effectivement derrière moi, à quelques mètres de distance. Au lieu de s’occuper de ses patients, il m’observait. Il ne broncha pas, rien ne disait que c’était plus qu’un hasard. Et pourtant je baissai les bras, désemparé, lorsque l’autre se retourna pour aller travailler.
Les semaines suivantes aussi, je continuai à escalader les échelles en bois pendant la nuit. Désormais, je m’habillais assez chaudement, il m’arrivait même parfois d’emporter un verre et la théière. J’en prenais fort à mon aise sur le toit. Assis en tailleur, j’observais la fenêtre obscure, et quand la lumière finissait par éclairer la pièce, de l’autre côté, je brûlais d’impatience, comme au cinéma. J’étais parfaitement conscient de ce que mes actes avaient de singulier et je m’efforçais donc de ne pas me faire voir. Cela m’était difficile, mais j’attendais toujours que le soir fût tombé, même lorsque je savais que le docteur était déjà chez lui. L’ampleur de ma curiosité et de mon impatience me soutenait. Je ne suis pas revenu, me disais-je, je suis malade, je suis solitaire.
Et pourtant j’appréciais ma vie secrète. Elle avait commencé avec la veuve. Nous ne pouvions nous voir que pendant les nuits, mais de cette manière nous étions entièrement l’un avec l’autre, loin de l’affairement de la journée. Une entente silencieuse régnait entre nous : sauf au début, elle ne parla jamais de sa famille et de ses enfants, quant à moi je ne lui racontai rien sur ma personne. La nuit nous entourait et nous protégeait, elle gardait pour elle ce que nous faisions.
Entre-temps, le Dr Stein avait aménagé son appartement. Il avait apparemment tout prévu et n’eut pas beaucoup de transformations à accomplir par la suite. Il avait accroché successivement, à différents murs de la pièce, un tableau encadré dont je ne pus hélas, au début, pas distinguer grand-chose. Allongé sur le lit ou assis sur son siège, le médecin avait tenté de lui trouver la meilleure position possible. Il finit par abandonner et je ne revis plus la toile.
Le quotidien s’installa alors. Je remarquai que le médecin n’avait jamais de visite, bien qu’il eût été un homme tellement important en ville. Mais cela ne paraissait pas le déranger. Lorsqu’il rentrait chez lui, le soir, il passait immédiatement un peignoir de bain et allumait la radio. Je savais qu’il profitait alors de sa Feierabend, de sa soirée libre.
Le docteur avait rangé quelques livres sur une étagère, mais il ne faisait jamais que lire les journaux qu’il apportait par piles. C’étaient des titres en provenance de l’Occident, j’en avais déniché quelques-uns – l’une des rares missions qui m’eussent été confiées par l’un de ses assistants.
Au bout d’environ deux semaines quelque chose changea. Un volumineux bouquet de roses se dressait dans la pièce. Je me demandai avec agacement qui le docteur avait bien pu envoyer pour les lui acheter. C’étaient probablement ses amis de l’administration municipale qui s’en étaient chargés. J’en aurais trouvé de plus belles s’il avait songé à me le demander. Pourtant, ces roses à longues tiges étaient somptueuses ; même à la lumière de l’ampoule nue, leur rouge velouté était comme une promesse.
Le lendemain soir, pour la première fois, le Dr Stein eut de la compagnie. C’était une Européenne. Nettement plus jeune que le médecin et presque aussi grande que lui, elle regardait autour d’elle dans la pièce, l’air un peu incertain. Elle avait pris une des roses, l’agitait comme un éventail et la tenait de temps en temps sous son nez. Adossé à la porte de la chambre, le docteur nettoyait ses lunettes avec un chiffon. Bien entendu, la rumeur avait fait depuis bien longtemps le tour de la ville : une femme étrangère était arrivée, et elle était à lui. Mais je fus le seul témoin de leur intimité ; le seul à voir la nervosité du docteur, l’incertitude d’un homme vieillissant qui avait passé une longue période dans la solitude. Et je pus observer le calme de cette femme au visage mince, presque maigre, cette femme qui se comportait comme si elle s’apprêtait à repartir d’un instant à l’autre. Une idée me vint à l’esprit : c’est peut-être sa fille. Mais juste après, le médecin mit ses lunettes, puis rangea méticuleusement son mouchoir dans la poche de son pantalon et prit la femme dans ses bras, avec précaution et pourtant un peu trop vivement. Quand ils s’embrassèrent, je détournai le regard.
La femme resta chez le docteur. Elle l’attendait le soir. J’entendais les gens parler d’elle, les commérages habituels, à cette différence près qu’on ne les échangeait pas ouvertement, mais sous le manteau. Après tout, il s’agissait d’étrangers, on ne pouvait jamais savoir.
Un jour elle vint à l’hôpital, probablement pour visiter le lieu où travaillait son mari. Elle portait un foulard, je la reconnus seulement au moment où elle passa devant moi et disparut dans le bâtiment. Je me promenai aux alentours des locaux, effrayé, jusqu’à ce qu’elle en ressorte enfin. Peut-être avait-elle besoin de mes services. Elle sortit dans la cour au bras du docteur et, aveuglée par le soleil de midi, se couvrit les yeux. Je les rejoignis à grands pas, mais Stein leva aussitôt la main. Il ne me regarda même pas, se contentant d’écarter le coursier de la main comme une mouche importune.
Je restai planté sur place, fou de rage, et je les vis tous les deux se diriger vers la sortie. J’étais désormais certain que le docteur ne voulait pas de moi comme factotum – de moi en particulier –, ni pour lui ni pour sa femme. Il ne me resta donc plus qu’à continuer à les observer tous les deux en bouillant de colère.
Au bout de quelques jours, déjà, l’histoire prit un tour intéressant. Derrière la fenêtre, à quelques mètres de distance, la femme et le docteur se faisaient face et semblaient échanger de vifs arguments. Le médecin ne cessait de lever les mains, comme pour se défendre contre quelque chose d’invisible. Elle, au contraire, se tenait toute droite. Sa chevelure blond châtain était défaite avec une telle ostentation qu’on aurait pu croire qu’elle voulait effrayer par son seul aspect. La dispute dura longtemps. Le docteur faisait plusieurs pas en arrière pour repartir aussitôt dans l’autre sens, les mains vers l’avant. Il voulait empoigner la femme et n’osait tout de même pas le faire. Finalement l’un des deux éteignit la lumière. L’obscurité dura quelques secondes. Mais d’un seul coup la fenêtre fut de nouveau violemment éclairée et la femme traversa la pièce à grands pas, l’air désemparé.
Cela m’inspira une certaine satisfaction. Lorsque je descendis l’échelle, je me demandai pourquoi le docteur devait réussir ce qui m’était interdit : mener une vie normale comme si rien ne s’était passé. Je restai encore longtemps dans la chambre noire et m’interrogeai pour savoir si je devais souhaiter le malheur à l’autre. Ne valait-il pas mieux, comme lui, espérer un recommencement au lieu de loger dans la nuit, comme moi, à la manière d’un hideux animal souterrain ?