Timor oriental, 1999. Alor, un jeune architecte indonésien, arrive à Díli chargé de concevoir une maison pour le leader indépendantiste du Timor. Il s’installe dans la Pension du Monde Perdu, où les chambres portent des noms de massacres. Dans les mois qui précèdent le vote pour l’indépendance, il va vivre un crescendo de violence, être manipulé, rencontrer une princesse, un moine soldat, un évêque, un agent de Jakarta et le Généralissime, alias La Relique, le premier chef de la nation, survivant d’un bombardement, caché dans une grotte dans la montagne.
Alor représente l’élu, le sauveur envoyé par le destin. Mais Dieu “est un crocodile étranger”, dit-on à Díli. Dans l’euphorie du référendum, Jakarta lance une opération, Alor disparaît dans le chaos, et on ne retrouve qu’une tête coupée dans une boîte.
La Suède envoie un évêque pour mener l’enquête. Ce livre réunit toutes les pièces et les rapports de sa mission.
Ce roman magnifique est un requiem pour les mondes perdus des restes de l’Empire portugais. Il est écrit du point de vue des colonisés. Nul ne pouvait mieux parler du Timor que le journaliste qui y a été correspondant dans une des périodes sanglantes de son passé récent.
-
"Racontée du point de vue des colonisés, cette période-clé de l'histoire de l'île ne pouvait être mieux restituée que par Pedro Rosa-Mendes, qui y fut longtemps lui-même correspondant de presse. Sous sa plume, elle ressemble à une ode funèbre." Lire l'article iciFlorence NoivilleLe Monde des livres
1
MATARUFA
A 9 heures du matin le samedi 4 septembre 1999, à l’hôtel Ma’hkota, àDili, Ian Martin, chef de la mission internationale, a annoncé les résultats de la consultation populaire au Timor oriental : 21,5 % avaient voté en faveur de l’autonomie, 78,5 % avaient voté contre. L’annonce a été faite simultanément au siège des Nations Unies a New York. Le résultat était sans équivoque car “la Commission a pu conclure que la consultation populaire a été exemplaire sur le plan juridique, et conforme aux Accords de New York, et constitue par conséquent un reflet exact de la volonté du peuple du Timor oriental”, sans irrégularités ou contraintes d’aucun ordre. Au milieu d’une joie indescriptible, j’ai remarqué un homme qui me faisait des signes a la porte du salon du Ma’hkota. Il me priait de le rejoindre. Il s’est incliné avec délicatesse, se montrant exagérément courtois pour l’occasion et ne faisant aucune allusion à la nouvelle qui à ce moment-là faisait le tour du monde. Il m’a simplement informé J’apporte un colis, il m’a mis entre les mains une boîte en carton, adressée à “Présidence de la République Timor-Dilly”
Peut-etre voudriez-vous l’ouvrir, et, regardant par-dessus son épaule, il a entrouvert la boîte sur les côtés. De la boîte s’est échappé le relent d’une blessure en putréfaction. Je continue a sentir cette odeur, elle est restée collée à moi, à nous, ça n’aurait pas dû mais c’était l’odeur d’un pays qui naissait, Lorosa’e, l’odeur de Ian Martin juste a côté nous en donnant la garantie, a nous et au monde, “Il n’y a aucun doute que la majorité écrasante du peuple de cette terre agitée souhaite se séparer de la République d’Indonésie.” M’a informé l’homme a la boîte, sans émotion, Ce n’est pas nous, il a allumé une kretek, C’est de votre côté, dans vos régions. Nous acceptons la tradition, comme nous acceptons le résultat ; un loroçá de plus des aswain Timor oan*. Mais c’est bien dommage qu’on lui ait fait ça, juste maintenant. L’homme portait une chemise javanaise traditionnelle en pure soie, élégante dans son extravagance ; sur un fond mauve et crème se répétait un motif imprimé de petits voiliers. J’ai remarqué que sur les voiles il y avait des Croix templières. Elles étaient pareilles aux parements de Nuno Álvares Pereira** dans mes livres de Soibada. Elles ressemblaient assez aux caravelles du XVIe siecle arrivées dans l’océan Indien avec des Portugais a bord. Sur les épaules carrées de l’homme, la flotte lusitanienne naviguait en ordre sur une mer brillante de soie. Étrange effet pour une étrange occasion. J’ai pensé : le raffinement cynique et silencieux des Javanais. De la boîte en carton est sortie une larve. Le capitaine de l’escadre de soie a eu l’air dégouté de mon dégout. Il a tiré plus fort sur sa kretek et l’a jetée par terre, sans l’éteindre. C’est en regardant le petit point qui se consumait en cendres a nos pieds qu’il a répété, Juste maintenant, alors qu’il avait ressuscité expres, sur ce il m’a salué bien bas et est sorti du Ma’hkota avec ses galions de soie, laissant entre mes mains l’indépendance, telle qu’elle nous était donnée par l’Indonésie. Un mégot a l’odeur d’œillet et de mort.
Dans la boîte gisait la tete d’un homme.
2
DALBOEKERK
Des sommets les plus hauts du couple Matebian – Homme et Femme – on aperçoit, par ciel dégagé, des centaines, des milliers de roches à l’arête verticale et austère. Ce sont des anthropomorphismes sculptés par les éléments, sans fonction défi nie. Légion, exode, procession, nécropole ? Ces grosses pierres, de grande envergure par rapport a la taille d’un homme, échappent a la perception de qui s’en approche, dissimulées par leur gigantisme. Ce n’est que de loin qu’elles expriment dans sa totalité un collectif symbolique, quand on les regarde depuis les sommets ou il ne pleut guère, parce qu’en vérité la pluie toujours les habite. De telles formations semblent faire allusion a des plissements créés et interrompus par un cataclysme. Elles suivent des directions diverses et aucune en particulier, pétrifiées dans leur désarroi. Ce sont des lignes et des ensembles qui tracent des prés et des escarpements, en pointes acérées ou en thalwegs. Leur silhouette prend un aspect dramatique lors du sacre de l’aube et du crépuscule et dans l’enivrement glauque du brouillard. Ces pierres, chacune d’elles se protégeant sur l’épaule de la suivante, paraissent ici monter difficilement, mais juste a côté semblent sur le point de dévaler la pente en désordre. Cela s’opère, aux yeux de l’observateur attentif, non en fonction de la topographie au sein de laquelle la nature a disposé ces roches, mais selon l’orientation uniforme de leur partie supérieure. En eff et l’érosion, avec une lenteur minérale, a vouté la stature de chaque mégalithe en une expression taciturne, ou fatiguée, ou soumise, ou autre forme de découragement qui pese sur leur nuque, dans la même direction, comme les arbres qui ploient pour obéir au vent. Depuis d’autres paliers et perspectives, l’ossature de ces grosses pierres crée une illusion de vertèbres et d’écailles dorsales. C’est l’impertinence paléontologique qui fait qu’a cet endroit précisément, au bout de l’arc formé par les petites îles de la Sonde, balcon sur le monde océanique, peut reposer une colossale bête pliocène. Peut-être ces formations sont-elles d’ailleurs un vestige de la nature primordiale du Matebian, créature endormie au creux de son propre fossile, invisible parce que de la taille de l’île. Le Matebian, porte entrouverte sur les appartements de Marômak, L’Illuminé, est cime de ciel, mais, en des ères reculées, il a été fond de mer, en ces âges ou terres et bêtes n’étaient pas encore nées, enfouies dans l’utérus aquatique de la Terre. La présence de coquillages a des altitudes supérieures à 2 000 mètres en atteste, ainsi que la composition corallienne de ses sommets. Qui sait, d’ailleurs, si ce n’est pas cette grande montagne qui maintient à la surface des mers toute la cordillère de Timor, seule île du groupe à ne pas être d’origine volcanique. Dans le Matebian résonnent des éternités que révelent, pour peu qu’on les mette au défi sur les versants les plus hauts, des vents qui ne descendent jamais au niveau de la mer, et l’écho occasionnel des séismes dans le cœur en fusion de la Terre. Matebian signifie “Mont des Âmes”, en langue macassai, le peuple homonyme qui habite la bande transversale entre les deux mers – Homme et Femme – de l’île, au levant des sommets du Monde Perdu (qui dominent les précipices et les alluvions de Viqueque) et au ponant du plateau de Lospalos. Le Matebian constitue une zone de transition entre le peuple de langue macassai et les peuples de langue naueti et macalere, fixés dans les amphithéâtres que le massif étend vers la Mer-Homme, dite de Timor. Ceuxci et d’autres peuples timorais, d’après les conclusions que j’ai tirées de divers récits que j’ai entendus par là-bas, ont adopté et vénèrent le Matebian comme l’étymologie de leur culte commun aux aïeux les plus anciens. Matebian veut également dire “âmes des ancetres”. Et donc, plus que tout, Matebian désigne la demeure commune d’ou partent et ou aboutissent les lignes de vie qui, en un collier de mille mots, unissent les Timorais en familles, les familles en clans et les clans en nations. Ces fi ls narratifs, lovés dans des légendes et des tabous, possèdent autant d’anneaux que le cou sectionné d’un arbre centenaire. Ils commencent a se dérouler avec un grand-père d’arrière-grands-pères et sont sous la garde des lia-nains, “seigneurs du mot”, dont la profession rituelle est leur propre mémoire prodigieuse, si étendue qu’en elle repose la mémoire vitale du groupe. Dit d’une autre façon, les ancetres sont leur propre lieu et comme telle cette montagne, n’étant pas la plus haute de Timor, est cependant la plus noble. Matebian, montagne du début et de la fin, coïncide avec le moment et le lieu où le verbe recrée, de mémoire, la genèse du monde timorais. J’ai réussi a avoir une vraie familiarité avec les pierres hominidées du Matebian. J’ai appris a apprécier leur constance, sinon leur loyauté. Elles m’ont reçu avec une infaillible assiduité. Ruisselantes de pluie, parfois, rayonnantes de chaleur d’autres fois. Certaines années plus humides elles prenaient un air de fête, enjolivées de mousses et d’herbes aromatiques. D’autres années, d’étés plus chauds, elles étaient parsemées d’une rougeole aux lichens orangés. Elles sont toujours restées au même endroit, quelle que fut l’heure a laquelle j’allais les retrouver, pendant ces trois décennies. Il n’est pas difficile de croire qu’elles m’attendaient depuis des siècles et qu’elles continueront a m’attendre après que j’en aurai fait le tour une dernière fois. Ni elles ni moi ne savons quand sera cette dernière fois. Je connais quelques-unes de ces pierres par leur nom car c’est moi qui les ai nommées. Donner un nom a une pierre est plus sûr que de nommer un enfant et plus honorifique que de nommer une fleur ou un animal. Moi, quand j’étais enfant, je rêvais de donner mon nom a une nouvelle espèce d’eucalyptus, d’orchidée ou de papillon. Mais ma vie n’a pas pris cette voie-là. Elle en a pris d’autres, diverses, qui se sont interceptées a Timor.
Les pierres, je les ai christianisées, excusez le terme. Je sais qui elles sont par leur nom propre. Il m’est facile de me rappeler des gens qui ont disparu sous mes yeux en cette terre timoraise au long de vingt-quatre ans. Parce que, pendant tout ce temps, j’ai donné aux pierres les noms de ceux qui disparaissaient. Ce sont la mes archives privées. Un état civil, si vous voulez, avec l’enregistrement des naissances qui correspond aux certificats de décès – ou le contraire. Dans mon cahier, pour chaque embuscade, pour chaque bombardement, pour chaque massacre, pour chaque torture, il y a une pierre dans le silence du Matebian. Il y a des noms d’alliés et d’ennemis. De civils et de militaires. De guérilleros, de simples soldats, de militaires de carrière. D’Indonésiens et de Timorais. Il y a, ou il y avait, à Haekoni, sur le coteau du Matebian-Homme, un vieil homme que nous laissions, depuis 1978, déambuler là-haut. Un jour, Nicodemos m’a trouvé, comme au cours des années précédentes, près d’un petit lac au-dessus de Rufaguia. Existe à cet endroit un pré de mégalithes, plutôt imposant. Deux rochers semblent se défi er, tournés et inclinés l’un vers l’autre, séparés par quelques mètres, comme les cow-boys lors d’un duel dans les films. Non loin de la, en novembre 1978, au cours de la bataille finale, un de nos soldats et un soldat des Falintil ont été dépouillés de leur camouflage : le brouillard serré qui les cachait l’un de l’autre s’est soudain levé, chacun des deux ignorant la présence aussi proche de l’ennemi. Les deux soldats, pris de court, ont tiré en même temps. Tous deux ont visé juste. Tous deux sont morts au même instant. Dans mon Matebian, les pierres-cow-boys au-dessus de Rufaguia portent le nom de ces deux malheureux. Je leur ai souvent rendu visite pour réfléchir sur notre long duel. Nicodemos m’a surpris dans un de ces moments-la. Il a pris son courage a deux mains pour demander si Vous, Indonésiens, vous allez aussi occuper nos ancêtres, Pak ?
Je n’avais jamais rien lu sur une telle possibilité, dans aucun manuel de guerre, ni dans aucune modalité d’Integrasi*. Je me suis assis à côté du vieil homme. Je lui ai parlé tout bas, à l’oreille, lui répondant que Non, grand-père. Seulement ceux qui seront nos descendants, idée qui a, certainement, tourmenté l’ancien durant plusieurs saisons des pluies. Donner un nom aux mégalithes du Matebian est plus facile qu’expliquer la présence de cette population de pierre sur le “Mont des Âmes”. On dirait un groupe affairé à son propre silence, emmuré entre son origine et son destin. Nombre de ces roches, plus grossières et plus burinées, sont tellement humaines que, à part la différence d’échelle, elles font penser aux ai-toos en bois, placés pour indiquer une sépulture, ete-uru ha’a en langue des Fatalucos de l’Est. Les ete-uru ha’a, hauts comme un petit enfant, étaient enterrés a même le sol et étayés a la base par des pierres. On en trouve encore quelques-uns par les chemins de montagne, ou dans la brousse de l’Est, pelés, hagards, émaciés par les moussons. Ils ont des traces de fractures, des plaies, des rides, a la façon de l’authentique peau humaine, que les intempéries de la vie tannent comme un cuir vieilli. Les occupants permanents du Matebian sont tous comme cela : femmes et hommes, guerriers et bergers, enfants et vieillards, esclaves et rois, tous émoussés et soumis, jusqu’a presque ne plus avoir de nom ni de taille. A la fin, les fragiles prières de sable récitées par ceux qui descendent d’eux les dispersent. Immobiles, pierres vivantes, gardés par leurs chevaux, qui paissent seuls dans les nuages, ils attendent un “qui”, un “ou”, remémorés et craints par les Timorais – car rien d’autre ne pourra venir à leur secours sinon la mythologie.
Si le mythe raconte la vérité des lieux, le Matebian- Homme et le Matebian-Femme veillent, là-haut, sur l’entière descendance des ancêtres de Timor. Ou, ce qui est redoutablement plus vaste, ils veillent sur l’ascendance de tous les enfants de l’île. La légende passe sous silence le motif qui a poussé L’Illuminé a transformer chacun de ces êtres en sa propre montagne-stèle : ont-ils trop longtemps regardé vers le passé ? Ou ont-ils échoué a se mettre d’accord sur le futur ?
3
MATARUFA
Hormis les promenades des péquenauds aux alentours de Dili pour cueillir des amandes des Indes ou compter les baleines dans le détroit d’Ombai – meme quand on n’est pas en octobre et que ce ne sont certainement pas des baleines – les excursions dans les districts sont toujours plus ou moins celles qui se faisaient il y a cinquante ans, quand Ruy Cinatti* est venu ici pour la première fois, après l’occupation japonaise, et qu’il courait partout pour recenser les champós et les murungus chaque fois que le gouverneur lui en donnait l’autorisation. Il suffit d’un jour pour visiter Tíbar, Liquiçá et Maubara, en bas, ou pour grimper à Gleno et Ermera, qui est une promenade accessible que les étrangers apprécient toujours, fascinés par le silence végétal des plantations. Dans la direction opposée, en huit jours on fait Dili, Baucau, Ossú, Venilale, Afaloicai, Baguia, Uatocarbau, Viqueque, Mundo Perdido – Monde Perdu –, Metinare, Dili. En deux semaines on peut boucler un “huit” par la pointe Est,avec Dili, Lautém, Lospalos, Muapitine, Tutuala, Lospalos, Loré, Baucau, Dili. J’ai voulu savoir combien de temps Alor avait pour son voyage d’exploration, et lui, étonné, Vous croyez vraiment qu’on sait combien de temps on a ? Ce qui m’a fait penser que j’avais toute liberté pour montrer mon jeu, disons, devant une grande carte de Tim- Tim qu’il y avait au quartier général de la police, car c’est là qu’Alor m’avait donné rendez-vous. Je lui ai donné mon opinion en peu de mots, les seuls possibles, Si vous voulez Barat on va vers l’ouest, si vous voulez Timur on va vers l’est – et si vous voulez vous embourber dans les marécages et les rivières, à la saison des pluies, on va vers le sud. Il a écouté, compris mon insistance et a décidé, en pleine excitation, Timurtimurtimur ! J’ai demandé à Alor un deuxième rendez-vous de travail avec d’autres cartes et en meilleure compagnie. Au quartier général de la police de Dili il n’y avait rien de récupérable, pas même une carte correcte, celle que j’avais montrée a Alor n’était qu’une carte d’approche militaire de l’île. Elle donne des instructions sur les récifs et les courants, les barrières de corail et les mangroves, et les profondeurs de la ligne de côte, quelques indications de navigation aérienne, des altitudes. Ce doit être une bonne carte pour préparer un débarquement mais elle ne vaut rien pour s’orienter à l’intérieur du territoire, il manque la majorité des routes, construites d’ailleurs par les Indonésiens, et beaucoup de localités n’y sont même pas signalées. Nous nous sommes rencontrés ensuite dans un restaurant de Bidau, chez quelqu’un de confiance. Alor a parlé avec passion de ses études d’architecture et de son intention, une fois l’université terminée, de se spécialiser dans l’utilisation de techniques de construction traditionnelles pour la conception de structures modernes. Son voyage scientifique à Tim-Tim avait été suggéré par un de ses directeurs de recherches. Et nous étions donc en train de planifier une expédition à l’intérieur du pays, à la recherche de la maison timoraise. J’ai tracé un plan de travail possible pour le projet d’Alor : la maison fataluco du plateau de Lospalos, avec une dérivation par le massif du Matebian, zone d’interception des territoires fataluco et macassai, très intéressante, parce que reculée, pour entrer en contact avec des matériaux et des modèles plus authentiques qu’en d’autres parties du territoire plus touchées par les progrès de la province. Alor a écouté et n’a posé qu’une seule question à la fin, C’est vrai que vous avez passé une année en prison parce que vous apparteniez a la guérilla ? Ma connaissance assez vaste de l’intérieur du pays peut être utile à votre projet et vous éviter de tomber dans des pièges, c’est ce que je lui ai dit à ce moment-là et lui n’a pas persisté dans son indiscrétion. J’ai continué : premier piège, la maison traditionnelle timoraise n’existe pas, point. Il existe différents types d’habitat chez les divers peuples timorais. J’ai même suggéré que la première question qu’Alor devait développer sur sa table de travail n’était pas théorique mais politique. A savoir, quelle “race” de maison traditionnelle allait-on construire pour le leader ? Le choix de l’étroite maison dagadá du plateau de Lospalos et du massif du Matebian, ex-libris de Tim-Tim depuis l’époque coloniale portugaise, pouvait etre, et était, un choix évident du point de vue esthétique. Cependant il serait polémique. Les peuples de la partie occidentale de Tim-Tim, les calades, comme on les appelait a l’époque des Portugais, seraient froissés par une maison-symbole d’inspiration fataluco ou macassai, timorais fi raco ou lorosa’e. Le problème serait le même si, inversement, la maison modèle était la maison de Maubisse, de Bobonaro, du Suai ou de l’enclave d’Oécussi, toutes d’une typologie différente pour des peuples différents ou, en général, de n’importe quel district occidental, loromonu*. Je n’entrais même pas dans le débat nécessaire sur la façon dont, à la fin du millénaire, une nouvelle maison “traditionnelle” pourrait intégrer l’influence de l’architecture européenne, inévitable pour des raisons de prix, de confort et de concept. Sur ce point, l’architecte aurait aussi a choisir entre deux influences croisées, celle des empreintes de l’Europe portugaise et celles de l’Europe hollandaise qui, à son tour, soulèveraient en aval des questions pertinentes, au moment où le cercle se refermerait en rendant évidentes les survivances souterraines, éloignées dans le temps, qui relient, par exemple, la maison dagadá a des modèles que l’on trouve a Sumatra, dans les îles Fidji ou en Indochine, et que difficilement les habitants de Timor considéreraient comme “traditionnel” du pays. Alor a compris Ce que vous êtes en train de me dire sans arriver à me le dire, c’est que Tim-Tim est un archipel en cale sèche et que la jalousie sociale commence par les symboles Ce que je suis en train de vous dire sans arriver a le dire, c’est qu’il ne vaut pas la peine de se fatiguer à construire une maison traditionnelle qui soit brulée par un incendie “traditionnel” le jour de son inauguration.
4
MATARUFA
Des croix, a dit Alor au passage de Samalari, sur la route qui monte depuis Laga, quand sa tète a cogné une fois de plus contre la fenêtre ou il avait posé son sommeil. La cabine métallique entretenait le froid glacial et l’odeur de crasse, nous étions trois bonshommes pas lavés, et dans le cas de Sixto depuis des semaines voire des mois. Alor s’est blotti contre sa propre poitrine, enfonçant sa tête dans ses épaules et ses mains sous ses aisselles. Les cimes étaient encore plongées dans la nuit, vides de végétation, d’animaux et de pâturages. A notre gauche, contre l’aube lilas, Des croix et encore des croix, une, deux trois, quatre…, des silhouettes de toits et de tombes passaient, nettes, Vous avez plus de croix que d’arbres, a remarqué Alor, Un de ces jours vous n’aurez plus de bois pour signaler les morts, ce a quoi notre chauffeur a répliqué, sans négliger le volant, C’est la tragédie de notre peuple, Pak Alor, mais le garçon n’écoutait plus la grammaire imparfaite du vieux Sixto, Timor souffre beaucoup de l’irosion, il paraît, et se laissant a nouveau tomber contre la fenêtre il marmonnait le décompte sur la route de Baguia, la bouche ouverte, un horrible filet de bave aux lèvres, que j’ai trouvé de mauvais augure, Vingt, trente, cinquante… cent… deux cents… trois cents… mille…
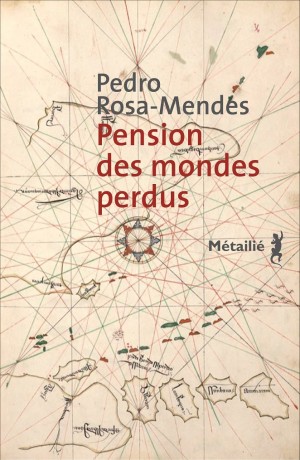


-100x150.jpg)