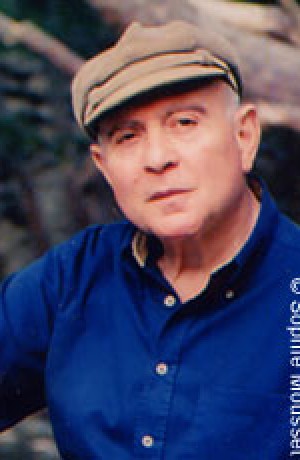Le XXe siècle peut être considéré comme celui de la mort des empires territoriaux dont le dernier était l'Union soviétique. Un nouvel ordre international s'est instauré sous l'égide des États-Unis. On assiste en une quinzaine d'années, entre les deux guerres d'Irak au reflux de la Russie sur l'ensemble de sa périphérie, à l'impuissance de l'Europe face à la crise yougoslave et à l'effet de boomerang du terrorisme islamiste, naguère instrumentalisé contre les Soviétiques. L'expédition punitive en Afghanistan au lendemain du 11 septembre est l'opération de contre-terrorisme la plus considérable de l'histoire. Légitimée par la lutte contre le terrorisme et les armes de destruction massive, la seconde guerre d'Irak s'est affirmée comme une "croisade" pour la démocratie et le remodelage du Moyen-Orient
Écrit dans un style élégant et direct, voici un essai en prise sur une actualité internationale dont les mouvements deviennent ainsi plus intelligibles aux non-spécialistes que nous sommes.
-
"Tout à la fois politologue, professeur, journaliste, Gérard Chaliand n'a cessé d'ausculter les zones de turbulences de la planète. Et de ces dix dernières années de tourisme stratégique, fort bien résumées dans cette collection d'articles et d'essais, on retiendra trois réflexions qui sous-tendent l'ensemble : 1. Sur le terrorisme islamiste. Gérard Chaliand n'est pas de l'école du Komintern islamiste. Il ne croit pas à l'existence d'un " centre " guidant, plus ou moins directement, les opérations de cellules terroristes disséminées ici et là. " Le mythe d'une internationale islamiste produisant un effet de dominos est aussi irréaliste que la théorie des dominos l'était durant la guerre du Vietnam ", écrit-il. S'il observe que le terrorisme, islamiste ou autre, a rarement fait tomber un Etat et ne menace sérieusement l'existence d'aucun des puissants, il ne nie aucunement la menace qu'il représente. 2. Les grandes déstabilisations présentes et à venir sont d'ordre économiques et sociales, estime Chaliand. Si la pauvreté a reculé ces dix dernières années, notamment en Asie, les inégalités ont augmenté. Dans certains pays les plus pauvres, l'Etat s'est effondré, accompagnant une dégradation de la sécurité dans les villes de plus en plus denses : " l'activité guerrière offre aux mâles désœuvrés et sans perspective des moyens d'existence sans commune mesure avec la vie civile ". 3. Dans ce monde-là, le sentiment d'une hyperpuissance américaine est, très largement, le reflet de l'impuissance politique et militaire de l'Europe. Avec des budgets de la défense en constante régression, l'Europe-qui, face à la Serbie, puissance militaire médiocre, a dû faire appel aux Etats-Unis- se condamne, écrit Chaliand, " à se retirer de la grande Histoire ".Alain FrachonLE MONDE DES LIVRES
-
« Le géopoliticien et spécialiste du terrorisme G. Chaliand nous propose une compilation d'articles de sa plume, rédigés entre les deux guerres du Golfe (1991-2003), parfois inédits. [...] Qu'ils aient été signés hier ou voici dix ans, ses textes restent d'une actualité précieuse pour qui veut appréhender les raisons complexes qui ont plongé les Proche et Moyen-Orients dans un kaléidoscope de conflits. »LIBERATION
LE PHÉNOMÈNE TERRORISTE
Les attentats du 11 septembre 2001, exécutés à l'aide d'avions-suicide par un petit groupe d'islamistes radicaux à New York et à Washington, ont de façon aussi inattendue que spectaculaire, ramené l'attention sur le phénomène du terrorisme. Cependant, avant d'en établir la portée et d'en mesurer les conséquences, il est utile de dresser un bilan sommaire des divers terrorismes depuis l'effondrement de l'Union soviétique et de remonter aux origines contemporaines de l'attentat-suicide.
Précédé par un attentat-suicide, en avril 1983, visant l'ambassade des États-Unis à Beyrouth et provoquant 9 morts, les deux camions-suicide qui en octobre de la même année tuent 241 marines et 53 parachutistes français, toujours à Beyrouth, marquent un des succès politiques majeurs dûs au terrorisme. En effet, peu après cet attentat qui produit un choc considérable dans l'opinion publique américaine encore marquée par la guerre du Vietnam, les États-Unis et leurs alliés européens retirent leurs troupes du Liban, ce qui permet à la Syrie d'y imposer une paix qui lui est favorable.
La réaction de l'opinion publique américaine, se refusant à assumer la perte de militaires professionnels sur un théâtre considéré comme de peu d'importance, fait partie, quelques années plus tard, du calcul de Saddam Hussein, pour défier les États-Unis. En effet, si l'Irak était en mesure d'infliger aux troupes américaines des pertes considérées comme inacceptables par l'opinion publique, le rapport inégal entre l'Irak et les États-Unis pouvait être inversé. Les attentats-suicide de 1983 provoquant le départ des troupes alliées était le signe d'une nouvelle sensibilité. Celle-ci est à l'origine de la conception de la guerre zéro mort, menée uniquement par voie aérienne, comme en Bosnie et au Kosovo. Entre-temps, l'un des attentats transnationaux les plus meurtriers est l'explosion, en vol, au-dessus de Lockerbie d'un avion de la compagnie Pan Am, causant 270 victimes. L'attentat est attribué à la Libye.
La chute du mur de Berlin (1989), suivie de l'effondrement de l'Union soviétique (1991), constitue pour nombre de mouvements, terroristes ou non, un important changement. C'en est fini de l'aide logistique ou financière du "camp socialiste. Désormais, les mouvements ou les groupes qui obtenaient jusque-là de l'aide et du soutien auprès des régimes communistes européens doivent trouver d'autres sources de financement et recourir plus que jamais aux trafics illégaux.
Où en est, à cette date, le terrorisme, qui occupe depuis 1968 une place importante, d'une part comme phénomène transnational, d'autre part comme problème local dans un certain nombre de pays ?
D'emblée, rappelons que ce sont les États qui désignent du vocable de "terroristes des mouvements de nature différente. Sans omettre le terrorisme d'État, largement utilisé dans nombre de pays non démocratiques en butte à une contestation violente, on peut diviser les organisations qualifiées de terroristes en deux catégories : d'une part les guérillas telles que celle menée par les Tigres tamouls qui ont une implantation à la campagne et se livrent à la fois au harcèlement des troupes irrégulières, au sabotage et à des actes terroristes. Ce type d'organisation oblige l'armée à un vaste quadrillage et à une contre-insurrection tant rurale qu'urbaine, destinée à éradiquer l'infrastructure politique clandestine de l'adversaire. D'autre part, les organisations qui n'utilisent que les actions à caractère terroriste, la plupart du temps comme substitut à une guérilla qu'elles n'ont pas les moyens politiques et/ou militaires de mener. On peut ranger dans cette catégorie le Hamas ou le Djihad islamiste, par exemple.
Enfin, ajoutons que c'est moins l'origine du financement d'une organisation qui est décisive que l'importance de sa base sociale.
Où en est-on en cette fin de guerre froide marquée par la guerre du Golfe et la disparition de l'URSS ?
Les sectes idéologiques telles que les Brigades rouges, la Rote Armee Fraktion, Action directe, Cellules communistes combattantes de Belgique, appartiennent au passé. Elles n'avaient aucune chance d'entraîner, comme elles l'escomptaient à leurs débuts, les masses populaires d'Europe derrière elles. Les mouvements de minorités luttant pour des droits en Europe occidentale connaissent des destins différents. Le mouvement irlandais (IRA) a, en gros, réussi à l'emporter. La situation des catholiques d'Ulster, de moins en moins minoritaires démographiquement, est très différente de ce qu'elle était en 1968, au début des actions armées. Le mouvement basque ETA, qui ne représente qu'une minorité d'un mouvement national auquel une large autonomie a été accordée comme aux autres provinces d'Espagne a, au contraire, malgré sa remarquable organisation, subi des reculs sérieux depuis que les polices espagnoles et françaises collaborent ensemble. Ce mouvement n'a pas et ne peut avoir de perspectives politiques.
Les différentes composantes des mouvements corses qui prétendaient lutter contre un statut colonial qui leur aurait été imposé par la France continentale ont connu au cours des dix dernières années une dérive mafieuse. Elles ont par contre profité du laxisme de l'État français qui depuis les événements d'Aléria (1978), lors desquels des gendarmes furent tués sans que les criminels ne soient sanctionnés, n'a cessé de vouloir davantage composer qu'appliquer les règles de l'État de droit. Entre-temps, les divers mouvements nationalistes - qui se combattent et ne représentent qu'une partie minoritaire de l'électorat - ont réussi à peu près complètement à confisquer le discours.
Hors d'Europe occidentale, les situations sont contrastées. En Amérique latine, le Sentier lumineux, qui menait à la fois une guérilla rurale dans les Andes et des opérations terroristes à Lima, a été décimé par l'arrestation de son dirigeant Abigael Guzman. Ce dernier, questionné par la police politique, a été amené à demander à ses troupes de déposer les armes. L'unique autre pays d'Amérique latine où des guérillas occupent le devant de la scène est la Colombie. Dans ce pays, où des tractations sont menées depuis plusieurs années entre l'État et les deux organisations combattantes - le Front armé révolutionnaire de Colombie (FARC) et Ejercito de liberacion nacional (ELN) - le terrorisme est surtout l'apanage des forces d'extrême droite paramilitaires.
En Afrique subsaharienne, il n'y a pas d'activité terroriste locale mais des guérillas ou des guerres civiles. En Algérie, le terrorisme des islamistes, de plus en plus affaibli par un contre-terrorisme particulièrement brutal, a adopté des méthodes d'une barbarie rare. Un nombre non négligeable d'islamistes algériens ont été entraînés en Afghanistan et font partie de réseaux transnationaux. Les manifestations les plus spectaculaires des islamistes ont été le détournement d'un Airbus qui a atterri à Marseille pour se réapprovisonner en carburant, dont le commando a été éliminé par le GIGN, et les actions entreprises par un groupe d'islamistes à Roubaix (auquel participaient des Français "de souche en 1996).
En France, on ne déplore aucun attentat depuis 1996. Par contre, nombre de réseaux dormants ont été discrètement démantelés avant de pouvoir commettre des attentats.
En Asie mineure, le PKK, taxé par l'État turc de mouvement terroriste bien qu'il ait obligé durant près de quinze ans l'armée turque à quadriller avec quelque 200000 hommes une douzaine de provinces en état d'urgence, subissait en 1998 un revers décisif lors de la capture de son chef, Abdullah Ocalan. Celui-ci avait été expulsé de Syrie au terme de pressions turques menaçant la Syrie d'une incursion militaire. D'abord réfugié en Russie, le dirigeant du PKK en était expulsé sur pression américaine. Réfugié politique en Italie, Ocalan commettait l'erreur de vouloir, grâce à la complicité des Grecs, gagner la Tanzanie où il était arrêté par les services turcs épaulés par la CIA et le Mossad. Ramené en Turquie au terme d'une période de détention qui laissait tout loisir aux services turcs de le questionner, il déclarait, comme le dirigeant du Sentier lumineux avant lui, qu'il était temps de déposer les armes et rejetait sur ses lieutenants la responsabilité d'actes qui lui étaient reprochés.
En juillet 1994, le Centre juif de Buenos Aires (Argentine) explosait en faisant 96 victimes. En Israël même, le Hamas et le Djihad islamique recouraient aux attentats-suicide. En octobre 1994 était commis à Tel Aviv l'attentat-suicide le plus audacieux et le plus meurtrier commis en Israël : il provoquait 23 morts. La technique des attentats-suicide, qui a pour modèle la technique des Tigres tamouls, est particulièrement redoutable. Comment le Hamas, par exemple, forme-t-il ses commandos-suicide ? Les recruteurs cherchent d'abord en milieu scolaire à distinguer les éléments les plus aptes à se dévouer. C'est auprès de ceux-là qu'est porté, après enquête sur leur famille, l'effort d'endoctrinement, l'exaltation de la cause, la responsabilisation, etc. Une fois le sujet jugé prêt au sacrifice, celui-ci est amené à l'annoncer devant le noyau de son organisation, à l'égard duquel il est désormais engagé. Celui qui va s'immoler en tant que martyr est déjà traité en héros de la cause et se trouve en quelque sorte tenu de s'exécuter, sauf à rompre complètement avec ce qui est devenu son milieu et comme sa famille. L'attentat-suicide qui est imparable, une fois le sacrifié à pied d'œuvre, n'empêche pas des groupes bien organisés et cloisonnés comme le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) de réussir d'audacieux attentats ciblés, tel l'assassinat en octobre 2001 d'un ministre du gouvernement Sharon en réponse à l'assassinat d'un des principaux responsables du FPLP l'année précédente. Ce cycle répression-attentats fait obstacle à toute ouverture de négociations afin d'aboutir à la création d'un État palestinien viable, et c'est le but du gouvernement Sharon qui a pour priorité le renforcement des colonies en Cisjordanie.
Le conflit du Cachemire est le plus ancien des conflits existants à l'heure actuelle puisqu'il est constitutif à la partition de l'Inde (1947) et source de deux guerres entre le Pakistan et l'Inde (1948, 1965). Après avoir aidé les Afghans qui luttaient contre l'intervention soviétique (1979-1989), le Pakistan a largement contribué à épauler la guérilla au Cachemire au début des années 90 mais celle-ci a été, pour l'essentiel, si affaiblie par l'armée indienne que les militants luttant pour l'indépendance du Cachemire (ou ceux luttant pour son rattachement au Pakistan) ont dû se contenter d'attentats à caractère terroriste. Au fil des années, les Cachemiris ont été de plus en plus soutenus par des islamistes radicaux, pakistanais ou non, venus combattre avec leurs coreligionnaires contre les Indiens. En 1999, l'armée pakistanaise lance officieusement une offensive sur les contreforts montagneux, à Kargil, destinée à internationaliser le conflit. C'est un échec et la modération dont fait preuve l'Inde affaiblit la position internationale du Pakistan et tend à distendre ses liens avec les États-Unis à l'heure où ceux-ci condamnent la nucléarisation des deux protagonistes. Bientôt, l'armée pakistanaise prend le pouvoir, provoquant des mesures de rétorsion économique qui ne sont apurées qu'au lendemain du 11 septembre 2001, lorsque le général Musharraf décide de se joindre à la coalition formée par les États-Unis. Les attentats ont repris avec violence à Srinagar, preuve que le Pakistan entend monnayer son alliance avec les États-Unis, au détriment d'une Inde quelque peu marginalisée depuis l'intervention américaine en Afghanistan. Les activités à caractère terroriste ont certainement des perspectives pour une durée indéterminée au Cachemire.
Les Tigres tamouls du Sri Lanka sont à l'heure actuelle la plus redoutable des organisations dites terroristes. En fait, techniquement, il s'agit, comme par exemple dans le cas du Hezbollah, d'une organisation politique menant des opérations de guérilla et pratiquant à la fois le sabotage et les attentats terroristes. Le LTTE est même capable de mener des actions frontales contre l'armée, ce qui, au cours des décennies passées, n'a été le cas que des Vietnamiens et des Érythréens. Ce qui caractérise les Tigres tamouls est l'accent absolu mis sur le sacrifice. Celui-ci n'a pas de connotation religieuse, le mouvement, bien que représentatif d'une minorité (10 %) de Tamouls qui sont des hindouistes dans un pays bouddhiste, est laïc et son idéologie est un nationalisme à toute épreuve ainsi qu'une dévotion à son dirigeant, Prebarkaran, créateur du mouvement. Celui-ci s'est, au fil des années, débarrassé de tout mouvement concurrent et de toute personnalité pouvant lui disputer le pouvoir. Le sien est absolu. Les jeunes gens et jeunes filles - ces dernières sont proportionnellement nombreuses - après avoir rompu tout lien avec leur famille pour rejoindre le couvent militarisé qu'est le LTTE, reçoivent un endoctrinement sans nuance et une formation militaire durant six mois. Après cette période, tous portent une ampoule de cyanure au cou avec pour ordre de se suicider plutôt que de se rendre. Les éléments les plus motivés sont destinés à faire partie des opérations-suicide. Ceux-là, une fois l'opération soigneusement préparée par une logistique appropriée, passent à l'action avec des chances de succès considérables, personne dans le groupe ne sachant qui va commettre l'attentat. Sur près de 200 attentats, les Tigres tamouls en ont raté moins de 10 et on compte parmi leurs victimes le dirigeant indien Rajiv Gandhi, un président du Sri Lanka, nombre de ministres ou de gouverneurs, etc. L'actuelle présidente a échappé de peu à un attentat (elle y a perdu un œil). En 2000, les Tigres tamouls réussissent un coup de maître à l'aéroport de Colombo en détruisant plusieurs avions militaires.
Depuis 1993, les islamistes radicaux occupent la première place en matière de terrorisme transnational. En février 1993, le premier attentat contre le World Trade Center, qui fait 6 victimes, est raté par rapport à ses objectifs mais indique déjà que les États-Unis, longtemps épargnés sur leur sol par le terrorisme transnational, sont infiltrés. L'attentat organisé par des islamistes radicaux avait pour but, à l'aide d'un camion chargé d'explosifs, de provoquer le maximum de victimes. Deux années plus tard, l'attentat perpétré contre le bâtiment fédéral d'Oklahoma était tout d'abord attribué à des islamistes avant que l'Amérique, atterrée, n'apprenne qu'il était l'œuvre d'un Américain d'extrême droite. Celui-ci provoqua 168 victimes et fut exécuté six ans plus tard sans avoir manifesté aucun remord, tant le rejet de l'État est total chez certains extrémistes.
L'année suivante, en juin 1996, en Arabie Saoudite, un attentat provoque 19 morts dans le complexe militaire américain. Depuis la guerre du Golfe, la présence de troupes américaines sur le sol de l'Arabie où se trouvent La Mecque et Médine, les lieux saints les plus révérés de l'Islam, était critiquée par les islamistes, Oussama Ben Laden en tête.
En novembre 1997, à Louxor, tandis que des touristes, surtout européens, visitent la Vallée des Rois, un commando d'islamistes égyptiens provoque en tirant à la mitraillette 62 morts et s'échappe sans encombre. En août 1998, deux attentats à la voiture piégée, tout à fait inattendus par leur localisation géographique, frappent deux ambassades américaines, à Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salam (Tanzanie), causant 224 victimes dont beaucoup sont africaines. Cette fois, le nom d'Oussama Ben Laden, déjà connu de ceux qui suivent l'évolution du terrorisme international, devient célèbre. Les États-Unis sont nommément visés. La réponse américaine se limite au bombardement d'un camp militaire (qui avait déjà été évacué) en Afghanistan et d'une usine de produits chimiques au Soudan soupçonnée de fabriquer des produits bactériologiques.
Oussama Ben Laden est bien connu des services américains. Issu d'une famille originaire de l'Hadramaout (Yémen), il est saoudien et milliardaire ; il arrive en Afghanistan dès 1980 et contribue à la lutte contre les Soviétiques. Puis on le retrouve au Soudan, lorsque ce pays devient officiellement islamique. En mai 1996, Ben Laden doit quitter le Soudan et il gagne l'Afghanistan. C'est l'époque où, avec l'aide très active des services pakistanais qui les ont entraînés, organisés et armés, les talibans s'emparent du pouvoir. Entre 1996 et 1998 se noue l'alliance entre les talibans, dont l'autorité suprême est le Mollah Omar et Ben Laden. Il s'agit d'une relation interactive : les talibans fournissent le territoire et les camps, Ben Laden leur fournit l'argent et les armes. À partir de 1998, Ben Laden prend le contrôle des camps d'entraînement et organise son réseau de façon à en faire une nébuleuse à vocation planétaire. Les deux attentats contre les ambassades américaines font pleinement prendre conscience à Washington du danger direct que représente désormais l'alliance entre le régime des talibans et Ben Laden. L'évolution de la menace islamiste s'est accompagnée du renforcement des moyens logistiques, en particulier dans le domaine financier. Bien que la responsabilité directe d'Oussama Ben Laden n'ait pas été officiellement établie, on attribue à son organisation, Al-Qaida, les attentats du 11 septembre 2001 à New York et à Washington. On sait que quatre avions des lignes intérieures ont été détournés par une vingtaine d'hommes, dont nombre de ressortissants saoudiens, et que trois de ces avions contrôlés par des commandos-suicide se sont écrasés à peu d'intervalle sur les tours jumelles du World Trade Center à New York et sur le Pentagone à Washington. Le quatrième avion détourné a, selon toute vraisemblance, été détruit en vol par l'armée américaine.
Le choc psychologique de ces attentats a été considérable, non seulement aux États-Unis, mais à l'échelle mondiale. D'emblée, l'idée d'une riposte a été avancée et très vite les accusations se sont polarisées sur les réseaux d'Oussama Ben Laden et le régime des talibans qui abrite les islamistes radicaux.
En très peu de temps, l'impact des attentats se faisait sentir, du point de vue économique comme du point de vue politique. La présidence de Bush Junior avait commencé par une volonté de retour à l'isolationnisme, symbolisée par la recherche d'un bouclier antimissile sanctuarisant les États-Unis. Les alliés avaient le sentiment d'être traités avec arrogance. Du jour au lendemain, la nécessité d'organiser une riposte amena les États-Unis à rechercher l'appui de leurs alliés et à mettre en place une coalition aussi large que possible. Les attentats du 11 septembre, pour audacieux et inattendus qu'ils soient, restaient des attentats terroristes classiques. Ils rééditaient, avec des avions, la technique de l'attentat-suicide des camions de Beyrouth en 1983. Le modèle tamoul, qui avait largement démontré son efficacité, était repris cette fois, et c'est sans doute ce qui constituait l'aspect le plus marquant, sur le terrain de l'adversaire. L'attentat avorté du World Trade Center de 1993 avait été un signe précurseur dont les services américains n'avaient sans doute pas suffisamment tenu compte. De l'avis général, les agences américaines ont, depuis des années, négligé l'infiltration et se sont reposées sur le renseignement technologique. Le retentissement des attentats tient au fait qu'ils ont eu lieu aux États-Unis, qu'ils ont touché de façon spectaculaire des sites hautement symboliques et qu'ils ont fait un nombre de victimes encore jamais atteint par le truchement du terrorisme non étatique.
Obnubilées depuis l'attentat au gaz sarin de Tokyo (1995) par le "terrorisme de destruction de masse, auquel étaient réservés tous les crédits de recherche, les autorités américaines sous-estimaient les possibilités du terrorisme classique, dès que celui-ci intègre la conception du commando-suicide. Peu après les attentas, cependant, apparaissait une menace nouvelle d'origine biologique : l'anthrax, "maladie du charbon véhiculée par une poudre blanche. Les premiers touchés furent des professionnels des médias, par le biais de courriers. Ensuite ce furent les institutions politiques. Les auteurs de cette campagne ne sont pas encore connus mais, une fois encore, il ne s'agissait pas de terrorisme de destruction de masse. Quatre morts au début de novembre 2001 et moins d'une vingtaine de contaminations sérieuses démontraient que l'impact psychologique de la campagne était très au-dessus de ses effets physiques, ce qui est la définition même du terrorisme.
La riposte américaine vise essentiellement, en Afghanistan, à faire tomber un régime dont le pays s'est transformé en sanctuaire pour la formation militaire des islamistes radicaux désireux de participer, soit à l'échelle internationale, soit à l'échelle nationale, aux divers combats menés par cette mouvance. En cas de succès, le terrorisme islamique n'en sera pas éradiqué pour autant mais il sera sérieusement affaibli. Quant au but poursuivi par les auteurs des attentats, il était de provoquer une riposte américaine, dont la conséquence souhaitée était la chute de divers régimes, surtout arabes (Arabie Saoudite, Égypte, etc.) sous la pression de la colère des masses musulmanes.
Les États se doivent de prendre les mesures appropriées pour faire face à toutes les formes de terrorisme, aussi improbables soient-elles. Veiller à la protection des sites sensibles, qu'ils soient chimiques ou nucléaires. Renforcer, particulièrement aux États-Unis, le contrôle des laboratoires où sont manipulées ou stockées des matières pouvant être utilisées dans le cadre du terrorisme biologique. À plus long terme, on envisage aux États-Unis (rapport Bauer-Cutler 2001) de réduire sensiblement le nombre des sites militaires, de coopérer activement avec les Russes pour contrôler les sites nucléaires russes et leur degré de sécurité, y compris en participant financièrement à ce programme. Enfin d'offrir aux spécialistes russes du nucléaire des contrats de recherche substantiels afin qu'ils ne soient pas tentés de travailler pour d'autres pays.
En dernière analyse, ce qui distingue les attentats du 11 septembre des actions terroristes des trente dernières années est la volonté, comme dans la tentative de 1993 au World Trade Center ou dans le métro de Tokyo en 1995, de faire le plus de victimes possible. C'est que dans le cas des islamistes radicaux que symbolise Ben Laden comme dans celui de la secte japonaise Aum, le terrorisme n'est plus une technique pour forcer une négociation dans le cadre d'un rapport de force inégal mais le vecteur d'une volonté de nuisance où il n'y a rien à négocier, l'hostilité étant absolue.