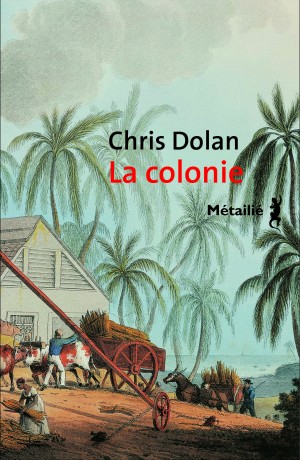Elspeth Baillie, jeune actrice écossaise, est choisie par Lord Coak, un énigmatique imprésario, pour jouer dans la troupe de théâtre qu’il veut créer dans l’île de la Barbade. Après un accueil flatteur de la part de l’aristocratie coloniale, sa vie dans les Caraïbes est bouleversée par le passage meurtrier d’un ouragan.
Elspeth est contrainte d’endosser un rôle ambigu dans le monde fermé d’une lointaine plantation de sucre. L’intendant, le Capitaine Shaw, s’emploie à construire une nouvelle Calédonie, peuplée d’émigrés écossais fuyant la misère du pays natal. Les espoirs d’Elspeth pour un nouveau monde plein de théâtre et de passion entrent en collision avec les drames trop réels et les amours illusoires de la vie coloniale. Elle devient prisonnière de la Colonie, cette entreprise dont le principe fondateur est la domination blanche.
Avec sa richesse linguistique et sa narration hypnotique pleine de retournements, ses personnages pleins de désir de vivre et de croire, le roman de C. Dolan interroge sur ce qui fait une nation. Les lignées ? Le langage ? L’Histoire ? Ou un idéal pour l’avenir ?
« La Colonie est un roman captivant et irrésistible. Les descriptions de la vie sur l’île sont vives, les personnages convaincants et la narration émouvante. » The Scotsman
« C’est un conte puissant et dérangeant, écrit avec une attention scrupuleuse à la fois pour les mots et leur sens caché ainsi que pour l’histoire d’hommes et de femmes forcés de vivre et de travailler pour une cause perdue et immorale. » The Independent
-
"Quelle frénésie réjouissante !" Lire l'article ici
Isabelle Montvert-ChaussySud-ouest -
"La Colonie fascine, et ne lâche pas son lecteur, saisi dès les premières pages. C’est un excellent roman d’apprentissage à la fois beau et terrible" Lire l'article ici
Webzine Café Powell -
"Un environnement magnifiquement décrit, des personnages multiples et complexes, une dénonciation du racisme et d'un nouvel esclavage économique." Lire l'article ici
Femme majuscule -
"On ne s’étonne guère que Chris Dolan soit aussi scénariste, car la narration menée tambour battant est très visuelle, et les personnages sont formidablement incarnés dans des scènes où la légèreté alterne avec un romantisme égratigné" Lire l'article ici
Aline SirbaOnlalu -
"Un roman au souffle épique, qui dérange et fascine." Lire l'article ici
Eliane GirardPrima -
"A l’heure où les romanciers se glissent volontiers dans la peau d’un autre (immigré chez Gunther Grass, Tête de Turc ou officier S.S. chez Jonathan Littell, Les bienveillantes), l’auteur Chris Nolan entre, lui, dans le corps/esprit/rôle d’une actrice, Elspeth." Lire l'article ici
Jane HervéFestival du livre et de la presse d'écologie.org -
"L'indigence culturelle se conjugue avec l'absence de lien avec la terre d'origine, l'identité se dilue, se recompose. Seules demeurent les blessures intimes qui n'ont presque plus de mots pour s'exprimer." Lire l'article ici
Robert MartinKeltia
Janvier 2012
Dans une vieille maison située dans le coin le plus reculé de cette île, j’ai trouvé le livre imprimé ci-dessous. Comment j’en suis arrivé à m’intéresser aux Rosies n’a que peu d’intérêt. Les petits blancs des Caraïbes forment un peuple en voie de disparition ; tant dans le sens de leur nombre décroissant que dans celui de leur invisibilité. Lorsqu’ils sont seulement remarqués dans les rues, au marché ou dans une rhumerie, par leurs compatriotes ou par un visiteur tel que moi, ils sont pris pour des touristes dépenaillés ayant peut-être passé une nuit dehors avant de retourner à leur hôtel en bord de mer pour se changer. En général, cependant, personne ne leur prête attention. Mais si les petits blancs sont indistincts, flous, les Rosies sont cachés et imperceptibles. En partie parce que personne n’a envie de les voir ; en partie parce qu’ils ne veulent pas être vus. Mais dans une île presque entièrement développée pour le tourisme leurs terres avaient de la valeur, ce qui explique comment j’ai appris leur existence. Un groupe de personnes vivant, oublié, sur un obscur et presque inaccessible cap de la Barbade.
Au début du mois de mars dernier j’ai emprunté un chemin pierreux envahi par la végétation qui menait à une vieille maison de plantation. Caché à côté de North Point, après le quartier écossais, le long d’un promontoire où la terre est constamment rongée par une mer puissante, se trouve Roseneythe. Au fil des années, ce domaine s’est vu presque entièrement coupé de la vie de l’île. La plantation des Rosies n’était plus viable, et c’est la communauté elle-même qui a lancé un appel d’offres pour ses quelques centaines d’arpents de terre, des champs de canne à sucre non rentables et la maison délabrée.
Mme Martha Ruddock, une vieille femme minuscule, bronzée au point d’avoir une teinte orangée alarmante tirant sur le cancéreux, m’a accueilli comme si j’avais été attendu. La maison était impeccable, à peine habitée. À la manière d’un agent immobilier professionnel, Martha m’a fait visiter, fournissant des détails sur les droits de propriété, les logements (il y avait une vingtaine de chattel houses mobiles en bois sur la propriété, cachées à la vue de la demeure principale par des arbres et une colline) et les équipements potentiels.
– Endroit impossible à viv’, mais ça vaut de l’or pour les margoulins.
Les fenêtres du haut offraient un beau panorama sur la propriété ; une jolie baie s’étendant au sud de la plantation et une zone boisée plantée apparemment deux siècles plus tôt. À part cela, le terrain était en grande partie plat. Martha avait raison – une aubaine pour les entrepreneurs. Idéal pour un complexe cinq étoiles, terrain de golf, sports nautiques. Je l’ai avertie qu’elle ne reconnaîtrait plus l’endroit une fois qu’ils en auraient terminé avec lui.
– Ils raseront les champs, les maisons, même cette colline là-bas… elle ne fera que les gêner. Ils creuseront tout le terrain jusqu’au plateau corallien, jusqu’à ce qu’il soit plat comme une crêpe. Ensuite ils le reconstruiront de fond en comble. Élargiront la baie. Démoliront la maison et en bâtiront une réplique en béton. Quand ces types auront fini, vous n’aurez plus l’impression d’être sur la même île.
Elle m’a emmené dans une vaste pièce, meublée d’une table et d’une vingtaine de chaises en acajou, impeccablement cirées. La pièce était restée inchangée, sans doute, depuis plus d’un siècle. Sur les murs s’étalait une série de portraits, peints, je le devinais, par un amateur. Les sujets – que des femmes sur les murs latéraux – étaient représentés un peu hâtivement, robes et châles baissés pour révéler des épaules roses. Elles avaient entre quinze et trente-cinq ans, toutes vêtues d’habits du dimanche de paysannes à la mode du XIXe siècle. Il n’y avait pas de signature d’artiste, pas de date, ni le nom des sujets.
– Elles nos ancêtres, c’est du moins ce qu’on m’a appris.
Chacune d’elles nous fixait depuis les toiles, avec le même regard dénué d’expression. Malgré les décolletés et les tentatives de petits sourires charmeurs, elles paraissaient toutes un peu rongées par les soucis : les plus âgées tendues, les jeunes pleines d’appréhension. La plupart avaient des cheveux châtain foncé, tirés en arrière, rassemblés sous un bonnet de toile blanc ; l’une d’elles était affligée d’une chevelure rousse d’une teinte particulièrement invraisemblable, et de traits communs frôlant la laideur. Elles avaient des visages d’une pâleur macabre, surtout celles qui étaient éclairées directement par le soleil entrant par la fenêtre.
Martha m’a raccompagné à l’autre bout de la salle.
– Sila c’est Lord Albert. Là-bas, le Cap’aine Shaw.
Elle est restée devant le portrait central.
– Elspeth Baillie, l’actrice.
Comme si j’avais forcément entendu parler d’elle.
Le gentilhomme titré avait d’épaisses lèvres humides et des paupières tombantes. Peut-être quarante-cinq ans. Ses vêtements semblaient dater d’une époque antérieure aux autres sujets. Le capitaine était mince, d’un âge indéterminé, en uniforme, monté sur un cheval. Un canasson si décharné qu’il ployait sous son cavalier, malgré la maigreur de celui-ci, voûté sur sa selle, la barbe en bataille et les vêtements tachés. Le poney était mené par un jeune garçon noir, un personnage à la Huckleberry Finn, affichant une expression de résignation totale.
La femme du milieu était la plus réussie de la collection. Du moins avait-elle été traitée avec plus de soin et de détails. Je suppose qu’elle était censée être belle – l’artiste l’avait avantagée en lui donnant des cheveux et des yeux plus brillants qu’aux autres. Un genre d’archétype de rose anglaise. Joues rougies, nez retroussé, lèvres pleines. Mais l’effet n’était pas des plus réussis. Aucun de ces portraits n’ajouterait de la valeur à la propriété. Mlle Baillie était assise sur une grande chaise à dossier haut, devant la fenêtre, avec la crique de Roseneythe qui s’étirait derrière elle en arrière-plan.
– Elle la mère de nou tout’. Ça l’est histoire vous entendez pas souvent. Une vie comme un conte.
Martha m’a conduit jusqu’à la cuisine où elle a ouvert une trappe dans le sol. Dessous se déployait un escalier en bois qui menait à une cave. Il y régnait une fraîcheur agréable et les murs avaient été replâtrés et repeints plus récemment que le reste. Une petite arche donnait sur une pièce exiguë, peut-être jadis un grand placard. À l’intérieur se trouvait une vieille écritoire, que Martha a ouverte pour en sortir deux livres. Elle en a posé un à l’écart, mais j’ai remarqué qu’il avait été écrit par un certain Alexander Kinmont. Le second, elle me l’a donné. Il n’y avait pas de titre sur la couverture en cuir humide et tachetée, ni même le nom d’un auteur. En l’ouvrant, j’ai vu que les pages n’étaient pas reliées, mais se résumaient à des feuilles volantes. Le manuscrit était écrit à la plume, d’une main délicate. Martha ignorait tout de ses origines, à part qu’il était là depuis sa naissance et de nombreuses années auparavant. Elle m’a permis de l’emporter.
– Comprenez, monsieur. Nou pas vréman au nord, et pas vréman au sud.
À mon retour à Bridgetown, je l’ai lu d’un trait. À la toute fin, le manuscrit était simplement signé “Jean Alexander”. J’ai passé les quelques semaines suivantes à le saisir sur mon ordinateur portable. Lorsque je l’ai rapporté à Roseneythe, Martha l’a rangé dans le bureau du sous-sol en disant :
– Petit jardin avoir mauvaises herbes plus tenaces.
1
Jamais il n’y eut de jour plus heureux pour Elspeth Baillie que celui où elle fut arrachée à son ancienne vie, la seule vie qu’elle avait cru possible, une graine à peine germée et transportée par-delà les océans pour être replantée à la chaleur du soleil. Elle qui n’avait été qu’une pauvre ronce rabougrie sur son sol natal : dix-neuf ans usants qui lui en avaient semblé quarante. Puis, à la veille de ses vingt ans, on l’avait déterrée et greffée sur une nouvelle vigne. Cette transplantation avait été effectuée par l’Honorable Lord Albert Coak : c’était lui qui avait retiré le mildiou et la moisissure qui s’étaient formés sur son âme, l’avait allégée et rendue à sa jeunesse.
La présence de cette éminente personnalité dans un port hostile – par chance la ville même qui accueillait Elspeth et sa famille – provoqua plusieurs jours de murmures, de suspicion et de magnifiques démonstrations de haussements d’épaules typiquement écossais. Ils avaient déjà leurs propres dandies, bien sûr, les bonnes gens de Greenock, mais ceux-ci étaient plus rustiques et déjà dépassés par rapport à ce nouveau venu. Le lustre de son costume sur mesure, son pardessus de laine bleu et la touche jaune souci sur son col, tandis qu’il se frayait un passage à travers la foule, ajoutaient une délicatesse d’aquarelliste au sombre tableau à l’huile de la ville. L’intrus circulait entre le bureau du capitaine de port, les locaux des agents maritimes et la raffinerie de sucre, achevant son après-midi de travail en tant qu’invité dans la splendide demeure d’un richard local plus commun. Il provoqua ensuite un considérable remue-ménage lorsqu’il réapparut, à dix-neuf heures tapantes, dans la salle de la Mission pour les Marins, où il prit une place pour “Une Soirée de Sketchs, de Chansons et de Monologues interprétés par M. Edward Baillie, sa femme Helen, sa fille Elspeth et divers nièces, neveux et cousins talentueux de la Troupe de Théâtre Baillie” – lesquels n’étaient eux-mêmes pas les derniers dans la famille des acteurs, et qui risquaient un œil de derrière leur rideau fait maison. Il s’assit seul dans le théâtre, attendant patiemment le début du spectacle, pendant que le reste du public demeurait à l’extérieur à boire et à se bousculer jusqu’au tout dernier moment, où personne ne pouvait plus repousser le divertissement.
– Qui peut-il bien être ? murmura la mère d’Elspeth, agitée.
– Fais pas attention à lui, répliqua son mari. Encore un de ces snobinards prétentieux qui s’esbignera longtemps avant qu’on ait terminé.
– Il a l’air plutôt à l’aise sur son banc, remarqua Elspeth. Peut-être qu’il vient du théâtre d’Édimbourg.
– On l’saura bien assez tôt. S’il s’extasie devant toi, on pourra être sûr que c’est pas le cas.
Elspeth s’éloigna de son père en effectuant une pirouette habile : son refus de reconnaître son génie ne l’offensait plus. Elle attendrait la fin de la représentation quand, comme cela se produisait après chaque spectacle, elle recevrait un déluge de compliments et serait entourée d’admirateurs, cependant que ses parents auraient l’œil à l’affût de mains baladeuses et l’oreille à l’écoute de propositions effrontées.
Comme toujours, le spectacle commença ce soir-là par les efforts des acteurs pour tenter de se faire entendre dans le chahut et le vacarme de la foule éméchée. Les doux vers d’une poésie d’inspiration gaélique devaient être hurlés à pleins poumons ; les déclarations d’amour subtiles de Messieurs Shakespeare et Scott n’obtenaient que des réactions salaces de la part des dockers assis aux premiers rangs ; les chorégraphies soigneusement élaborées se transformaient en piétinements, dans une tentative pour s’assurer un minimum d’attention. Elspeth s’en moquait : le gentilhomme distingué assis au fond restait immobile et attentif. Elle savait d’expérience qu’une fois que le répertoire de la soirée arriverait à son soliloque de Cléopâtre, le silence s’abattrait sur la salle.
Helen Baillie, en turban et tunique, déposa aux pieds de sa fille le panier contenant le joli reptile du Nil qui tue sans douleur. Un bouffon installé au dernier rang cria – comme quelqu’un le faisait toujours dans tous les publics d’Ayr à Musselburgh – “Moi aussi j’en ai un !” Et, comme toujours, le reste de la réplique de Helen Baillie fut noyé sous les rires. Mais Elspeth savait comment les gagner à sa cause. Elle resta parfaitement immobile. Pendant si longtemps que les spectateurs se demandèrent si elle n’avait pas oublié son texte, et ils se turent tous, mus par la curiosité. Finalement, elle fit trois pas lents et hésitants en direction du panier fatal. Elle tomba à genoux et dit dans un demi-murmure : “Et moi, me mangerait-il ?”
Elle leva les yeux, apparemment aveugle mais scrutant les visages devant elle, s’assurant que le gentilhomme était penché en avant sur son siège, ce qui était le cas. Elle s’agenouilla devant le panier du serpent et plongea courageusement le bout des doigts de sa main gauche dans le repaire mortel. Elle laissa échapper un cri des plus retenus mais garda héroïquement la main à l’intérieur, la ressortant enfin, dégoulinante de poison – en réalité, du lait caillé. “Je sens en moi des désirs impatients d’immortalité.” Elle se releva et, de la main droite, desserra les lacets de sa robe, laissa lentement tomber une goutte unique de son doigt entre les renflements de ses seins. Elle laissa le public reprendre son souffle avant de dépérir, de vaciller. Le public était en transe ; les plaisanteries et les querelles d’un instant plus tôt oubliées à la vue d’une belle et jeune reine à l’agonie et, mieux encore, qui laissait voir quelques bons centimètres de son décolleté.
À travers la suie visqueuse de la fumée des bougies, dans la pénombre de la Mission pour les Marins, Elspeth sentait le regard insistant du visiteur tout autant qu’elle-même le surveillait. Une chaleur sur sa peau par une nuit froide, comme si la lune s’était mise à chauffer. Les hommes l’avaient toujours fixée, bouche bée, quand elle marchait sur la pointe des pieds pour parader devant eux, vêtue de façon moins volumineuse – en fonction de la scène – que les femmes qu’ils avaient l’habitude de voir. Assurément, il y avait aussi du désir dans les yeux de l’élégant gentilhomme : elle devinait de l’attirance jusque dans les rangs du fond ; mais il y avait autre chose. Quelque chose de différent. Qui la vidait de sa substance. Son regard lui creusait les entrailles, comme le couteau d’une poissonnière, laissant un espace drainé, prêt à être rempli par quelque élément nouveau et inconnu.
Lorsqu’elle réapparut – après les applaudissements qui persistèrent pendant sa sortie et les deux bonnes minutes suivantes – pour chanter en duo avec son père La P’tite Bergère d’Aberlour, un refrain grivois composé dans sa jeunesse par Edward Baillie en personne, la foule fut stupéfaite de voir que la belle reine, qui à peine un instant plus tôt gisait, morte et pitoyable, était à présent transformée en une fruste fille de la campagne. Derrière son fard, son père regarda d’un œil noir les lacets desserrés de son corsage qu’elle avait omis de renouer, ainsi que ses clins d’œil et ses gestes théâtraux excessifs, mais personne ne prêtait attention à lui. Tous criaient pour encourager la bergère tandis qu’elle chantait ses peccadilles, et riaient à ses tournures de phrase indélicates. Mais même cette pièce grossière avait son finale mélodramatique, quand le fermier réprimandait sa fille pour son comportement coupable et qu’elle promettait de rester sage à tout jamais. Elspeth prit une voix brisée, une posture voûtée, et transforma l’histoire d’une femme repentie en celle d’une femme vaincue.
Elle n’eut pas besoin d’attendre que la troupe se fut rhabillée et eut quitté la salle pour tomber nez à nez avec l’homme qui – la rumeur avait désormais atteint les loges – était un seigneur du royaume, venu à Greenock pour le sucre, anglais et avec de l’argent à dépenser. Fut un temps où un tel personnage aurait immédiatement été traqué et poursuivi par son père, puis soumis à quelques vantardises à propos de ses propres talents. Mais Edward savait que ce temps-là était révolu et il faisait désormais des pieds et des mains pour éviter tout contact avec la promesse de ce qui aurait pu être. De sorte que, lorsque Lord Coak invita toute la famille à partager un pichet de vin avec lui, il haussa les épaules et laissa les autres le devancer.
– Tu sais très bien c’qu’il veut, cria-t-il à Elspeth, alors qu’il se débattait avec la cote de maille de Marc-Antoine qui ne lui allait plus.
“Bon sang n’saurait mentir”, aimait à dire sa mère, et Coak était la preuve de cet adage. Il s’entretint diligemment avec chacun des membres de la troupe, depuis les tantes Jessie et Nanie, qui accompagnaient leurs fils et filles en tournée et maintenaient en ordre la garde-robe familiale, à M. Nicol, de la Mission pour les Marins, le remerciant à profusion d’ouvrir ses locaux à des événements aussi agréables et importants que le théâtre et la chanson. Il complimenta les acteurs du plus jeune au plus âgé, gardant ses éloges les plus exubérants pour M. et Mme Edward Baillie. Il n’adressa qu’un hochement de tête en passant à Elspeth. Elle ne s’offusqua point du fait qu’il l’ignorât : il la réservait pour la fin. Elle le regarda faire son tour, s’incliner légèrement devant les personnes les moins importantes de l’assistance, sourire quand il le fallait, exprimer son agacement lorsqu’on l’attendait de lui, parlant le moins possible de sa personne, faisant peu de cas de la présence d’un lord en un lieu aussi humble. C’était un homme assez petit, un peu dégarni, avec une bedaine qui pointait sous son manteau telle une taupe cherchant la lumière du jour. Mais ses manières étaient taillées aussi délicatement que ses vêtements, et sa voix captivait – son accent, un mélange d’anglais de la haute société pour les voyelles et d’étrangeté coloniale pour les consonnes. Ce n’était pas un homme séduisant, pourtant il y avait chez lui quelque chose d’attirant, au-delà même de l’attrait de son statut. Elspeth aimait la modestie avec laquelle il avait infiltré la troupe, s’adressant à une personne à la fois, comme si c’était lui qui avait eu le privilège de les rencontrer.
Il passa un peu trop de temps, pensa-t-elle, avec sa sœur Peggy. Celle-ci en fit grand cas, multipliant les révérences, riant, haussant la tête pour mettre en valeur son cou élancé. Le gentilhomme lui donna une tape dans le dos, au grand plaisir d’Elspeth, car c’était là un geste ouvertement condescendant. Puis il se détourna brusquement de Peggy pour s’avancer vers Elspeth, de façon directe et inattendue. Il ne se présenta pas. Omit de lui faire poliment la conversation. Il ne s’adressa même pas à elle par son prénom. Il se posta simplement devant elle et déclara de but en blanc :
– Vous avez la faculté de trouver de la beauté dans le banal.
Elspeth fut prise à contre-pied par la soudaineté de son arrivée et la franchise de son compliment. Elle fit une révérence, lui dit merci, le rouge aux joues, et se reprocha son manque de préparation.
– Votre don est naturel, ma chère. Il a réussi à survivre à toutes les bêtises qu’on a pu vous apprendre. Accepteriez-vous de venir me voir demain ? Pouvez-vous trouver un moyen de le faire, pour le moment, sans que personne ne le sache ? Je vous l’assure, je souhaite vous entretenir uniquement d’affaires professionnelles.
Elspeth se surprit à hocher bêtement la tête. Les belles phrases qu’elle avait répétées pour cet entretien s’étaient envolées, le rejet travaillé de ses flatteries s’avérait inutile, et elle restait là comme une enfant qu’un oncle sévère a envoyée faire une course. Et pourtant il y avait de la chaleur dans les yeux de Coak, et son allure était aimable. Si elle était pour lui une enfant, alors c’en était une particulièrement choyée. Elle avait reçu des invitations similaires par le passé, mais celle-ci était dépourvue, pensait-elle, de toute inconvenance. Comme il lui donnait l’adresse de son logement et proposait l’heure de leur rendez-vous, elle éprouva à nouveau cette sensation d’être vidée de l’intérieur. Plus forte maintenant qu’il se tenait tout près et s’adressait à elle en aparté. Elspeth Baillie – la fille qu’elle avait été, la jeune femme qu’elle était à présent – se sentait réduite, comme de l’eau s’évapore sur un feu, drainée et prête pour la vie à venir.
Elle tourna les talons et quitta la Mission pour les Marins, la journée s’avérant exactement telle qu’elle l’avait espérée. Ce matin lorsqu’elle s’était levée, avant le lever du soleil, et longtemps avant que la présence d’un lord en ville ne parvînt à ses oreilles, elle avait vu par la fenêtre de la chambre de l’auberge où elle partageait un lit avec sa sœur et deux de ses cousines, une ondulation de lumière dans le ciel. Peut-être un feu qui luisait quelque part au loin, ou une trace d’aurore boréale. Mais Elspeth l’avait interprétée comme un signe. Elle avait déjà vu des signes semblables et était retournée se coucher à la fin de la journée en se demandant si elle n’avait pas manqué quelque occasion cachée. Pas ce soir. Le destin l’avait depuis longtemps dans sa ligne de mire, et désormais elle s’en remettrait entièrement à son pouvoir.
Où était la beauté dans la petite scène qu’elle jouait à présent ? Une pluie noire tombait d’un ciel boueux. Peut-être aurait-elle dû penser à la nuit comme à des braises encore chaudes, arrosées par les larmes de Dieu ? L’arbre contre lequel elle était clouée était dur et froid, ses feuilles, sous la lune souffreteuse, grises et humides. Un vrai poète aurait vu la scène différemment : des rameaux sur lesquels dansaient des elfes minuscules. Mais même un poète aurait eu du mal à faire de Thomas un héros fantastique. Peut-être, si jamais elle devait raconter l’histoire un jour, pourrait-elle décrire le garçon ahanant au visage rouge comme un ardent jeune prétendant, sa tunique et sa culotte comme l’uniforme honnête d’un conducteur de bestiaux convenable et viril ; ses yeux exorbités, alors qu’il tentait de couler un regard à l’intérieur de la robe qu’il arrachait, comme brûlants de passion, stupéfaits par la grâce de sa poitrine juvénile et innocente.
Le plus rare des dons, avait dit l’honorable gentilhomme. La faculté de trouver de la beauté dans le banal. Le destin s’était montré aimable avec Thomas ce soir, aussi. Le brusque échange d’Elspeth avec un lord l’avait laissée rêveuse.
Les ports de la côte ouest en pleines festivités débordaient de jeunes gens lubriques vêtus de chemises en flanelle d’occasion et de compliments usés. De marins dont la fortune serait dilapidée avant la fin de la nuit ; d’ingénieurs et de jeunes dockers qui espéraient que leur salaire tiendrait plus longtemps avec une actrice qu’au bordel. Dans une société pareille, Thomas était un prétendant aussi raisonnable qu’un autre, et elle le laissa l’entraîner dans le parc où l’on pouvait entendre d’autres couples anonymes se courtiser à la brune.
L’éternel dans l’éphémère. C’était ce que le gentilhomme avait dit. Un véritable gentilhomme. Dans des habits propres. Et une touche de parfum des plus subtiles – une teinture exotique qui, à ce qu’en savait Elspeth, pouvait aussi bien être l’odeur naturelle des bien-nés. Seuls les gens bien éduqués étaient capables de parler comme il le faisait sans l’aide d’un script. Un lord anglais, venu d’aussi loin que les colonies, dans le seul but de la trouver, elle, Elspeth Baillie, sur la scène du plus minable et du plus bordélique des théâtres à quatre sous. Un jugement pareil était, sans nul doute, digne de confiance.
Malgré ses efforts, cependant, elle ne parvenait pas à transformer un cul-terreux en cavalier, le gentil Tom en admirateur fringant. L’arbre ressemblait seulement à un arbre, et si les gouttes de pluie étaient des larmes, ce n’étaient pas celles de Dieu. Les mots d’amour que choisissait Thomas étaient loin d’être de la poésie : entre deux grognements, il employait les seuls noms qu’il connaissait pour désigner les parties du corps d’Elspeth et du sien, et ses intentions étaient décrites en termes humbles, quoique assez honnêtes. Le pauvre Thomas ne parvenait qu’à accroître le sentiment de vide qu’Elspeth éprouvait au fond d’elle. Elle avait pitié de lui, sachant qu’elle l’emmenait à l’orée de ses rêves pour le repousser ensuite. C’est pourtant ce qu’elle fit, et avec une certaine violence. Le garçon, surpris et convulsant dangereusement, ne put que laisser échapper un cri horrifié.
– Tom. Va voir Peggy.
– C’est pas Peggy que j’veux.
Le Très Honorable Albert Coak n’avait pas pour habitude – du moins, pas dernièrement – d’assister à des spectacles burlesques bon marché dans des Missions pour les Marins. Il s’était accoutumé au cours de ces dernières années à des spectacles plus civilisés et plus fastueux à La Scala, à l’Adelphi ou au Strand de Londres. Mais il s’était retrouvé tout seul en voyage d’affaires le jour de son anniversaire, et la famille Baillie proposait l’unique divertissement de la ville. Après une journée d’engagements pénibles – à parler tonnage de sucre et qualité de raffinage –, la perspective d’un humour grossier et d’interprétations maladroites le séduisait.
Contrairement à Elspeth, Albert n’avait pas vu de lumière particulière dans le ciel ce matin-là ; même s’il en avait vu une, il n’y aurait attaché aucune importance.
Alors qu’il s’installait dans la Mission pour les Marins, sa lassitude se fit plus oppressante. Ceci, assurément, ne serait pas – ne pourrait être – l’endroit où il trouverait ce qu’il cherchait. Si La Scala l’avait déçu, ainsi que Drury Lane, et si toutes les salles, aussi bien célèbres que populaires, de New York, Berlin et La Havane n’avaient pas révélé le talent qu’il cherchait, alors il doutait que Greenock pût venir à sa rescousse. Mais dès l’instant où cette fille avait posé le pied sur scène – en fait, un espace aménagé entre les chaises –, les yeux de Coak, et son cœur, s’étaient agrandis. Qui l’eût cru ? Et n’est-ce pas toujours la façon dont les choses que vous cherchez se trouvent dans le dernier endroit où vous regardez ? Il retint son souffle au moment où ses yeux se posèrent sur Elspeth Baillie, lutta contre sa propre incrédulité, refréna ses espoirs et demeura littéralement captivé pendant tout le reste de la soirée en tentant de se convaincre qu’il se trompait. Mais elle était bel et bien là devant lui – avenante, enthousiaste, plaisamment présomptueuse et sans doute abordable –, la meilleure candidate qu’il eût vue pour son projet. Après tant d’années passées dans d’innombrables théâtres et salles de concert, il avait vu des filles plus jolies. De meilleures actrices ou, à tout le moins, mieux rompues aux arts dramatiques. De meilleures chanteuses ; des comédiennes encore plus effrontées et sûres d’elles que la petite Baillie. Cependant sa voix était forte, et douce, et convaincante ; son jeu de scène étonnamment maîtrisé et pourtant, il en était certain, susceptible d’être amélioré par des cours particuliers. Et sa beauté, à mesure qu’avançait la soirée, le frappa à chaque instant comme de plus en plus remarquable. Il y avait eu par le passé des candidates dont le refus de son offre l’avait irrité : des chanteuses italiennes qui gagnaient ou avaient la certitude de gagner un jour plus qu’il ne pourrait les payer ; des Londoniennes qui n’avaient pas le désir d’échanger leur pays natal contre une colonie qu’elles ne pensaient faite que pour accueillir des détenus et des femmes déchues. Il était à présent heureux que ces femmes eussent décliné son offre. La voix fraîche et authentique qui insufflerait de la vie dans le théâtre des Caraïbes était enfin là, au milieu de nulle part, au fond de la gorge fine de la jeune Elspeth Baillie.
Il avait fait le nécessaire : s’était attardé dans cette misérable petite salle déprimante ; avait laissé ses lèvres toucher le “vin” qu’on lui avait offert et entretenu une conversation polie avec toute l’ennuyeuse famille Baillie, le père vulgaire et la mère faible d’esprit, les innombrables cousins, tantes et subalternes qui entouraient le joyau qu’il s’apprêtait à leur arracher. Certes, il aurait pu éviter toute cette fastidieuse entreprise, lui soumettre directement sa proposition et l’expédier par bateau dès le lendemain matin, son petit cœur frustré débordant de gratitude. Mais il n’était pas pressé. Le navire qu’il avait affrété dans la journée ne lèverait pas l’ancre avant presque un mois et, étant un homme prudent, il ne voyait aucune raison de ne pas vérifier la valeur d’une éventuelle acquisition.
Le lendemain matin, armé d’une longue-vue, il épia la famille, caché derrière un arbre dans un bosquet de peupliers à quelque distance de l’auberge du port que les acteurs avaient retenue. Il était Galilée étudiant les lunes de Jupiter à un million de kilomètres de là ; Napoléon à la tête de son Armée d’Orient repérant les insurgés du Caire. Et il y avait Cléopâtre parmi eux – évoquant plus encore la Reine du Nil ce matin, tandis qu’elle criait et se plaignait auprès de son père, de sa mère, de sa cousine et de sa tante, et tapait du pied sur les pavés du quai, que la veille au soir lors de sa scène finale. Son entourage s’affairait à sortir les costumes de la troupe, empilant chemises et robes, tuniques et toges, perruques et chapeaux, dans une carriole qui les acheminerait, ainsi que leurs propriétaires, à deux cents mètres du ferry qui à son tour les emmènerait jusqu’à leur prochain engagement, à Helensburgh, de l’autre côté de l’estuaire. La scène était délicieuse aux yeux de l’observateur : afin de se faciliter la tâche, chaque membre de la troupe portait une pile de vêtements, mais également des perruques sur la tête surmontées de deux ou trois chapeaux, drapait des manteaux autour de ses épaules et se fourrait des accessoires sous les bras. Il y avait donc un vieux cavalier arborant une perruque de juge et portant un mousquet de Manteau rouge. Une vieille femme affublée des boucles de Raiponce brandissait un cimeterre turc. Helen Baillie portait plusieurs fausses barbes autour du cou et une pile de tricornes sur la tête, tandis qu’elle avait une tête coupée sous un bras et un mannequin de taille réelle qui pendouillait sous l’autre tel un sacrifice. Albert se prit aussitôt d’affection pour eux, et d’autant plus pour Elspeth, exaspérée et qui, empourprée par l’effort et la colère, semblait encore plus théâtrale dans la vie que sur scène. Sans doute son exubérance dérivait-elle d’une dispute à propos de son insistance pour s’absenter, sans fournir aucune bonne raison, pendant une heure par une journée aussi chargée. Son excuse, il pouvait l’imaginer, serait naïve mais imparable ; cette fille ne le laisserait pas tomber, et il commençait à attendre impatiemment leur entrevue.
Lord Coak se comporta en parfait gentleman pendant la représentation privée. Il était assis à l’autre bout de la pièce et écouta attentivement sa Dame du lac – parfois, à la consternation d’Elspeth, fermant les yeux en signe d’appréciation juste un peu trop longtemps.
Le déplacement de la famille, suivi par la longue dispute avec son père pour la laisser s’échapper une heure, ce qui retarderait d’autant leur traversée en ferry jusqu’à Helensburgh, l’avait agitée. Personne n’avait été convaincu par le fait qu’elle fût tombée tellement amoureuse des paysages nordiques de la Clyde – un panorama que personne ne l’avait vue remarquer jusque-là – qu’elle devait absolument passer du temps seule à le contempler. Elle eut droit à toutes sortes d’accusations, la plus infâme venant de son père en personne, lequel n’avait aucune idée de l’endroit où devait se tenir son rendez-vous galant mais savait parfaitement qui elle allait y retrouver.
Son malaise s’accrut en arrivant au manoir d’un affréteur – un des associés de Coak – qui surplombait le port de Greenock, où on la traita comme une fille de cuisine venue demander une place qu’elle n’avait aucun espoir d’obtenir. Mais lorsqu’on la conduisit dans une pièce au mobilier raffiné, où son mécène l’accueillit par un sourire aimable, tout sentiment de trouble la quitta aussitôt. Comme la veille au soir, Lord Coak ne perdit pas de temps en préliminaires, mais entra directement dans le vif du sujet, lui demandant de jouer une petite pièce pour lui. Elspeth déclama les lignes d’ouverture du poème de Sir Walter Scott avec tout le rythme et l’émotion dont elle était capable.
– Harpe du Nord, toi qui fus longtemps négligée, suspendue à l’ormeau magique dont l’ombrage protège la source de Saint-Fillan !
Le gentilhomme colonial – aussi apprêté et immaculé que la veille – hocha la tête pendant toute la récitation, souriant ici, fronçant le sourcil là. Elle ne récita pas la pièce dans son intégralité – cela les aurait menés longtemps après l’heure à laquelle le ferry devait partir et, par ailleurs, cela n’aurait fait qu’augmenter ses risques de commettre une erreur. La version qu’elle déclamait avait été revue par son père, lequel y avait inclus autant de lyrisme, et autant de bataille et de mort, que le public pouvait en espérer. Elle termina courageusement, d’une voix forte et assurée avec une pointe infime d’accent gaélique dans sa diction, par des vers qui, espérait-elle, attireraient l’attention sur elle plutôt que sur l’héroïne de Scott :
– Tout annonçait en elle la fille d’un chef ; son snood de satin, son plaid de soie et son agrafe d’or.
Elle fit une légère courbette et s’aperçut que, maintenant qu’elle avait cessé de jouer, l’anxiété qu’elle avait ressentie au début était revenue. Lord Coak resta immobile, hochant silencieusement la tête pour lui-même, et regarda par la fenêtre le fleuve en contrebas pendant une période si prolongée qu’elle commença à se dire qu’elle l’avait déçu.
– Un talent inné. Si je puis me permettre, vous seriez surprise, mademoiselle Baillie, d’apprendre combien d’acteurs plus expérimentés sont incapables de transmettre leur aisance et leur joie de jouer devant un public.
Il se retourna vers la fenêtre au point qu’Elspeth se demanda si sa présence n’était plus requise. Au moment où elle se dirigeait vers la porte, cependant, il s’anima, levant un bras. Comme si, sur un brusque coup de tête, il lui demandait d’attendre un instant. Elle s’immobilisa, l’observant pendant qu’il se perdait à nouveau dans quelque pensée insondable. Enfin, il exprima ses pensées à haute voix :
– Je comprendrai si vous jugez ma demande suivante complètement déplacée. Vous ne devez pas la prendre pour telle et, si vous décidez de refuser, j’espère que vous ne penserez pas du mal de moi.
Lord Coak n’avait pas dans la voix d’intonation particulière exigeant de l’obéissance ; au contraire, il y avait une certaine douceur dans ses manières et ses paroles. Sa position et son titre, bien qu’imposants, ne lui donnaient aucune autorité sur elle. Elle sentit que c’était un homme timide – malgré ce qu’il s’apprêtait à lui demander – et sur lequel elle commençait à exercer un peu de pouvoir. Elle ne dit rien, mais prit un air attentif.
– Vous n’envisageriez pas, je suppose, de déclamer à nouveau les premières strophes, mademoiselle Baillie, mais cette fois-ci dévêtue ?
Il sembla, un instant, sur le point d’expliquer sa proposition indécente, puis il la balaya d’un geste de la main, se détourna à nouveau et la laissa décider sans autre incitation ni justification. Elspeth sentit le rouge lui monter aux joues, bien que sa gêne ne fût pas provoquée par un quelconque sentiment d’indignation. Elle aurait été plus scandalisée si un homme – quel que fût son rang – n’avait pas souhaité la regarder de plus près. Non, la difficulté de la tournure pas tout à fait inattendue de ces événements était plus une question de politique. Si elle accédait à sa demande, cela conduirait-il à d’autres avances non désirées ? Bien qu’elle n’y vît aucune objection, elle était peu disposée à devoir regarder à son tour une partie dénudée du corps du vieil homme. Mais surtout, si elle décidait de décliner, l’offre qu’il envisageait de lui faire tiendrait-elle toujours ?
Il attendit qu’elle eût fait un geste, remarquant que ce n’était pas en direction de la porte, avant de reprendre la parole.
– Les grands acteurs, ma chère, doivent se mettre à nu devant leur public. Vous ne devez voir aucune autre signification à ma suggestion – aussi étrange, je vous l’accorde, puisse-t-elle vous paraître.
Tout ce qu’elle avait fait était de passer d’un pied sur l’autre, mais de ce geste il avait déduit qu’elle réservait un accueil favorable à sa suggestion. Il le sut avant elle. En dépit de leurs différences, elle sentait que cet étranger la comprenait d’une façon dont elle ne se comprenait pas encore elle-même et savait qu’il avait parlé non pour la convaincre ou pour se défendre mais pour cacher le malaise qui s’installa entre eux lorsqu’elle commença à se dévêtir. Il la laissa faire sans couler un seul regard dans sa direction. Comme elle déboutonnait sa robe, elle décida de faire entendre sa voix.
– Je vous suggère, votre honneur, de vous reculer un peu plus dans la rotonde de la fenêtre pendant que je me tiens plus près de la porte. Vous pouvez m’assurer, j’espère, que personne n’entrera pendant ce temps ?
– Personne ne vous dérangera, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de cette pièce. Vous avez ma parole.
Tout en parlant, il se leva pour pousser son fauteuil si près des carreaux qu’elle craignit qu’ils ne passassent l’un et l’autre par la fenêtre. Elspeth se posta derrière la porte, et lui tourna le dos.
L’intimité, se dit-elle, retirant les lacets de sa chemise, était un luxe auquel les acteurs itinérants, qui s’habillaient ensemble dans des remises et des granges derrière les théâtres, ne devraient pas s’accoutumer. Cependant, en regardant maintenant ses dessous, une nouvelle inquiétude la fit à nouveau s’empourprer : qu’allait penser un homme aussi parfaitement vêtu de ses pauvres effets grisâtres et tachés ? Certes, sa mère avait toujours veillé à ce que sa lingerie et ses dessous fussent régulièrement frottés, mais ils étaient loin d’être neufs et immaculés. Il était trop tard pour faire demi-tour à présent, cependant ; elle pouvait seulement espérer que le fard qu’elle avait piqué ne la couvrît pas comme une allergie et ne cachât pas le teint délicat de fleur de cerisier de sa peau dont elle était si fière.
Lorsqu’elle fut entièrement nue, elle se retourna et regarda dans sa direction. Coak attendit un instant puis se tourna vers elle. Il garda ostensiblement les yeux au-dessus de son encolure, fixant même un point au-dessus de sa tête, ce qui donna à Elspeth l’occasion de l’examiner. Elle s’assura qu’il ne s’agissait point d’un imposteur : son visage tanné et ses cheveux rebelles témoignaient clairement de longs voyages et de pays chauds et lointains. Ses vêtements étaient accessibles uniquement aux nantis, et il n’y avait aucune trace du souffle altéré et de la rougeur de Thomas en présence de la chair féminine. Elle avait perdu ce sentiment naissant de pouvoir pendant qu’elle retirait ses sous-vêtements défraîchis, mais désormais nue, et alors qu’il regardait si résolument au-dessus d’elle, celui-ci lui revint. Elle laissa une faille s’ouvrir entre eux : elle ne commencerait pas son récital avant d’avoir son attention pleine et entière, aussi resta-t-elle droite et digne jusqu’à ce qu’il fût obligé de la regarder.
– Quand vous voudrez.
En entendant sa propre voix prononcer la première strophe du poème, elle s’aperçut que celle-ci était encore plus forte et plus magistrale qu’auparavant. Libérée des entraves des robes et des chemises, et pleinement consciente de n’avoir plus rien à enlever ni à perdre, elle limita ses gestes mais sentit chacun d’eux acquérir d’autant plus de grâce et d’efficacité dans leur retenue. Elle choisit de réciter d’autres vers au lieu de se répéter, gardant uniquement ceux qu’elle pensait mettre en valeur ses talents particuliers, et choisissant des phrases plus menaçantes extraites d’autres parties de l’épopée. Elle laissa les mots et les images grandir, pas tant au niveau du volume ou de l’émotion mais de l’intensité, et termina par un geste presque peiné :
– Ce ne sera pas en vain que tu m’auras inspiré ! Harpe du Nord, enchanteresse, réveille-toi !
Pendant tout ce temps, Lord Coak avait continué de veiller à ne pas laisser ses yeux descendre trop souvent ou de façon trop flagrante en dessous de son épaule et, une fois qu’elle eut atteint le finale, il parvint à afficher un sourire qui, soupçonnait-elle, masquait des larmes. Il applaudit discrètement et murmura “Bravo”.
– Votre élocution possède un rythme des plus exquis, mon enfant. Parfaitement naturel, et parfaitement remarquable.
Il poursuivit dans cette veine alors que chacun tournait le dos à l’autre, ses mots élogieux mais servant uniquement à combler le temps délicat pendant lequel elle se rhabillait et à préparer l’annonce qu’il s’apprêtait à faire. Il réitéra son point de vue selon lequel jouer revenait à se débarrasser des couches et des revêtements trompeurs, cette fois-ci, pensa-t-elle, avec une nuance d’excuse dans la voix. Lorsqu’elle eut achevé de retrouver sa décence – sa veste et ses jupes agrafées et ses chaussures en lambeaux à ses pieds –, les dispositions furent aussitôt prises pour lui assurer une place à bord d’un cargo jusqu’à l’île de la Barbade, un mois plus tard.