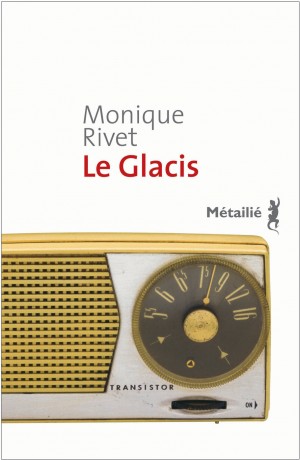« Le Glacis, au nord de la ville, c’était une grande avenue plantée d’acacias qui séparait la ville européenne de la ville indigène. Une frontière non officielle, franchie par qui voulait et gravée pourtant dans les esprits de tous comme une limite incontestable, naturelle, pour ainsi dire, à l’instar d’une rivière ou d’une orée de forêt.
Le temps où j’ai habité la ville était le temps de cette violence. Le temps de ce que le langage officiel déguisait d’un intitulé pudique : les “événements”, quand l’homme de la rue disait : la guerre. La guerre d’Algérie.
Ce pays, je ne lui appartenais pas, je m’y trouvais par hasard. J’y étais de guingois avec tout, choses et gens, frappée d’une frilosité à fleur de peau, incapable d’adhérer à aucun des mouvements qui s’y affrontaient. Cette guerre, je ne la reconnaissais pas, elle n’était pas la mienne. Je la repoussais de toutes mes forces. Si j’avais eu à la faire… – s’il avait fallu que je la fasse, aurais-je pu la faire aux côtés des miens ?
Je l’ai oubliée. Je ne suis pas la seule : nous l’avons tous oubliée, ceux qui n’ont pas eu le choix et ceux qui ont refusé de choisir ; ceux qui n’ont pas voulu s’en mêler et ceux qui s’y sont perdus. »
Laure a 22 ans lorsque, à la fin des années 1950, elle est nommée professeur de lettres classiques dans un lycée d’une petite ville de l’Oranais. Elle regarde ce monde dont elle ne possède aucun des codes.
-
« C'est avec une tendre naïveté que Monique Rivet, alors jeune femme insouciante et éprise de liberté, nous livre ses "événements" d'Algérie. Mutée dans l'oranais en tant que professeur dans un collège de filles, Monique Rivet va découvrir l'Algérie et son conflit que l'on n'ose pas encore nommer guerre. Son absence d'engagement et de parti pris dans ces "événements" auxquels elle ne comprend pas grand chose et qu'elle n'arrive pas à considérer comme siens, fera très vite monter des tensions. Les ragots deviendront de la délation et les relations amicales, un jeu d'alliance politique. Le roman de Monique Rivet brille par sa sobriété et son élégance. Un roman magistral et nécessaire. »
Emilie PautusLIBRAIRIE LA MANŒUVRE (Paris 11e) -
"Frontières visibles ou invisibles entre communautés, injonction tacite de prendre parti, méfiance au quotidien :
Voilà ce à quoi se heurte Laure, jeune enseignante parachutée en Algérie française pendant ses euphémiques "événements". Une guerre qui ne dit pas son nom et dans laquelle elle n'a pas sa place. Sans fard, sans détour, c'est dans une langue pure et au plus près du réel que nous parvient cette fiction précieuse aux accents de témoignage."Aline et Virginie -
« Le Glacis est une œuvre sobre et forte, dont le récit nous touche par ce qu’elle nous rapproche, bien au-delà de la guerre d’Algérie, des autres conflits qui ensanglantent la planète, aujourd’hui. Tous les acteurs de ce drame sont crédibles, intéressants, libres de toute caricature, et le personnage de Laure, un peu agaçant au début de l’histoire avec ses provocations un peu puériles –El Djond n’est pas le Quartier latin – finit pour nous émouvoir par sa sincérité et sa générosité : elle qui n’avait pas pris parti pour rien, s’était intégrée à rien et avait vécu dans un splendide isolement… »
Claude Amstutz -
« Le Glacis de Monique Rivet est un livre rare, qui traite de l’Algérie coloniale que l’auteur a bien connue puisqu’elle y était enseignante au milieu des années 50. En creux, on sent tout le poids de l’expérience vécue par l’auteur car ce texte, relevant plus du témoignage que du roman, a été écrit dès son retour en France. Elle l’avait gardé dans ses tiroirs jusqu’ici. Son héroïne est une grande naïve, qui se laisse entrainer par la complexité de la situation mais qui sait aussi s’affirmer et dire ce qu’elle pense, sans discerner ceux à qui elle ne devrait pas... Elle en paiera le prix. Nous espérons que l’auteur viendra nous parler de ce roman dans les prochains mois. »
Marielle Dy -
« Ce texte a été déposé sur le bureau d'Anne-Marie Métailié en juin dernier par une inconnue. Ecrit en 1955, son auteure n'avait jamais cherché à le faire publier. A une époque où employer le mot "guerre" était interdit, on peut légitimement se demander si ce roman (écrit de surcroît par une femme, chose très très rare) aurait trouvé un éditeur ? Et si cela avait été le cas, tout laisse à penser qu'il aurait été censuré. Toujours est-il qu'Anne-Marie Métailié, saisie par ce personnage de femme qui choque son entourage par sa franchise, et par l'expression de son incompréhension grandissante face à ce quelle voit et entend autour d'elle, a pris la décision de le faire découvrir aux lecteurs d'aujourd'hui. »
Florence Lorrain
-
« L’écriture colle admirablement au récit, au ton de la voix de cette jeune femme de 25 ans qui se pose des questions en un temps où cela n’était pas évident. » Plus d'infos ici.Noé GaillardSITE MURMURES MAGAZINE
-
Plus d'infos ici.Dominique ConilMEDIAPART
-
Plus d'infos ici.LE BLOG DE YV
-
Plus d'infos ici.MONTREAL 157
-
Plus d'infos ici.ACTUALITTE.COM
-
Plus d'infos ici.LE MATIN DZ.NET
-
Plus d'infos ici.L’Humeur VagabondeFRANCE INTER
-
Entretien avec Jean Lebrun à consulter ici.FRANCE INTER « La Marche de l’histoire »
-
« Le parallèle avec le monde contemporain et les territoires en rébellion ne cesse de s’imposer. »Christelle LefebvreVAR MATIN
-
« Ce roman passionnant est également un témoignage poignant. L’occasion de mieux comprendre l’absurdité de la colonisation, ainsi que le terrible conflit que fut la guerre d’Algérie. »David RoussetFORCE OUVRIERE
-
« Un livre porté par une indignation qui n’a rien de dépassée. »Fabien MollonJEUNE AFRIQUE
-
Plus d'infos ici.entretien avec Coline Hugel de la librairie La Colline aux livresPAGE DES LIBRAIRES
-
« Avoir 25 ans à Siddi Bel Abbès. » Plus d'infos ici.Philippe LançonLIBERATION
-
"Un regard neuf, impartial et troublant sur le verso d'une page douloureuse de l'histoire du post-colonialisme"Pierre ShaveyTHE LION
-
« Tout simplement bouleversant »Jacques LindeckerL'ALSACE
-
" Le roman de Monique Rivet, inspiré de sa propre expérience Algéreinne, livre un portrait subtil d'une jeune femme déboussolée dans une société coloniale et une guerre qui la dépassent.Agnès NoëlTEMOIGNAGE CHRETIEN
-
« Peu de femmes ont écrit sur la guerre d’Algérie … »Catherine SimonLE MONDE DES LIVRES
-
« A lire absolument, en priorité, la nuit. »Michel LeplayREFORME
-
« Magnifique roman, qui a valeur de témoignage, de document même, tant l’ambiance à la fois sensuelle et purulente de cette ville est retranscrite avec justesse ».Gilles HeuréTELERAMA
-
" Monique Rivet livre un pamphlet universel à l'encontre de ce qui doit toujours nous faire horreur".Luc MongeLA SAVOIE
EDITIONS MÉTAILIÉ, vidéo de présentation de l’auteur
-À bas la France ! Tu le comprends, ça, oui ou merde ? Alors tu le cries ! Crie, bordel !
Il le tire à lui par l’épaule, la veste usée se déchire. Alors il le renvoie comme une balle dégonflée. L’homme faillit tomber.
Christo cracha par terre.
-Laisse donc, dit-il à son camarade, tu vois bien que c’est une lopette.
-Je veux qu’il crie.
Ils se mirent à le secouer violemment. L’homme perdait l’équilibre, se rattrapait, voltigeait de nouveau, très maigre, pitoyable, avec des yeux affolés et ternes à la fois, se protégeant de son bras quand les coups menaçaient son visage.
Martin le lâcha le premier.
-Même pas le courage de ses opinions, dit-il avec mépris. Pourquoi tu cries pas, con ? Tu as peur ? Ça c’est vrai qu’il y a des tas de gens par ici, à bas la France, ils aimeraient pas. Même pour rigoler. Mais nous ça nous plairait de t’entendre dire ça, tu vois, histoire que pour une fois les choses soient claires. On en a marre de vos sales gueules d’hypocrites, hein, Christo ?
L’homme restait muet. Christo se mit à rire :
-Dix, non, quinze coups de pied au cul si tu cries pas, raton.
Ils avaient lâché l’homme, mais celui-ci ne chercha pas à s’enfuir. D’une bourrade Christo lui fit faire un demi-tour sur lui-même et lança à toute volée le premier coup de pied. Martin d’abord se contenta de compter : un, deux, trois… Puis il finit par se mettre de la partie. À chaque coup de pied l’homme trébuchait vers l’avant et, docile, faisait un pas en arrière pour se retrouver à la portée de ses persécuteurs, tassé sur lui-même, recroquevillé presque, comme s’il avait cherché à offrir le moins de prise possible aux coups. Mais il ne criait toujours pas.
Martin s’arrêta.
-Peut-être que vraiment il comprend pas ce qu’on lui dit.
Christo haussa les épaules :
-Tu parles ! C’est un têtu, c’est tout.
Et il le poussa violemment en hurlant soudain :
-Fous le camp, nom de Dieu, fous le camp, qu’on te voie plus jamais dans le coin, tu comprends le français, sale bougnoule ?
L’homme se redressa lentement. Il regardait les rues qui s’ouvraient devant lui en longs rayons noirs. Puis il se mit en marche. Il se dirigeait vers le glacis. Au-delà c’était ce qu’on appelait le village nègre. Des barbelés zigzaguaient dans la lumière de la lune.
C’était la nuit de Noël, peuplée d’hommes en armes. Dans toute la ville soldats et territoriaux patrouillaient. Il n’y eut pas de messe de minuit cette année-là et la plupart des réveillons se firent dans l’intimité des familles. C’est la guerre, me disais-je. Rien ne ressemblait à Noël sinon le froid de la nuit et un peu de neige rare que les caroubiers avaient gardé sur leurs feuilles vernissées et qui était comme un faux sourire d’un faux hiver, incongru de s’accrocher à des arbres restés couverts de leurs feuilles, et étrange sur les toits en terrasse faits pour le linge qui claque au soleil.
Il fallait contourner des flaques de boue glacée. J’avançais péniblement, chaussée de souliers trop fins. Devant la prison civile deux gardes armés me suivirent des yeux en silence. Il était tard. J’étais seule. Sur la place Carnot, pas une âme, pas un son. L’inquiétude me prenait. Je traversai le terre-plein aussi vite que je pus et m’enfonçai au hasard dans une ruelle. À l’approche d’un carrefour, un bruit de pas se fit entendre : je me cachai dans l’encoignure d’une porte, avançant un peu la tête pour voir qui arrivait.
Un sergent parut. Derrière lui un soldat, et puis un autre soldat, et deux autres de l’autre côté de la rue, main droite sur la mitraillette. Ils marchaient sans hâte, leur pas s’emboîtaient comme à la parade. La rue les avala. Je sortis de ma cachette, songeant que c’était bien la peine, toutes ces rondes et tout cet attirail, puisqu’ils ne m’avaient même pas vue, le sergent et ses hommes, dans cette encoignure d’où j’aurais pu surgir une grenade à la main. Quand j’écrivais à ma mère, je lui disais que je me sentais en sécurité à El-Djond et c’était vrai d’habitude, mais non ce soir, où pourtant on avait, paraît-il, doublé les gardes.
Sûrement ma mère pensait à moi en ce moment, elle se demandait ce que je faisais, où je réveillonnais, avec qui. Et moi je l’imaginais dans son appartement parisien. Pourquoi n’étais-je pas avec elle ? J’aurais pu. J’étais en vacances. J’aurais demandé une attestation de congé et on ne m’aurait certainement pas refusé un visa de sortie. Pourquoi ne viens-tu pas ? m’avait-elle écrit. Oui, pourquoi…
Je n’avais pas trouvé d’excuse. J’aurais pu lui dire : c’est parce que je suis sûre de revenir. On quitte au petit matin son pays, sa ville, on ne songe pas à se retourner sur eux parce qu’on sait qu’on les reverra. Et si l’on se trompait ? Si, revenant, l’on n’appartenait plus à ce pays, à cette ville, si l’on était désormais de nulle part, si ce qui nous attend, dans le lieu où nous allons, avait la force de détruire le passé ? Ou de ressusciter le mal qu’il a contenu ?
Une voiture arrivait derrière moi. Elle roulait au ralenti, ce qui d’abord me parut suspect, puis je me souvins qu’après le coucher du soleil il était interdit de rouler à plus de vingt-cinq kilomètres à l’heure. Elle me dépassa, sans que je puisse voir les gens qui étaient à l’intérieur. Je pressai le pas. Je m’étais un peu perdue, mais j’arrivais maintenant au Cercle militaire, où je devais retrouver Elena.
Au portail je fus arrêtée par une sentinelle qui me demanda avec un fort accent allemand ma carte d’invitation. Comme il me la rendait en saluant, je vis que les bâtiments du Cercle était entourés d’un cordon de soldats immobiles ; au milieu du jardin un lieutenant casqué était assis dans une jeep munie d’une antenne de radio.
-On est bien protégé, dis-je à la sentinelle.
-Mademoiselle n’a pas peur, répondit-il avec un sourire. Son… – Il chercha un instant le mot – … son plaisir est bien gardé.
Il faisait chaud et clair dans la grande salle du Cercle et il y avait foule. On dansait au milieu de la salle. Du bar Elena me fit signe. Elle était avec un grand diable de capitaine qui la dépassait de toute une tête.
Je me frayai un chemin jusqu’à eux.
-Eh bien, enfin ! dit-elle. Je commençais à m’inquiéter. Ne me dites pas que vous vous êtes promenée !
Elle fit les présentations : capitaine Géraud, Mlle Delessert. Le capitaine me proposa un whisky.
-Un jus d’orange plutôt, si vous voulez bien.
Je me hissai sur un tabouret à côté de lui. Elena le prit à témoin de ce qu’elle appelait mon imprudence : se promener seule en pleine nuit dans les rues d’El-Djond.
-Même moi je ne m’y risquerais pas, dit-elle.
-Pourquoi, même vous ? Comme si vous étiez moins en danger que moi dans les rues.
Mais je comprenais bien ce qu’il y avait derrière le même moi : cet instinct de protection qu’elle avait vis-à-vis des gens et qui faisait qu’elle se sentait en quelque sorte immunisée contre le danger, comme il lui semblait l’être contre la maladie : elle était médecin. Je lui souris avec amitié tandis qu’elle continuait à maugréer :
-On n’a pas idée ! Vous croyez toujours que vous n’avez pas quitté…
-Le Quartier latin, je sais, dis-je.
-Oui, je vous l’ai déjà dit… Je radote un peu, mais c’est que vous recommencez toujours les mêmes bêtises.
Pendant qu’on m’apportait mon jus d’orange, elle m’examinait d’un air d’approbation mitigée.
-Bon, finit-elle par dire, vous êtes à peu près nippée.
Je soupirai. C’était l’un de ses thèmes, la façon dont je m’habillais, ou plutôt dont je ne m’habillais pas, parce que, disait-elle, ce que vous avez sur le dos, c’est pour aller dans une salle de gymnastique, dans un stade, c’est le genre sport, on sent que vous vous en fichez complètement, bref… Quand elle ne concluait pas elle-même, je concluais pour elle : bref ce n’est pas féminin.
Le capitaine s’était détourné pour causer avec son voisin de bar. Je l’observai. Pourvu d’une curieuse petite tête d’oiseau sur un long corps maigre, il évoquait irrésistiblement l’un des êtres mi-humains mi-animaux des dessins de Grandville.
-Parachutiste ? demandai-je tout bas à Elena.
Il m’avait semblé voir l’écusson sur sa vareuse.
-Et alors ? fit-elle, agressive.
Je haussai les épaules. Elle eut un geste d’agacement.
-Si vous ne voulez pas voir des militaires, ne venez pas ici.
-C’est vous qui m’y invitez.
Elena fréquentait régulièrement le Cercle, elle s’y plaisait.
-Et puis, ajoutai-je, je n’avais pas le cœur d’être seule ce soir de Noël. J’aurais dû aller voir ma mère. Même s’il n’y avait pas la guerre, je crois que je ne l’aimerais pas, cette ville. Vous n’avez pas envie d’aller exercer votre métier ailleurs ? On a besoin de médecins partout.
-Non, je me trouve bien ici, j’y suis depuis dix ans, j’ai été bien accueillie, j’y ai mes patients, des amis. C’est vous qui ne vous y trouvez pas à l’aise. Pourquoi restez-vous ?
-Ah, moi, on ne m’a pas demandé mon avis pour m’envoyer ici. Je suis “nommée d’office”, je vous rappelle. Personne ne voulait plus venir, alors… De toute façon maintenant je me suis attachée aux gamines, je ne m’en irai pas : qu’est-ce qu’elles penseraient si je les plantais là en cours d’année ? Non.
Elena me regardait curieusement.
-C’est drôle, dit-elle, dès qu’il s’agit des gamines, comme vous dites… Ce sens de vos responsabilités, vous qui êtes si… si…
-Si égoïste, achevai-je en riant, dites-le. Eh bien oui, je ne savais pas du tout ce que cela allait être, comment cela marcherait. Et puis… je les ai tout de suite aimées. Je n’ai pas l’intention de les laisser, non.
Elena allait répondre, mais une petite femme brune se dirigeait vers nous d’un pas décidé, suivie d’un grand bonhomme large d’épaules, une peu gros, le visage tanné. Les Lebreau. Riches propriétaires, dont les terres et la ferme se trouvaient à quelques kilomètres de la ville. Ils n’y vivaient plus, mais Lebreau s’y rendait régulièrement, revenant le soir à El-Djond où ils avaient un appartement. Elena était leur médecin, comme elle l’avait été, au temps de la sécurité des routes, de tous les habitants de la ferme.
-Il faudra venir visiter la propriété, me dit Mme Lebreau. Je suis sûre que cela vous apprendra beaucoup de choses. Comme tous ceux qui viennent pour la première fois dans notre pays, vous avez certainement des idées toutes faites à notre sujet.
-Sûrement, mais si on n’avait que les idées qu’on se fabrique soi-même, on n’en aurait pas beaucoup !
Elle me regarda.
-La vérité est une femme qui danse, dit-elle.
Et comme je la regardais à mon tour avec étonnement, elle ajouta :
-C’est de Paul Valéry.
Elena souriait ironiquement, l’air de me dire : hein, vous êtes bluffée ! Ça oui, je l’étais. Quand les Lebreau nous eurent quittées, je l’avouai candidement.
-Elle lit Valéry, cette femme-là ?
-Ma foi, je ne savais pas, mais pourquoi pas ? Et vous, vous lisez Valéry ? Ça n’est pas votre rayon, les poètes ?
-Ben, en principe si…
Déjà Elena, répondant à l’invitation d’un colonel qui s’était incliné devant elle, s’engageait avec lui sur la piste de danse. Je me retournai vers le bar, me demandant ce que je faisais dans cette salle prétendument en fête du Cercle militaire. Mes pensées allèrent de nouveau vers ma mère. Elle dormait sans doute, maintenant ; j’ouvrais la porte de sa chambre et j’écoutais sa respiration, envahie par la tendresse, les larmes aux yeux.
Le capitaine à tête d’oiseau s’était tourné vers moi, son voisin l’ayant quitté, il me proposa un deuxième jus d’orange. J’acceptai le jus d’orange et le capitaine m’énuméra toutes les raisons que nous avions d’écraser la rébellion, avant de passer à l’exposé des moyens qu’il fallait y mettre.
Heureusement Elena revenait vers nous, flanquée du colonel, nous nous sommes mis à parler de la ville que le capitaine connaissait bien puisqu’il y était né et y avait sa famille. Je lui demandai si on y avait toujours connu cette ségrégation des communautés ou si c’était un phénomène dû à la guerre.
-La guerre ? Vous appelez cela une guerre ? Nous ne faisons pas une guerre, nous rétablissons l’ordre public. Quant aux communautés, si elles vivent séparées, c’est que cela leur convient, nous n’en avons pas fait une obligation.
Un peu plus tard, comme nous traversions le jardin pour sortir du Cercle, Elena me reprocha le mot guerre :
-Ici on dit les événements, au cas où vous n’auriez pas remarqué.
-J’aurais cru que le mot guerre n’était pas un mot, comment dire ?, outrageant pour des militaires. Je me trompe ? Vous les connaissez mieux que moi…
-Cessez de faire la maligne !
-Ah bon.
Derrière nous une voix lance :
-Alors on s’en va, mes poulettes ?
C’était l’assistante sociale, dite Biche, par abréviation de Bichonneau. Elle s’empare du bras d’Elena pour reprendre une conversation apparemment entamée un peu plus tôt au Cercle.
-Oui, je vous disais tout à l’heure, ils sont sur le point de rompre.
Elena affiche un air indifférent. Je dis à tout hasard à son adresse :
-Alors vous avez vos chances.
Mais Biche me coupe.
-Ah ça, ce n’est pas évident. S’il rompt, c’est sans doute qu’il a quelque chose ailleurs.
Elle avait dû y penser pour elle. Biche surveillait jalousement les femmes seules qui venaient au Cercle et particulièrement Elena, la quarantaine séduisante et qui ne se cachait pas d’aimer à séduire. Je me mis à rire.
-Je peux savoir ce qui vous prend ? demande Biche.
-J’étais en train d’imaginer la fin du monde.
La terre se fend, les arbres sont arrachés et soulevés dans les airs, les villes s’affaissent sur elles-mêmes. Et Biche est là, dans son petit coin près du bar où toutes les bouteilles se sont brisées, à se demander si oui ou non X va coucher avec Y, quelles sont les chances de Z ou les siennes, et moi je fais réciter rosa et dominus à des ombres pendant qu’Elena met des compresses à un cadavre.
-La fin du monde, dit Elena, pour un soir de Noël… Vous n’avez pas moins macabre ?
-Bah, le macabre est à la mode. Bon, qu’est-ce qu’on fait ? On s’en va ? Parce qu’on gèle dans ce jardin.
Biche proposa de nous ramener en voiture à nos domiciles respectifs. Je protestai que je n’habitais pas loin, que je pouvais rentrer à pied. “Il n’en est pas question”, déclara Elena avec autorité.
Nous passons devant la jeep où se trouve toujours l’officier en tenue de campagne que j’avais vu en arrivant et qui semble maintenant recroquevillé de froid sur son siège. Biche l’interpelle familièrement :
-Tout est calme ?
-Très calme.
Très calme en effet. La nuit nous ouvrait ses portes étincelantes d’étoiles, comme toutes celles qui avaient couvert de leur splendeur les crimes et les assassinats d’autrefois. Quel assassinat, quel crime la nuit d’El-Djond cachait-elle pour nous dans ses plis ?
Une autre nuit me revint en mémoire, celle où j’avais vu, depuis une fenêtre de train, scintiller les lumières d’un petit port italien allongé sur la rive d’un golfe. Nous étions sur la rive opposée, je remontais vers le nord. J’avais eu le désir de m’arrêter là, de renoncer à l’avenir pour une ville qui n’avait ni nom ni visage et qui offrait, me semblait-il, à mes chimères un abri contre les cruautés du monde.
Les lumières disparurent. Nous courions après l’aube, je rentrais chez moi : le rêve était terminé.