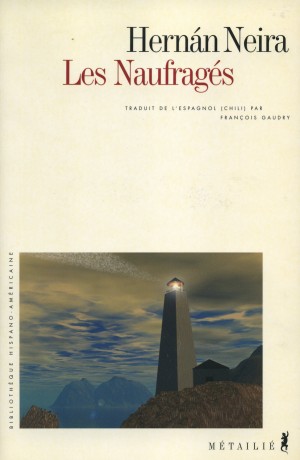"Je me souviens que j'étais encore un enfant, un jeune enfant, lorsque mon père m 'avait dit: si tu t'embarques, je te coupe une jambe! Il voulait à tout prix me trouver un travail à terre et me transmettre sa haine de la mer, cette haine qu'éprouvaient ses frères et toute sa famille devenus pêcheurs parce qu'à la campagne il n'y avait plus rien à manger."
Devenu gardien de phare sur une île perdue dans les brumes, le jeune homme s'éprend de Mareika, 1'une des filles de l'étrange communauté taciturne qui vit en autarcie sur l'île. Oublié du monde, confronté à des crimes qui ne le concernent pas mais le terrifient, le jeune couple parvient à s'évader de l'île, cherchant à échapper à un destin inéluctable.
Le monde extérieur se révèle aussi hostile et étranger que celui qu'ils ont fui et dont Mareika reste prisonnière.
Un roman au style lyrique où résonne subtilement un écho d'un monde conradien.
" Beau, étrange et inquiétant, ce texte nous offre une merveilleuse description de la nature abrupte du bout du monde." Luis Sepúlveda
-
Sur une île, Ameland, un jeune gardien de phare. Sur cette île, une communauté vivant en autarcie avec son lot de lois. Et Marieka, la fille de l'ancien gardien de phare. Très vite, ils vont s'aimer, puis s'évader.
Revenons aux îliens : ils sont là depuis le naufrage de l'Ameland, il y a longtemps, survivants, arrachant leur pitance à la mer. Cette île est une bande de sable où il faut s'enterrer pour combattre le froid. La mort est partout : meurtres, infanticides, impuissance sexuelle... Lorsque des ouvriers vont débarquer pour construire le phare, il y aura une forme de socialisation. Presque le début d'une autonomie et d'un échange avec les autres, les non-îliens. Mais ça ne durera pas.
Pour Mariera et son mari, l'arrivée sur le continent sera le révélateur de la folie latente de la femme. Le couple retournera à l'Ameland, l'île vampire qui assèche les coeurs, les corps, les esprits. Pour le couple, par-delà l'amour il y a le silence, l'évite-ment, la haine qui cimentent cette symbiose pathologique.Georges Daburon
-
"C'est un bref roman dont les premières phrases donnent le ton d'une extrême violence implicite et explicite: "Je me souviens que j'étais encore un enfant un jeune enfant, lorsque mon père m'avait dit: -Si tu t'embarques, je te coupe une jambe. Sa voix était claire et grave, et j'eus peur, moi qui ne lui arrivais pas à la taille." Le narrateur s'embarquera. Il y a beaucoup de naufragés dans ces Naufragés dont l'auteur est né en 1969 et enseigna à l'Institut d'études politique en France avant de le faire maintenant à l'université australe du Chili. Le titre original du livre est Ameland et Ameland est une île, quoiqu'une île épouvantable. "Bien que la mer et le sable soient éternels, Ameland avait une histoire", et, depuis l'origine, cette histoire est faite de naufragés, au sens propre, qui devinrent les premiers "îliens", les premiers humains, du moins, d'un lieu abandonné à des animaux on ne peut plus sauvages. Le narrateur est un naufragé plus psychologique, c'est pour avoir débarqué dans l'île qu'il sera à la dé-rive. L'histoire Ameland ne demeure pas dans la mémoire des terriens, ainsi qu'il le constatera quand il sera redevenu l'un d'eux, mais ne disparaîtra au contraire jamais de l'esprit de ceux qui eurent le malheur d'y mettre les pieds. Y avoir découvert l'amour ne suffit pas à transformer positivement cette estimation. On pourrait dire que les Naufragés ressort de la littérature d'évasion, mais d'une évasion bien particulière. On n'échappe pas à Ameland, on ne guérit pas de son séjour là-bas. L'évasion n'est pas un morceau de plaisir, quand bien même un bateau vous recueillerait-il."Mathieu LindonLIBERATION
-
« H. Neira fait tant et si bien, baignant son roman dans une ambiance de folie qui s'installe progressivement, insidieusement, que ses pages se referment sur nous comme les portes d'une tour sans fenêtre. [...] Neira signe ici un roman étrange et beau, lyrique, teinté de fantastique. »P. HausbergLE SOIR
PARTIR
1
Je me souviens que j'étais encore un enfant, un jeune enfant, lorsque mon père m'avait dit:
- Si tu t'embarques, je te coupe une jambe!
Sa voix était claire et grave, et j'eus peur, moi qui ne lui arrivais pas à la taille.
Il voulait à tout prix me trouver un travail à terre et me transmettre sa haine de la mer, cette haine qu'éprouvaient ses frères et toute sa famille, devenus pêcheurs parce qu a la campagne il n'y avait plus rien à manger. Il m'interdisait de naviguer et quand il parlait de pêche, il ne racontait que des histoires de tempêtes, de noyades, d'averses de grêle, d'os brisés et de doigts gelés par un métier qui permettait à peine de survivre. Souvent, lorsque la famille se réunissait autour du foyer, je l'entendais proférer les plus terribles menaces.
Je ne suis devenu ni pêcheur ni paysan. Il se produisit un événement qui vint en aide à mon père, mais je ne saurai jamais si cette aide-là me fut bénéfique. Le gouvernement avait décrété la loi de l'enseignement gratuit et obligatoire pour tous. Quelques mois plus tard, le jour même où, bien décidé à contribuer moi aussi à nourrir ma famille, j'allais m'embarquer, un policier me fit descendre par la peau du cou de la chaloupe où j'étais monté et me conduisit à l'école. Mon père garda un silence sévère et ma mère fondit en larmes, mais ils comprirent que, pour la première fois, un membre de la
famille allait échapper à la malédiction de la mer, c'est-à-dire à celle de la faim.
Ni mon père ni ma mère ne savaient ce qu'était l'école, ils ne s'étaient jamais assis devant un pupitre. Je me sentais bizarre. J'étais le seul enfant de la baie à avoir abandonné la pêche; les autres, avec la complicité de leurs parents, s'étaient cachés pour échapper aux policiers. Je ne sais ce que l'école m'a inculqué, je sais seulement que mon père me fouettait pour que j' apprenne à lire, à faire des additions et des soustractions. Parfois, quand il s emportait, il brandissait les vieilles menaces, non pour m empêcher d'embarquer, mais pour m'obliger à étudier:
- Gare à toi si tu recommences je te flanque une raclée, me dit-il un jour où j'avais oublié de faire mes devoirs.
J'ai passé ces années-là sans comprendre pourquoi je devais écouter le maître; dans mon milieu, nous ne connaissions personne ayant été à l'école et qui m'eut servi d'exemple. C'étaient là des choses de la capitale, ou du port, et moi je n'avais jamais quitté cette baie lointaine et perdue. A l'âge où les jeunes maîtrisaient filets, caps et bateaux, à l'âge où ils se mettaient déjà à la barre et pilotaient des embarcations sous le regard de leur père, j'avais appris à lire mais le mal de mer s'emparait de moi dès que je posais le pied sur le pont d'un bateau.
Mon père mourut. Mes oncles se concertèrent avec ma mère et prirent une décision: je ne pouvais rester à l'école, je devais apprendre un métier et gagner ma vie sans plus attendre. Un jour, le sacristain me fit appeler. Les soutanes et les églises me faisaient peur. Je voulus m'échapper mais ce fut inutile. Ma mère, qui n'avait pas manqué une seule messe dans toute sa vie, m'empoigna par le bras et me
conduisit à l'église. Ils eurent une brève conversation que je ne me rappelle pas. Peu de jours plus tard, elle m'emmena sur le chemin, m'embrassa, versa quelques larmes et me fit grimper sur la carriole qui passait périodiquement par la baie. Un homme me hissa, elle m'embrassa de nouveau et je partis.
- Hue! lança l'homme aux chevaux, qui partirent au trot.
Je ne savais pas où on me conduisait et, de mon siège, je regardai fixement ma mère qui rapetissait au loin. Je fondis en larmes mais, bientôt, laissant la baie derrière nous, nous traversâmes une colline et je me mis à observer le paysage si différent de celui que je connaissais et que je contemplais pour la première fois. Je devais avoir dix ou onze ans, je ne sais pas exactement, je n'ai jamais eu de certificat de naissance. On me fit entrer dans un internat religieux où j'appris le travail manuel et dès lors je ne vis ma famille que pendant l'été. De cette époque je n'ai pas d'autres souvenirs, ils s'effacent tous jusqu'au jour où je fus séparé de mes camarades.
- Tu as l'air mûr pour l'École de la mer, me dit-on.
Je craignis qu'on ne fasse de moi un pêcheur, mais ce fut très différent. Je n'appris ni à glisser sur les vagues ni à lancer le filet, mais à laver vitres et miroirs, à tailler la mèche, à bien mélanger les huiles et à interpréter les signaux de secours. Je ne serais pas pêcheur: on avait fait de moi un gardien de phare. Quelques étés plus tard, à la fin des cours, un tirage au sort me destina à Ameland.
Tout le monde évitait Ameland. Située à une centaine de lieues du continent, cette île était, et est encore, entourée de bas-fonds, et le temps ne s'y comptait pas en années mais en marées. Sur le continent tout le monde connaît la durée des cycles, mais là-bas, en pleine mer, les uns parlent de mois, d'autres d'années, et il en est pour affirmer que les marées montent ou descendent au mépris de toute régularité. Ameland n'était pas seulement entourée d'eau mais de bancs de sable et, plus au large, d'une ceinture de récifs qu'aucune carte n'avait pu localiser avec précision. Les vagues les découvraient et les recouvraient sans laisser le temps de les franchir ni de jeter les sondes. Aucun bateau, fût-il à gouvernail mobile, ne pouvait s'approcher du rivage. Le sable rendant impossible la construction de quais, il n'y avait pas d'autre solution pour partir à la pêche que de haler les bateaux avec une remorque tirée par des chevaux jusqu'à atteindre un niveau de flottaison suffisant.
Les plus pessimistes affirmaient qu'il y avait des fosses et qu au milieu d'une faible déclivité, un tourbillon pouvait soudain creuser des cavités où hommes et chevaux étaient engloutis. Chaque retour et chaque sortie en mer s'effectuaient avec mille précautions, on sondait le sable avant d'y prendre appui. Dans ces instants-là régnait une grande nervosité. On prenait tellement soin des bêtes et des embarcations que, sur cette île, un cheval ou un bateau valaient plus qu'un homme. Les animaux paraissaient sacrés; le froid et l'inhospitalité de l'île, ajoutés à la rareté de l'herbe, rendaient difficile de satisfaire les besoins d'une jument quand elle mettait bas. Les bateaux étaient l'objet de la même vénération; Ameland n'avait pas d'arbres et pour construire la plus petite embarcation il fallait commander des planches sur le continent, une, voire plusieurs marées à l'avance.
Y revenir était plus difficile qu'en partir. Le gouvernail relevé, les bateaux dérivaient à la merci des vents et des
courants. Même de vieux pilotes avaient parfois du mal à garder le cap. Chargés de poissons, les bateaux naviguaient au-dessous de leur ligne de flottaison; sur ces immenses plages, cela signifiait toucher le fond à des centaines de mètres du rivage. Telles des baleines échouées, les chalutiers se traînaient laborieusement sur le sable, la coque craquait, on avait l'impression que le bateau se disloquait. Le déplacement constant des bancs de sable empêchait de tracer une route, ou simplement d'avancer perpendiculairement à l'île, et contraignait les pilotes à une approche tâtonnante comme si c 'était la première fois.
L'île était tout aussi inabordable depuis la haute mer. Les courants y étaient trop violents, seuls pouvaient les affronter les clippers ou des géants de quatre ou cinq mâts, dont les larges quilles leur interdisaient de s'approcher des immenses plages qui s'étendaient à l'infini. Les difficultés d'accostage étaient telles et Ameland offrait si peu d'intérêt que le continent et l'île, à force de s'ignorer, vivaient comme si au-delà de la côte n'existaient ni terres ni hommes. Mais la marée montait parfois beaucoup plus que d'ordinaire, si bien qu'une embarcation légère à gouvernail mobile, comme en étaient équipés les chalutiers du continent, pouvait, malgré les hasards de la navigation, aborder et surtout repartir.
C'est ainsi que je m'embarquai, un jour de marée haute, pour prendre mon poste à Ameland. A mesure que nous en approchions, le pilote relevait le gouvernail à l'aide d'une poulie fixée à mi-mât, ce qui lui permettait d'avancer sans toucher le sable à faible profondeur.
- Tu vas croupir là-bas, me dit-il. Regarde-moi, regarde comme je suis vieux. Je la connais, cette île, j'ai participé à la construction du phare. Quand j'y suis arrivé, j'étais jeune, mais quand j'en suis reparti, ma gueule avait tout d'un raisin sec et mes cheveux avaient blanchi. On me l'a dit quand je suis revenu, je ne m'en étais pas rendu compte. Et depuis, je n'arrête pas d'y aller, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours moi qu'on envoie quand il faut livrer de l'huile et des mèches pour le phare. Pendant des années je n ai rien vu de bon là-bas, ça ne m'étonne pas que l'ancien gardien ait voulu partir. Quand je l'ai débarqué ici, il était comme toi, les jeunes sont tous pareils, mais après... Je l'ai ramené sur le continent entre quatre planches. On dit qu'il est tombé du haut du phare et que depuis personne ne l'a remplacé. Tu savais, toi, qu'il n'y a jamais de volontaires pour Ameland?
J e n'eus pas le temps de répondre car un matelot s'écria:
- Vite, au travail! La marée redescend!
Nous chargeâmes les vivres, le bois, du fourrage, des barils d'huile et des rouleaux de mèche sûr des espèces de traîneaux que l'on utilisait pour mettre à l'eau les embarcations sur le sable en pente douce et que les chevaux halèrent jusqu'à la terre ferme. Une fois le déchargement terminé, nous revînmes sans tarder avec les bêtes pour remettre à flot le bateau dont la quille commençait à toucher le fond. Les hommes remontèrent à bord, le pilote hissa les voiles qui claquèrent au vent et mit le cap sur le continent. Je restai seul, immobile. J'étais dans l'eau jusqu'aux cuisses. Je portais mes affaires sur l'épaule, des livres contenant les instructions relatives à mon travail et les prévisions pour l'année prochaine. Ce n'était pas très lourd, mais mes pieds s'enfonçaient dans le sable et, dans l'eau jusqu'à la taille, j'avais du mal à avancer.
Personne n était venu m accueillir ni me saluer et j'entrai dans le phare sans avoir échangé un mot avec les îliens. Ma maison, au pied de la tour, en ciment, pierres et briques, était la seule à se dresser sur l'île; les autres, faites de boue, de sable et de peaux de bêtes, n'avaient pas de murs; c'étaient des espèces de cabanes enfouies sous des tumulus d'un mètre et demi à deux mètres de hauteur, couvertes d'herbes et de mousses pour conserver la chaleur pendant les mois d'hiver, c'est-à-dire la plupart du temps.
Ce que je craignais le plus était la solitude et l'absence de femmes. Étranger que j'étais à un passé que tous partageaient, mon isolement fut d'autant grand que l'île était dépourvue de collines et de bois où me cacher. Mais je pus le supporter; bien que mon père ne m'ait pas appris son métier, il m'avait transmis sa résistance à la solitude propre aux hommes de mer. Sur cette île régnait un ordre patriarcal. Il y avait peu de femmes et celles qui n'étaient pas mariées étaient déjà destinées à un mari choisi par les familles. Les relations, strictement cantonnées aux échanges, furent troublées par mon arrivée. Mes seuls biens étaient les vivres que j'échangeais contre du poisson. Les hommes ne tardèrent pas à me faire comprendre que je devais me tenir à l'écart des jeunes filles: "Elles sont occupées", "Elles travaillent"... "Laisse-les tranquilles", finit par me dire un homme sur un ton menaçant que je perçus parfaitement bien que j'eusse du mal à comprendre sa langue.
Je fus bien obligé de rester à l'écart. Je m'absorbai dans la contemplation du paysage en haut de la tour. A l'horizon gris et humide je vis rarement un bateau qui ne fût un chalutier d'Ameland. Je suppose que les grands voiliers passaient pendant la nuit et que je ne pouvais percevoir leurs faibles feux alors qu'eux voyaient ceux du phare. C'étaient comme des fantômes que je guidais depuis mon poste de travail sans jamais les voir. J'avais rêvé de voyages, de ports lointains, de navires énormes, de ponts recouverts de tapis, de salles de bal, de mâts comme des cyprès, et le gardien de phare et fils de pêcheur que j'étais ne rencontrait que de pauvres bateaux de pêche. Certains jours, le découragement me gagnait et j'en arrivais à douter de l'utilité des feux que j'allumais le soir.
Le temps passant, je remarquai parmi les femmes une solitaire qui faisait de longues promenades sur la plage, loin des bateaux et des pêcheurs. J'étais intrigué par son allure et son absence de relations amicales avec les habitants de l'île. Mareika, aux traits encore adolescents, aux chairs généreuses et aux grands yeux marron, le teint pâle, les cheveux châtains et hirsutes, paraissait moins encline à la volupté qu'à la méditation et aux grands silences. Je m'arrangeai pour que nos pas se croisent, mais au début elle m'évita. Je m'étonnai de ne pas là voir soumise à l'ordre patriarcal de l'île et qu'on ne fasse pas pression sur moi pour que je garde mes distances. Je demandai aux îliens qui était cette jeune fille, mais aucun ne voulut me parler d'elle ni me fournir d'explications. Un jour, par hasard, ou désespoir de nos solitudes respectives, je parvins à rompre le silence. Elle marchait sur la plage et je la suivis. Mareika pressa le pas. Moi aussi. Elle se mit à courir, de plus en plus vite, s'épuisant et m'épuisant. Plus elle cherchait à m'échapper, plus j'avais envie de l'atteindre, plus je la désirais. Je finis par la rejoindre et la saisis par le bras. Elle se débattit pour se libérer, mais en vain, je la serrais fermement mais sans violence. Elle comprit bientôt à mon regard que je ne lui voulais aucun
mal. Nous luttions en silence, sans cris, ni insultes, ni appels à l'aide. Brusquement elle cessa de résister et s'immobilisa. Nous nous regardâmes sans rien dire, elle fit mine de partir et je la laissai faire. Elle s'éloigna de quelques pas et s'assit sur le sable. Pendant quelques minutes je n'osai pas bouger ni parler, jusqu'à ce que, troublé, je m'approche d'elle