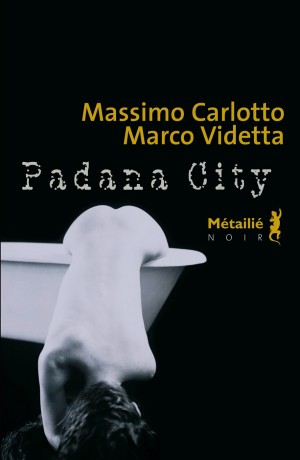A une semaine de son mariage avec Francesco, la belle et brillante Giovanna est assassinée par son amant et le crime maquillé en suicide. Avec l’aide d’un carabinier désabusé et de la meilleure amie de la morte, Francesco, jeune avocat promis à un brillant avenir, cherche la vérité. A sa suite, nous découvrons les secrets peu reluisants du triomphe d’une caste d’industriels, dans l’une des régions les plus riches et les plus dynamiques de l’Italie, le Nord-Est, la Padanie. Avec son cortège de pollution clandestine, de délocalisations sauvages, de trafics en tous genres, l’illégalité diffuse qui a permis l’accumulation de tant de richesse a corrompu jusqu’aux notables les plus à l’abri du soupçon. Jusqu’à des personnes très proches de Francesco…
Comme toujours chez Carlotto, l’intrigue se fonde sur une documentation sans faille.
-
« Un roman à conseiller à tous ceux qui aiment l’Italie et désire la découvrir sous un autre jour. »Laurence PatricBIBLIOBLOG
-
« Padana City possède ce souffle propre à la littérature policière italienne, qui ose regarder son pays dans les yeux et aller là où les journalistes ne vont plus. »
Mikaël DemetsEVENE.FR -
« Dans Padana City, la lutte des classes continue comme si le polar devait être le dernier refuge, désenchanté, d’un militantisme et d’un journalisme d’investigation devenus ringards en Italie. »
Roger GaillardLE TEMPS -
« Ce très visuel roman de la corruption ordinaire a été écrit à quatre mains par Massimo Carlotto auteur de plusieurs romans adaptés au cinéma et par le scénariste Marco Videtta, avec un sens consommé de la technique narrative – et de l’actualité la plus brûlante. »
Michel LoetscherLES AFFICHES-MONITEUR -
« L’Italie est minée par la mafia, mais combien d’autres pays le sont à des niveaux divers, combien de systèmes sont gangrenés par la corruption de l’argent ? Des questions essentielles, posées sans détour par ce polar. »
Luc MongeLA SAVOIE -
« C’est le portrait d’une drôle d’Italie que nous peint Carlotto. On sait bien qu’il s’agit d’un roman, de fiction. Tout y a l’air pourtant si vrai qu’on se prend à douter… »
Gérard ClavairolyMUTUALISTES -
« Au milieu des notables, avocats et autres bigots rongés par la corruption, le jeune Francesco aura bien du mal à prouver son innocence. Un sujet que Massimo Carlotto connaît bien puisqu’il a lui-même été injustement condamné pour le mettre d’une jeune femme à 19 ans de prison. »
Victor DillingerL’AMATEUR DE CIGARE -
« L’Italie du Nord qu’ils décrivent est parfaitement réaliste et fait froid dans le dos, autant que le beau livre de Saviana et le beau film de Martone, Gomorra, pour Naples. »
Paul Louis ThirardROUGE -
« Massimo Carlotto, en tandem avec Marco Videtta, met en scène dans Padana City un avocat balloté entre son sens de la dignité et l’incompétence de la justice, gangrenée par l’appât du gain et du pouvoir. »
Martine LavalTELERAMA -
« Le romancier Carlotto et le scénariste Videtta, associés ici pour la première fois, ont élaboré un thriller noir, très noir et très actuel, ancré dans le pire de la réalité italienne grâce à une documentation impeccable. Ça se situe en "Padanie", mais ça pourrait se passer n’importe où ailleurs, là où il y a des salauds capables de tout, y compris de tuer ou de ravager la planète, pourvu qu’ils s’enrichissent un peu plus. »
Jean-Claude PerrierLIVRES HEBDO -
« Adulé en Italie, Massimo Carlotto est un maître du polar. »
Alain LéauthierMARIANNE
Un mercredi comme tant d’autres
C’était un mercredi comme tant d’autres. Un mercredi d’hiver dans le Nord-Est. Toute la journée, les routes s’étaient couvertes de banlieusards et de camions. De longues files avaient engorgé autoroutes, nationales et départementales. A Padoue et à Vicence, pour la énième fois, le seuil de pollution avait été franchi. Le saut-de-mouton de Mestre était encore, en pleine nuit, un long serpent de poids lourds qui avançaient lentement dans les deux sens. De la marchandise légale et illégale qui allait et venait des pays de l’Est. Ce jour-là, quatre nouvelles entreprises avaient mis la clef sous la porte ; la plus grosse employait 51 personnes. Quatre nouveaux hangars vides avec l’inscription à louer, traduite en chinois. Ce matin-là, les hangars avaient été l’objet d’une conférence d’un prof d’urbanisme de la faculté d’architecture de Venise. Il avait expliqué à ses étudiants que, à force de construire 2 500 hangars par an, au moins 3 500 kilomètres carrés avaient été ôtés à l’agriculture et que, dans la seule province de Trévise, on comptait 279 zones industrielles ; une moyenne de 4 par commune. L’enseignant était préoccupé. Il avait affirmé que la dévastation du territoire était importante et profonde. Sans doute irréparable. Désormais, dans le Nord-Est, les hangars avaient effacé la mémoire de la terre et l’identité de ses habitants. Ce jour-là, c’est également d’identité locale dont il était question dans une autre université. Trois personnes sur quatre continuaient de parler le dialecte, y compris au travail. Une information réconfortante, avait-on dit, le dialecte représentant un élément de grande importance pour la cohésion de la communauté. D’ailleurs, de nombreuses expressions dialectales avaient été utilisées au cours d’un colloque qui s’était tenu au Musée de la chaussure de Montebelluna où avait été annoncée la délocalisation de 44 entreprises du secteur. La faute aux Chinois, avait-il été souligné. L’importation de Chine de chaussures en cuir avait augmenté de 700 % en un an. Le ministre de l’Artisanat avait souhaité l’introduction de lois antidumping pour endiguer le phénomène et la Coldiretti*, dans un communiqué, avait exprimé sa préoccupation devant l’importation sauvage de Chine de haricots secs et de légumes saumurés, lesquels représentaient des productions importantes dans certaines zones du Nord-Est. Ce jour-là, les Chinois avaient racheté des établissements publics et des commerces. Ils avaient payé comptant, comme toujours, sans discuter le prix. Ce jour-là, il avait été question d’argent dans d’autres rencontres où des représentants du milieu bancaire avaient constaté une augmentation positive des bénéfices trimestriels. Notamment de 262 fraudeurs du fisc, dont il avait été aussi question lors d’une conférence de presse de la brigade financière. Au cours d’une enquête, on avait débusqué 1 200 travailleurs au noir et 776 en situation irrégulière. Beaucoup d’entre eux étaient des étrangers sans permis de séjour en règle. Et la plupart des personnes arrêtées ce mercredi-là par les forces de l’ordre du Nord-Est étaient des étrangers clandestins. Depuis des années, les cultures criminelles en provenance de l’est et du sud de la planète s’étaient établies sur le territoire du Nord-Est italien ; la criminalité organisée n’était plus qu’un souvenir pour journalistes de faits divers. Ce jour-là, les prostituées, malgré le froid et le brouillard, avaient commencé de tapiner depuis la fin de la matinée sur les départementales. A cette heure de la nuit, elles avaient envahi les villes et les villages. Le secteur rapportait. Comme celui de la drogue, d’ailleurs. En revanche, la prostitution dans les discothèques et les boîtes de strip-tease était en crise. Les gérants des établissements de nuit avaient été les premiers à ressentir les effets de la récession économique. Les industriels et les professions libérales qui auparavant peuplaient ces lieux, dépensant des milliers d’euros par soir en champagne et en femmes, se montraient moins. Seule amélioration par rapport à l’année précédente, la production vinicole, dont les exportations avaient augmenté. Ce jour-là, des centaines de caisses de marzemino, de prosecco, de sauvignon et autres vins, avaient été expédiées aux quatre coins du monde. Sur le plan politique, l’avenir était plutôt incertain, malgré la réélection du précédent gouvernement régional. Ce jour-là aussi, il y avait eu des réunions et des rencontres confidentielles dans la majorité et dans l’opposition pour essayer de surmonter les divisions internes et les rivalités de pouvoir. On avait l’impression que personne n’était plus en mesure de gouverner l’avenir. Ce jour-là, c’était un mercredi comme tant d’autres. Passé la vingt-quatrième heure, le brouillard, épais et laiteux, dominait partout. Profitant de la trêve nocturne, le cœur du Nord-Est battait plus lentement.
“Elle arrive quand ? Il est presque une heure.”
La sculpture de cire qui prenait forme entre ses mains ne pouvait pas lui répondre, bien que la ressemblance, à force de travailler dessus, devînt chaque jour plus troublante. La lumière d’un spot tombait sur un visage de femme, très beau, presque parfait. Pourtant, il lui manquait encore quelque chose. Il lui manquait l’âme. Mais comment pouvait-il capturer son âme ? Ce n’était pas un sculpteur à la hauteur. A vrai dire, il n’était à la hauteur pour rien. Et puis, l’angoisse était en train de le dévorer, sa prothèse à la hanche refusait toutes ces heures debout. Même sa cicatrice pulsait sur sa joue, comme si, la nuit, elle se réveillait. Peut-être était-ce l’idée que dans neuf jours Giovanna allait se marier avec Francesco.
Il tendit une main vers la table de travail et serra entre ses doigts un des fers acérés qu’il avait mis à chauffer sur le fourneau à alcool. Il plaça le fer rouge sur l’orbite de l’œil droit de la sculpture.
Les yeux sont le miroir de l’âme et il avait envie de la creuser, cette âme ; encore fallait-il la trouver.
“Elle arrive quand ?” se demanda-t-il à nouveau, tandis que la cire grésillait au contact du fer rougi.
Le brouillard ne l’empêchait pas de pousser sa Mazda rouge au-delà de la vitesse autorisée. Giovanna connaissait cette route de campagne, elle la connaissait bien. Et ce n’était pas les virages qui l’angoissaient. C’était l’homme qui lui avait gâché la vie, qui avait fait d’elle une putain et qui l’attendait.
Un dernier virage avant d’arriver chez lui, pour la dernière fois. Son amie Carla avait raison. Elle ne pouvait se marier avec Francesco sans tout lui raconter. Mais comment le lui dire ? Qu’est-ce qui allait se passer ? Francesco voudrait-il encore d’elle ?
Alors que ces mauvaises pensées se propageaient dans son cerveau comme une métastase, la voiture prenait le dessus. L’idée de perdre Francesco était tombée comme un écran sombre entre elle et le pare-brise, et pendant un instant elle ne vit plus la route. Son cœur avait tressailli dans un remous, juste à temps pour ordonner à sa main le mouvement imperceptible qui l’avait remise sur la ligne droite, après la courbe.
“Regarde ta route, pauvre conne”, se dit-elle.
Chaussée d’élégants talons aiguilles, elle avait levé le pied juste à temps. La voiture avait ralenti d’un coup et son cœur aussi. Si seulement elle pouvait échapper à ses soucis avec la même facilité !
Mais après le virage, à la fin de la ligne droite, il y avait celui qui l’attendait. L’homme qui lui avait gâché la vie.
Une lueur dans le rétroviseur aveugla ses pensées. De nouveau son instinct la mit en garde. Les phares se déplacèrent à gauche, les vitres fumées d’une Cherokee se baissèrent et des cris sauvages l’assaillirent. Elle savait qu’elle n’aurait pas dû regarder mais elle ne put s’en empêcher. Juste un instant, le temps d’apercevoir une silhouette qui faisait de grands gestes dans le brouillard. Mieux valait ne pas accélérer, elle leur aurait fourni un prétexte pour engager une course, pour s’exciter davantage. Heureusement, elle allait bientôt arriver.
Deux cent mètres plus loin, elle s’était garée le plus près possible de la petite maison. La Cherokee s’était arrêtée de l’autre côté de la chaussée.
Encore une vingtaine de pas et elle serait devant la porte. Cinq minutes plus tôt, elle n’aurait jamais imaginé attendre de lui le salut. Ses talons glissaient sur le gravier. Avec ces chaussures, c’était comme escalader une dune de sable. Elle devait éviter de se retourner. Il n’y avait pas eu de portières claquées ni même de pas de course derrière elle. C’est seulement quand elle fut devant la porte qu’elle décida de se retourner. Les vitres teintées du 4¥4 avaient été remontées et peu lui importait de savoir si on l’observait ; il allait lui ouvrir d’ici un instant. Obscurité et brouillard. Elle sonna avec insistance.
–Giovanna, enfin te voilà, je m’inquiétais.
Sa voix à lui, si rassurante.
Elle entra et se laissa enlacer, plongeant son visage dans sa poitrine, dans son parfum.
Pendant un instant, elle ne s’était plus vue comme sa maîtresse, sa coquine à problèmes, comme il l’appelait, mais presque comme une gamine qui rentrait chez ses parents après une grosse frayeur.
C’est plus tard, quand il lui avait relevé le menton et qu’il l’avait embrassée sur la bouche, dans la bouche, que cette passion si autoritaire l’avait fait se sentir encore une fois perdue.
Sans rien dire, il l’avait poussée sur le lit et à présent il bougeait en elle, comme elle aimait. Il était fort, sûr de lui. Elle ne percevait pas chez lui l’angoisse de la satisfaire qu’avait Francesco. Lui, il prenait et il donnait. C’était ça, leur jeu. Mais ensuite il l’avait envoûtée et elle n’avait plus rien à donner. Elle savait quand même comment s’y prendre. Elle poussa de toutes ses forces pour se débarrasser de ce poids sur elle.
–Arrête ! J’ai pas envie, arrête, je te dis !
Il s’arrêta, la regarda droit dans les yeux et comprit.
Il se releva, la libéra de son poids et s’assit sur le bord du lit.
–C’est fini, c’est ça ?
Giovanna ne répondit pas. Elle appuya délicatement la pointe de ses doigts sur son dos nu.
Il acquiesça avec lassitude. Elle ne croyait pas que ce serait aussi facile.
Et pourtant, maintenant elle était là, dans son bain chaud, enveloppée d’un nuage de vapeur. Sans pensées, protégée dans sa niche liquide. Depuis toute petite, elle aimait prendre des bains chauds. Elle avait l’impression qu’il n’y avait pas de lieu plus sûr au monde. Le plus beau moment de la journée, c’était quand sa mère s’agenouillait devant la baignoire pour lui laver les cheveux, qui, à l’époque, étaient plus blonds et lui descendaient jusqu’au derrière. Sa mère l’appelait “ma petite sirène”.
L’enfance avait été la seule période vraiment heureuse de sa vie. Après, elle avait dû grandir vite sans avoir le temps de faire la distinction entre les hommes et les gamins, comme si son adolescence lui avait été volée. Des peluches à la maîtrise, ç’avait été un saut du plongeoir olympique sans avoir eu le temps d’enlever les brassières en plastique.
En ville, on disait qu’elle avait misé sur Francesco pour se faire une place dans les milieux qui comptent. En fait, Francesco lui avait restitué son adolescence. Mieux, il lui avait fait connaître l’innocence. Francesco avait été son dédommagement. C’est pour ça qu’elle lui dirait tout dès demain. Non pas pour se libérer d’un poids mais par honnêteté. Par amour.
Une fois, elle avait lu un haïku japonais : Prends le bien. Entasse-le sur un plateau. Répète l’opération avec le mal. Mets-les en balance. Quand les plateaux seront à niveau, tu connaîtras le poids de la vie.
Si Francesco réussissait à lui pardonner, leur vie serait comme certains dimanches quand on se réveille dans la tiédeur du lit chaud, que dehors il pleut et qu’on a tout le temps qu’on veut pour se prélasser ou pour se rendormir. On jouit de ses propres odeurs, on caresse sa peau lisse et reposée et on se sent heureux. Heureux de s’être réveillé.
L’eau refroidissait mais elle n’avait pas envie de sortir. Elle ouvrit le robinet d’eau chaude. Elle ferma les yeux, glissant dans une torpeur plaisante.
Sur le moment, elle ne comprit pas ce qui lui avait fait rouvrir les yeux. Un souffle d’air froid, un frisson sur la peau. La flamme des bougies oscilla.
Sur le pas de la porte, il venait d’apparaître en chemise. Heureuse, elle l’avait oublié pendant un instant. Il était resté dans l’autre pièce, assis sur le lit, sans parler. Sans la regarder. Elle avait espéré qu’il soit parti. Sorti pour toujours de sa vie. Quelle conne ! pensa-t-elle. Le Tavor qu’elle avait avalé avant le bain avec une bonne gorgée d’armagnac, voilà ce qui l’avait tranquillisée.
L’eau chaude continuait de couler et la baignoire était sur le point de déborder.
Il se pencha pour fermer le robinet.
–Tu t’étais endormie ?
Elle le vit s’asseoir sur le rebord, se retrousser les manches, se verser du shampooing dans la main. Elle sentit ses mains glisser délicatement sur ses cheveux.
“Comme maman” : la pensée surgit, absurde et incongrue.
Ses mains à lui, des mains fortes et soignées, parcoururent ses cheveux, qui étaient courts depuis longtemps maintenant, depuis qu’elle n’était plus une enfant, et descendirent le long de son cou, jusqu’aux épaules.
–C’est la dernière fois que tu me touches. Demain, je dis tout à Francesco.
Les mains se bloquèrent, mais sans abandonner les épaules.
–Comme ça, on arrête une bonne fois pour toutes.
Les mains s’attardèrent encore un peu. Puis, elles la poussèrent. L’eau avait un goût de sel et de jasmin. Elle n’imaginait pas qu’il avait autant de force. Elle parvenait à soulever la tête mais pas assez pour respirer à la surface. Il était entré dans la baignoire et avait appuyé un genou sur son sternum. Elle sentit l’air sortir de sa poitrine en formant des bulles. Ses yeux brûlaient. Ses mains glissaient le long des parois de la baignoire. Une jambe jaillit de l’eau. Saporedisalesaporedimare. Dieu sait d’où lui revenait cette chanson. Une douleur aiguë, le talon qui avait tapé contre le bord de la baignoire. Puis, plus rien, le noir les yeux ouverts. Les dernières bulles.
Et le râle douloureux de l’homme qui avait mis fin à ses jours.
La nuit, les petites gares sont désertes. A la place des hommes, désormais, il y a des machines qui gèrent le trafic et qui vendent les billets. C’est pourquoi il avait choisi le dernier train, qui arrivait de Venise. Personne ne l’attendait, personne ne pouvait même imaginer qu’il arriverait. Il était sûr qu’on ne le verrait pas. Et même s’il croisait quelqu’un, le brouillard se chargerait de le camoufler.
Dans ce brouillard épais, il se sentait comme une âme damnée dans un de ces cercles dantesques qu’il avait étudiés superficiellement, dans une autre vie. Il remonta le col de son blouson. S’orientant avec peine, guidé par son instinct, il lui semblait que toute cette vapeur jaillissait de lui. Il se souvint, à ce moment-là, de l’histoire du taureau. Il avait dix ans et il revenait de l’école. Un taureau lui avait coupé la route, qui devait s’être perdu et soufflait bruyamment tout en le fixant, immobile. Il n’avait parlé à personne de cette rencontre, mais pendant des années il avait eu la conviction que ce taureau était le diable et le brouillard son maléfice pour enlever les enfants en toute tranquillité. A présent, c’était lui qui soufflait de la haine. C’était lui qui avait besoin de ce brouillard pour agir en toute tranquillité.
Arrivé sur la place, il reconnut le profil du campanile et l’enseigne fluorescente du bar Central. Il laissa tomber par terre un sac gros et lourd, tourna lentement sur lui-même, laissant à sa mémoire le soin de voir chaque détail.
Le bruit d’une voiture le fit sursauter. Il ramassa son sac et courut se cacher sous les arcades. La voiture, une Cherokee, se mit à faire des tours sur la place. Des vitres baissées arrivaient les cris jeunes et excités. Puis, d’un puissant coup d’accélérateur, elle disparut dans le brouillard. Il sortit de sa planque et chercha une cabine téléphonique. Il en trouva une près du vieux kiosque. Elle était complètement dans le noir ; des gamins avaient dû s’amuser à casser le néon. Il tira de sa poche un briquet et une feuille, puis, à la lumière de la flamme, il lut un numéro. A l’autre bout du fil, la voix impersonnelle du répondeur ; elle n’était pas chez elle.
–Où est-ce que t’es, putain ? hurla-t-il.
Seule la crainte d’être découvert lui imposa de retrouver calme et lucidité. Il déambula sous les portiques comme un vieux rat qui désormais en connaissait un rayon en matière de survie.
J’étais réveillé depuis un moment mais la nausée m’empêchait de me lever. J’avais trop bu. Gin tonic et champagne. Je sentais encore le parfum épicé de l’entraîneuse sur mon cou et sur le menton. La matinée allait être difficile. Heureusement, je n’avais pas de plaidoiries, juste deux rendez-vous au cabinet. Je regardai le réveil digital pour la énième fois. Il me restait encore un peu de temps pour finir de cuver. Et après un café et une bonne douche bien chaude, je serais prêt pour une nouvelle journée de jeune avocat. Giovanna allait me demander comment s’était passé l’enterrement de ma vie de garçon que mes amis avaient organisé dans la seule boîte de la ville. En fait, elle voudrait savoir si j’avais fini au lit avec une des filles du Diana. Non, j’étais resté sage. La fête avait été un véritable désastre. Du moins pour moi. Davide et les autres s’étaient probablement amusés. Ils étaient pas mal défoncés. Ils étaient entrés et sortis de l’arrière-salle où un des Roumains qui travaillent dans la boîte tient toujours prêts des rails de coke, et ils avaient fait les cons avec les entraîneuses. La plus belle, une Sud-Américaine, je crois qu’elle s’appelait Alicia, ils me l’avaient poussée dans les bras, enrubannée comme un paquet-cadeau. “Elle est pas aussi belle que Giovanna, avait souligné Davide, mais il paraît qu’elle baise divinement bien.”
Elle s’était donné du mal mais j’avais fait attention à ne pas dépasser les limites. Je suis un Visentin et, comme me l’avait souvent répété mon père, il y a des choses que, nous, nous ne faisons pas. “Du moins pas dans le diocèse”, comme il avait ajouté en souriant.
Et puis, pendant la soirée, j’avais reconnu plusieurs personnes, la plupart de petits industriels au portefeuille bien garni. Certains étaient des clients de mon père. Constantin Deaconescu, le propriétaire du Diana, un Roumain à l’air louche, était venu me féliciter pour mon mariage.
Bref, tous les regards étaient braqués sur moi. Je me sentais mal à l’aise. Cet endroit ne me plaisait pas. Il était vulgaire et faux, comme la marque de champagne que les serveurs servaient sans discontinuer. Quand Alicia s’était mise à me caresser trop bas vu ma position sociale, me confiant qu’elle était à ma disposition pour toute la nuit, je l’avais regardée attentivement. Elle était belle et provocante mais à ce moment-là j’aurais préféré être avec Giovanna et, sous prétexte que j’avais trop bu, j’étais sorti prendre une bouffée d’air, poursuivi par les cris moqueurs de mes amis. Il devait être deux heures du matin et l’air gelé coupait le souffle. Soudain, d’une voiture était descendue la dernière personne au monde que j’aurais voulu voir ce soir-là : Filippo Calchi Renier.
–Qu’est-ce que tu veux ?
Il m’avait indiqué son coupé BMW.
–On va faire un tour, faut que je te parle.
–T’as besoin d’un avocat ?
Il secoua la tête d’un air agacé. Sa cicatrice sur la joue était livide à cause du froid.
–Faut qu’on parle de Giovanna.
–Comme par hasard, grognai-je tandis que je me dirigeais vers lui.
Filippo et Giovanna étaient sortis ensemble quelques années auparavant. Puis elle l’avait quitté pour moi. Elle le lui avait annoncé un soir d’été pendant la fête du saint patron de la ville. Il était monté dans sa voiture et deux heures après s’était écrasé contre un platane le long d’une ligne droite. Il roulait comme un fou et un trou lui avait fait perdre le contrôle de sa voiture. Ça, c’était sa version ; mais, en ville, tout le monde avait pensé à une tentative de suicide. Depuis, il n’était plus le même, ni physiquement ni mentalement. Il me faisait de la peine. Et Giovanna éprouvait un sentiment de culpabilité qu’elle n’arrivait pas à surmonter. On ne pouvait pas aborder le sujet sans s’engueuler.
Filippo était le fils unique de la comtesse Selvaggia Calchi Renier. Sa famille était la plus en vue de la ville, après c’était la mienne. Moi aussi, j’étais fils unique. Ma mère était morte il y avait une quinzaine d’années, emportée par un cancer dans une clinique de Californie. Tout l’argent de mon père n’avait pas suffi à la sauver.
Filippo avait démarré.
–C’est pas la peine d’aller quelque part, je lui avais dit. On peut très bien parler ici.
Il ne m’avait pas écouté et avait passé la première.
–Tu peux pas l’épouser.
–Le mariage est dans neuf jours. Va falloir t’y faire.
–Elle ne t’aime pas.
–Et je parie que c’est toi qu’elle aime ?
–Oui.
–Tu me fais faire le tour de la ville pour me dire ces conneries ?
Filippo avait accéléré.
–Ralentis ! avais-je hurlé, effrayé. Ralentis, imbécile !
Il avait mis les pleins phares et orienté l’avant de la voiture vers le mur d’enceinte du parc qui portait le nom de son père.
–Tu l’épouseras pas. Giovanna est à moi.
J’étais terrorisé et je m’étais couvert le visage avec les mains en attendant le choc. Mais Filippo avait pilé au dernier moment et le coupé s’était arrêté à quelques centimètres du mur.
J’étais descendu en titubant et je m’étais jeté sur Filippo. Je l’avais sorti de la voiture et d’une énorme gifle l’avais mis à terre. Il ne s’était pas défendu. La lumière jaune des réverbères éclairait son petit sourire imbécile et le sang qui lui coulait du nez.
–T’es malade, faut te faire soigner.
–Je suis un malade exemplaire, je prends mes cachets bien comme il faut.
J’allais le frapper à nouveau mais quelque chose dans son regard m’en empêcha.
–Elle te fera cocu, comme elle l’a fait avec moi, m’avait-il dit, s’essuyant le sang du nez.
Ce n’était qu’un pauvre fou. Je l’avais envoyé au diable et étais rentré chez moi à pied. J’avais bu deux gin tonic bien tassés pour faire passer ma colère et je m’étais mis sous les couvertures, bien décidé à ne rien dire à Giovanna. C’était exactement ce que voulait Filippo, espérant qu’elle se précipiterait pour le consoler. Je m’étais endormi en pensant que j’en parlerais quand même à mon père. Ce crétin de Filippo pourrait faire une scène au mariage. Parce que, évidemment, il avait été invité. Sa mère et lui auraient une place d’honneur à la table de mon père, tout comme Prunelle, la mère de Giovanna. C’était le moment de mettre en garde la comtesse ; elle ne permettrait jamais à son fils de faire mauvaise figure, elle le bourrerait plutôt de sédatifs. Selvaggia détestait Giovanna. Elle n’avait jamais vu d’un bon œil la relation entre Filippo et une Barovier marquée par les fautes du père, et elle la tenait pour responsable de l’accident de son fils. Mais, naturellement, elle ne l’avait jamais exprimé de façon explicite, c’eût été trop vulgaire. Il avait suffi de quelques réflexions venimeuses que Giovanna et sa mère avaient dû encaisser le sourire aux lèvres. Le jour du mariage, elles se reverraient, s’enlaceraient et s’embrasseraient. Des félicitations et des remerciements des plus faux et des plus hypocrites. Mais c’est comme ça chez nous. Les grandes familles ne se donnent jamais en spectacle. Et Filippo ne devait pas échapper à la règle.
Je trouvai la force de m’asseoir sur le lit. La tête me tournait un peu, mais pas trop. Je renonçai à l’idée de café, une camomille me ferait plus de bien. Je me traînais jusqu’à la cuisine quand le téléphone sonna.
–Mais tu es encore chez toi ? éclata mon père sans me dire bonjour.
–Je n’ai que deux rendez-vous en fin de matinée.
–Tu dois quand même ouvrir ton cabinet. Un avocat sérieux…
–Papa ! l’interrompis-je d’un ton agacé. Je sors juste de l’enterrement de ma vie de garçon et d’une rencontre peu sympathique avec Filippo.
Il resta silencieux.
–Je vois, dit-il au bout d’un moment. Giovanna est avec toi ?
–Non.
–Ses collègues de cabinet et les secrétaires lui ont organisé un pot avant le mariage. Tu sais, ces pratiques des bureaux milanais… Mais elle n’est pas venue et elle n’est pas joignable. Ils sont restés le bec dans l’eau, ils voulaient lui offrir leurs cadeaux.
Giovanna était comme ça. Parfois elle disparaissait, oubliant de prévenir. A quelques jours du mariage, elle devait être en vadrouille pour s’occuper des derniers détails. C’était une perfectionniste-née, du signe de la Vierge, comme elle aimait le rappeler.
De mon appartement dans le centre-ville, j’allai au cabinet à pied. Et comme d’habitude, je m’arrêtai un instant devant le cabinet de mon père pour regarder la plaque de laiton brillant. Sous Maître Antonio Visentin, il y avait la ribambelle des noms de ses collaborateurs. En quatrième position, celui de Giovanna Barovier. Mon père l’avait prise comme stagiaire uniquement pour me faire plaisir. Lui aussi, comme Selvaggia, s’était opposé à notre relation mais il avait fini par comprendre que j’étais amoureux et que Giovanna valait mieux que la réputation de son père. Après le mariage, je devais entrer moi aussi dans le cabinet de mon père et la plaque serait changée. On mettrait mon nom sous le sien. Jusqu’à ce jour, il avait voulu que je m’en sorte tout seul, pour faire mes premières armes. Il ne voulait pas qu’on pense qu’il m’avait pris avec lui uniquement parce que j’étais son fils. Tous les autres avocats du secteur l’avaient fait sans se poser la moindre question. Mais lui, non. Lui, il était le meilleur, le plus connu, celui qui faisait autorité. Il disait toujours que les fils de famille étaient des mous, incapables de gérer les entreprises mises sur pied à force de travail par leurs parents. Même s’il n’avait jamais prononcé son nom, je savais qu’il pensait surtout à Filippo. Et, pour moi, il avait voulu un apprentissage dur et difficile. J’avais passé mes diplômes à Padoue, puis j’étais parti à Milan comme avocat stagiaire. J’avais ensuite ouvert un cabinet en ville et, péniblement, j’avais dû me créer une clientèle à moi, bien que de petit niveau. Les meilleurs clients, les plus riches, c’était mon père qui les avait. Il m’était souvent arrivé de plaider contre ses assistants ; lui était dans le public pour voir comment je m’en sortais. Je lui tournais le dos, mais je sentais qu’il était là, je sentais son regard. Moi aussi je suivais toujours ses procès. Mon père était vraiment le meilleur. Il n’élevait presque jamais la voix, comme le faisaient en revanche la plupart des vieux hâbleurs qui peuplaient le barreau. Quand il ajustait sa robe, avant de commencer sa plaidoirie, un silence respectueux tombait dans la salle, qu’il faisait durer le plus longtemps possible avant de le rompre de sa voix d’acteur que tous ses confrères lui enviaient. Ma mère disait qu’il ressemblait à James Stewart. Pas seulement physiquement et par son regard doux et un peu mélancolique, mais aussi dans ses mouvements calmes et sûrs.
Une semaine auparavant, il m’avait annoncé que j’étais prêt pour le grand saut. Il allait enfin me prendre avec lui. J’étais ému. Il m’avait embrassé.
–Tu es un bon avocat, Francesco, tu le mérites.
C’est vrai, je le méritais. Depuis ma maîtrise, j’avais travaillé dur pour avoir mon nom sur cette plaque. Je m’étais spécialisé en droit des sociétés pour devenir l’avocat de son principal client, la Fondation Torrefranchi. Elle avait été créée dans un but culturel, mais lorsque le Nord-Est était devenu la locomotive de l’économie italienne, elle s’était transformée en un formidable consortium d’entreprises capable d’embrasser tous les domaines et de faire des affaires avec n’importe qui. Le chef incontesté en était Selvaggia, la comtesse.
Fille de paysans, elle avait réussi à épouser le seul noble du coin, le comte Giannino, d’une vingtaine d’années plus âgé qu’elle. Son prénom de jeune fille était Fausta – et son nom Tonon – qu’elle avait rapidement remplacé par celui, plus chic, de Selvaggia quand le comte lui avait demandé sa main. Son astuce lui avait permis de comprendre où soufflait le vent et d’investir les capitaux de son défunt mari dans des opérations rentables, impliquant la plupart des industriels du secteur. Mais le cerveau juridique avait toujours été mon père. Il avait rendu possible les rêves de la comtesse et lié à la Fondation toutes les personnes qui pouvaient en renforcer l’image et le pouvoir au niveau local : politiques, artistes, intellectuels, magistrats et même quelques hauts prélats.
Ma place était là. Je pouvais enfin recueillir les fruits de tant d’efforts. J’allais devenir un avocat à succès, et une personnalité importante de la ville et de la région. Comme mon père. Ma vie était déjà écrite en lettres d’or. J’étais un Visentin. Et j’allais épouser la plus belle fille de la ville.
Mon premier rendez-vous m’attendait devant mon cabinet. Je n’avais pas de secrétaire et le client avait patienté devant la porte cochère. C’était un éleveur de dindons. La soixantaine, trapu, il ne s’exprimait qu’en dialecte. Tandis que je le conduisais jusqu’à mon bureau, il me raconta qu’une rave – il lut le nom sur un papier écrit par sa petite-fille – avait été organisée près de son élevage et que ses volailles, effrayées par le bruit de la musique, s’étaient jetées contre la clôture, se marchant dessus. Elles étaient presque toutes mortes. Il voulait 30 000 euros de dédommagement. Une affaire médiocre et à l’issue imprévisible, mais on ne refuse jamais un client sans une bonne raison. Je finis par lui serrer la main et il partit satisfait après m’avoir confié qu’il avait entendu parler de moi en bien au bistrot.
Mon deuxième rendez-vous était une ancienne camarade de lycée. Elle voulait que je plaide son divorce. Je connaissais son mari. Au pensionnat, nous avions joué dans la même équipe de volley-ball.
–Pourquoi tu ne demandes pas à Giovanna ? lui dis-je. Elle a plus d’expérience que moi dans ce domaine.
–Mon mari s’est déjà adressé à un avocat du cabinet de ton père.
–Alors, je ne peux rien pour toi. A mon retour de voyage de noces, je vais y entrer.
Je lui conseillai un autre avocat et elle me présenta ses félicitations pour le mariage, avec une pointe d’envie qu’elle ne parvint pas à dissimuler.
Peu après, je reçus un coup de fil de Carla, la meilleure amie de Giovanna et son témoin.
–Je n’arrive pas à trouver Giovanna, me dit-elle.
–Elle n’est pas allée au cabinet. Elle doit rendre folle la couturière ou la fleuriste, tu sais comment elle est.
–On y est passées hier, chez la couturière, m’informa-t-elle.
Puis elle resta silencieuse pendant un moment et finit par me demander, embarrassée et hésitante, si Giovanna m’avait parlé.
–De quoi ?
–Je sais pas très bien, mais c’était important. Très important.
–C’est-à-dire ? Je ne comprends pas.
Carla ne dit rien de plus. Elle raccrocha après un au revoir pressé. Elle était revenue depuis peu en ville après un long séjour en Campanie. Diplômée en biologie, elle avait suivi un camarade de fac à Caserte. Puis elle l’avait quitté et Giovanna l’avait aidée à trouver une place à l’ASL* de la ville. C’était du moins ce que m’avait raconté ma fiancée. Je ne la connaissais pas très bien, Carla. Je savais que Giovanna et elle étaient des amies d’enfance et qu’elles étaient toujours restées en contact. Moi, je n’avais jamais eu d’ami aussi intime. Je connaissais tout le monde en ville, je fréquentais le club de golf et le bar de la place à l’heure de l’apéritif. Je parlais à un tas de gens, j’allais dans les fêtes, mais j’étais un Visentin, et donc, d’une certaine façon, inaccessible pour tous les autres. Tout petit déjà, j’avais eu la sensation d’être un privilégié, ce qui obligeait les autres, grands comme petits, à me considérer comme différent. A cette époque, il n’y avait pas la richesse diffuse d’aujourd’hui et les différences sociales étaient plus marquées. Aujourd’hui encore où villas avec parcs et piscines, Mercedes, BMW et Ferrari se banalisent, je percevais cette ancienne déférence à l’égard de ma famille.
Ma mère avait tout essayé pour que je devienne le meilleur ami de Filippo, mais on ne s’était jamais plu, même en culottes courtes. Des gamins comme lui, j’en avais connu beaucoup dans le pensionnat exclusif où j’avais passé mes cinq premières années de lycée, et même si je m’entendais bien avec eux, je n’avais jamais franchi le seuil de l’amitié vraie. A l’université, ç’avait été différent mais c’était trop tard. Je m’étais rendu compte que je n’étais plus disponible ni intéressé par quelque chose de plus profond que la simple camaraderie. Je partageais le monde entre gens sympathiques et gens antipathiques. Et ça valait aussi pour les filles. J’en avais eu plusieurs dont je ne gardais aucun souvenir particulier. Sexe et affection, être bien ensemble pendant un temps, et puis clore l’expérience avec tact, sans séquelles, comme me l’imposait ma position sociale. Et puis Giovanna était arrivée et tout avait changé. Avec elle, je m’étais perdu dans une myriade de sentiments et de sensations que je n’arrivais pas à maîtriser. Giovanna était ma femme, ma maîtresse, mon amie. Elle était toute ma vie. Et j’étais heureux comme je ne l’avais jamais été depuis la mort de ma mère. Tout me paraissait parfait. Le monde, l’avenir.