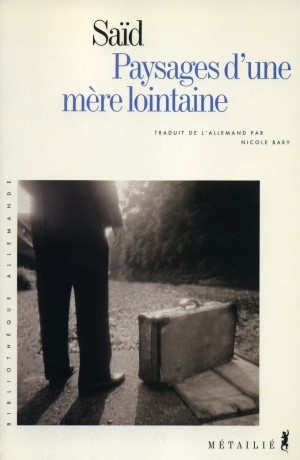« il faut que tu comprennes : j’avais peur de toi, notre rencontre, de notre première nuit.
je voulais arriver chez reza, passer la nuit chez lui et venir te voir le lendemain.
mais des amis m’ont mis en garde. on ne peut pas agir ainsi, pas avec une mère, les mères ne supportent pas ce genre de surprises. »
Dans ce court récit, le narrateur va au plus profond d’une rencontre impossible: il a fui le régime du shah et vit en Allemagne depuis de longues années. Ses parents se sont séparés avant sa naissance et il a été élevé dans la famille de son père. Il ne sait presque rien de sa mère. Il a la quarantaine lorsque l’un de ses demi-frères l’invite à Toronto pour rencontrer cette mère lointaine.
Cette rencontre réveille l’amertume d’une enfance loin de toute tendresse maternelle, l’amertume d’un impossible dialogue avec une mère et un pays natal prisonniers d’une société étouffante et répressive.
Saïd est poète et son talent apparaît dans ce récit allusif et elliptique, émouvant et tragique.
-
Né à Téhéran en 1947, exilé par deux fois de son pays (par le régime du Shah, puis par les sbires de Khomeiny), Saïd s'est établi en Allemagne et écrit dans la langue de Goethe. Représentant de la littérature allophone en République fédérale, il a reçu deux prix pour Paysage d'une mère lointaine. L'histoire brève, mais intense d'une rencontre longuement désirée. Entre le narrateur et sa mère dont il ne sait presque rien, ses parents s'étant séparés avant sa naissance, lui-même ayant été élevé dans la famille de son père. C'est à l'occasion d'un voyage à Toronto, invité par l'un de ses demi-frères, que celui qui se sent quasi orphelin découvre celle qui lui a donné le jour. Une rencontre difficile, réveillant le traumatisme d'une enfance dépourvue d'amour maternel. Une rencontre terrible aussi, révélant l'abîme entre ce fils et cette mère, incarnation d'un pays natal encore prisonnier d'une mentalité étouffante.Alain FavargerLA LIBERTÉ
-
« Saïd procède par touches, par allusions, par bribes arrachées à la mémoire. Il oscille entre un style minimaliste, purement descriptif, sans majuscules, et des envolées poignantes, sentimentales, charnelles, ce qui donne un caractère expérimental à l'ensemble. »Isabelle FiemeyerLIRE
Mai 1900
Munich riem.
je vais au guichet de la compagnie aérienne pour confirmer mon billet (faire ok comme dit la fille au guichet). la fille, jeune, blonde, jolie, visage
stéréotypé:
« votre passeport, s’il vous plaît. »
pas de passeport, seulement une autorisation de sortie du territoire (accords du 28 juillet 1951). de couleur bleue. avec deux barres noires en biais en haut à gauche. en
dessous: république fédérale d’allemagne. encore en dessous l’aigle.
sur la première page: cette autorisation ne sera plus valide après le 10 octobre si elle n’est pas prolongée. nom, prénom. pseudonyme. en dessous (imprimé en petits
caractères): « cette autorisation a été établie à seule fin de permettre à son détenteur de voyager à l’étranger sans utiliser son passeport national, mais elle n’est en aucun cas une attestation de la nationalité du détenteur ni de son changement de nationalité. »
page suivante, description,
taille: 1, 67. couleur des cheveux: châtain foncé. couleur des yeux: bruns.
nez: fort. forme du
visage: ronde. couleur de la peau: blanche. signes particuliers: cicatrice au genou gauche.
il m’a fallu du temps pour me réconcilier avec cette cicatrice, jusqu’à présent – à cause de ma biographie
– j’avais évité ou nié tout signe particulier, mais un jour cette cicatrice m’a convaincu qu’elle faisait partie de moi.
l’autorisation de sortie du territoire, dans le jargon
politique: le passeport garantissant l’asile et en plus le mot demandeur d’asile; moi qui me suis toujours considéré comme un réfugié politique.
la fille jette un regard à l’autorisation de sortie du territoire, elle se lève, la prend, la prend entre le pouce et
l’index: « le document doit être contrôlé par notre service de sécurité », puis avec le sourire de papier glacé de toutes les employées des compagnies
aériennes: « ça ne prendra pas longtemps. »
ça prend longtemps.
vingt minutes, le temps d’aller et de venir, la blonde propriétaire de cette sorte de sourire-là n’a pas compétence à contrôler mes papiers; c’est un privilège de la police, la compagnie aérienne n a pas de pouvoir exécutif, et la blonde sans visage encore moins, elle n’a même pas regardé attentivement mon visa pour le canada. et dire que j’ ai tellement tremblé à cause de lui.
depuis que tu as téléphoné et dit que l’allemagne ne te donnait pas de visa, que tu ne pouvais pas venir ici ou je vis. tu étais furieuse. tu avais même proposé, comme garantie, de l’argent liquide ou un terrain, ce
que l’ambassade d’allemagne à téhéran demande généralement. et malgré cela ta demande de visa a été refusée, sans raison, comme si souvent, c’est alors que tu as fait la proposition
suivante:
tu pouvais te rendre à toronto, chez ton fils. je devais y aller aussi, te rejoindre.
et je t’ai dit au
téléphone: « j ‘espère que les canadiens me donneront un visa. »
« pourquoi? tu as des problèmes de passeport ? » as-tu immédiatement demandé.
comment pouvais-je te l’expliquer? que sais-tu des passeports, des visas et des frontières. tu n’as jamais quitté l’iran, tu n’as jamais eu de passeport.
jusqu’à ce que tu m’aies trouvé, c’est alors que tu as demandé un passeport, en iran, pour venir me voir
à munich, en allemagne.
ton passeport, tu l’as obtenu. pour rien, l’ambassade d’allemagne à téhéran ne t’a pas fait cadeau d’un visa.
« tu ne dois pas y voir un mauvais présage ! » as-tu dit, je me suis u
« ça va marcher. tu verras. »
tu avais raison, les canadiens n’ont fait aucune difficulté, un visa pour trois mois.
et maintenant ce visa pour lequel j’ai tellement tremblé, on le regarde à peine.
aller et venir.
le visa est valide, le passeport correct. la blonde sans visage ne peut rien y faire, je m’envole avec, vers toronto. vers toi. de l’aéroport de munich je t’appelle, je voulais t’appeler seulement après avoir atterri à toronto, ou même le lendemain, mais des amis m’ont prévenu que tu pourrais avoir un choc. je voulais passer la première nuit chez reza. je l’avais déjà appelé, il m’attendait. reza est un vieux compagnon de l’époque de la lutte contre le shah, il y a onze ans que nous ne nous sommes pas vus – la dernière fois à rome où il vivait à l’époque je lui ai rendu visite, c’était au printemps 1979, le « printemps de la liberté », comme khomeyni a appelé cette saison au cours de laquelle il a pris le pouvoir à téhéran.
à ce moment-là, tous les opposants
au shah sont rentrés au pays – remplis d’enthousiasme et le regard embué. sans défense et aveuglés, aveuglés par l’espoir de ne plus devoir jamais vivre en terre étrangère. sans défense parce que nous avions attendu trop longtemps ce jour-là. puis « le printemps de la liberté » nous a frappés si durement que quelques années plus tard nous étions encore tout abasourdis.
j’étais revenu pour constater que des assassins assoiffés de sang nous attendaient, j’étais tellement ahuri qu’en arrivant à l’aéroport, encore sur la piste, je
me suis allumé une cigarette. un inconnu, quelqu’un du personnel de bord, quelqu’un qui ces jours-là avait, à
plusieurs reprises, été témoin de crises de larmes, me prit par le bras: « mon frère, dit-il, ici tu n’as pas le droit de fumer. »
frère!
les hommes le sont, partout. citoyens. camarades. frères. ils commencent par supporter pendant des décennies l’oppression et l’humiliation. puis ils font une révolution et se vengent horriblement des années au cours desquelles on les a rabaissés, de préférence sur ceux qui n’y sont pour rien, après coup ils tiennent des discours égalitaires et décident de bannir à jamais toutes les humiliations.
« frère. »
les voilà tous égaux. cette fois devant l’état et devant dieu.
les révolutions sont surtout des phénomènes bizarres, comme les patries sont des constructions bizarres. quand les français ont fait la révolution, ils ont aboli dieu par décret, jusqu’à ce que « l’incorruptible » remarque que le peuple a besoin de quelque chose qui ressemble à un dieu – s’il veut éviter de régresser et de devenir un alliage de révolutionnaires et de parias, ils ont donc trouvé un remplaçant à
dieu: « l’être suprême. »
les communistes ont fait un pas de plus, ils ont aboli dieu, sans lui donner un remplaçant.
ces « frères » ici vont encore plus
loin: ils font la révolution directement au nom de dieu, c’est la différence fondamentale entre les autres révolutions et « la
nôtre": « notre » révolution, comme si elle était faite pour nous. l’histoire ne prête pas attention aux nostalgies des émigrants de retour au pays.
au beau milieu de ces dieux, de ces révolutionnaires, de ces frères et de leurs fontaines de sang – moi. tout seul, n’appartenant à aucun parti, sans credo clair et précis, sans chez-moi, sans travail, sans repères historiques, blessé psychologiquement, incapable d’agir et habité par une grande angoisse. pas une angoisse du futur, mais une angoisse du présent. seul, avec un bout de papier dans la poche. dessus, le nom d’un inconnu qui doit me mener à toi – ma mère que je n’ai jamais connue.
j’étais désorienté et je n avais pas le moindre regard pour quiconque, pas même pour toi. ces jours-là
à téhéran, quelqu’un qui voulait me parler a téléphoné chez ma tante, pour me transmettre un message de ta part – vraisemblablement un message d’amour. mais je n’avais pas donné signe de vie à ma tante, par égard pour son mari qui, ancien général de l’armée, avait déjà suffisamment d’inquiétude et de problèmes – sans moi. ma tante ne se doutait donc pas que j’étais à téhéran. elle dit à cet individu que j’étais en allemagne, et celui-ci lui répondit qu’il avait lu dans le journal que j’étais de retour.
ma tante lança son fils à ma recherche. il se rendit
à l’université, l’agora de cette révolution, la liberté y régnait encore. les gardes de la révolution n’avaient pas encore tout en main, mon cousin trouva quelques amis qui venaient d’allemagne. il les questionna à mon sujet et les pria de m’informer que je devais téléphoner chez lui. ce que je fis et je leur rendis visite le soir même.
ma tante pleura, moi aussi. son mari, l’ancien général, allait et venait pour ne pas montrer son émotion. il montra du doigt une gigantesque photo de khomeyni sur le rebord de la
cheminée: « l’un s’en est allé, l’autre est arrivé. » il avoua que seulement quelques jours auparavant c’était encore le portrait de sa majesté qui se trouvait là. et finalement il raconta d’une voix blanche et avec force détails qu’il avait détruit en même temps que toutes les photos du shah son uniforme et ses médailles.
« on ne sait jamais, s’ils perquisitionnent notre maison, c’est préférable ainsi.
« pourquoi perquisitionneraient-ils votre maison ? » lui ai-je demandé. « vous ne vous êtes jamais rendu coupable d’aucun méfait et vous êtes à la retraite depuis longtemps. » je l’aimais bien, il avait toujours été comme un père pour moi.
il répondit comme si cela n’avait pas
d’importance:
« ils sont précisément en train de pendre les généraux, tu sais, et s’ils en manquent, ils viendront chez moi, et toi, tu n’es pas vraiment non plus pour khomeynî. »
j’avais saisi la perche qu’il me tendait. je lui racontai moi aussi, comme si cela allait de soi, qu’il était préférable que j’habite en ville, près de l’université, car j’avais à y faire. je lui dis que j’étais logé chez un ami. il en fut soulagé, demandant encore si cet ami était fiable. pour finir il se soucia avec tact de savoir si j’avais suffisamment d’argent.
« je sais bien sûr que tu as de l’argent. je veux
dire:
as-tu de l’argent iranien sur toi ? »
puis ma tante me parla de cet inconnu qui avait appelé, de ta part, et m’avait demandé. elle se leva, chercha un bout de papier qu’elle me tendit. un nom et un numéro de téléphone. je mis le papier dans ma poche en hochant la tête.
je n’ai pas appelé l’inconnu, je n’ai pas tenu compte de ce signe. c’était trop pour moi. il y avait tout simplement trop d’étrangers autour de moi, dans mon téhéran, après quatorze années d’absence.
j’étais désorienté, trop désorienté pour hériter, pardessus le marché, d’une mère. il me fallait d’abord prendre conscience que j’étais de retour, le comprendre avec mon corps, pour en tirer des conséquences pratiques. la première vague d’arrestations et les noms des premières personnes appréhendées étaient suffisamment explicites, j’étais déjà en train de préparer mon retour, cette fois le retour vers un nouvel exil, et je le préparais sans prendre de risques, alitalia, rome. quelques semaines plus tard cela n’aurait plus pu se passer aussi
aisément, de nombreux inconnus durent s’enfuir par-delà les montagnes et les frontières. je m’envolai pour rome et rendis visite à reza.
nous avons parlé – à ce moment-là, pendant ce « printemps de la liberté » – de nos repères perdus et nous nous sommes demandé ce que nous allions devenir. peu de temps après sa femme l’a quitté. elle voulait vivre chez elle, en iran. reza ne le pouvait pas. il est resté
à rome, jusqu’à ce que la ville lui paraisse trop exiguë, jusqu’à ce qu’elle lui rappelle trop sa femme. il est alors parti pour le canada, pour toronto. c’est là que je viens de lui téléphoner, aujourd’hui, neuf ans plus tard.
il faut que tu
comprennes: j’ avais peur de toi, de notre rencontre, de notre première nuit.
je voulais arriver chez reza, passer la nuit chez lui et venir te voir le lendemain.
mais des amis m’ont mis en garde. on ne peut pas agir ainsi, pas avec une mère, les mères ne supportent pas ce genre de surprise.
je t’ai donc appelée. de l’aéroport de riem. à toronto, au canada. où tu es en visite, chez ton fils. tu m’attends, tu décroches le téléphone. (plus tard tu m’as raconté que chez toi tu n’as pas de téléphone, que tu n’as jamais donné toi-même un coup de fil, que tu ne sais même pas composer un numéro.)
je t’ai dit que j’allais bientot m envoler pour toronto. demain, peut-être après-demain, que je devais me
rendre chaque jour à l’aéroport, prêt à embarquer; à cause du billet bon marché.
« c’est bien, as-tu dit, appelle-moi dès que tu seras arrivé. »
trop vite.
ta réponse est venue trop vite, tu n’as même pas pris le temps de réfléchir ou même de douter.
est-ce que ma mère a tout
deviné ?
mais maintenant les jeux sont faits et malgré mon désarroi, je suis en quelque sorte soulagé.