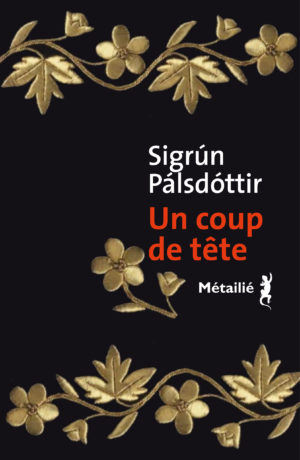À la fin du XIXe siècle, à Reykjavík, un veuf excentrique élève sa fille pour tenir la maison, cuisiner, broder (elle y révèle un talent rare), mais aussi l’aider à cataloguer ses recherches archéologiques islandaises. C’est sans compter sur les rêves de voyage et l’esprit d’indépendance de la jeune fille.
Elle décide sur un coup de tête de partir pour New York proposer ses compétences à un collectionneur en emportant avec elle un objet unique et inestimable. Un malheureux hasard la conduit dans un atelier de couture des bas-fonds de Manhattan. Elle nous surprendra grâce à sa ténacité et son intelligence.
Un court roman efficace et passionnant, une tragicomédie sur la préservation de l’héritage culturel, un texte sur les coïncidences qui déterminent les destins autour d’un personnage attachant et déroutant qui suit sans faille son chemin vers la liberté.
-
A la fin du 19ème siècle, une audacieuse jeune femme, Sigurlina Brandsdottir, quitte Reykjavik pour New York. Un jubilatoire roman d'émancipation !!!
-
Intrigant et jubilatoire, voici le roman très réussi d'une émancipation féminine pour le moins originale. A découvrir !Sylvie
-
Avec son premier roman, l'Islandaise Sigrún Pálsdóttir prouve s'il est besoin que tout l'art d'un conteur est de savoir broder des histoires. Telle Sigurlina sa jeune héroïne, passée maître dans l'art de l'aiguille (et aussi celui des fourneaux )… Dans ce roman palpitant, l'autrice excelle à restituer une époque ( la fin du XIXe siècle ) et rappelle Dickens par sa peinture sociale et pour sa veine picaresque. Les péripéties et les rebondissements s'enchaînent : nous nous réjouissons puis tremblons pour Sigurlina, nous vivons à ses côtés dans la joie comme dans la déveine. Tel un roman-feuilleton, chaque page est haletante et brosse le portrait d'une héroïne courageuse et déterminée. Assurément ce "Coup de tête" peut mener loin et vous prouver qu'il n'est jamais trop tard pour prendre son destin en main.Sébastien
-
Fin du XIXe, Sigurlina part de Reykjavik réaliser son rêve de liberté. Elle emporte avec elle un objet d’une grande valeur et tente de s’établir à New York. Une histoire de femme très attachante dont l’intelligence et la détermination surprennent dans ce récit court et troublant.Isabelle
-
"Sans en avoir l’air, ce récit jubilatoire est d’abord celui d’une émancipation féminine. A sa manière, l’autrice joue avec les traditions du picaresque et du mélodrame du XIXe siècle pour mieux les détourner."Marie CharrelLe Monde des Livres
-
"Drôle et original, érudit et subtil." Lire la chronique iciThierry MaricourtSite Voyage dans les lettres nordiques
-
"Une délicieuse dérive romanesque : tel est le roman de Sigrun Palsdottir, vivifiant comme un frais vent islandais !"Damien AubelTransfuge
Le bruit montait du salon. Des sonorités étranges. Un instant, ne comprenant pas un mot des paroles échangées, je crus que je rêvais. Puis j’entendis les ronflements discrets de grand-mère à mon côté et je compris que j’étais éveillée. Je me redressai dans le lit pour enjamber son corps frêle, me faufilai à travers la grande pièce commune sous les combles et m’allongeai sur le sol, le visage tourné vers la cage d’escalier. À travers la fumée de tabac qui flottait dans la pièce, je distinguais un homme d’âge mûr assis sur le canapé à côté d’une jeune femme. Il portait une veste brune et un foulard bleu, elle, un manteau vert et un chemisier clair orné d’un col en dentelle à la racine de son cou gracile, sous son menton. Le vieux Magnus était assis sur le tabouret en face des invités tandis que Gudlaug, debout, la cafetière à la main, remplissait les tasses. Mon père était installé dans le fauteuil sous la fenêtre et ma mère sur le coffre juste à côté, légèrement à l’écart de la fumée et du monologue du visiteur, interrompu par une remarque de la jeune femme au col en dentelle qui montra sa tasse du doigt. Elle semblait s’adresser à ma mère qui hocha la tête avec un sourire. Mais ce sourire ne m’était en rien familier, en réalité maman, adossée au mur du salon, avait un air étrange et le dos étonnamment voûté. Elle se redressa légèrement tandis que mon père prononçait quelques mots dont je compris qu’ils étaient la réponse aux questions de l’étrangère. Puis les invités se levèrent, ils prirent congé, et Magnus et mon père les raccompagnèrent à la porte. Voilà qui me permit de mieux distinguer les vêtements de la jeune femme, son ample robe longue qui s’évasait en partant de sa taille de guêpe et tourbillonnait sur son passage tandis qu’elle avançait dans le salon. Je me relevai, enjambai à nouveau grand-mère et fis semblant de dormir quand maman vint me caresser la joue. Elle me posa l’index sur le bout du nez et comprit que je ne dormais pas.
Le lendemain matin, personne ne fit état de la visite de la veille et je ne posai aucune question. Je n’éprouvais d’ailleurs pas le besoin d’en savoir plus. Le souvenir de ces senteurs exotiques me suffisait amplement, de même que l’image des hôtes dont la présence semblait avoir agrandi l’espace de notre salon. Je ne passais cependant pas le plus clair de mon temps à penser à ces étrangers élégants et, en réalité, j’avais presque oublié leur visite un jour que j’aidais ma mère à faire le ménage, jour où je découvris une image pleine de couleurs posée au sommet de la pile d’enveloppes que mon père n’avait pas ouvertes sur son bureau. C’était une carte postale. Je reposai mon chiffon pour l’examiner en la prenant à deux mains :
Le soir tombait sur une grande ville, les rues blanchies renvoyaient la lumière et des flocons étrangement épais descendaient vers la terre. Une petite fille entraînait sa mère vers la devanture d’un magasin pour lui montrer un grand renne, un homme en haut-de-forme noir, vêtu d’un manteau à col de fourrure, portait un paquet volumineux et tenait sa femme par la main. Derrière eux, un adolescent traînait un gros arbre de Noël et, de l’autre côté de la rue, des garçons faisaient des boules de neige pour les lancer sur le fiacre noir vernissé qui passait. Chacun avait une foule de choses à faire, mais se retrouvait figé dans sa course. Tous, sauf la jeune femme dans le coin à droite, qui semblait s’être immobilisée juste avant cet instant, et dont on ignorait si elle s’apprêtait à traverser la rue ou à continuer son chemin sur le trottoir. Vêtue d’un manteau bleu marine et d’un élégant chapeau rouge, elle protégeait ses mains du froid dans un manchon en cuir brun qu’elle serrait contre elle. Son visage était plus net que les autres détails de l’image : elle semblait perdue.
J’étais en train de me demander si elle était seule quand je sentis tout à coup la présence de ma mère derrière moi. Elle pencha la tête et posa le menton sur mon épaule pour regarder la carte. Du coin de l’œil, je la vis sourire en disant que ce courrier arrivait avec un certain retard. Puis elle se redressa et se remit au travail. Je retournai la carte adressée à Brandur Johnson. En haut, à droite, on lisait : New York, le 15 décembre 1879. L’écriture avait quelque chose de brouillon et, évidemment, je ne comprenais rien. Mais je pensais connaître l’expéditeur de cette carte.
Plus tard dans la journée, face à mon insistance, mon père consentit à me l’offrir. Je la rangeai dans le coffre que j’avais au pied de mon lit, où je pouvais la prendre quand j’avais du mal à trouver le sommeil après ma lecture du soir. Et, même au plus noir de la nuit de l’hiver 1880, je parvins encore à voir l’image en la maintenant assez longtemps devant mes yeux. Plongée dans les ténèbres, je distinguai en réalité des détails que je n’avais pas remarqués auparavant : au fond d’une étroite ruelle tapissée de neige, deux hommes chaudement vêtus se tenaient l’un face à l’autre en grande conversation. Plus je scrutais la carte, plus il me semblait que toute leur attention se concentrait sur la jeune femme au chapeau rouge. Désormais, j’avais l’impression que le désespoir qui envahissait son visage s’expliquait par le poids de leur regard, elle cherchait à savoir si elle devait se mettre à l’abri, ou si ce poids s’évanouirait.
Ma main retomba. La carte atterrit sur la couette et, aussitôt, la jeune femme au chapeau rouge traversa la rue, enjambant le merry christmas en grandes lettres dorées en haut à droite de l’image, avant de s’échapper du cadre. Au même moment, les deux hommes se mirent en route et lui emboîtèrent le pas. Ils ne couraient pas, mais franchirent la chaussée à grands pas, traversèrent brutalement le Joyeux Noël, s’évanouissant lorsque j’entendis les craquements de l’escalier. Je sursautai et, dans ma torpeur, j’eus l’impression de voir grand-mère s’approcher du lit en boitant. Allongée, les yeux fermés, je cherchai la carte à tâtons et la glissai sous la couette. Grand-mère se coucha, je me tournai de l’autre côté. Et avant que ses ronflements discrets ne parviennent à m’enfermer dans le monde exigu de la pièce que nous partagions sous les combles, je m’engouffrai en chemise de nuit dans l’étroite ruelle où je suivis sur la neige blanche les deux hommes et la jeune femme qu’ils avaient prise en chasse.
I
Fin de réception à Reykjavik. Mars 1897
– Quant à cette boucle de ceinture finement ornementée, elle a souhaité l’acquérir pour la somme de quinze mille dollars américains. Auprès de sa propriétaire, une jeune Islandaise dénommée Branson. Miss Selena Branson.
Le Gouverneur se lève de son fauteuil et s’avance vers la fenêtre du salon. Il regarde le vol suspendu des flocons et la place Lækjartorg toute blanche de neige qui apporte un peu de lumière à la nuit sans fond :
– Eh bien, je vous demande, mes chers amis, s’il ne s’agit tout simplement pas là de Sigurlina Brandsdottir, la fille de Brandur Jonsson l’Érudit, le copiste de Kot dans le Skagafjördur.
Alors ça, c’était la cerise sur le gâteau ! Et ladite cerise laissait les invités du plus haut représentant du roi en Islande plus que dubitatifs. “Quelle absurdité !” tonna le Juge ; “Seigneur, non !” s’écria le Pasteur ; “Le petit bouchon de Brandur ?” se récria le Préfet ; “Le tout petit bouchon”, ricana le Poète ; “Un bouchon ?” claironna l’Historien ; “Quinze mille dollars ? s’étrangla le Trésorier du roi. Comment un objet aussi petit et aussi vieux pourrait-il avoir une telle valeur ? Une somme qui correspond à la quasi-totalité des réserves de la Banque nationale d’Islande ?”
Mais le septième invité, le Rédacteur en chef aussi svelte que bel homme, n’a aucune réaction. Il est assis légèrement à l’écart, tout près du mur, penché en avant, le regard concentré sur un détail du tapis d’Orient tissé main qui recouvre le parquet de ce salon d’apparat. Il essaie de se remettre en mémoire le visage d’une jeune fille, mais ne voit rien d’autre qu’un corps gracile enveloppé d’une robe aérienne retenue à la taille par une ceinture ornementée, une jolie poitrine sur laquelle retombent de fines mèches blondes et un col carré brodé au fil d’or dessinant un motif grec. Un ruban noir autour du cou et un bandeau doré sur la tête. Enfin, son visage lui apparaît. Il voit d’abord des lèvres fines qui esquissent un sourire, un nez élégant, légèrement épaté, puis des narines. La jeune fille les pince, comme pour essayer de retenir un rire, de maîtriser son énergie et sa vigueur. Ses yeux sont dissimulés derrière un masque noir, mais il les voit tout de même. Bleu d’eau derrière leurs paupières lourdes, soulignés de légers cernes. Un regard enjôleur qui le rend fou de désir, si bien qu’il sursaute, murmure le nom de Sigurlina, se redresse et se rend compte que tous le fixent d’un air inquisiteur : le Gouverneur, le Juge, le Pasteur, le Préfet, le Poète, l’Historien, le Trésorier du roi. Était-il censé dire quelque chose ?
Le jeune homme recule et s’adosse à l’épais mur de cette ancienne prison au plafond bas devenue résidence officielle, bâtiment que certains qualifient de bicoque. Le Rédacteur a presque disparu derrière la plante tropicale chétive installée contre la paroi, au plus près de la porte laquée de blanc par laquelle on accède au salon. De l’autre côté du battant, l’oreille collée au bois, se trouve la servante, une grande femme imposante. Elle tient d’une main une carafe vide, son autre main plaquée sur la bouche. Voyant que les invités du Gouverneur n’ont plus aucun commentaire à faire sur l’histoire qu’il vient de raconter et qu’ils ne semblent guère désireux de répondre à sa question, elle recule lentement mais résolument. Puis elle longe le couloir, le pas rapide et décidé, et entre dans la cuisine. Elle repose la carafe en cristal, se débarrasse de son tablier et de sa coiffe, se dirige vers le vestibule et la porte de service, prend son manteau, le boutonne, et jette son châle sur ses épaules. Elle ouvre la porte d’un geste véhément. Un mur de neige qui lui monte jusqu’aux cuisses obstrue l’ouverture, mais qu’importe, elle sort et le traverse avec une telle énergie que la poudreuse virevolte devant elle. Elle s’avance à grandes enjambées vers le muret en pierre qui entoure la maison et le franchit lestement.
À petits pas, levant bien haut les jambes dans l’épaisse couche de neige, elle descend la rue Bankastræti. Lorsqu’elle atteint Austurstræti, en passant devant la demeure du Trésorier du roi, elle perd presque l’équilibre et laisse échapper un tout petit cri toutefois assez puissant dans la quiétude glaciale de Reykjavik pour faire sursauter la jeune fille à la fenêtre, qui se pique le doigt avec son aiguille, assise dans l’élégant fauteuil où elle brode au fil d’or des pantoufles vertes. La demoiselle se lève et pousse la petite lampe à pétrole sur le côté. Elle plaque son visage pâle à la vitre et ôte son index de sa bouche : “Eh bien, il y a des gens rudement pressés”, commente-t-elle, mais la servante du Gouverneur a déjà disparu, d’un pas vif, vers l’ouest de la ville. Et elle avance sans la moindre hésitation, elle accélère jusqu’à l’angle de la rue Adalstræti où elle tombe nez à nez avec deux chevaux affolés qui se cabrent, la font trébucher et atterrir de tout son long dans la congère. Une porteuse d’eau coincée dans la neige devant l’hôtel Islande hurle quelques paroles acerbes bien qu’incompréhensibles, puis se fraye un chemin vers l’accidentée à qui elle tend sa main bleue et gonflée. La servante la repousse et se relève sans son aide. Elle s’ébroue pour se débarrasser de la neige avant de reprendre sa route. Et elle allonge encore le pas, c’est presque une course qu’elle achève en rampant pratiquement dans la poudreuse. C’est qu’elle n’a pas une minute à perdre. Elle doit arriver au plus vite chez Brandur, à Brandshus. Tant que l’histoire de la petite Lina Branson, avec tous ses détours, ses rebondissements, ses ellipses et ses merveilles, est encore claire dans son esprit.