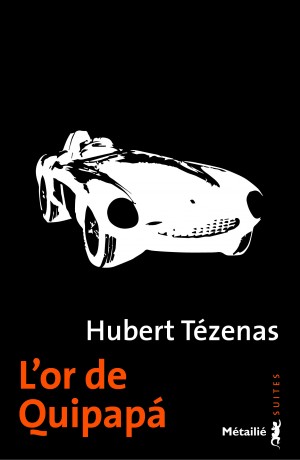« Les employés de la distillerie ne me portent pas dans leur cœur. Ça les regarde. Mais je ne vais pas tolérer qu’ils se foutent de ma gueule. Ma tête à couper qu’il y en a plus d’un qui aimerait voir partir ma Monza dans le décor. Ils peuvent toujours attendre.»
Pernambouc 1987, l’assassinat d’un délégué syndical jette toute la région sur les chemins de la violence. Toute la famille Carvalho, du patriarche autoritaire au dernier bâtard, se lance dans une course en avant pour maintenir son emprise sur l’immense plantation familiale.
Corruption, faux semblants, trahisons tissent la trame de ce roman taillé à la machette.
L’auteur s’élève dès ce premier roman à la hauteur des classiques du genre hard-boiled.
Pas un temps mort : les pages s’avalent au même rythme que la cavale haletante du héros. Un coup de maître. B. F. Challenges
Ce premier roman, qui ne cède à aucune facilité est une belle réussite, J.Desaubry , 813
Prix du Goéland masqué 2014
-
"Corruption, faux-semblants, trahisons au menu de ce roman taillé à la machette." Lire l'article ici
Françoise MonnetLe Progrès -
"Attention pépite! Corruption, faux-semblants, trahisons émaillent ce roman qui s'avale comme un Pintado, avec délectation, jusqu'à la pirouette finale." Lire l'article iciAnne LessardLe Télégramme
-
"De son plongeon dans les geôles sordides du Brésil à la fin des années 1980 à la découvertes des exactions des propriétaires terriens, Hubert Tézenas réussit un coup de maître avec son premier roman." Lire l'article iciSoizic BriandChallenges soir
-
"Le Français Hubert Tézenas trempe sa plume au cœur du roman noir à l'américaine - la parenté avec Jim Thompson et Cormac McCarthy est flagrante."Lire l'article iciElise LépineTransfuge
Il est à peine huit heures mais le soleil cogne dur. Les petits cubes sur pilotis de l’UR-11 viennent de disparaître dans le sillage du bus qui l’emporte ce matin-là vers le centre de Recife quand Alberico Cruz pose les fesses sur un baquet en polypropylène. La semaine pourrait démarrer plus mal.
La surface visqueuse du Tejipió défile au-delà du parapet. À la lisière de la mangrove une colonie de pêcheurs en short farfouille la vase pour attraper des crabes goinfrés d’ordures. Ils les suspendront sous une perche et essaieront de les fourguer sur les plages de la zone sud aux plus cons des gringos. Et si ça ne marche pas ils les mangeront eux-mêmes. La brise torride de l’estuaire chahute la cabine aux vitres béantes d’un bout à l’autre du pont Motocolombo et ébouriffe les passagers en nage. Puis le chauffeur met la gomme dans la ligne droite de l’avenida Sul. Alberico Cruz est un jeune homme noir de poil et blanc de peau. Il porte comme tous les jours de la semaine une chemise blanche et un pantalon beige. Ses joues replètes sont rasées de frais et ses cheveux peignés avec soin. Dans le maquis de sa poitrine scintille une fine croix d’or retenue par une chaînette. Une serviette de skaï fauve est nichée sous son coude. Les îles du centre se rapprochent à toute vitesse. C’est un amas déliquescent de palais coloniaux et d’immeubles noircis par le cagnard et les déluges. Des ponts rouillent lentement sur les bras du fleuve et les perspectives sont asphyxiées par le fourmillement des camelots et des char- rettes à bras. Le bus s’engouffre de toute la force de son diesel dans le quartier du port. Il quitte l’avenida Rio Branco et longe les docks désaffectés en dispersant à coups de klaxon les crève-la-faim qui traversent l’asphalte labouré par les dix-huit roues. Alberico Cruz s’éponge la nuque. Il se lève en serrant sa serviette et empoigne une barre d’appui. Il tire sur le cordon aux deux tiers du pont de Limœiro. Il débarque sur le trottoir grouillant de l’avenida Norte et slalome sur deux cents mètres pour rejoindre la rue étroite de l’agence. Il achète la Folha do Recife et le Jornal de Pernambuco à l’infirme assis comme tous les jours sur son tabouret au pied de l’edifício Caxangá puis s’engage dans le hall. Un voile de lassitude vitrifie ses yeux charbonneux lorsqu’il découvre la queue aux ascenseurs. Au moins trente personnes. Il y a trois cabines mais le syndic n’en fait tourner qu’une pour économiser l’énergie. La faute à cette putain de crise qui sévit depuis des années. Depuis que le cours du brut a replongé. Quatre cents salariés déferlent chaque matin entre huit heures et neuf heures trente sur les dix-neuf étages de bureaux serrés comme des alvéoles derrière la façade encrassée du Caxangá. Trois cabines chargées à mort s’envolent sous le nez de Cruz. Il met près d’un quart d’heure à arriver au onzième mais là aussi ça pourrait être pire : les black-out l’obligent régulièrement à rejoindre les gloussantes processions qui prennent d’assaut l’esca- lier à la lueur des briquets. Et il n’est pas mécontent de s’être retrouvé plaqué contre une fausse blonde jusqu’au septième. Cruz bande encore un peu lorsqu’il pousse la porte en verre dépoli de l’agence Luxor rétro-éclairée par un fluo blême. Bonjour, Alberico. Ça va ? Cette garce de Lena ne lève même pas la tête de sa machine à écrire nichée sous un climatiseur vrombissant dans l’angle de la minuscule pièce d’accueil. On fait aller. Des appels ce matin ? Lena daigne enfin croiser son regard. Elle est à tomber raide avec la queue-de-cheval qui ruisselle aujourd’hui sur son dos d’ambre. Cette fille est une machine à fantasmes : elle peut être noire ou indienne ou blanche, au choix – selon le jour et l’angle et la lumière et l’humeur. Cruz rêve de se la faire depuis son entrée à l’agence. Ce n’est pas pour demain. La petite pute couche avec Montenegro. Il faut faire attention aux dérapages. Quelques-uns, répond Lena. Elle se lève pour prendre le thermos derrière elle sur le rebord de fenêtre. Son cul moulé dans un jean est une œuvre d’art. Cruz n’a jamais rien vu d’aussi beau. Une dame qui voulait des infos sur le trois-pièces à vendre, ajoute-t-elle. En face du shopping center Boa Viagem. Elle m’a raccroché au nez dès que j’ai dit le prix. Et le monsieur du pas-de-porte, celui de l’Imbiribeira, s’est énervé comme d’habitude parce que sa boutique n’est toujours pas louée. Il parle de nous retirer l’exclu. J’ai aussi eu deux coups de fil d’un type intéressé par le meublé de la rua da Aurora. Ça a l’air très urgent. Il veut le visiter ce matin. J’ai dit que vous rappelleriez. Cruz jette son gobelet dans la corbeille. Loupé. Il le ramasse en secouant la tête et passe dans la pièce voisine. C’est une salle mal éclairée de sept mètres carrés et meublée de deux bureaux métalliques et d’une tablette pour la machine à écrire. Ses fosses nasales sont agressées par les relents de moisissure qu’exhale la vieille moquette gris-vert lorsqu’il franchit le seuil. Il s’assied derrière son bureau. L’autre n’est qu’un vestige des temps glorieux où le patron de la Luxor employait deux agents à temps plein. Pas question, lance-t-il de loin à Lena. Il sort les journaux de sa serviette avant d’ajouter : Les visites du matin, c’est pour Montenegro. J’ai mes coups de fil à passer. Les acquéreurs sont rares à cause des taux stratosphé- riques. Toute la profession s’est rabattue sur le marché locatif et se dispute chaque matin les annonces des parti- culiers. L’immobilier est devenu un sport de combat. M. Montenegro a téléphoné il y a un quart d’heure, dit Lena après un court silence. Il ne pourra pas venir aujourd’hui. Il a rendez-vous chez le dentiste. Il ne serait pas plutôt en train de cuver dans un hôtel du littoral ? Alberico, voyons. Je plaisante. Alberico Cruz grimace et se pince l’arête du nez. Qu’est-ce qui lui a pris ? La crise frappe tous les secteurs de l’économie et Lena peut le faire sauter d’un claque- ment de doigts. Ce vieux porc de Montenegro lui passe tous ses caprices. Le grand atout de Cruz est que les agents capables de se contenter d’un salaire aussi minable que le sien ne courent pas les rues. Et il a su se rendre indispensable : seule sa présence permet au patron d’écluser sans remords ses deux bouteilles quotidiennes de vodka nationale. Un jour il aura l’agence pour lui seul. Et peut-être Lena en prime. C’est ce qui le fait tenir. Il n’a pas l’inten- tion de rester toute sa vie un sous-fifre salarié du Caxangá. Il attend seulement qu’Oscar Montenegro lui tombe dans la main comme une mangue pourrie. C’est bien parti : l’homme n’est plus présentable à partir du déjeuner. Il revient chaque jour de la lanchonete en flageolant au bras de sa secrétaire. Il va ensuite s’affaler sur le clic-clac de son bureau personnel situé de l’autre côté de l’aire d’accueil et n’en émerge que vers quatre heures ou quatre heures et demie. Il signe alors tout ce qu’on veut d’une main tremblante et répond aux ques- tions de Cruz par des borborygmes parfumés au Bacardi. Puis il disparaît jusqu’au lendemain. Le téléphone sonne. Sûrement Fátima. Elle l’appelle chaque jour à neuf heures moins cinq : dès que sa mère est sortie traînée par son rottweiler. Fátima et lui se sont connus il y a quelques mois dans un cours du soir d’initiation au basic. Quelques regards et quelques mots chuchotés tandis que leurs doigts se frôlaient sur les touches du pavé numérique lors d’un exercice commun de programmation ont suffi à métamorphoser cette jeune fille sage. Ils se sont jetés ensemble à corps perdu dans l’exploration clandestine de toutes les formes de rapprochement susceptibles de préserver l’hymen de Fátima. Mme Souza est une veuve portugaise bardée de principes : elle y tient comme à la prunelle de ses yeux. Les langueurs inhabituelles de sa fille unique ont fini par l’alerter et elle l’a sommée de tirer un trait sur l’informatique. C’est bien elle. Fátima se met à décrire un modèle de chambre de bébé repéré en vitrine d’un magasin chic de la zone sud sans le laisser en placer une. Le poste de Lena se met à sonner. Lena décroche. Bijou, dit Cruz en secouant la tête, tu sais que c’est compliqué en ce moment. Déjà que j’ai du mal à joindre les deux bouts, je ne vois… Alberico ? lance Lena. C’est pour vous. Il faut que je te laisse, bijou. J’ai un appel. On en reparle ce soir. D’accord ? Tu remets toujours tout à plus tard, Rico. Tu ne m’écoutes jamais. Je viens de te dire que je t’ai choisi pour être le père de mes enfants et tu ne réagis pas. Quand est-ce que tu comptes te décider à envisager sérieusement l’avenir de notre couple ? Écoute, soupire Cruz en tripotant le capuchon de son stylo à bille. Je t’assure que je ne pense qu’à ça, mais… Il y a des moments où je me demande si tu as vraiment envie de construire quelque chose de solide avec moi. Bien sûr que oui. Je passerai vers six heures. D’accord ? Fátima consent du bout des lèvres. Cruz raccroche et prend l’appel en attente de Lena. C’est le client intéressé par le deux-pièces de la rua da Aurora. Cruz fait le forcing pour lui donner rendez- vous sur place en début d’après-midi mais l’homme – M. Silva – ne veut rien entendre. Sa chambre d’hôtel doit être libérée à midi pile. À neuf heures dix – vingt minutes plus tard – Cruz ressort de l’edifício Caxangá d’humeur massacrante et part à pied vers la rua da Aurora. Il n’a plus les moyens de se payer le taxi. Il déteste ce meublé qui est de loin le plus mauvais produit de la Luxor. Et il devra sûrement refaire la queue devant l’ascenseur à son retour. Sans la déco- lorée du septième. Il longe le bras de mer fétide qui sépare son quartier de la zone portuaire et s’engage à pas pressés dans la rua da Aurora en jetant de-ci de-là des coups d’œil circons- pects pour repérer un éventuel voleur à la tire dans la masse compacte des piétons et des camelots. Il sait que sa chemise impeccable et ses mocassins cirés font tache dans cette foule pauvre. Sa serviette ne contient qu’un contrat-type et les clés du meublé mais rien n’empêchera les chapardeurs du centre de se l’imaginer farcie de grosses coupures. Il arrive devant le 132 et lève les yeux avant de monter. Le numéro est inscrit au fusain au-dessus d’une porte en massaranduba vermoulu. Le sommet du vertigineux escalier droit se perd dans l’ombre. Facile quatre mètres cinquante sous plafond : les architectes d’autrefois ne mégotaient pas sur les volumes. La façade est fissurée de partout. La peinture vert lime part en lambeaux. Sur sa gauche une sérénade s’échappe des trois hautes portes à œil-de-bœuf du bar à filles caverneux qui occupe le rez- de-chaussée d’une bâtisse coloniale de même style mais encore plus décatie. C’est l’heure creuse. Il n’y a que des mouches autour des tables. L’unique serveur est plié en deux sur un tabouret : il somnole en attendant la reprise. Un travesti essaie de faire du scandale dans la pharmacie voisine pour qu’on échange sa seringue. Personne ne lui prête attention. Il y a du bruit et du monde partout. Les piétons débordent des trottoirs encombrés d’étals et se répandent sur la chaussée chaque fois que le flot de véhi- cules stoppe au feu rouge de l’autre côté du pont peintur- luré qui enjambe le rio Beberibe. Cruz part à l’assaut des marches abruptes. La cage d’escalier empeste la pisse. Il prend le temps de souffler au deuxième puis repart. Un petit bonhomme d’une cinquantaine d’années l’attend sur le palier suivant. Une sorte de nègre blanc aux cheveux gris crépus et aux bras maigres. Il est taillé comme une amphore : sa bedaine saillante dissimule mal un début de cachexie. Il sent l’aguardente à plein nez. Encore un que l’alcool ne tardera pas à liquider. Son visage est à la fois bouffi et osseux. Comme si ses cellules graisseuses avaient décidé d’abandonner ses joues concaves pour migrer vers son cou et les replis de son triple menton. Il porte un costume beige en lin trop serré dans sa partie centrale et trop flasque ailleurs. Ses chaus- sures en cuir ocre sont artisanales et doivent venir d’un marché de Bahia. Une paire de lunettes à monture métal- lique chevauche son nez épaté. Enchanté, monsieur Silva. Cruz lui serre la main : calleuse. Je cherche un meublé, dit Silva. Pour un temps. Son accent est encore plus fort qu’au téléphone. Ce plouc doit sortir tout droit d’un champ de canne de la Zona da Mata. Cruz ouvre la porte et le précède dans l’appart. L’odeur de renfermé l’agresse encore plus qu’à l’agence. Un moignon de couloir aveugle dessert les trois pièces. Il pousse d’abord la première porte à gauche. C’est la chambre. Le mobilier se réduit à une armoire en mélaminé et à un vieux sommier à lattes sur lequel est jeté de travers un matelas en mousse jaune. Plus une chaise sous l’ampoule nue qui oscille au plafond. On crève, grommelle Silva. Il enlève sa veste et la jette sur le lit. Y a des ventilateurs, j’espère ? Un seul. Mais je peux vous proposer un studio clima- tisé à… Laissez tomber. Je suis allergique à la clim. Après avoir visité la salle de bains située en vis-à-vis de la chambre – étonnamment spacieuse avec sa baignoire à pieds – ils reprennent le couloir et arrivent dans ce qui tient lieu de séjour. Une pièce sommairement séparée de la kitchenette par une minuscule table en formica bleu ciel flanquée de deux tabourets assortis. Trois coussins en tissu vert à rayures jaunes recouvrent une banquette en maçonnerie que personne ne volera jamais. Idem pour la verrue qui fait office de table basse. Cruz ouvre les rideaux. Ça pue, fait Silva en balayant la pièce du regard. Et je parie qu’on entend tout ce qui se passe chez les voisins. Vous faites des contrats à la semaine ? Renouvelables ? Bien sûr. Nos contrats sont les plus souples du marché. Vous comptez rester combien de temps ? Le moins longtemps possible. Si Dieu le veut. Vous êtes ici en vacances ou pour le travail ? Travail. Mais je peux pas encore vous dire combien de temps je vais rester. Ce n’est pas un problème. Vous connaissez Recife, monsieur Silva ?
J’ai habité dans le coin, mais la ville a changé. C’était plus calme dans le temps. Vous venez de loin ? Tout dépend de ce qu’on appelle loin, jeune homme, soupire Silva en déposant sa valise sur les petites lames noires du parquet. Bon. C’est pas terrible mais ça ira. Nous avons beaucoup mieux en termes de rapport qualité-prix, monsieur Silva. Ce quartier n’a pas très bonne réputation. On est trop près du port. Pour la zone sud – à moins de deux minutes à pied du front de mer – nous avons en ce moment une offre promotionnelle à cent quatre-vingt mille cruzados par mois. Vous ne trou- verez pas mieux. Silva lâche un sifflement. C’est au-dessus de mes moyens. Nos autres produits sont impeccables. Et les proprié- taires sont obligés d’anticiper l’inflation. Je prends celui-ci. Il n’a pas le téléphone. Ni la télé. Aucune importance. Il y a des draps ? Des serviettes ? De quoi se faire à manger ? Bien sûr. Tous nos appartements sont entièrement équipés. Mais vous avez sûrement remarqué que cet immeuble n’a pas de portier. Il n’y a pas non plus de veil- leur de nuit. Je dois vous dire que le quartier est assez dangereux le soir. Tous ces marins étrangers, forcément. Ça attire les voleurs et les filles. Nous recommandons à nos clients de n’ouvrir à personne. Ça risque pas. On voit le contrat ? Cruz sort sa calculatrice et fait voler ses doigts sur les touches.
Le loyer est réglable d’avance. Il faudra rajouter la taxe d’habitation et la consommation d’électricité. Ça vous fera quatre-vingt-six mille trois cent soixante cruzados en tout. Ok. Allez-y. Cruz tend la main. Il me faudrait une pièce d’identité. S’il vous plaît. Bien sûr. Silva acquiesce. Il palpe l’une après l’autre ses poches de pantalon et regarde Cruz d’un air navré. Bon sang, je… j’ai dû laisser mes papiers à l’hôtel. Non mais quel con. Un ange passe. Cruz est sur le point d’ouvrir la bouche quand le visage de Silva s’éclaire. Ah, heureusement que j’ai pensé à prendre mon fric. Ça j’en suis sûr, je me rappelle qu’il a fallu que je sorte mon portefeuille de ma poche intérieure pour y caser la liasse. Et j’ai oublié de le récupérer, c’est tout moi. Ça m’inquiète un peu, vu la racaille qu’ils engagent mainte- nant dans les hôtels. On ne peut plus rien laisser traîner. Mais bon, l’argent est le nerf de la guerre, pas vrai ? Et je connais mon numéro de carte d’identité par cœur. Celui de mon CPF aussi, si vous voulez. La main de Cruz retombe. Impossible d’établir un contrat sans pièce d’identité, monsieur Silva. C’est la loi. Puisque je vous dis que j’ai oublié mes papiers à l’hôtel. Faites-moi ce contrat, l’ami. Je passerai vous les montrer tout à l’heure à votre agence. Mais je dois libérer ma chambre avant midi. Vous connaissez le système. Je regrette, monsieur Silva. C’est impossible. Silva. Le nom de ce type sonne aussi faux que son histoire de papiers oubliés. Montenegro a eu récemment de gros ennuis avec la police civile pour avoir loué une temporada de Boa Viagem à un trafiquant de coke évadé du Carandiru. Calmer les flics leur a coûté cher. Silva revient à la charge. Bon. Je vais être franc avec vous. Je suis ici incognito et j’ai besoin de cet appartement tout de suite. C’est une question de vie ou de mort. Il y a trente mille de mieux pour vous si on signe dès maintenant. De la main à la main. Je ne mange pas de ce pain-là, monsieur Silva. Bien sûr. Je comprends. Mais écoutez-moi. Ma vie est en danger. Je suis syndicaliste dans une distillerie de l’intérieur. Je défends les coupeurs de canne. Il y a un contrat sur ma tête. Il faut m’aider, jeune homme. Ils ont décidé de me liquider. Parce que je me bats contre la misère dans les plantations. Je ne vois pas en quoi je… Trente mille cruzados pour remplir un formulaire- type en cinq minutes… J’en connais plus d’un qui signe- rait à deux mains. Surtout par les temps qui courent. Cruz porte une main à sa croix d’or. Son loyer sera exigible le surlendemain et il manque quarante mille cruzados sur son compte pour éviter le couperet de la correction monétaire – qui doit tourner ce mois-ci autour de dix-neuf ou vingt pour cent. Ça restera entre nous. Promis. Personne n’en saura rien. Cruz sent vaciller sa détermination. L’image d’Oscar Montenegro vient de surgir dans son esprit et commence à lui brouiller les idées. C’est de sa faute s’il se retrouve dans cette galère. Et avec son alcoolémie toujours au-dessus de deux grammes le vieux n’y verrait que du feu. Non. Vraiment. Je… Ma vie est entre vos mains. Cinquante mille. Quarante. Et c’est mon dernier mot. Cruz soupire. Il tire un tabouret et s’assied à la table. Il ouvre sa serviette. Vous me réglez d’abord et je vous établis le contrat. Bon. D’accord. Où est ma veste ? Ah oui. Je l’ai laissée sur le lit. Mais vous êtes dur en affaires, mon garçon. Cruz éprouve une pointe de remords en voyant Silva disparaître dans le couloir. Et puis non. Il songe à Fátima. À la chambre du bébé. N’importe qui ferait pareil dans sa situation. Il se met à remplir le formulaire- type pour penser à autre chose pendant que les pas de son client s’estompent de l’autre côté de la cloison. Un crac sourd explose dans l’entrée. La porte claque et Cruz entend un début de cavalcade. Un cri le fait tressaillir. La voix de Silva. Cruz se lève d’un bond. La cavalcade recommence. Cette fois c’est dans la chambre. Une détonation claque. Et une seconde. Silva crie encore. Moins fort. Mais plus longtemps. Cruz attend quelques secondes avant de risquer un œil entre le chambranle et le battant entrou- vert de la porte du séjour. Il voit un homme de dos émerger de la chambre en portant Silva sous les aisselles et se diriger vers la pièce d’en face : la salle de bains. Un blond assez costaud mais pas très grand. La tête de Silva est renversée en arrière et se balance. Ses jambes tendues semblent en lévitation à cinquante centimètres du sol et ses genoux sont déjà dans la salle de bains. Quelqu’un d’autre le tient par les chevilles mais le retour de cloison empêche Cruz de le voir. Cruz ne distingue plus personne mais des murmures lui parviennent. Suivis d’un cri qui dégénère en gargouillis. L’entrée n’est pas loin. Quatre ou cinq enjambées le séparent du palier. C’est le moment ou jamais. Cruz va s’élancer quand deux hommes sortent de la salle de bains. Le blond d’abord et derrière lui une ombre que Cruz a à peine le temps d’entrapercevoir avant de se plaquer contre la cloison juste derrière la porte du séjour. Allez, fait une voix d’homme. On prend le dossier et on se tire. Tu es sûr qu’il a son compte ? T’as pas vu comment ça pissait ? Je lui ai tranché la carotide. Va jeter un œil au salon. Je m’occupe de la chambre. Cruz se mord les lèvres et ravale de justesse le cri qui enfle dans sa gorge. La porte du séjour pivote doucement sur ses gonds. Dans l’interstice Cruz voit apparaître un homme de dos. Pas le blond : l’autre. Grand. Brun. Effrayant. L’homme s’avance à pas de loup vers la table où sont restés sa serviette et le contrat avec son stylo dessus. Il s’arrête. Il va se retourner. Cruz se jette en avant et le pousse de toutes ses forces entre les omoplates. L’homme s’affale sur la table avec un grognement. Cruz se précipite dans le couloir. Hé. Jamais il n’oubliera la tête du blond accroupi devant la valise ouverte de Silva au moment où il traverse en trombe le seuil de la chambre. Son visage lunaire. Son front bombé immense. Ses cheveux jaune sale coiffés en arrière. Ses yeux bleus étrangement rieurs. Globuleux. Écartés. On dirait un poupon monstrueux. Le blond se redresse et porte la main droite à sa ceinture. Cruz est déjà sur le palier. Une balle lui siffle aux oreilles et il plonge dans la cage d’escalier et se laisse tomber en roulade avec les bras autour de la tête. D’autres balles fracassent le bois et le mortier autour de lui. Cruz poursuit son roulé-boulé jusqu’à l’étage infé- rieur et se redresse. Ça galope juste au-dessus. Il dévale les deux interminables volées de marches restantes. Il jaillit dans l’aveuglante clarté de la rua da Aurora et prend ses jambes à son cou. Plusieurs étals de camelots s’effondrent comme des châteaux de cartes sur son passage et la rue se fige pour suivre la course de ce drôle de fugitif. Il y a une seconde de flottement. Quelques désœuvrés s’élancent gaiement dans son sillage en criant au voleur. Ils ont envie de savoir comment finira l’incident. Cruz vire à angle droit au coin de la rua Capita˜o Lima. Ses poumons sont en feu. Au bout de quelques mètres il jette sans ralentir un regard par-dessus son épaule. Un début de meute hilare l’a pris en chasse. Ses jambes faiblissent à chaque foulée. Il sait qu’il n’ira plus bien loin. Un brouillard gris envahit peu à peu son champ de vision. Un gant de fer lui broie le cœur. Arrêtez-le. Il m’a saccagé mon étal. Droit devant Cruz apparaissent deux silhouettes casquées. Il ralentit et se laisse tomber aux pieds des poli- ciers militaires. Jamais il n’a ressenti un tel soulagement. Une pluie de coups de matraque s’abat sur son dos. Sa tête. Sa nuque. Son ventre. Ses genoux. Il est à bout de souffle et incapable de crier. Il ne peut que se recroque- viller sur les pavés. Une botte ferrée lui écrase la main droite. C’est celle du plus grand des deux PM. Un mous- tachu. Le moustachu cesse de le frapper. Il se met les poings sur les hanches et balaie du regard le cercle de curieux. Qu’est-ce qu’il a fait ? Les réponses fusent. Aucune idée, chef. Il a volé à l’étalage. N’importe quoi. T’as vu comment il est habillé ? Il a piqué le sac d’une vieille. Pas du tout. Je l’ai vu sortir en courant d’un immeuble. Rua da Aurora. Peut-être que c’est un cambrioleur. Ou un pervers. Le PM moustachu fait un signe de la main et son collègue ralentit la cadence de ses coups puis s’arrête pour de bon. Le calme revient. Cruz est en position fœtale. Il a pris une botte ferrée dans les couilles. Bon, fait le moustachu en ôtant son casque. Qui c’est qui a vraiment vu quelque chose ? Qui c’est qui serait prêt à témoigner ? Les badauds se replient dans un silence ponctué de quelques rires. Puis une vague de murmures s’élève quand une vieille Indienne aux joues ravinées fend la foule pour se planter devant les policiers. Moi je l’ai vu sortir du 132. Juste à côté du cabaret. Je vends des raisins devant. Vous avez qu’à demander. Ce fumier m’a renversé mon étal. Il avait le feu au cul. Tout le monde éclate de rire. Vous êtes sûre, mamie ? Par le sang du Christ. Faut qu’on aille voir ça, dit le moustachu en se tournant vers son collègue penché sur Cruz. Allez Carlos, on l’embarque. Les deux agents forcent Cruz à se lever et le traînent jusqu’à la rua da Aurora. La foule qui leur emboîte le pas enfle à vue d’œil et ramasse dans ses filets tout ce qui arrive en sens inverse. Le serveur du bar à putes émerge de sa somnolence à l’arrivée du cortège et s’avance sur le seuil comme un zombie. Deux camelots se disputent encore les colifichets répandus sur le trottoir. Cruz commence à reprendre ses esprits. Le mous- tachu s’en aperçoit et l’oblige à lever la tête en lui tirant les cheveux. C’est quoi ce bordel ? Tu vas nous dire ce que t’as fait, oui ou merde ? Un bredouillis s’échappe des lèvres de Cruz. Il est incapable d’articuler un mot. On n’a qu’à monter voir, propose l’autre PM. Un vieillard torse nu dévale la cage d’escalier. Il ne porte qu’un short usé en nylon rouge et a l’air hors de lui. Ses bras fripés sont couverts de tatouages. Ah, les flics. Grâce à Dieu. Vite. Montez vite. Qu’est-ce qui se passe ? demande le moustachu. En face de chez moi. Au troisième. La porte a été enfoncée. Elle est ouverte. J’ai rien vu mais y a eu un boucan de tous les diables. J’ai eu la peur de ma vie. Dépêchez-vous. Le vieillard a un fort accent étranger. Encore un marin échoué à Recife. Vous avez entendu quelque chose de pas normal ? Des bruits suspects ? Et comment. Des coups de feu. Je sais pas combien. Y a toujours cette odeur de poudre dans l’escalier. Vous sentez pas ? Il y a du monde là-haut ? Je sais pas. Je crois pas. J’ai attendu longtemps avant de sortir. Y a plus personne. Vous risquez rien. Cruz sent des mains le pousser vers l’entrée de l’immeuble. Ils arrivent au pied de l’escalier. Un des PM l’encourage à monter d’un coup de casse-tête derrière les cuisses. Ils arrivent au troisième. Le moustachu dégaine et se met en position d’intervention devant la porte entre- bâillée. Il souffle comme un bœuf. Il jette un regard à son collègue et pousse le battant de la pointe de sa botte. Il entre dans le meublé l’arme au poing. À peine a-t-il disparu qu’un silence s’abat sur le palier. Cruz est toujours plié en deux mais voit l’inquiétude grandir dans les yeux du PM resté en couverture quand une espèce de grognement s’échappe de l’appartement. Le moustachu revient peu après. Il est blanc comme un linge. Carlos. Viens voir. Ça vaut le coup d’œil. Les deux flics escortent Cruz jusqu’à la salle de bains. Le cadavre égorgé de Silva barbote dans son sang au fond de la baignoire. Ses yeux écarquillés fixent le plafond et ses lèvres sont tordues en un rictus imbécile. La valise de Silva est renversée dans la chambre. Ses affaires gisent éparses sur le sol. Le moustachu observe Cruz en fronçant les sourcils. Qu’est-ce qui t’a pris, salopard ? Cruz secoue la tête. Carlos lui flanque une gifle sonore.