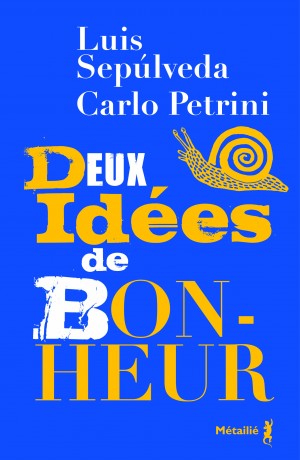Ce texte est né d’une conversation entre deux hommes venus d’horizons et de pays différents, l’écrivain chilien Luis Sepúlveda et le gastronome italien Carlo Petrini, défenseur du slow food et du “manger local”. De l’Amazonie au cœur de l’Afrique, de l’expérience amère de l’exil à la communion collective de Terra Madre, les souvenirs et pensées de ces deux auteurs d’exception tissent une conversation qui passe en revue l’actualité et la littérature, la gastronomie et la politique, la défense de la nature et de la tradition. Rencontres, récits, histoires de grands leaders et de petits héros du quotidien, Petrini et Sepúlveda nous entraînent à leur suite dans cette quête du droit au plaisir qui est aujourd’hui le plus révolutionnaire, le plus démocratique, le plus humain des objectifs. Avec cependant la lenteur et la sagesse de l’escargot. Parce que nous aussi nous pouvons cesser de courir vers une destination inconnue, et recommencer pleinement à exister.
-
"Le bonheur est à portée de main et de tous, voilà le message de Sepulveda et de Petrini dans ce magnifique roman plein de bon sens et de poésie. Comme une discussion amorcée par nos deux comparses, cet ouvrage nous livre les clefs du bonheur au quotidien, de la gastronomie, à la nature en passant par la lecture et le politique. Le bonheur n'est pas que dans le pré, la preuve, il est dans ce livre! "
Sarah Ponzo
-
"Ils étaient faits pour se rencontrer. Ce livre est né d'une conversation savoureuse et philosophique." Lire l'article ici
Claude BaudryL'Humanité -
"Au fil d'une conversation intimiste et stimulante, le mieux manger au quotidien apparaît comme l'une des pistes les plus sûres pour accéder au bonheur." Lire l'article ici
François-Régis GaudryL'Express Styles -
"Chacun le sait, qu'elles soient spirituelles ou terrestres, les nourritures sont associées à la sensation de plaisir. Mais l'écrivain chilien Luis Sepûlveda et le sociologue italien Carlo Petrini vont plus loin." Lire l'article ici
Gérard GuéganSud ouest dimanche -
"Avant d'être un écrivain, je suis un citoyen, et en tant que tel, j'estime que j'ai une série de devoirs sociaux extrêmement importants." Lire l'entretien ici
Entretien de Mohammed AïssaouiLe Figaro -
"L'échange entre l'écrivain chilien Luis Sepûlveda et le fondateur du mouvement Slow Food, Carlo Petrini, a les vertus d'un baume apaisant. Vivifiant même." Lire l'article ici
P. de G.Les Echos week-end -
Voir la chronique et le grand entretien ici
Philippe LefaitDes mots de minuit.fr
Conversation entre Carlo Petrini et Luis Sepúlveda
Carlo Petrini : Luis, ton dernier livre, Histoire d’un escargot qui découvrit l’importance de la lenteur, m’a beaucoup ému, parce qu’il parle d’un concept fondamental pour Slow Food, avec son animal symbole. Tu dis que ce livre est né d’une question de ton petit-fils…
Luis Sepúlveda : Les enfants exigent des réponses de type poétique. La question portait sur la lenteur. Je lui ai dit : “Laisse-moi un peu de temps et je répondrai à ta question.” C’est comme ça que l’histoire de l’escargot est née. Et j’ai découvert, en faisant des recherches sur ce thème, que dans bien des contextes ethniques l’escargot est un symbole d’équilibre. Parce que l’escargot possède le nécessaire, juste le nécessaire. Il a l’espace exact dans lequel habiter, son exosquelette : s’il doit grandir de deux millimètres, son exosquelette grandit de deux millimètres, pas plus.
CP : J’aime le passage où il monte sur le dos de la tortue et dit : “Comme tu vas vite !” Tout est relatif. La lenteur, naturellement, est notre mot d’ordre. Quand nous avons élaboré l’idée du Slow Food, il y avait déjà cet élément philosophique, et avant il y avait eu le livre de Milan Kundera, La Lenteur ; notre manifeste fondateur disait : “Contre la vie dynamique, nous défendons la vie confortable. Contre ceux, majoritaires, qui confondent l’efficacité avec la frénésie, nous proposons le vaccin de plaisirs sensuels en juste proportion, à pratiquer dans une lente jouissance prolongée.” Parce que Slow Food repose aussi sur le droit au plaisir, lié de manière indissoluble à la lenteur : chacun des deux est nécessaire à l’autre. Malheureusement, la revendication, décidée, du droit au plaisir a toujours entraîné autant de joie que de peine. De peine parce qu’elle nous a aussitôt placés dans la catégorie des privilégiés, ceux qui grâce à leur argent peuvent mieux manger que les autres. Et de joie parce que je pense que le droit au plaisir est un droit universel de toute l’humanité, pas seulement des riches. Je suis agnostique, les plaisirs, je préfère les avoir sur cette terre plutôt que dans l’autre monde.
LS : Ce serait l’idéal, oui. Le droit au plaisir pourrait être considéré comme l’autre visage du droit au travail, qui est un des droits humains fondamentaux auquel tout le monde semble avoir renoncé dernièrement : partis et organisations politiques, de droite comme de pseudo-gauche. Tous s’emploient à dégrader ce thème, on parle du travail comme d’une espèce de cadeau, plutôt que d’un droit, oubliant que la défense du travail est la défense de l’unique arme de lutte des travailleurs. Voilà, le système qui attente au droit au travail, au nom de l’intérêt des entrepreneurs et des banquiers, est le même qui refuse ensuite aux travailleurs, à la partie de l’humanité qui n’est pas riche, le droit au plaisir. Entendu non comme un luxe, mais comme la liberté qui garantit des joies simples, ne serait-ce que se promener dans sa ville, contempler la vie, regarder autour de soi et découvrir des petits éléments de bonheur.
Un des problèmes de ces dernières années, un des motifs pour lesquels nous avons gâché des occasions de changer, c’est qu’en Amérique latine, comme dans presque le monde entier, nous avons eu une gauche stoïque, spartiate, qui ne s’est pas posé le problème du principe du plaisir, entendu comme dignité pour tous. Une gauche qui résonne presque comme le message religieux promettant le paradis après la mort parce que notre monde est un monde de souffrances. Le message de cette gauche est presque le même : aujourd’hui il faut souffrir, et après la révolution on pourra conquérir le bonheur. Changer cette culture est difficile. De ce point de vue, les initiatives qui revendiquent la dignité, la vie bonne, le bon gouvernement, le respect de l’environnement, sont une minorité. Qui grandit de manière systématique, mais reste encore, malgré tout, une minorité. Alors que ce discours doit devenir universel, et le message résonner bien clairement : la vie est courte, bonne, et il y a un droit fondamental qui est le droit au bonheur. Qui ne se manifeste pas et ne doit pas se confondre avec une sorte de droit naturel à devenir riche, ou à surpasser les autres. Nous parlons d’un autre bonheur. Des petites satisfactions, qui pourtant valent beaucoup.
CP : Bien sûr, sur cette terre et pas dans l’autre monde, le droit au plaisir doit être garanti à tous et pour cela il faut aussi mesurer notre capacité à ne pas exagérer, comme l’escargot. Parce que dans le domaine alimentaire le plaisir n’est pas la débauche, l’excès, l’égoïsme de penser à soi sans partager.
Nous tous qui venons de la gauche, les discours sur le partage et sur les limites, nous les avons dans notre adn. Mais tandis qu’une partie de la gauche aimait souffrir, ou plutôt faisait semblant d’aimer souffrir, beaucoup d’entre nous ont choisi un autre modèle. Parce que le droit au plaisir doit être revendiqué, et je dois dire que là-dessus nous n’avons pas encore été très bien compris. Slow Food a réussi à changer la donne avec Terra Madre (le grand rassemblement international des communautés alimentaires, organisé par Slow Food depuis 2004 tous les deux ans, qui est devenu aujourd’hui un puissant réseau mondial de l’alimentation durable, cf. www.terramadre.org), et maintenant nous allons la changer encore plus avec l’Afrique (avec le projet “Dix mille potagers en Afrique”). De temps en temps, il faut donner des objectifs précis à un réseau très libre comme celui de Terra Madre. Au dernier congrès international de Slow Food, nous avons dit : “Aujourd’hui, l’homme doit libérer l’Afrique de la faim, parce qu’on ne peut pas parler d’alimentation tant qu’on meurt encore de faim.” Changer la donne signifie faire comprendre que la bataille pour le droit au plaisir c’est aussi cela, que le plaisir pour tous passe aussi par ces grandes questions de civilisation. C’est un scandale qu’aujourd’hui on souffre encore de la faim et de la malnutrition dans le monde.
À ce propos, il m’est venu à l’esprit une analogie entre la faim et l’esclavage. Quand les États-Unis d’Amérique sont nés, alors qu’un pays entier écrivait une constitution dans laquelle on proclamait l’égalité et le droit au bonheur, il y avait encore des esclaves. Et pour vaincre cette barbarie, il a fallu deux siècles parce que la dernière loi esclavagiste a été abolie au xxe siècle. Nous sommes dans la même situation avec la faim. Personne ne met en doute le droit à manger à sa faim, mais nous vivons avec le fléau de la famine et de ses victimes. Elles sont là, qui nous interpellent. La fao dit qu’il suffirait de trente-quatre milliards de dollars par an pour résoudre le problème. Soit à peine quelques bombardiers en moins. Une bricole pour les gouvernements du monde ! Mais ces personnes continuent à mourir, dans l’inertie générale. Pour éviter tout malentendu, disons que moi, à ce point-là, je ne crois plus beaucoup aux interventions extérieures, aux structures internationales qui devraient résoudre le problème. Il faut commencer par autre chose, travailler dans une autre direction. Dans nos communautés africaines, par exemple, il n’y a pas de missionnaires, de fonctionnaires, de coordinateurs ou de personnel salarié qui viendrait de l’extérieur. Il n’y a que des citoyens africains. Parce que nous devons faire en sorte que les Africains puissent se libérer d’eux-mêmes de cette honte. Nous autres Occidentaux, jusqu’à présent nous nous sommes contentés de spolier l’Afrique, à travers des formes terribles de colonialisme ou de néo-colonialisme, il est temps que nous commencions à restituer quelque chose. Nous devons les aider, mais sans leur expliquer ce qu’ils doivent faire, nous devons seulement les laisser faire. Et c’est là que le droit au plaisir doit être revendiqué, en Afrique ! Un plaisir sobre, juste, la possibilité de manger suffisamment et bien, d’arriver à la fin de la journée sans l’angoisse de ne rien avoir à donner à manger à ses enfants.
Sur ce plan, sur le plan de l’autonomie des peuples et de leur capacité à être les acteurs de leur propre changement, nous n’y sommes pas encore. Quand on me demande quels sont les piliers de Terra Madre, j’en indique deux. Le premier, je l’appelle “intelligence affective” : j’aimerais que tu puisses venir au Salon International du Goût et Terra Madre 2014 pour voir comment ces dix mille paysans de religions et de territoires on ne peut plus variés interagissent entre eux. Dans ce contexte, tu sens l’intelligence, mais une intelligence différente de l’intelligence purement rationnelle, parce que faite d’anciennes saveurs et aussi de beaucoup d’humanité, de la capacité à s’aimer et à se resserrer autour de nos existences, dans un sentiment de partage. Le deuxième pilier est ce que je décris comme une “austère anarchie” : chacun chez lui fait ce qu’il veut. Moi, italien, je ne peux pas aller en Amérique latine décréter ce qu’ils doivent semer. Du reste, le réseau, si c’est un vrai réseau, ne doit pas avoir une structure hiérarchique, il faut le laisser libre. C’est un discours difficile, je le sais, mais c’est le seul possible. Nos communautés ont une créativité et une capacité à interpréter le territoire qu’aucune organisation ne pourrait jamais donner. Aucune. Je viens juste de rentrer du Brésil. Dans les favelas, nos amis sont en train de construire des écoles de cuisine pour les jeunes des deux sexes, dont l’une, la “Favela Orgânica”, est dirigée par un personnage spécial, la cuisinière Regina Tchelly : ils ont des petits potagers, grands comme ce canapé, sèment dans la cour de chaque maison pour que chaque famille puisse subvenir à ses besoins et en même temps redécouvre la culture du jardin. Ce sont elles, les communautés, qui produisent le changement ! Nous devons nous tenir à leurs côtés !
De ce point de vue, en lisant l’histoire de ta vie et de tes batailles, j’ai découvert que c’est un sentiment de communauté idéale qui nous unit, je crois : tu as été, et tu es, un combattant sincère de la démocratie, pour les droits civils. Tu as vécu au contact de Salvador Allende, tu as partagé des moments très importants de l’histoire latino-américaine, comme la révolution sandiniste au Nicaragua, tous ces mouvements qui ont contribué à plusieurs titres et de plusieurs façons à faire du continent latino-américain un des lieux de plus grande espérance en l’avenir. Par exemple, tu as eu une expérience avec les Indiens en Équateur, il y a plus de trente ans…
LS : En 1977-78, j’ai vécu avec les Indiens de la serranía, la partie andine de l’Équateur, et aussi dans une autre région dans la province de Cotopaxi, où Slow Food aussi est présent, je crois. C’était le début de mon exil, j’ai travaillé avec le syndicat des paysans à l’alphabétisation de la zone. Je me suis inspiré de mes lectures de Paulo Freire et en partant de celles-ci, j’ai inventé une méthode pour alphabétiser, en me débrouillant tout seul, en réunissant les textes, les images, tout le nécessaire. En six mois, nous avions trente mille personnes qui savaient lire et écrire.
CP : Comment était gouverné l’Équateur ?
LS : Il y avait une dictature étrange, un général médiocre tyrannisé par sa femme : la vraie dictature, c’était celle de cette dame. On ne pouvait pas parler de vraie répression, surtout parce que, possédant du pétrole, l’Équateur était un pays riche. Et malheureusement, à cause de la concentration sur l’or noir, les autres problèmes étaient négligés : l’agriculture, l’Amazonie, les paysans… rien de tout cela n’était important, seulement le pétrole. De 1975 jusqu’à 1983, l’Équateur a été le deuxième producteur de pétrole d’Amérique latine, après le Venezuela, ce qui a procuré une énorme fortune à une classe sociale très réduite. Personne évidemment ne payait d’impôts dans le pays, les capitaux migraient vers les îles Cayman et autres paradis fiscaux.
Après deux ans en Équateur, je suis allé au Nicaragua. La révolution sandiniste a triomphé en juillet 1979. En mars de cette année un appel pressant avait été lancé à tous ceux qui étaient capables de combattre, pour qu’ils se précipitent au secours de la révolution. C’est ainsi que nous avons formé la dernière brigade internationale, la brigade internationale Simón Bolívar : nous étions un groupe de Sud-Américains – des Argentins, des Chiliens, des Uruguayens – plus quelques Européens, par exemple quelques Italiens et deux ou trois Allemands. Nous sommes partis en hâte pour le Nicaragua, pour aller combattre. Et nous avons vaincu ! Ça a été la seule fois, mais nous avons vaincu.
Je suis resté au Nicaragua jusqu’en janvier 1980, mais je n’ai pas aimé l’évolution du pays. La révolution au pouvoir est partie du mauvais pied, sans rien faire pour éviter la corruption, le vrai problème du pouvoir. Sans comprendre qu’un conflit armé qui avait duré si longtemps avait besoin d’une solution radicalement pacifique. Une seule personne l’avait compris, un commandant de la révolution nommé Eden Pastora, dit commandant Zéro, qui avait un plan : après le triomphe de la révolution, le 19 juillet 1979, nous aurions dû jeter tout de suite les armes, en faire un grand bûcher et solliciter l’aide des Nations Unies pour défendre les frontières du Nicaragua. Ainsi, au lieu de dépenser trente pour cent des ressources pour la défense, nous aurions pu travailler à relever le pays. Mais aux États-Unis Reagan était au pouvoir, il a tout de suite lancé l’opération Contras ; la violence a continué et la violence engendre la corruption. Les résultats sont clairs. L’actuel président du Nicaragua, Daniel Ortega, un des commandants de la révolution sandiniste, a maintenant un patrimoine personnel de plusieurs millions de dollars et des résidences à l’étranger. C’est ainsi qu’a fini la révolution.
CP : D’un côté Reagan qui s’en prend à elle, de l’autre ces gens qui retournent leur veste… Il faudrait approfondir cette mutation génétique d’un processus révolutionnaire.
LS : Et c’était vraiment une belle occasion pour un peuple comme celui du Nicaragua, qui depuis tant d’années luttait pour sa liberté. Sandino avait commencé sa lutte en 1927. Le premier commandant de la révolution avait été Tomás Borge, un des fondateurs du mouvement sandiniste ; il avait passé vingt ans en prison. Nous l’avons libéré en juin, un mois avant la victoire. Après vingt ans dans ce trou, il quittait la prison presque invalide, presque un vieillard. Pour tout le monde, c’était un camarade à la morale indiscutable, une figure indiscutable. Deux ans au pouvoir ont suffi à le transformer en une espèce de caricature, une bête pleine d’ambition personnelle, avec un robinet en or chez lui. Quand on a passé vingt ans en prison, on peut bien désirer une douche, ou même un peu de luxe, mais un robinet en or ? Pastora, au contraire, a choisi une autre voie. Il a compris que les choses finiraient mal et il est parti à la frontière du Costa Rica pour devenir pêcheur, dans une quasi-clandestinité. Il vit encore là, malgré son âge il a un physique de pêcheur, avec des bras puissants.
CP : Un personnage que je voudrais absolument connaître. Celui qui travaille la terre, qui pêche, qui entre en rapport avec la nature pour se procurer de la nourriture de manière respectueuse est une personne à connaître et à écouter. Souvent ils sont considérés comme les derniers, les humbles, mais à bien y regarder ils peuvent beaucoup nous apprendre, nous expliquer beaucoup de choses de la vie. Qui sait ce qu’un homme comme Pastora aurait à nous raconter… Mais à propos de politique, au Chili, il y a du renouveau dans l’air, non ?
LS : La grande nouveauté, ce sont les quatre jeunes gens du mouvement étudiant entrés au Parlement aux dernières élections. Camila Vallejo est la plus célèbre. Il y a du nouveau dans l’air mais voyons qui résiste, ne serait-ce que parce que, comme dans beaucoup d’autres pays, l’abstentionnisme augmente : aux élections de 2013, le pourcentage de votants a été très bas, cinquante pour cent. Mais l’histoire n’aide pas, parce que cette méfiance des électeurs vient de loin.
Revenons en arrière, à la fin des années 80. Au plébiscite de 1988, au Chili, le “non” à la dictature l’emporte et commence une grande mobilisation sociale. Il faut se rappeler que, durant les seize ans de dictature, il y a toujours eu une force politique clandestine pour conserver la mémoire d’une autre possibilité de vie, la possibilité démocratique : un groupe militaire très fort qui s’appelait Frente Patriótico Manuel Rodríguez, des gens très jeunes, presque tous membres des jeunesses communistes. Quand la possibilité d’une solution pacifique émerge, avec une immense sagesse ils quittent la lutte armée et, aux premières élections de 1989, affrontent la vieille droite traditionnelle. Ils constituent une nouvelle force politique très puissante avec plusieurs partis, parmi lesquels le vieux parti socialiste, la vieille démocratie chrétienne et un petit parti social-démocrate : ils fondent la “Concertation pour la démocratie”, avec un slogan très efficace : la alegría, c’est-à-dire le bonheur, arrive. Un slogan qui veut indiquer la fin de la longue nuit sombre de la dictature. Premier point du programme, une nouvelle constitution, parce qu’un pays ne peut pas fonctionner avec une charte constitutionnelle élaborée sous une dictature ; d’autres thèmes importants sont traités, parmi lesquels la justice sociale ; bref, tout ce qui manquait jusque-là au Chili.
Le premier gouvernement arrive, avec un président démocrate-chrétien, mais l’alegría… elle non, elle n’arrive pas. On ne change pas la constitution, les injustices continuent, la corruption aussi. Au deuxième gouvernement, socialiste, on se dit : maintenant, elle va venir, l’alegría ! Mais la déception est encore pire quand on constate qu’elle s’est plutôt éloignée. Pour donner un exemple pratique, elle aurait eu besoin d’un peu d’alegría, cette large couche de fonctionnaires, d’enseignants, de travailleurs de la santé qui aujourd’hui ont entre soixante-dix et quatre-vingt-cinq ans et qui un peu avant la fin de la dictature, en 1982, n’étaient pas loin de la retraite. Même dans les moments les plus sombres de la sécurité sociale chilienne, il existait une caisse qui assurait à cette catégorie une retraite digne. En 1982, la dictature décida de prélever l’argent de cette caisse, c’est-à-dire les retraites d’une quantité énorme de gens, et de le jouer en Bourse. Et elle le perdit. Il n’y eut ni excuses ni remèdes, mais juste un communiqué public : “Excusez-nous, le gouvernement, pensant bien faire, a joué en Bourse l’argent de vos retraites, c’est dommage, ça a mal tourné.” Et sous une dictature vous ne pouvez pas protester. Voilà, là, dix ans étaient passés mais le minimum d’alegría auquel on s’attendait du nouveau gouvernement socialiste était qu’il dise à ces gens : vous allez recevoir une petite compensation. Au moins un minimum. Et en réalité toute une génération est morte sans jamais la recevoir. Ma mère était une de ces personnes, elle avait travaillé toute sa vie et, à la fin, pas de retraite. Ils ont vécu leurs dernières années dans une énorme pauvreté, soutenus par la solidarité sociale.
Avec le troisième gouvernement, de nouveau démocrate-chrétien, l’alegría n’arrive toujours pas. Et pire encore avec le dernier espoir, Michelle Bachelet. Durant son premier mandat, de 2006 à 2010, la tromperie a été énorme. D’une part, ça se comprend, une constitution élaborée sous une dictature n’aide pas à changer les choses ; mais, d’autre part, la volonté politique manquait pour changer vraiment, le courage manquait. Et pourtant Bachelet termine en 2010 son mandat avec quatre-vingt pour cent d’approbation populaire, un pourcentage historique ; elle ne peut pas se représenter tout de suite parce que la loi impose de laisser passer au moins un mandat entre deux candidatures et c’est Sebastián Piñera qui est élu.
Son gouvernement est de droite, sans aucune alegría, mais il réussit à faire des choses qu’aucun gouvernement de gauche n’avait osé faire.
Prenons quelques exemples. Le peuple se demandait pourquoi ces militaires, condamnés comme assassins, qui ont violé les droits humains, torturé et fait disparaître des gens, sont maintenant dans une prison de luxe, cinq étoiles. C’était une bonne question. Piñera a dit : bon, vous avez raison, fermons cette prison de luxe et envoyons ces gens dans la taule normale où on met les délinquants. L’un d’eux, parmi les plus importants, ne l’a pas supporté, il s’est suicidé. Ce gouvernement de droite a pris une décision qu’aucun gouvernement de gauche n’avait eu la volonté politique de prendre, en se demandant : pourquoi dix pour cent des revenus de toutes les exportations du cuivre, qui est le point fort de l’économie chilienne, va à l’armée ? Et il les lui retire, obtenant en même temps une limitation importante du pouvoir des militaires, qui étaient presque un État dans l’État auparavant. Et Piñera le fait avec une désinvolture intelligente, il appelle le ministre compétent et lui donne cet ordre difficile à digérer, sans consulter le Parlement. Une autre grande doléance du peuple : pourquoi la justice, le pouvoir judiciaire ne fait-il pas son mea culpa, pourquoi n’admet-il pas avoir été complice de la dictature, avoir fermé les yeux sur ce qui se passait dans le pays ? Et Piñera l’oblige à s’excuser. En somme, dans son dernier mois au pouvoir, le gouvernement de droite de Piñera finit par se révéler comme le meilleur gouvernement de gauche du Chili.
Fin 2013, avec la nouvelle victoire de Michelle Bachelet, le pouvoir revient aux socialistes et l’alegría, on l’a oubliée.
CP : Le seul à ne pas rentrer dans ces schémas, c’est Pepe Mujica, le président de l’Uruguay, qui vraiment ne les accepte pas.
LS : Mujica est un homme d’une autre stature, je le connais depuis longtemps. Il y a presque huit ans, je me trouvais à Montevideo et je suis allé visiter le marché qui est l’orgueil de la ville et en particulier d’un de mes grands amis, Mario Delgado Aparaín, adjoint à la Culture de la commune de Montevideo, qui a durement travaillé à la restauration de cette zone. Il s’appelle Mercado de la Abundancia, et c’était le marché traditionnel de la ville. On l’a rénové de manière extraordinaire : la partie souterraine, qui était utilisée pour les ordures, a été reconvertie en espace permanent d’exposition et de vente de l’artisanat uruguayen, tandis que la partie destinée à la vente de fruits, de légumes et d’autres produits alimentaires est constituée de stands mobiles, entourés de chaque côté de parrillas, les grilles sur lesquelles on cuit la viande. À l’heure du déjeuner, on déplace les étals de vente alimentaire, la partie centrale de la zone ainsi dégagée est remplie de tables et le marché devient un énorme restaurant populaire. Après le déjeuner, les étals recommencent à fonctionner et puis, pour dîner, de nouveau un grand restaurant populaire. Et le samedi et le dimanche, le soir, une fois les étals rangés, l’orchestre arrive et le marché se transforme en tanguería, une énorme salle de bal pour danser le tango, ou bien en un espace culturel pour présenter des livres, faire des conférences…
Durant mon séjour à Montevideo, Mario et moi étions donc en train de manger dans ce restaurant populaire, à midi, et je me suis aperçu que l’un des hommes qui s’occupaient des parrillas me regardait.
– Ce type, là, qui fait griller la viande, il me regarde, j’ai dit à Mario. Je crois le connaître.
– C’est sûr, ça doit être quelqu’un qui sait qui tu es, a-t-il répondu.
– Non, non, je le connais d’avant, mais je ne sais plus d’où.
Entre-temps, l’homme quitte sa parrilla et vient me saluer, il m’embrasse :
– Sepúlveda, comment tu vas, tu te souviens de moi ?
– Je me souviens de ta tête, mais pas de ton nom.
– Je suis Pepe Mujica !
Je l’avais connu en 1969, à la première réunion de la Junta Coordinadora Revolucionaria del Cono Sur, en Argentine !
CP : Alors il était là, à faire la parrilla ? Et pourtant il était déjà au Parlement.
LS : Il siégeait au Parlement mais il travaillait là, le mercredi, à griller la viande. Il ne touchait pas l’argent de sa charge politique, il travaillait trois-quatre heures aux parrillas et puis il allait au Parlement. Encore maintenant il donne presque tout son salaire aux pauvres, il n’a pas de gardes du corps, il lui suffit d’avoir un logement et ce dont il a besoin pour manger. Pour son premier jour en tant que président, il est allé au palais du gouvernement dans sa vieille voiture, un tacot des années 70, accompagné de son chien, qui n’a que trois pattes. Il arrive et essaie de se garer devant le palais du gouvernement. Un policier s’approche aussitôt :
– Sors de là, on n’a pas le droit de se garer.
Et Mujica :
– Mais je travaille là.
– Écoute, je te laisse cinq minutes, propose le policier gentiment.
– Je suis désolé, mais j’ai peur que ça dure plus longtemps.
– Tu as besoin de combien de temps ? lui demande le policier.
– Ben, le mandat présidentiel dure quatre ans.
CP : Voilà, ton ami Pepe Mujica, personnage extraordinaire, est une des démonstrations vivantes que, si aujourd’hui l’Amérique latine est ce qu’elle est, si elle permet au monde d’entrevoir des espérances, des idéaux, un avenir, l’envie de vivre, c’est grâce à cette génération, celle des gens comme toi. Nous sommes nés la même année, toi et moi, et quelquefois je pense que notre génération a su concilier la politique et la poésie, l’activisme et la littérature. Peu d’auteurs expriment cette synthèse aussi extraordinairement que toi mais, en général, comme je dis toujours à mes jeunes étudiants de l’université : malheur au pays qui n’a pas de poètes. Les poètes voient plus loin que nous. Respecter la poésie, respecter cette sensibilité est un devoir pour tous. Souvent, avec arrogance, les représentants des pouvoirs forts nous disent : “Eh oui, mais vous, avec vos idées, vous êtes des utopistes, vous êtes des rêveurs, vous êtes des poètes”, presque comme si être poète était le signe d’un manque de sens du concret. Mais nous devons répondre que la poésie est la seule arme qui puisse vraiment changer le monde. Quand on nous accuse d’être utopistes, nous devons répondre qu’il y a beaucoup plus de concret dans l’utopie que dans le faux pragmatisme de toute cette économie qu’on nous refile comme unique loi dominante. Désormais, face au pouvoir du marché, les programmes politiques ne comptent pour rien. Parce que, si vous acceptez la logique du marché, vous pouvez faire le programme politique le plus progressiste du monde, vous n’arriverez pas à l’appliquer.
LS : Le président de l’Équateur, lui aussi, s’est confronté à cette dictature du marché. Il a réussi à faire quelque chose pour restaurer la dignité de son peuple. Par exemple, il a obligé une grande compagnie pétrolière américaine à payer une indemnité, une compensation énorme, pour les dommages infligés à l’environnement en Équateur, et il a lancé un vaste programme de défense de la biosphère en Amazonie. Mais en même temps la dictature du marché est si tyrannique qu’il est impossible de contrôler le processus de destruction systématique de la forêt.
CP : Tu ne penses pas que le niveau de responsabilité et de participation de la base n’est pas encore assez élevé et déterminant pour soutenir le changement politique ? Parce que nos communautés de Slow Food et de Terra Madre, par exemple, sont déjà, dans les faits, les interprètes d’une nouvelle politique, mais pour changer le système la masse critique doit être plus forte. Le problème ne peut pas être résolu seulement par un gouvernement si par ailleurs la base n’a pas cette éducation, cette formation au changement. Des phénomènes comme Mujica, si grand que soit son charisme, ne suffisent pas contre les oligarchies puissantes qui tiennent les journaux, les télévisions et toute l’économie.
LS : C’est vrai, le changement doit venir d’en bas. Par exemple, en Patagonie, une région que j’aime, beaucoup de gens tentent de construire le changement à travers de nombreuses petites initiatives. Je vais te raconter la belle histoire de l’homme qui recueillait les graines.
Si tu regardes la cordillère des Andes au sud du 42e parallèle avec Google Earth, en prenant une photo antérieure à 1990, tu vois qu’entre les grands parcs nationaux argentins et chiliens, constitués de forêts, il y a de vastes zones désertifiées. Mais si tu regardes la même photographie prise aujourd’hui, tu verras que tous ces parcs nationaux sont maintenant reliés par une ligne de forêt. Cette ligne a été tracée par un homme, un seul. Il s’appelle Lucas Chiappe.
Chiappe est de petite taille, il doit faire un mètre soixante-deux, et c’est un homme de gauche. Il a quitté Buenos Aires au temps de la dictature, pour aller vivre en Patagonie, une sorte d’exil dans son propre pays. Là, il a découvert qu’aussi bien le gouvernement argentin que son homologue chilien avaient mis en place une politique de protection de l’environnement complètement erronée en instituant des parcs nationaux. Parce qu’ils ont chassé du territoire les seuls qui avaient la capacité d’administrer cette forêt : la population mapuche, qui savait en prendre soin, qui avait les connaissances pour exploiter, dans le sens positif du mot, toutes les possibilités et les richesses du sous-bois pour la médecine naturelle, une grande richesse. Les gouvernements ont décidé au contraire que, dans le parc naturel, seuls les animaux pouvaient vivre. Tous les êtres humains, dehors. Clairement, cela a signifié la ruine économique et un traumatisme terrible pour une communauté mapuche très importante.
Après avoir étudié cette histoire, Lucas Chiappe a commencé à se rendre dans la forêt pour ramasser des graines. Puis il allait voir les Mapuches pour leur demander :
– Comment s’appelle cette graine ?
– C’est la graine de telle plante.
– Et si je plante cette graine dans la terre, un arbre va pousser ? demandait Chiappe.
Et le Mapuche :
– Ben non. Tu dois d’abord faire une pépinière, il y a une sélection naturelle, sur dix que tu plantes, il en poussera peut-être quatre et, ceux-là, tu les repiques.
Alors, Lucas a parlé avec un professeur et lui a demandé s’il pouvait emmener les élèves de la classe de sciences naturelles dans la forêt pour ramasser les graines, les emmener ensemble chez les Mapuches et apprendre auprès d’eux comment elles s’appellent, comment on les plante, comment on les cultive. C’est ce qu’ils ont fait. À la fin de la première année de ce projet, ils ont rendu à la forêt entre mille deux cents et mille trois cents arbres, non pas dans le parc national, parce que ce n’était pas possible, mais juste à côté. En même temps chaque enfant apprenait à un autre et celui-ci à un autre et ainsi de suite, ils se multipliaient. Et la communauté mapuche a commencé à s’intéresser au projet et à collaborer. En dix ans, ils ont planté plus de seize millions d’arbres, cette ligne verte qu’on voit maintenant sur la photo. Et on a aussi restauré une capacité économique qui se perdait, celle du peuple mapuche, qui venait de la forêt.
CP : Ça me rappelle l’histoire de Jean Giono, l’homme qui plantait les arbres, qui dans les années 30 écrivit une Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix, encore très actuelle. Et si on revient à cette réalité qui existe et qui, comme un fleuve souterrain, n’est pas encore visible, n’a pas encore la puissance nécessaire pour changer la politique, Edgar Morin, à plus de quatre-vingt-dix ans, fait un discours de ce genre : “Vers la fin de ma vie, si je regarde l’absence de politique, le désastre environnemental, la domination du marché, je pourrais dire : bon, c’est fini, non ? Mais non, je suis convaincu qu’il y a dans le monde cette humanité qui, au sein de communautés, est en train de changer les choses. Quand tout doit recommencer, alors tout est déjà recommencé.” En effet, c’est comme ça, l’histoire nous dit que tout est déjà recommencé. Et notre espoir c’est que cette réalité complexe, aux multiples facettes, puisse devenir de plus en plus formatrice, éducative, qu’elle entraîne de plus en plus de personnes dans la réalisation de projets toujours plus nombreux, comme dans ton histoire. Mais la clé, c’est le droit au bonheur : il faut l’exiger aujourd’hui, et sur cette Terre, et en partant des choses apparemment petites, comme les graines qui doivent rester propriété de tous et pas seulement du petit nombre qui les fait breveter. Des petites choses qui, en réalité, sont grandes.
LS : C’est un concept très important, ça, pour moi. J’ai été très proche de Salvador Allende et je ne peux pas oublier le jour où Régis Debray, un grand intellectuel français, est arrivé au palais présidentiel. Il s’était trouvé mêlé aux processus révolutionnaires de l’Amérique latine, il avait été en prison en Bolivie, c’était justement Salvador Allende qui l’avait tiré de cette prison et, maintenant qu’il était devenu président du Chili, Debray voulait lui consacrer une grande interview pour le Nouvel Observateur. Debray, comme beaucoup de Français, était un homme d’une arrogance intellectuelle remarquable, convaincu de la supériorité de ses idées de théoricien du marxisme. Allende, lui, était un intellectuel à sa manière, d’une grande humilité, très intelligent, mais il n’en faisait pas étalage. Moi, je faisais partie de sa garde personnelle, et le jour de l’interview je me trouvais au palais présidentiel avec lui. Il nous a dit :
– Les gars, restez là et écoutez bien. Écoutez bien tout ce que me demande le Français, et si je dis une bêtise faites-moi un signe.
L’entretien commença. Debray avait une série de critiques à faire au gouvernement d’Allende, dont deux très graves. La première : la presse était pleine d’insultes contre le gouvernement et il ne comprenait pas comment un gouvernement de gauche pouvait permettre une chose pareille. Allende lui dit :
– Il n’y a qu’une seule réponse, nous avons un grand respect pour la liberté de la personne, et dans ce pays, il n’y a pas de censure. Chacun est libre d’insulter le président et, si l’insulte dépasse certaines limites, il en répondra devant les juges. Nous avons un gouvernement révolutionnaire avec une pleine liberté d’expression : sinon, ce n’est pas une révolution, c’est une dictature.
Seconde grande critique de Debray : le discours idéologique officiel d’Allende était pauvre en citations des grands textes, des classiques du marxisme. Et Allende lui répondit :
– Mon très cher Debray, je vais t’expliquer quelque chose. Nous sommes dans un pays avec une population jeune en majorité. Ici, la révolution se fait avec très peu de Lénine et beaucoup de Lennon. Et maintenant, je voudrais te poser une question : est-ce que tu connais l’espérance de vie des Français ?
Debray l’ignorait.
– Moi, je la connais. Le Français moyen a une espérance de vie de soixante-cinq ans. Et tu sais quelle est aujourd’hui l’espérance de vie d’un Allemand ou d’un Suédois ?
Debray l’ignorait.
– L’Allemand et le Suédois moyens ont une espérance de vie de presque soixante-dix ans. Et, par hasard, tu sais quelle est aujourd’hui l’espérance de vie d’un Chilien ?
Debray l’ignorait.
– Moi, je le sais. Le Chilien moyen a une espérance de vie de quarante-huit ans. Alors, mon cher Debray, nous, nous faisons cette révolution juste pour vivre autant d’années que les Français, ou les Allemands, ou les Suédois. On fait cette révolution pour vivre heureux, pas pour devenir une dictature.
Le Français n’a sans doute rien compris à ces paroles. Mais moi oui, et je me rappelle encore cette interview, et je me rappelle que j’ai pensé : comme c’est vrai. Parce que même si on veut considérer la question avec une rigueur idéologique, il ne peut pas y avoir une “raison supérieure”, aucune motivation plus forte que celle-ci : être heureux, obtenir le bonheur.
CP : Et, là-dessus, il faut admettre que la gauche officielle a fait défaut…
LS : Cette gauche spartiate et stoïque, et masochiste. Allende était un homme qui avait un sens de l’humour très fort, très particulier.
CP : En Équateur, j’ai vu Correa il y a deux ans donner de sa personne tous les samedis ; chaque samedi un nouveau lieu, il parcourait le pays en répondant aux questions des gens en direct. Mais cela ne suffisait pas non plus. En Équateur, pour construire le changement par le bas, il faut parler aux paysans, comme le fait entre autres une de nos excellentes collaboratrices, Claudia García, qui travaille avec différents organismes pour la promotion de la culture de la production, de la consommation et de l’alimentation, pour la défense des paysans. L’alimentation est un des instruments les plus puissants pour parler de beaucoup d’autres thèmes, pour changer les choses de manière concrète. Il faut seulement dédiaboliser la gastronomie, l’idée même de gastronomie, sa réputation imméritée ludique-élitiste-hédoniste.
La gastronomie est bien autre chose, c’est une science complexe, interdisciplinaire. Comme l’écrivait Brillat-Savarin dans Physiologie du goût, en 1825, “La gastronomie est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l’homme en tant qu’il se nourrit. […] Le sujet matériel de la gastronomie est tout ce qui peut être mangé ; sa fin directe, la conservation des individus ; ses moyens d’exécution, l’agriculture qui produit, le commerce qui échange, l’industrie qui prépare et l’expérience qui invente les manières d’employer au mieux chaque chose.” À travers l’alimentation, on peut tout faire, on peut faire de la politique, de l’économie, de la sociologie. On a tort de penser seulement à la débauche de ceux qui peuvent manger beaucoup et bien. Parce que le plus grand patrimoine de la gastronomie, par exemple, ce sont les femmes qui l’ont accumulé en inventant des plats très humbles qui ont rassasié l’humanité, des plats faits avec le peu dont elles disposaient, mais si goûteux et nourrissants qu’ils sont entrés dans l’histoire et les traditions des peuples. Ce ne sont pas les plats inventés par les chefs ; eux ils viennent après et c’est autre chose, ils ont certainement leur part dans l’histoire de la gastronomie mais elle est moins grande que cet incroyable patrimoine culturel qui nous a été offert par les plus humbles, femmes et hommes. La grande gastronomie naît dans les maisons paysannes, dans l’économie rurale qui n’avait rien mais réussissait à créer des plats extraordinaires. C’est cela qu’il faut comprendre pour saisir quel pouvoir elle peut avoir, autrement nous finirons tous abrutis autour de la cuisine-spectacle à la télé qui fait un malheur sous toutes les latitudes : lacunaire, souvent ignorante, devenue insupportable. La gastronomie c’est autre chose, c’est une science noble dans toutes ses composantes, qui sont si nombreuses et concernent tous les niveaux de la société.
LS : Pour donner un exemple “de famille”, je suis très satisfait que mon neveu, le fils de mon frère, ait ouvert une petite boulangerie au sud du Chili. Il avait fait des études de technicien sanitaire mais faire du pain est plus important.
CP : Un jour, le directeur d’un quotidien italien important m’a téléphoné :
– J’ai un problème avec un de mes neveux, toute la famille est inquiète, m’a-t-il dit.
– Quel type de problème ?
– Il a fini le lycée et ne veut pas aller à l’université, il veut venir chez toi au cours de pain.
Toute une famille d’intellectuels, le père médecin, l’oncle directeur d’un journal, et ce garçon qui veut faire du pain. Tu imagines à quel point ils étaient inquiets.
– Tu peux jeter un coup d’œil, le suivre, me dire ce que tu en penses ?
– Entendu.
J’ai lu alors la lettre de motivation que le garçon avait écrite pour demander à être admis à notre Université de sciences gastronomiques à Pollenzo – où nous donnons des cours d’apprentissage supérieur pour former des boulangers, des maîtres brasseurs, des artisans de l’alimentation – et j’y ai trouvé une lucidité incroyable pour un jeune homme de dix-huit ans. Puis, quand je l’ai connu, j’ai été enchanté, j’ai téléphoné à son oncle :
– Soyez tranquilles, votre gamin a sa route bien tracée et il la voit clairement.
Beaucoup de jeunes comme lui sont en train d’élaborer de nouvelles approches de la vie, qui déplacent les anciens paradigmes et lieux communs. Je crois que c’est une des plus belles composantes de cette nouvelle jeunesse, assez désenchantée, qui sait mieux accepter qu’il y a dix ans la complexité de la vie et du travail.
1
LS : Oui, il y a eu longtemps l’idée que l’université était le seul avenir possible, parce que l’université, croit-on, permet de rentrer plus vite dans le monde du travail. Toujours le culte de la rapidité. Quand je vivais à Hambourg avec un de mes enfants, qui a eu la chance d’étudier dans un lycée public allemand, il a passé son bac. Avant de prendre congé d’eux, le tuteur a convoqué une réunion des parents et leur a tenu un discours que personne n’a compris, je crois. Il a dit, plus ou moins :
– Vous êtes tous des membres de la classe moyenne et votre désir est certainement que vos enfants aillent à l’université, poursuivent leurs études. Bon, ce pays, l’Allemagne, est en train de vieillir, un pourcentage croissant de la population a plus de soixante-cinq ans. Vos enfants feront quelque chose de sage si, je ne dis pas au lieu, mais avant d’aller à l’université, ils choisissent un cours de formation supérieure pour retrouver les savoirs traditionnels et apprendre quelque chose qui soit utile à cette partie de la population.
Il avait raison. Le mythe de l’université a été criminel, ces vingt dernières années, il a entraîné la disparition de beaucoup trop de professions traditionnelles. Et il avait raison aussi de prévoir que bientôt, je dirais dans toute l’Europe, le seul marché du travail vers lequel on pourrait s’orienter serait celui des services destinés aux vieux. Mais nous n’avons été que deux parents sur huit, je crois, à être d’accord avec ce discours, les autres étaient horrifiés. Ils disaient que ce serait du temps perdu, qu’il fallait aller tout de suite à l’université, parce que la concurrence est terrible. De nouveau la vitesse.
Mon fils a ensuite décidé de suivre un cours de formation professionnelle de trois ans comme administrateur d’un centre thermal pour personnes âgées, tout, du secours en piscine à la comptabilité. Il a fini ces études-là, a travaillé six mois, puis a décidé d’essayer l’école de cinéma. Si le cinéma ne marche pas, a-t-il conclu, il pourra toujours revenir au centre thermal pour les vieux. Et il a bien fait, ça a été une bonne forme de démystification du terrible mythe de l’université comme voie unique ; en Espagne, cinquante-six pour cent des jeunes de moins de trente-cinq ans sont au chômage, sans aucune possibilité de travail, et tous sont qualifiés, ils ont une instruction supérieure. Nous avons beaucoup de garçons de café diplômés de philologie.
CP : Nous, à l’Université des sciences gastronomiques, nous avons offert des cours d’apprentissage supérieur dans les matières “artisanales”, les métiers traditionnels liés à l’alimentation comme justement la boulangerie, exactement pour le même motif : aujourd’hui, il y a tellement de diplômés qui ne trouvent plus leur chemin dans la vie, ils sont perdus et à la merci d’une crise économique qui ne les accepte pas et en même temps exige d’eux qu’ils s’adaptent à ses schémas et modèles. Nous devons restituer une dignité, y compris académique, à ces anciens métiers, parce qu’ils sont en train de disparaître et parce qu’ils peuvent être la clé pour donner un sens à tant de jeunes vies, mais surtout à notre avenir à tous. C’est ainsi qu’on forme des personnes meilleures, plus sages, ainsi qu’on développe des communautés, et il n’est pas exclu que, comme ton neveu, ces jeunes, un de ces jours, forts de leur expérience et de leur sens pratique, puissent devenir philologues, philosophes, des intellectuels raffinés. Et ils seront les meilleurs. Par chance, des jeunes qui ont cette détermination à faire quelque chose de pratique, il y en a beaucoup aujourd’hui ; moi je trouve ça fantastique, et je trouve beaucoup plus de sagesse dans un pain bien fait que dans les beaux discours en l’air.
LS : J’ai toujours été frappé par le geste, commun partout, surtout chez les plus humbles, de s’asseoir à table et de manger le pain, simplement le pain. Je trouve que ça a quelque chose de sacré. J’ai vécu dix ans à Hambourg, j’étais correspondant de l’hebdomadaire Der Spiegel, j’ai été pour eux en Angola, au Mozambique, au Salvador, etc. J’habitais dans le quartier le plus mal famé d’Hambourg, Sankt Pauli, le quartier du crime et de la prostitution, près du port ; comme souvent, c’est aussi celui des gens les plus vrais, authentiques, humains. J’allais toujours boire une bière et jouer au Skat, un jeu de cartes typique du nord de l’Allemagne, dans la Kneipe, la brasserie, avec les vieux du quartier. Il y avait toujours les mêmes clients qui jouaient, parlaient, fumaient, avec une bière ou un verre de vin. Un de mes compagnons de cartes était un homme de presque soixante-dix ans, Hans, qui possédait une petite boulangerie. C’était pour moi un plaisir énorme d’aller à sa boutique à cinq heures du matin, pour voir comment il travaillait, avec quel amour, pour faire son pain rien que pour le quartier. Il m’expliquait les différents types de graines, de pâtes, les préparations, les temps de levée, et pendant ce temps il travaillait : vingt sandwichs d’un certain type, trente d’un autre… À six heures, il y avait du pain pour tout le monde, qui sentait bon. Et les gens l’emportaient chez eux, au travail, c’était comme une invitation à commencer la journée accompagnés par un peu d’amour et d’expérience.
Jusqu’à ce qu’un jour, Hans annonce qu’il avait la maladie de tous les boulangers, les rhumatismes. Ils sont provoqués par le changement continu de température, la chaleur, le froid, la pâte, l’eau et le mouvement incessant des doigts, des mains. Ainsi, à plus de soixante-dix ans, il partirait à la retraite et aucun de ses enfants ne voulait continuer ce métier terrible, assassin, debout chaque jour à quatre heures du matin pour faire le pain. Donc Hans a organisé une fête, très belle avec un fond de tristesse, durant laquelle il a pétri et cuit ses miches pour la dernière fois : à cette fête, on n’a mangé que du pain et bu que du vin, presque comme pour un sacrement. En même temps, il invitait ses amis du quartier à prendre les objets de la boulangerie.
– J’ai passé plus de cinquante ans à faire ce métier, disait-il. Et le fruit de mon travail a connu beaucoup de cuisiniers différents. Je suis content. Maintenant, si quelqu’un veut quelque chose là-dedans, il peut le prendre et l’emmener chez lui comme souvenir, j’en serai heureux.
Et alors les habitants du quartier ont pris chacun quelque chose, l’un voulait la balance, et un autre avait l’usage d’un outil.
– Et toi, Luis, qu’est-ce que tu prends ? m’a-t-il demandé.
– Donne-moi, si tu veux, la table, celle sur laquelle tu as fait le pain pendant toutes ces années, j’ai répondu.
– Bien sûr, parfait. Si tu me laisses deux ou trois jours pour la nettoyer, je te l’amènerai chez toi.
– Non, non, je l’ai interrompu. Je ne veux pas tu la nettoies, elle me plaît comme ça. Avec ses marques et le parfum du pain que tu as pétri chaque jour.
Aujourd’hui, vingt-cinq ans plus tard, cette table a toujours le même arôme : du pain, du sésame. C’est encore la table sur laquelle je travaille. Et il est facile d’écrire sur une table qui contient en elle la magie du pain. Du premier aliment, le plus important.
Ma femme Carmen est poète, trois de ses livres sont publiés en Italie, et parmi ses poésies il y en a une qui me plaît particulièrement, dans laquelle elle raconte l’histoire de son exil juste en nommant les différents types de pains qu’on fait dans les pays où elle a vécu.
Pain
Il n’y a pas un pain
pareil à l’autre.
Pain noir aux sept céréales,
miche blanche, pain au miel, à l’ail et cuit au bois,
pain de Norrland,
pain des terres gelées,
pain de feu,
pain de Chiloé.
Pain extrême de noble pâte.
Moi j’ai mangé ce pain.
Des mains d’amour pétrissent la moelleuse consistance.
Pain de froment,
pain de guerre.
Sacré quignon de pain dur
dans la bouche de la faim.
Pain de seigle fumant
enveloppé dans une toile de coton blanc
Pain tribut de la terre
Dernier bon petit plat.