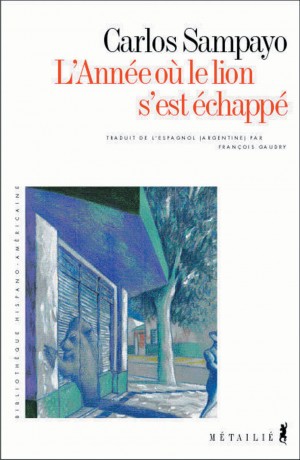Un matin de mai 1957, dans un Buenos Aires dont les nuits sont bercées par les mitraillages de justiciers qui éliminent les petits délinquants, les journaux font leur une sur l'évasion de Casimir, le lion du cirque.
León Ferrara, modeste pickpocket et grand danseur de tango, se trouve ce même jour entraîné dans une aventure qui dépasse largement ses ambitions et sa vie médiocre. Trois étrangers, dont une femme mélancolique aux yeux pâles, déclenchent une série d'événements incontrôlables et tous les plans se trouvent brouillés : tentative d'assassinat d'un commissaire, infidélité d'une femme, exécutions sommaires, errances du lion affamé qui ne comprend rien, ne rêve que de revenir dans sa cage et dont la présence est utilisée pour faire régner la terreur sur la ville...
Voici un roman noir et ironique au charme pénétrant qui nous parle du fascisme ordinaire et des subtils mécanismes de l'amour.
-
« 1957, à Buenos Aires. Casimir, le lion du cirque, s'est effectivement échappé. [Mais] la seule chose qui intéresse vraiment [Leon Ferrara] c'est d'aller danser le tango le samedi soir. Sauf que cette vie modeste va se retrouver chamboulée par trois mystérieux étrangers, sur fond de meurtres perpétrés par une milice étrange. [...] C'est drôle, grave, foisonnant, un peu triste, ça tire et ça part dans tous les sens: de la dénonciation du fascisme aux illusions de l'amour. »Delphine PerasFRANCE SOIR
I
Ce matin de mai 1957, León Ferrara éclata de rire en lisant les titres des journaux : "Danger dans les rues : un lion s'est échappé", "Un lion du cirque Ferrari en liberté dans les rues de Buenos Aires", ou encore ce dernier : "Lion en cavale", dont il eut l'impression que la syntaxe faisait allusion à sa personne. Mais il n'était pas un lion ni n'en avait l'aspect; il était plutôt une souris ou, si l'on préfère, un lapin, à cause de sa mobilité et parce qu'il ouvrait les portefeuilles volés dans le métro, le tramway ou le trolleybus (c'était un partisan acharné de la traction électrique) avec ses dents, plates et carrées, dont il prenait grand soin. C'était sa façon de rendre grâce à la chance.
Mais León était bien plus dangereux que le lion car, la police ne l'ayant pas encore fiché, il jouissait du statut idéal de tout pickpocket : l'anonymat. Il devait cette situation, qu'il savait précaire, à son habileté pour le camouflage et à un honnête penchant pour l'incognito. Soigné, discret, d'une parfaite correction, il respectait la limite que franchissent souvent les délinquants, au-delà de laquelle on trouve montres et dents en or, bagues aux pierres scintillantes, eaux de toilette chères, onctuosité des manières et femmes voluptueuses promptes à trahir. Son secret professionnel consistait à adopter l'apparence de ses victimes, à ne pas se faire connaître des collègues (bien qu'il sût, à peine entré dans un transport urbain, si celui-ci était "occupé" ou non), et à s'être fait dérober plus d'une fois son propre portefeuille. Quarante ans plus tard, il expliquerait à son petit-fils:
- C'était une façon d'apprendre, il fallait être humble, Leonardo, comme dans tous les métiers.
Mais ce jour de mai était particulier. L'analogie entre son nom (patronyme neutre d'une lointaine judéité) et celui du cirque conjuguait deux états de grâce : le lion se retrouvait enfin en liberté, bien que ce ne fût pas dans la jungle ou la savane, et lui, León, se sentait heureux parce que deux minutes après être monté dans le premier trolleybus, il s'était approprié un portefeuille à la substance pulpeuse : deux mille cinq cent quatorze pesos, l'équivalent d'un salaire mensuel modeste, celui, par exemple, d'un caporal de police en uniforme, précisément sa dernière victime.
Il fallait avoir du cran pour faire cela, mais les porteurs d'uniforme étaient les candidats préférés de León et, bien qu'il n'ait pas encore eu la moindre relation conflictuelle avec eux, il n'ignorait pas qu'un jour viendrait où un policier (en uniforme ou en tee-shirt) lui briserait les os de sa main habile, après l'avoir identifiée, à l'aide de la presse de relieur qui attendait les pickpockets dans chaque commissariat comme une ombre funeste. Quant au lion, s'il avait de la chance et ne commettait pas l'erreur de dévorer un passant et de déguster les membres de quelques autres, il ne risquait qu'un retour dans la triste cage où il devait faire le clown et sauter à travers un cerceau enflammé. Connaissant la peur que pouvait inspirer la ville, León savait que le pauvre animal serait terrorisé par les pots d'échappement des voitures, le vacarme des tramways et même les cris des enfants et les fientes de pigeon qui tombent du ciel par surprise.
Deux mille cinq cent quatorze pesos ! Il ne lui restait plus qu'à récolter deux fois cette somme pour atteindre les sept mille cinq cents pesos qu'il lui fallait pour vivre confortablement dans une pension de famille du quartier de Flores, et faire des économies pour l'avenir de ses futurs enfants. Mais cette fois il prendrait un peu plus de risques. La période était propice, l'automne s'offrait dans toute sa beauté et le lion en liberté distrairait l'attention de l'ennemi. Et, surtout, il venait de s'acheter un Wincofón, extraordinaire appareil qui amplifiait le plaisir de la musique car il permettait de passer des longplays : outre un danseur expert, León était un amoureux passionné du tango et de la milonga.
Mme Calcagno, patronne de la pension, insistait :
- Vous devriez vous présenter à un concours, monsieur Ferrara...
- Madame, c'est juste une distraction du samedi, la coupait-il avec sobriété.
Les autres pensionnaires formaient un groupe de loufoques, réduits, pour diverses raisons, au célibat. Le moins extravagant d'entre eux était Ignacio Larrañaga, adjudant de la police fédérale. Pendant les dîners qu'ils partageaient - Larrañaga travaillait par roulement -' León ne pouvait s'empêcher d'observer ses mains noueuses, violacées et crispées, ni de penser que la spécialité de ce convive était de tabasser les petits délinquants pour leur arracher des aveux. Parfois, l'adjudant déclarait :
- Si on me laissait faire (et León regardait ses mains), je vous jure qu'il ne resterait pas un seul voleur vivant dans ce pays - affirmation adressée à la maîtresse de maison, mais que León interprétait comme un message lui étant destiné. Les risques du métier le ramenaient chaque soir vers une pensée inquiétante, qu'il apaisait par une infusion de tilleul : "Maintenant on tue des gens en pleine rue."
C'était systématique: on retrouvait un cadavre tous les deux ou trois jours.
Il y avait d'abord eu un voleur à la tire, puis un braqueur de merceries suivi de deux pickpockets. Une balle ou deux.
Une balle dans la nuque en guise de signature, toujours la même, suffisait pour adresser un avertissement clair aux survivants, dont León faisait partie. Ces derniers matérialisaient les désirs de l'adjudant Larrañaga, mais ce n'était pas lui l'assassin, sinon il ne se serait pas exprimé ainsi devant son assiette de soupe aux vermicelles. Et voilà maintenant qu'un lion entrait en scène. S'il y avait une justice dans ce monde, le fauve boufferait l'assassin des voleurs, pensa León en souriant.
- Grande nouveauté: monsieur Ferrara sourit, déclara Mlle Martita, une autre pensionnaire, sur le ton avec lequel la presse du cœur révèle les ragots.
- Vous voyez, j'ai des souvenirs agréables, répondit León pour se montrer courtois.
Martita était plaisante à regarder et ses tétons l'étaient encore plus, mais le pickpocket préférait réserver l'épanchement de ses désirs à des endroits éloignés de son foyer. Il considérait que la pension, dont la fonction était d'offrir gîte et couvert, était la maison maternelle de l'adulte, de sorte que Martita, mais aussi l'adjudant Larrañaga, étaient à ses yeux des espèces de frères, presque de véritables frères puisqu'il ne les avait pas choisis.
Mme Calcagno avança une conjecture sur le lion en fuite :
- Imaginez qu'un jour on sonne à la porte, j'ouvre et c'est le lion. Les animaux de cirque sont très intelligents.
Rires de complaisance et d'autoprotection : personne n'ignorait que celui qui détient la puissance sur le pain quotidien est maître d'une partie de la vie. Même l'adjudant, homme grossier et ennemi des subtilités, souscrivait à l'obligation d'être bien vu par la maîtresse de maison.
- On ne me laisse pas faire la peau aux voyous, mais si je tombe sur cette bestiole, je jure que je lui colle quatre balles.
Voilà comment, pensa León, le paradoxe de destins croisés tenant à la similitude de noms peut conduire à une même et tragique contingence. Un frisson le parcourut comme s'il avait touché un fil électrique dénudé et, pour la première fois de sa vie, ce fut cet homme qu'il eut envie, fugacement, de tuer :
Larrañaga était un personnage avec lequel il était pénible de respirer le même air. Et voilà que celui-ci lui posait, Dieu sait pourquoi, une question qu'il lui avait déjà posée :
- Et vous, dans quoi travaillez-vous, je ne me rappelle plus?
- Je vous ai déjà dit que j'étais représentant en pièces détachées pour voitures. Une firme anglaise.
Silence et deuxième plan. Mme Calcagno alluma la radio pour écouter les informations: "Dans toute l'Amérique se succèdent les nouvelles sur le mouvement de guérilla commandé par le Dr Fidel Castro, un jeune avocat qui tente de renverser le dictateur Fulgencio Batista, le sergent devenu général..."
- Encore des histoires d'étrangers, ici il ne se passe rien depuis que Perón a été viré.
- Attention, madame, il est interdit de prononcer son nom ! rappela Martita en jetant un regard en coin au policier.
- C'est juste une façon de parler, corrigea-t-elle.
- Nous sommes dans un pays libre, lâcha Walther sans ironie, dans son coin.
Il n'avait pas parlé depuis trois mois.
Walther était un homme grand, blond, aux yeux bleus et au visage anguleux : un étranger. León trouvait sa présence agréable, malgré le soupçon infondé que Walther connaissait sa véritable occupation.
Tous les regards se tournèrent vers lui, les mouvements s'interrompirent, quelques cuillers s'arrêtèrent à mi-chemin avant de poursuivre leur voyage. Ce qui se produisait chaque fois que le blond ouvrait la bouche. Mme Calcagno réaffirma:
- Oui, monsieur, un pays libre et j'en suis fière quand on voit ce qui se passe en Hongrie et ailleurs, avec tous ces petits orphelins.
- Et la faim, donc ! s'enthousiasma l'adjudant, parce que nous, la nourriture, nous en avons à revendre : nous sommes le grenier du monde!
- Et sa boucherie! renchérit Mlle Martita en s'examinant un ongle.
- Moi, le lion, j'essaierais de le capturer avec des filets ou au lasso, dit León. C'est un animal de grande valeur : il sait faire des tas de choses, il s'est laissé dompter.
- Oui, mais vous, monsieur Ferrara, vous êtes tellement bon! déclama Mme Calcagno avec un tremblement de double menton et un regard en coulisse qui firent frémir le complimenté.
"Vous ne m'avez pas rencontré dans le tramway, pensa León. Au travail, nous sommes tous implacables." Et Mme Calcagno elle-même n'épargnait ni son énergie ni son ingéniosité pour réduire le coût des repas et de la literie.
Au moment où la patronne de la pension allait changer de station pour finir la journée par un peu de musique romantique, deux détonations retentirent.
Deux coups de feu dans la rue, ici même, devant la porte.
Avant de mourir, Anacleto Rodríguez avait observé la fenêtre de la pension. Il y avait deux raisons à cela : Mlle Martita, qu'il avait connue lors d'une soirée dansante et désirait revoir, et l'établissement même, dont il avait vérifié que la propriétaire ne possédait ni compte courant ni livret d'épargne et donc que la recette (peut-être de plusieurs années) se trouvait quelque part dans la maison, probablement dans un coffre-fort. Les coffres-forts "domestiques" n'avaient pas de secrets pour Anacleto. Malheureusement, c'était un voleur connu de la police et il devait agir avec prudence. Peine perdue : comme si quelqu'un avait deviné ses intentions, deux balles dans la tête le laissèrent dans l'impossibilité de deviner qui les avait tirées, pourquoi et comment. Pan ! Pan ! Rideau.
De la fenêtre, les pensionnaires (sauf Walther qui s'était retiré dans sa chambre) virent deux hommes s'engouffrer dans une Morris 1949 noire et s'éloigner sans hâte. Après quoi, ils allèrent contempler ce qui restait d'Anacleto, dont le visage était miraculeusement intact. En reconnaissant ses traits, Mlle Martita poussa un cri; c'était logique, trois jours plus tôt elle avait frotté son corps contre celui du refroidi non sans éprouver de stimulantes sensations. Pour ne pas être en reste, Mme Calcagno lança un cri plus perçant et l'adjudant ordonna que personne ne bouge, bien que tous fussent immobiles.
Lorsque Larrañaga descendit, une voiture de police était déjà sur place avec un officier et deux agents.
- Un de plus, dit l'un des agents. C'est Rodriguez, le type des coffres-forts, il aurait été incapable de tuer une poule.
León sentit les poils de sa nuque se hérisser. Lui non plus n'était pas capable de tuer une poule, ni de la manger (la graisse jaune l'écœurait), et cette nouvelle analogie le démoralisa. Le problème était qu'il ne savait rien faire d'autre que voler des portefeuilles.
Tout ce qu'ils savent faire, c'est tuer, pensa Walther sur son lit, tout habillé, en train de fumer dans l'obscurité. Moi aussi, un jour, je vais devoir tuer.
La maison sentait le brûlé. Mme Calcagno avait oublié sur le feu la plaque pour les crêpes à la confiture de lait, le dessert du jour.
- Ah! Mon Dieu! Un malheur ne vient jamais seul! s'exclama-t-elle sans avoir conscience de la disproportion entre les deux catastrophes.
Une demi-heure plus tard, le cadavre fut emporté dans un fourgon bleu et Walther, qui était descendu, pensa à d'autres morts qu'il avait vus ou dont on lui avait parlé, à d'autres derniers voyages (la métaphore l'amusait) moins rapides.
À présent, tout le monde savait que le mort était un délinquant, un nom de plus sur la liste de ceux que l'on assassinait.
Dans un état quasi catatonique, Martita bavait légèrement.
D'un geste discret, León lui essuya la bouche avec un mouchoir.
Le téléphone sonna. C'était pour Sigmund, mais comme Sigmund ne logeait pas à la pension, Mme Calcagno raccrocha. Walther s'apprêta à sortir. León aussi.
À peine était-il entré dans le café Independencia de las angelitos qu'il remarqua une présence inhabituelle. León était habitué à repérer les individus sans se servir de ses yeux. Sentant qu'on le regardait, il assouplit son pas, prit le journal du soir et se prépara à accomplir son rite quotidien : une infusion de boldo bien chaude, avec une rondelle de citron, étrange combinaison de saveurs qui, pensait-il, maintenait en alerte l'instinct de conservation. On l'observait d'une autre table et ce n'était pas un policier
Quand il se tourna pour s'adresser au serveur, il repéra la table. Trois personnes y parlaient une langue étrangère et l'une d'elles était Walther.
- Si on ne lui avait pas collé deux balles, c'est le lion qui l'aurait bouffé... affirmait le serveur.
- Pardon, j'étais distrait, que disiez-vous?
- Ce voleur qu'on a liquidé, eh bien il paraît que le lion en fuite se baladait dans le quartier, des gosses l'ont vu, et si on ne lui avait pas collé deux balles, à ce voyou, le lion l'aurait peut-être bouffé.
Il riait de sa plaisanterie tout en essuyant le marbre de la table.
León lui rendit un sourire courtois et reporta son attention sur son infusion et sur la table voisine. L'un des compagnons de Walther était un homme de plus de soixante ans, petit, chauve, avec une tendance à l'embonpoint, un ex-athlète aimant les bonnes choses, qui en dépit de son aspect lourd parlait en murmurant et sans gesticuler. L'autre était une femme d'une trentaine d'années, blonde, pâle, aux yeux bleus et à la peau transparente. León la vit comme l'incarnation d'un ange. Il sentit peser sur lui le regard de l'homme âgé, puis celui de la femme. Il supposa que Walther leur avait dit qu'il était un des clients de la pension.
Ils parlaient d'une affaire privée, peut-être secrète. Mais ils avaient beau feindre le naturel, León habile dans l'art de jouer les indifférents, savait qu'ils s'efforçaient de jeter un voile sur ce dont il était en réalité question autour de cette table. Il n'éprouvait pas de curiosité - "chacun son truc" - mais cette femme, d'une beauté singulière, maintenait son attention en éveil.
En outre, il était impossible de déchiffrer ce qu'ils disaient. Ils s'exprimaient dans une langue bizarre et gardaient les mains immobiles. Ils buvaient du café et fumaient - la femme également. Ils n'étaient pas contents.
Tout à coup ils se levèrent, comme sous l'impulsion d'un ressort, et se dirigèrent vers la sortie après avoir laissé l'argent des consommations sur la table.
León n'escomptait pas que Walther le saluât. Il voulut lire l'article sur l'assassinat de Rodriguez mais ne le trouva pas. Avait-il perdu la notion du temps? Il s'agissait moins d'une sensation de danger que d'imminence. León se sentait comme un chat et ce n'était pas confortable.
Par ailleurs, il y avait l'affaire de ce lion en fuite. Personne ne l'avait vu, mais il était déjà le plus célèbre des personnages publics. Dans le journal figurait un article, dénué de scrupules, sur une soi-disant promenade du félin ("bête impitoyable", avait écrit le rédacteur) dans un bidonville boueux. Il était insinué que ce charmant petit animal était entré dans une masure et y avait trouvé un couple en plein coït ("tout aussi fortuit qu'extra-conjugal", s'enthousiasmait le journaliste), qu'il avait dévoré tout cru. Pour une question d'honneur à protéger, les faits n'avaient pas transpiré. Une véritable aberration. León pensa qu'il aimerait bien faucher le portefeuille de ce crétin qui n'avait écrit cela que pour lui nuire. "On ne peut pas faire peur ainsi aux gens."
Les monstruosités journalistiques avaient réussi à lui faire oublier le "problème" de l'étrangère blonde. Non loin de là, deux coups de feu claquèrent, plus espacés que ceux qui avaient mis fin à la carrière du perceur de coffres-forts. ils étaient clairs et nets, il faut dire les choses comme elles sont.
Il sortit dans l'air pur de l'après-midi printanier avec l'intention de prendre le métro et de voler un portefeuille. Il aperçut Walther au coin de la rue, appuyé contre une boîte aux lettres. il regarda dans sa direction et ne fit aucun geste.
Il l'attendait.