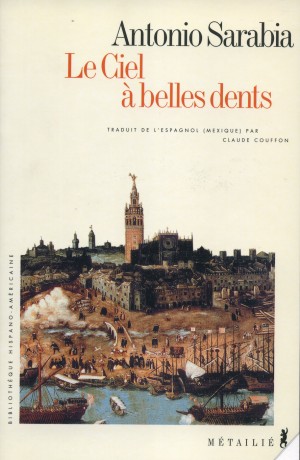Au XVIe siècle, dans une Séville frémissante de l’aventure que représente la découverte de l'Amérique, les navigateurs ramènent des épices et de l’or, mais aussi des esclaves indiens. Parmi eux, le jeune Cristobalillo, page du futur défenseur des Indiens, Bartolomé de las Casas, et Catalina, la cannibale caraïbe, vendue à un aubergiste et attraction du lieu par la fascination érotique qu’elle exerce et sa réputation de porter chance.
Catalina refuse de parler espagnol malgré les leçons de Cristobalillo et les attentions amoureuses d’un jeune pprenti imprimeur, féru de romans de chevalerie. Les jeunes gens parcourent la ville, le port et leurs merveilles, jusqu’au jour où Catalina, enceinte, disparaît, échappant à toutes les recherches. Elle ne reparaîtra que sur le bûcher dressé par l’Inquisition qui l’accuse d’avoir dévoré son enfant.
Avec ses personnages attachants et un style élégant et limpide, Antonio Sarabia nous montre la Conquête dans ce qu’elle avait de passionnant et de porteur d’avenir, mais il nous confronte aussi à la brutalité inouïe, au viol qu’a signifié pour tout un continent l’arrivée d’hommes persuadés de détenir la vérité.
-
Séville, 1500. Depuis la découverte huit ans plus tôt de ce qui deviendra l'Amérique, la ville espagnole est en constante ébullition. Un étonnant quatuor de jeunes gens sillonne les rues de la cité Il y a Alonso Alvarez, apprenti imprimeur, son ami Bartolomé de Las Casas et deux esclaves. Le premier, Cristobalillo, est un Indien Taïno. Le père de Bartolomé l'a ramené des Indes pour l'offrir à son fils. Les deux garçons sont devenus amis. La seconde, Catalina, est une femme caraïbe., Elle a été achetée par le frère d'Alonso, un obscur tavernier. Sa beauté et son, "arrogance sauvage" ont attiré une importante clientèle dans la gargote. Un jour, la jeune femme, enceinte, disparaît... Caravelles, aventuriers, inquisiteurs - le Mexicain Antonio Sarabia signe un roman historique de facture classique, mais plaisant. A noter deux portraits intéressants: Christophe Colomb en fou de Dieu rêvant de libérer le Saint Sépulcre et Bartolomé fervent défenseur des Indiens.LIRE
-
« A. Sarabia [...] narre Séville et son port, particulièrement actif au temps des conquistadors. [...] On bascule sans cesse de la candeur à la violence, de la soumission à la révolte. [...] Histoires de l'Histoire. »Caroline de Hugo et Jérome de SternLA TRIBUNE
PREMIERE PARTIE
La taverne de l'indienne
Nous sommes tous captifs :
l'aigle, empereur de l'air,
le tigre, cœur de la montagne.
Nul n'est assez fort, nul n'est assez beau
pour se croire libre.
Poème Nahuatl
VIENS AVEC MOI, MON CHER LIVRE, susurra Alonso Alvarez en prenant le volumineux exemplaire de Tirant le Blanc, imprimé à Valence dix ans plus tôt par Nicolas Spindeler et conservé avec amour sur une haute étagère de l'imprimerie où il travaillait. Ce matin-là, après avoir essuyé l'encre de ses mains sur son tablier, il se saisit du précieux livre et se mit à en caresser délicatement la couverture. L'édition, en date du 20 novembre 1490, avait connu le prodigieux tirage de sept cent quinze exemplaires. On ne pouvait souhaiter meilleure compagnie pour aller à la rencontre de son ami Bartolomé qui lui avait donné rendez-vous au débarcadère de El Arenal afin d'admirer les caravelles qui arrivaient des Indes. Depuis qu'on les avait aperçues devant Sanlucar de Barrameda, des cavaliers venus de Horacadas, de El Puntal, de Borrego, de Coria et de San Juan de Aznalfarache, avaient commencé à affluer en diffusant des nouvelles de leur laborieuse avance sur le fleuve. En réalité, les curiosités rapportées de l'autre côté de la Mer Océane importaient moins à Alonso que le roman qu'il tenait sous le bras. Si, comme tout le monde, il continuait d'attendre les navires avec l'illusion de les voir apparaître chargés d'or, il regrettait que leur cargaison fût chaque fois invariablement la même : colliers à grains, bracelets de coquillages, ceintures de squelettes de poissons, perroquets et esclaves. Alonso avait pris l'habitude de les attendre en compagnie de son inséparable camarade de jeux et d'aventures lorsque le père de ce dernier séjournait aux Indes. Bartolomé, orphelin de mère, était resté vivre avec sa sœur, Isabel de Sosa, tandis que son père, don Pedro de las Casas, et son oncle, don Francisco de Peñalosa, tous deux fonctionnaires de Leurs Majestés, avaient pris le chemin de la Côte des Epices, quand le Grand Amiral Christophe Colomb avait entrepris son deuxième voyage. Depuis, chaque fois qu'un bateau était annoncé, Bartolomé arrivait au port, guettant l'arrivée d'une lettre ou, bien qu'il n'en parlât jamais ouvertement, le retour toujours possible de son géniteur. Cette allée et venue sporadique derrière des bateaux dont la plupart ne venaient même pas des Indes avait duré ce que dura l'absence paternelle : plus de cinq ans. Don Pedro était revenu mais il n'avait pas renoncé à assister au débarquement des caravelles, même si Alonso comprenait de moins en moins l'intérêt qu'un tel spectacle éveillait encore chez son ami. Que voyait-il donc dans ce va-et-vient occasionnel d'embarcations qui sillonnaient annuellement les eaux ? N'avaient-ils pas épuisé déjà ce qui, à l'origine, avait pu paraître une inestimable capacité de surprise ? Non, Alonso ne se l'expliquait pas. Il haussa les épaules, découragé. Bon, si cette arrivée se prolongeait, si elle n'apportait rien de nouveau, la lecture lui servirait de refuge parfait contre l'ennui.
Ses compagnons de travail avaient pris leur journée pour accueillir les nefs, et Alonso, qui dormait la nuit sur un vieux plumard dans un coin de l'atelier, fut le dernier à quitter l'établissement. Il partit après avoir verrouillé la porte et se mit à marcher avec son roman sous le bras à travers le labyrinthe des ruelles bourbeuses de Séville. Il s'avançait allégrement, du pas rapide de celui qui aime son métier et dort sans rien se reprocher. En effet, il se sentait heureux d'être le plus jeune apprenti de l'atelier de Melchior Gorrizio, un ancien libraire de Novara qui avait décidé de tenter sa chance en créant une imprimerie dans la ville. Sous sa tutelle, Alonso avait appris à lire et à écrire, se prenant vite d'affection pour l'odeur d'encre des tampons de cuir qui enduisaient les caractères et qui, plus tard, émanait du métal des galées, avant d'adhérer au papier fraîchement imprimé. Il s'émerveillait de l'orfèvrerie minutieuse des lettres qu'on modelait avec la délicatesse du sculpteur ciselant les filigranes d'un bas-relief ; du bruit sec du marteau sur l'acier du poinçon pénétrant le métal tendre des matrices où l'on déposerait ensuite les caractères choisis ; de la lourdeur puissante de la presse où il intervenait, lui, pour encrer les formes, actionner la barre du tour ou remplacer les cahiers. Les histoires et la compagnie du vieil Ahmed, le savant Morisque chargé de préparer les casses, de relire les épreuves et d'apporter les corrections, le subjuguaient. Il appréciait l'éternelle amabilité du patron qui traitait chacun avec la même égalité d'humeur, d'affection et de justice mais qui, en ce qui le concernait, non seulement lui avait donné un emploi, mais, le sachant orphelin, lui avait offert un toit sous lequel dormir. Il se sentait très fier de participer à une entreprise aussi novatrice même si, comme l'affirmait Gorrizio, dans le genre elle n'était pas des plus prospères, ce dont se moquait Alonso car l'important, pensait-il, était de fabriquer des livres selon un procédé qui les mettait enfin à la portée de tous. Nul n'aurait pu le convaincre qu'il existait au monde une meilleure industrie.
Il traversa la place San Francisco et s'achemina par la rue de Génova vers la cathédrale. Les boutiques des orfèvres étaient closes et aussi celles des libraires, ce qui fit qu'Alonso ne put jouir, comme il l'aurait souhaité, de l'exposition des éditions les plus récentes, sous les arcades des maisons. Il passa également devant les portes fermées de la célèbre imprimerie des " compagnons allemands ", Juan Pegnitzer, Magnus Herbst, Tomas Glockner et Paul de Cologne, que la reine Isabelle avait fait venir de Venise pour imprimer le Vocabulaire Universel et qui étaient installés à quelques pas de la non moins célèbre imprimerie d'Estanislao Polono et Meinardo Ungut, ce dernier décédé depuis peu, l'un et l'autre émigrés de Naples.
Alonso pensa que si son patron, que son ancien métier de libraire tenait très au courant des exigences du marché, avait tant de mal à se frayer un chemin dans l'édition lucrative en imprimant les œuvres d'Aristote et de Cicéron, sans compter une quantité non négligeable de missels, de choix de prières et autres textes sacrés, il fallait en chercher la cause dans la concurrence hermétique pratiquée par les héritiers directs de l'inventeur de cette nouvelle technique qui se répandait dans le monde : la France, l'Angleterre, les Flandres, la Pologne, Gênes, Venise et l'Espagne elle-même étaient irrémédiablement envahies par une génération d'imprimeurs allemands qui avaient cessé d'être dans leur pays de simples artisans pour acquérir le droit de porter les vêtements brodés d'or et d'argent jusqu'alors réservés à la noblesse.
En s'approchant des échoppes qui entouraient la Cathédrale, il obliqua sur la droite et se dirigea par la rue de la Mer vers la porte de El Arenal. Les imprimeries et les librairies qu'il venait de laisser rue Génova ramenèrent ses pensées au roman de chevalerie qu'il portait sous le bras. Il le serra avec tendresse pour le protéger du vent et se dit que dans quelques années peut-être il pourrait se charger de son impression en espagnol. Non qu'il lui en coûtât de le lire écrit comme il l'était en valencien vulgaire, mais parce qu'il rêvait de le rééditer selon son goût. C'était son épopée préférée et la rééditer signifierait l'engendrer à nouveau, participer avec l'auteur à la tâche de la création. Il relirait personnellement les épreuves pour introduire les corrections qui en feraient un livre impeccable. Il l'imaginait imprimé sur un papier de luxe, non avec les caractères gothiques habituels mais dans ces lettres rondes et claires, si faciles à lire, que venait de dessiner l'Italien Aldo Manucio, et illustré de planches en couleurs. Il songea à une gravure montrant Tirant le Blanc au moment d'accepter le duel avec Kirieleyson de Montalban, une autre, en train de croiser le fer à la cour du roi d'Angleterre, une autre encore où on le verrait se battre la nuit avec le seigneur de Villas Yermas ou faire naufrage au nord de l'Afrique avec l'esclave Plaisir-de-ma-Vie. Il ne pouvait manquer non plus, imagina Alonso dans un élan de luxure, une estampe montrant le prince Philippe, fils cadet du roi de France, réjouissant ses yeux du corps sans voiles depuis la taille de l'infante Ricomana, héritière du royaume de Sicile, tel qu'elle le lui avait permis, et pourquoi pas ? une autre estampe où l'on verrait Tirant le Blanc en personne, caché dans une malle du cabinet de toilette de la princesse Carmesina, fille de l'empereur de Grèce, la regardant entrer et sortir du bain dans toute sa merveilleuse nudité. Ces gravures seraient confiées aux maîtres du genre. Rien ne resterait soumis au hasard. Il se réserverait, bien entendu, l'exemplaire de tête. Il l'emporterait chez lui pour le conserver comme un trésor intime, auprès du volume si usagé qu'il caressait sous son bras, et pourrait le lire et le relire aussi souvent que l'envie l'en prendrait.
Il sortit dans El Arenal par la porte du même nom au moment où les nefs nouvellement arrivées et arborant les étendards de Castille et d'Aragon offraient aux assistants deux tonitruantes salves de leurs pièces d'artillerie. Le canon juché dans la Tour de l'Or répondit par une autre salve de bienvenue. La liesse commençait, dans un tournoiement de pigeons affolés. La rive du Guadalquivir sentait la fête et la poudre. Au milieu des vivats, des hourras, des trompettes, des chalumeaux et d'une nouvelle canonnade sous le vent, un cortège officieux d'alguazils, de maires, de conseillers municipaux et de notables de la ville montèrent dans une barque pour se rendre à bord du vaisseau amiral. Alonso, son livre bien à l'abri sous le bras, tarda quelques minutes à apercevoir son ami dans la foule bigarrée des badauds qui s'étaient rassemblés sur la rive du fleuve. En s'approchant pour le rejoindre, il vit avec satisfaction - car ces dernières semaines il s'était pris pour lui d'une affection véritable - que Bartolomé n'était pas seul. Il était accompagné de Cristobalillo, le jeune et silencieux esclave que son père venait de lui rapporter des Indes.
SI LE MONDE A UN CUL, c'est ici le cul du monde, pensa Cristobalillo dans le port de Séville, en cette matinée d'été de l'an 1500. Il vivait depuis peu dans la métropole andalouse et les mythes de ses aïeux bouillonnaient encore dans sa tête. Il était convaincu que tout ce qui l'environnait, à commencer par cette ville étrange que peu à peu il découvrait, avait sa vie propre. C'est pourquoi il était naturel de posséder quelque part, même s'il n'était pas évident de les trouver, une bouche, des yeux, des oreilles, un ventre, un cul.
Il n'était pas non plus difficile d'imaginer comme un cul - yarima, disait-on dans sa langue - ces dépôts d'ordures adossés à l'extérieur des murailles et qui grandissaient de jour en jour près des masures, des friperies et des éventaires de poteries entre lesquels les gens se frayaient maintenant un chemin en criant et en se bousculant pour mieux apprécier l'arrivée des bateaux, des marins, des hidalgos, des commerçants, des arrimeurs, des badauds, des putains et des mendiants.
Un groupe d'Indiens qui, comme toujours, souleva dans la foule un remous admiratif, fut débarqué ; les mains liées dans le dos, attachés les uns aux autres par une corde qui leur entourait le cou, on les conduisait à travers la foule vers la Porte du Charbon. On les voyait épuisés, effrayés et malades. Cristobalillo comprenait parfaitement leur peur, leur découragement, leur affolement devant cette multitude bruyante, leur crainte des détonations et leur stupéfaction en regardant pour la première fois les hauts remparts massifs de la ville ou le profil somptueux de la Tour de l'Or, dressée comme une vigie solitaire à l'extrémité opposée de El Arenal. Quelques mois plus tôt, il avait éprouvé lui aussi dans sa propre chair le même hébétement après les effets pervers du voyage. Le balancement incessant sur cette prison flottante à ciel ouvert qu'était devenu le bateau. Les intempéries parmi les planches, les amarres et les grelins d'un pont où ils ne recevaient jamais assez d'eau pour calmer leur soif et à peine ce qu'il fallait pour se maintenir en vie. Là, entassé avec les autres dans la vomissure perpétuelle des malades, au milieu des coups de roulis, des puces, des cafards et des rats, il s'alimentait de biscuits pourris et somnolait en grelottant de froid par beau ou mauvais temps. Plusieurs semaines passèrent ainsi. Cristobalillo n'avait jamais vu avant et ne reverrait plus jamais après la plupart des captifs qui l'accompagnaient. Caraïbes en majorité, mangeurs de chair humaine, les Taïnos timides et l'équipage du navire les regardaient avec dégoût et méfiance, horrifiés par leurs habitudes d'anthropophages. Malgré leur dureté et leur férocité supposées, bien peu résistèrent au voyage. Le froid, la soif et la mauvaise alimentation en vinrent à bout. Morts, les marins les jetaient à la mer sans autre regret que la perte du prix qu'ils représentaient sur le marché aux esclaves. Par bonne ou mauvaise chance - cela restait à démontrer, songea Cristobalillo en regardant amer la crasse et le désordre qui l'entouraient à El Arenal - il devait de survivre à une femme, une jeune Caraïbe précisément, fille, à ce qu'il avait pu comprendre, d'un de ces roitelets féroces, les caciques, disait-on, décimés par les envahisseurs, laquelle, bien qu'elle fût son ennemie naturelle, l'avait abrité contre elle les nuits où il faisait un froid de chien. Cristobalillo, mort de peur, se laissait faire, croyant d'abord que la cannibale le protégeait ainsi pour le dévorer tout cru durant son sommeil, avant de s'abandonner plus tard au besoin de sollicitude et de chaleur. Il mit du temps à comprendre que dans son abandon total et dans la confusion de la situation nouvelle, elle avait le même besoin que lui de la compagnie d'une chose ou d'un être auxquels se raccrocher.
Pour sa survie, il avait pu compter aussi sur la noblesse du maître qui l'emmenait prisonnier. Un homme généreux, nommé Pedro de las Casas. Celui qui avait ordonné, alors qu'il se trouvait encore à terre, qu'on lui versât un peu d'eau sur la tête tandis qu'il faisait le signe de la croix. Après quoi, il s'était mis à l'appeler Cristobalillo, en hommage à cet autre personnage de haute taille, aux cheveux prématurément blanchis, aux yeux bleus affables et au nez aquilin, qui était resté dans l'île où il avait imposé sa volonté avec un sens inné du commandement ; presque tous le traitaient avec une obséquieuse déférence en l'appelant Amiral. Cette courtoisie douteuse n'avait jamais trompé le jeune Taïno : il le connaissait sous le nom de Guamiquina, le chef unique, et avait pu se rendre compte que nombre de ceux qui l'adulaient auraient tout donné pour lui planter une dague dans le cœur.
Arrivé à destination, on l'avait d'abord débarqué sur le quai de Las Muelas où l'on payait un impôt pour chaque prisonnier venu sur le bateau et où son maître s'était opposé à ce qu'on lui marque la joue du signe qui l'identifierait comme esclave. Puis il l'avait emmené chez lui pour le mettre au service de son fils, un garçon de son âge appelé Bartolomé qui, après avoir dominé sa surprise, s'était mis à le traiter avec la même gentillesse et bienveillance que son père.
Maintenant ils étaient là tous deux, observant les bateaux arrivés de terres pour beaucoup lointaines et étrangères mais pour lui, proches et siennes. Il compara à regret cette frange de terre sale et saturée qui s'étendait entre les murailles et le fleuve sous le nom de El Arenal, à cette autre, immense et toute de sable blanc et fin, qu'il avait laissée de l'autre côté de la mer. Sa ville ne comprenait là-bas que quelques cabanes rondes aux toits de paille, des bohios, disait-on, où il vivait nu en se nourrissant d'iguanes, d'huîtres, de coquillages et de poisson, et aussi de fruits que les arbres mettaient à portée de main ; jusqu'au jour où étaient arrivés ces bateaux, plus grands que la hutte où il vivait, qui apparurent entraînés par ce qu'il pensait être des nuages attachés à leurs mâts. Il avait même cru - bien qu'aujourd'hui cela le fît sourire - que ces barquettes mises à l'eau pour le débarquement étaient les bébés des nefs et que celles-ci se préparaient à les allaiter. Qu'aurait-il pu imaginer de différent, alors ? Et qui d'autre que des êtres tout-puissants, des dieux peut-être, aurait pu arriver sur ces embarcations magiques ? On les avait appelés maguacochios, les hommes habillés, qui portaient des armes capables de vous fendre en deux d'un seul coup. Aujourd'hui, des mois plus tard, dans ce Séville où on l'avait amené comme esclave, il prenait peu à peu douloureusement conscience de l'étendue de son erreur, et de sa réussite.
Dans son île, il pouvait entendre le langage des plantes, le bourdonnement des insectes, les cantilènes des oiseaux, les cris des perroquets, le raffut soudain des singes. Il parlait aux arbres s'il avait besoin de leur bois et leur demandait la permission de les couper. Eux seuls avaient le pouvoir de décider s'ils souhaitaient faire partie des murs, des supports ou de la façade de sa maison. Là-bas, tout pour lui avait un sens. Par contre, dans cette ville sombre aux ruelles étroites et boueuses, dont beaucoup ne menaient nulle part, toutes bordées de demeures de pierre où sévissaient des hommes corpulents qui couvraient de vêtements leur peau velue et blanche et des épouses qui avaient honte de montrer leur sexe et leurs seins, il se sentait perdu. Non seulement la flore mais aussi la faune étaient différentes dans ce pays de l'autre bout du monde : les animaux à plumes qui ne volaient pas, les grands chevaux sur le dos desquels on parcourait de longues distances, les chiens, les chats, les ânes, les mules, les vaches, les cochons, tous étaient aussi bizarres que leur comportement et il était incapable de prévoir leurs réactions ou de communiquer avec eux. Mais il comprenait très bien pourquoi, dans cette région pleine de menaces qu'il venait de considérer comme le cul du monde, les chiens aboyaient et les oiseaux fuyaient épouvantés à l'approche des êtres humains.