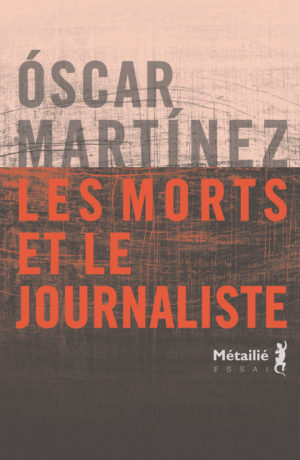Peu de livres ont en même temps un effet physique, moral et intellectuel sur les lecteurs. Peu de livres vous bousculent par leur honnêteté et leur pertinence. Ce livre, brutal et nécessaire, est l’un d’eux.
Il parle de la vie de trois personnes qui ont un jour décidé de témoigner et de leur mort, conséquence de ce témoignage. À partir de l’assassinat de trois de ses sources, Óscar Martínez, l’un des reporters les plus courageux de l’Amérique latine, mène une réflexion unique sur le journalisme, un métier qui donne un immense privilège et une énorme responsabilité : être témoin du monde au premier rang, même si parfois le spectacle est terrible.
Ce livre sur l’un des endroits les plus violents de la planète ne donne pas d’explications, il n’est qu’une histoire qui a amené le journaliste à comprendre ce qu’il a vu, raconté, choisi, raté pendant 13 ans, ce qui lui a permis de s’enfoncer volontairement dans ces abîmes, et les conséquences de cette immersion.
Peu de livres sont capables de relier avec autant de puissance le doute et le courage, le risque et la justesse, le sort d’un paysan salvadorien et l’importance d’un métier universel, la vie et la mort. Ce livre le fait.
-
"Le livre d’Óscar Martínez n’est pas le récit d’une enquête, ni un essai sur la responsabilité du reporter. C’est une œuvre personnelle et percutante, qui mêle souvenirs, témoignage et réflexion."Gilles BiassetteLa Croix
-
"Un essai choc, à la portée réflexive sur le journalisme et la violence, à lire le cœur bien accroché." Lire la chronique iciSite Benzine Magazine
-
« Apostrophant le lecteur et remuant les consciences, le journaliste salvadorien Óscar Martinez livre le récit sans fard de son travail, de ses rapports avec ses sources, entre colère et confession. […] On ajoutera que ce document extraordinaire, qui se lit comme un roman selon un stéréotype tout ce qu’il y a de journalistique, est remarquablement écrit. »François MontpezatDernières nouvelles d'Alsace
-
« Un témoignage brûlant, humain et passionnant. »Sophie PujasAlibi
-
"Les morts et le journaliste est un polar ultra violent formidablement écrit qui se lit d'une traite mais ici tout est vrai, ce qui rend ce récit absolument terrifiant." Lire la chronique iciBlog Baz'Art
prologue : le fond
Écrire ce livre ne m’a pas coûté. Cela a été un processus organique, comme vomir. Cela ne m’a pas coûté, ce qui ne veut pas dire que j’y ai pris plaisir, mais je suis content de l’avoir fait.
Dans les pages qui viennent vous trouverez une histoire centrale reliée à d’autres histoires secondaires. Toutes sont affligeantes dans les grandes lignes : j’en ai connu le fond. Le récit central va plus loin, il va au bout de l’échec, il s’enfonce de tout son poids aussi profond que possible, et est sans aucun doute susceptible de descendre plus bas que le niveau atteint par les lettres que je forme.
Il y a dans ce livre des vies qui se déroulent dans des profondeurs auxquelles on a du mal à croire qu’il est possible de s’habituer. J’ai moi-même du mal à y croire alors que je l’ai écrit pendant un an. Il n’y a pas de héros véritables ni de victimes revendiquées ; ce n’est pas une réalité à l’élégance “noire”, avec des bienfaiteurs à la morale douteuse, qui ont de la classe et du mystère, imparfaits et attirants ; il y a de la déformation, de la sauvagerie et de la cruauté.
Mais il n’y a pas non plus de méchants sans nuances. De fait, il n’y a pas de méchants, et pas de bons non plus, ni d’antipodes saillants. Il y a un autre monde avec d’autres règles, avec d’autres limites, et avec des principes, des certitudes, des haines et des amours qui ne correspondent pas aux canons acceptés par ceux d’entre nous qui acceptent les choses et les publient sur Internet, qui font des discours et donnent des conférences, qui boivent des verres à New York comme à Medellín.
“Raconte-moi un souvenir heureux”, ai-je un jour demandé au personnage principal. “Comment ça ?” m’a-t-il répondu, et nous n’avons jamais pu nous comprendre.
Il y a des gens qui ont survécu autant qu’ils ont pu. Et dans ce combat contre tout, ils ont distillé des essences qui permettent de réfléchir sur la vie, le courage véritable, l’engagement amoureux, les privilèges, l’injustice, la trivialité de sociétés où tout est pose, le quotidien assassin et inhumain auquel nous condamnons la majorité qui, dans l’échange tellement moderne et pitoyable de likes et de petits cœurs, ressemble à une minorité muette.
C’est un livre sur des gens qui sont très nombreux.
Dans la région violente que j’ai couverte durant treize ans, ils sont très nombreux.
Dans certaines autres aussi, j’imagine.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez ce que je sais à propos de la couverture de la violence. Ce que je sais, ce sont ces erreurs, ces doutes nombreux et ces rares certitudes.
Ce n’est pas un livre pour journalistes, mais c’est un livre où un journaliste – moi – raconte l’histoire en s’y incluant lui-même.
Je réfléchis sur mon métier parce que c’est la méthode qui m’a permis de m’enfoncer volontairement dans ces abîmes. De là, j’ai vu, raconté, écarté, choisi. Ce livre est raconté à partir de mes yeux plus que tout autre que j’ai écrit, même si je les ai tous inévitablement écrits depuis cette perspective. C’est seulement que la réflexion sur le comment j’ai vu n’avait jamais été un élément primordial et soutenu dans aucun autre de mes livres. Jusqu’à celui-ci.
Dans ce livre, il y a des pandilleros, mais ce n’est pas un livre sur les pandillas[1] ; il y a des narcos, mais les narcos ne sont pas le sujet ; il y a le Salvador, le Honduras, le Guatemala, le Mexique, les États-Unis, mais il ne traite pas de ces pays ; il y a aussi des policiers, des juges, des présidents et des politiciens corrompus, mais il ne prétend pas s’appesantir sur ce mal endémique de la région ; il y a des migrants, mais la migration n’est pas le sujet ; et il y a des réflexions sur le journalisme et des phrases de journalistes célèbres, mais il ne s’agit pas de ça.
Ce livre, c’est ce que je sais sur le fond du monde que j’ai couvert. J’ai consacré mes écrits précédents à essayer de l’expliquer. Ce livre-ci dit en plus comment j’ai couvert ce monde. Et il est aussi ce que je ne sais pas, ce que je n’ai pas pu expliquer, face à quoi je ne peux que douter.
Ces lignes, ce sont plus des questions que des réponses qui les ont guidées. Elles répondent quand elles le peuvent. Elles questionnent toujours.
Qu’est-ce que ça fait de ne pas avoir d’opportunités ?
Comment c’est d’être misérable ?
Comment vivent ceux du dernier rang ?
Qu’est-ce qu’ils pensent de nous ?
Qu’est-ce que la violence extrême ?
Pourquoi ne se rendent-ils pas ?
Pourquoi continuent-ils ?
Pourquoi est-ce qu’ils tuent ?
Pourquoi est-ce qu’ils ne tuent pas davantage ?
Qu’est-ce que la justice pour eux, et la démocratie et le gouvernement et les lois ?
Que sont-ils selon eux-mêmes ?
Que sommes-nous ?
Quand en auront-ils enfin assez ?
Ils mangent, ils chient, ils rient, ils aiment, ils regardent la télé, ils aiment leurs mères, ils fêtent Noël, ils conservent précieusement les dents de lait de leurs enfants ?
Raconte-moi un souvenir heureux.
Comment ça ?
Comment raconter tout ça ?
Comment l’ai-je raconté ?
Et les doutes du livre incluent aussi celui qui écrit.
Pourquoi l’ai-je fait ?
C’était quoi mon but en racontant ce massacre ?
Cela justifiait-il de mettre en danger cette survivante ?
Ai-je changé des choses ?
Quand faut-il arrêter ?
Qu’est-ce que j’ai voulu savoir ?
Qu’est-ce que j’ai fait pour raconter ?
Qu’est-ce que j’ai promis ?
À quoi ai-je renoncé ?
Est-ce que c’était important pour moi ?
Pourquoi ai-je raconté ?
J’ai commencé ce livre comme mû par une pulsion organique : un besoin d’abord. Je l’ai traversé comme un tunnel fragile : avec peur et volonté.
La première semaine de mars 2020, une fois la quarantaine décrétée dans mon petit pays, j’ai su que j’avais besoin d’échapper à la conjoncture mesquine de cette nation : son goût pour le court terme, sa mémoire de memento, son scandale du jour, son match de foot du lendemain. J’ai écrit toutes les nuits.
J’ai choisi de griffonner une histoire que je n’ai jamais su raconter et que j’ai suivie durant des années. J’ai choisi d’écrire une histoire que, parce qu’elle était obscure et sans perspective, j’ai toujours cherché à réduire, comme on enferme le chien qui ne sait que mordre.
Le jeudi 26 mars 2020, à 20 h 42, j’ai envoyé un mail à mes agentes en y joignant une dizaine de pages. J’ai écrit :
Très chères : j’espère que vous allez bien. Drôle de période. Drôle de panorama pour l’avenir. Même si je continue à faire des reportages à l’extérieur, j’ai eu un peu de temps pour écrire plutôt que devenir fou. Je vous envoie dix pages de mon projet de livre-essai sur le métier. L’idée est de relier l’assassinat de trois de mes sources avec le métier de journaliste et les leçons que j’ai apprises après plus de dix ans où je n’ai pas cessé d’avoir les yeux fixés sur la violence dans l’un des endroits les plus violents qui soient. Ce n’est pas un livre qui prétendra donner des explications sur un gang ou un pays, mais sur des traits humains en général et sur l’exercice du métier dans l’abîme moderne. Le ton en deviendra intime quand cela sera nécessaire. La structure pour le moment est le récit en continu de l’affaire, entremêlé de réflexions et d’interruptions correspondant à des souvenirs concrets, dont je vous donne un exemple. Ne faites pas attention à la partie en jaune à la fin, c’est moi qui me parle à moi-même.
Je vous l’envoie pour que vous me disiez : laisse tomber, arrête tes bêtises ; ou continue, mais pas dans cette direction ; ou continue. Je me connais, si j’écris davantage je ne voudrai plus m’arrêter. Là, je suis encore au carrefour.
Je vous embrasse.
Je leur fais confiance parce qu’elles sont honnêtes avec moi et qu’elles m’aiment. Et personne n’est franc ni n’aime s’il ne saisit pas l’occasion de sauver du ridicule celui qu’il aime. Elles m’ont dit d’écrire. Et elles ont fichu en l’air toute ma quarantaine et bien plus encore. Je vous en remercie, Andrea et Paula, et ce n’est pas une pose de ma part, c’est sincère. Quoi qu’il arrive, merci.
Je n’avais jamais affronté un défi pareil. Ce n’est pas mon travail le plus méthodique, ni, loin de là, le plus concluant, et certainement pas le plus fouillé, mais de beaucoup le plus exigeant : j’ai essayé de répondre quoi, comment et pourquoi. Je me suis arrêté au bord du chemin, je me suis assis avec mes 28 carnets remplis à ras bord, gardés précieusement durant treize ans, démuni, sans plan préconçu, je les ai classés, j’en ai écarté certains, j’ai mis des étiquettes, je les ai relus plusieurs fois et je me suis souvenu de ce que j’avais fait, de ce que j’avais vu et écrit, de ce qui avait marché, de ce qui n’avait pas marché, et je me suis demandé pourquoi. Et je me suis remis à écrire.
C’est ce que j’ai fait.
C’est ce que je sais.
C’est ce que j’ai raté.
C’est ce que j’ai réussi.
C’est ce que je ne sais pas.
C’est ce que j’ai écrit de plus honnête.
Óscar Martínez
San Salvador, 24 mars 2021
- lisez ou laissez tomber
Si ce dimanche 16 avril 2017 au soir je ne m’étais pas pointé dans le village de Santa Teresa, peut-être que Herber n’aurait pas été assassiné à coups de machette au visage ; peut-être que Wito n’aurait pas été décapité ; peut-être que Jéssica n’aurait pas été obligée de fuir. Rudi, lui, je crois qu’on l’aurait tué de toute façon.
Mais ce qui s’est passé n’est pas simple, et déterminer quel a été mon rôle dans tout cela n’est pas si intéressant. Ce qui est vrai, c’est qu’une histoire que j’ai commencé à suivre parce que je savais qu’elle se terminerait par la mort s’est terminée avec encore plus de mort. Pour comprendre comment tout est arrivé, il faut que je vous demande quelque chose qui ressemble à un truc de bonimenteur : lisez ce livre jusqu’à la fin. L’important, les règles du comportement de la violence que j’ai couverte durant plus de dix ans dans l’un des coins les plus sanglants du monde, c’est dans les détails du comment c’est arrivé qu’il se révèle. Le résultat n’est que le quotidien d’un pays comme le Salvador ou de beaucoup d’autres. La fin, je vous l’ai déjà racontée : les cadavres démembrés de trois frères salvadoriens jeunes et pauvres ont été retrouvés dans un champ de canne à sucre sans nom.
Si vous décidez de ne pas me lire, je vais vous éviter de tourner les pages. La dernière ligne de ce livre sera la suivante : Il y a des morts. Point.
[1] Pandilla : gang ; pandillero : membre de gang. (nde)