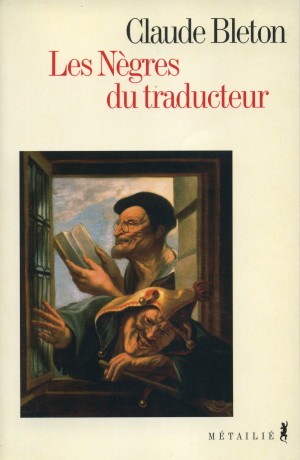Un homme et une femme sous un pont, ils boivent, il parle. Il voulait faire carrière dans les lettres, c'est pourquoi il s'était marié à une héritière du meilleur monde littéraire et faisait des traductions résolument post-modernes...
Devenu étoile au firmament des cénacles hispanistes, il avait mis au point une méthode ingénieuse: il rédigeait une traduction puis cherchait un auteur espagnol pour en écrire la version originale. Les auteurs étaient d'accord, la vie est si courte et l'écriture si difficile. Mais l'un d'eux s'est rebellé, et le traducteur a été obligé de l'éliminer...
Dans ce récit ironique et cocasse, tout bouge et change, le lecteur est pris dans des filets dérivants. Où est la vérité? N'y a-t-il que le commissaire à la retraite qui sache lire? Jusqu'où est-il possible de traduire? Un texte peut-il exister sans auteur?
A lire!
-
« un premier roman savoureux, qui tourne finement en dérision son propre métier de «traître». [...] A la fois conte cocasse et polar poétique, ce roman rend un hommage espiègle à la fée Imagination. »Delphine PérasFRANCE SOIR
-
On sent que Claude Bleton , traducteur d'une centaine d'ouvrages d'écrivains espagnols réputés (Goytisolo, Marsé, Munoz Molina, Savater , Saer, Montalban, etc) s'est beaucoup diverti à fignoler ce premier roman où il se moque autant de lui même que des autres, dans un séduisant cocktail d'exagération et de finesse.Isabelle MartinLE TEMPS
-
Moralité de cette fantaisie policière, à mi-chemin entre roman à clef et l'essai théorique : s'il est légitime parfois de se méfier du traducteur, le plus redoutable dans toute cette affaire, c'est toujours le lecteur.Gérard MeudalLE MONDE DES LIVRES
Tu vois, maintenant, je m'attache à la forme. À celle des bouteilles, par exemple. Ovales, effilées, pansues. Mes doigts se promènent sur leur galbe. J'achète, je débouche, je vide. Les deux mains entre cul et goulot. Accessoirement, je bois. Autrefois, je lisais les étiquettes, je choisissais les crus, j'hésitais longtemps. Savoir ce qu'on fait, savoir ce qu'on boit. L'attente était une partie du plaisir. Quand je buvais, j'en laissais toujours un peu au fond - la lie. Un trop joli mot pour ce qu'il désigne. Puis je jetais la bouteille. Tu vois, un bon moyen de mesurer le chemin parcouru: maintenant, je me fous du goût. Je préfère la forme, cette poussière des choses. C'est à cela que je m'aperçois que j'ai changé. Mais je me demande quand c'est arrivé.
Avant, je buvais un premier verre, lentement, passage obligé le long du palais. Puis les suivants. Aujourd'hui, tout a la même saveur, du début à la fin. Et je ne laisse plus rien au fond, à quoi bon, puisqu'il n'y a plus de dépôt dans les bouteilles. Je pourrais aussi bien commencer par le dernier verre. La fin, le début, je ne fais plus la différence. Au lieu de ranger, je remets tout en désordre. Comme Aurore. Aurore... Dès que je parle d'elle, affluent les couleurs et les odeurs, ces deux grandes absentes aujourd'hui. Je l'avais rencontrée dans un cocktail. Au moment de partir, nos regards se croisèrent. Pourquoi? Et pourquoi avoir échangé nos adresses? Aucun calcul dans cet instant. Alors, quand s'est-il insinué entre nous? Sans doute quand les instants se sont mélangés. Sans doute dans la succession des instants.
Mais j'ai le sentiment que je prends tout à l'envers. Soudain, cela me gêne de boire le dernier verre avant le premier. J'aimerais remettre le vin à l'endroit. Pourquoi n'a-t-il plus de goût? Il n'en a pas toujours été ainsi. Donne-moi une autre bouteille. Je ne peux les caresser que lorsqu'elles sont pleines. C'est là que la caresse a encore un sens.
Quand je rencontrai Aurore, je trouvai injuste de ne pas l'avoir rencontrée plus tôt. Je lui en voulus soudain d'avoir une vie privée. D'apparaître avant que je l'aie décidé. Et je cessai de croire que la vie est un chemin plus large que long où nous marchons loin des ornières. Mais les choses ne se passèrent pas du tout comme je viens de te le dire.
- Tu veux que je te raconte des histoires?
- Oui.
La simplicité de cette réponse me désarma. Oui. Et pourtant nous ne nous connaissions pas. J'aurais pu être l'étrangleur, le tueur en série du quartier. La confiance est un phénomène incompréhensible. Par la suite j'en ai abondamment profité. Je la revis chez elle, la semaine suivante, un dernier étage dans le xiie arrondissement. Des cheveux très blonds, très longs, des traits un peu bâclés, un regard limpide, une légère cassure dans la démarche, mais le port très droit. Une sportive. Et surtout des yeux immensément bleus. Je commençai tout de suite, je m'en souviens, c'était une histoire de Ferme-l'œil.
Il y avait un long chemin herbu, une clairière, un arbre. Et une profusion de bestioles, bien sûr. La tempête se levait et toute une ménagerie s'affairait... C'était palpitant, comme son petit cœur qui tressautait sous ma paume, par sein interposé.
Ce genre d'histoire doit te paraître ridicule. On ne les raconte pas à la jeune fille que l'on rencontre pour la première fois. Et pourtant, Aurore écoutait de tout son corps. Pendant huit heures, je racontai les aventures de Ferme-l'œil. Après, je rentrai, épuisé. Elle m'avait poussé gentiment vers la porte et embrassé sur les deux joues. En sortant de là, je sentis poindre le désordre. Je sentais soudain que la vie n'est pas une longue enfance, que les histoires sont un rempart illusoire contre la mémoire et que, même déguisé, le passé revient.
Mais il faut que je reprenne dans l'ordre. Le premier verre d'abord, par fidélité avec mes manies d'autrefois. Cette manie des fables, je la tiens de moi-même, de mon enfance. Je n'ai pas de souvenirs, seulement des histoires. J e commençai mon premier roman à l'âge de dix ans. À dix ans et demi, dix-huit pages étaient écrites. Impossible d'avancer. Même pas de faire démarrer une voiture. Il me semblait qu'écrire "la voiture démarra" était une imposture, que les lecteurs comprendraient aussitôt que je n'y entendais rien en mécanique et en conduite. Et surtout, qu'ils ne comprendraient pas le fil des événements. J'observais les gens au volant, découvrant peu à peu l'existence du changement de vitesse, de l'embrayage, du contact, du frein à main dans certaines circonstances... mais je ne savais comment agencer tous ces éléments. Et j'avais parfois l'impression qu'au lieu d'écrire un roman, je rédigeais un manuel pour apprendre à conduire. J'arrachai ainsi des pages et des pages de mon cahier, car la voiture ne pouvait partir et les bandits que l'on poursuivait avaient tout le temps de prendre le large.
Je mis encore six mois à découvrir, après un calcul d'une grande complexité pour un enfant de mon âge, qu'il me faudrait quarante ans à ce rythme pour achever un premier roman. Je compris que je ne serais jamais un auteur et que la meilleure solution était encore de recopier ce que les autres avaient écrit. Le début d'une vraie vocation de paresseux: je serais traducteur. Certes, à l'époque, d'autres voies m'attiraient. Pompier ou motard. Mais ces carrières n'étaient pas moins confrontées aux mêmes problèmes techniques de démarrage, d'entretien et d'équilibre subtil entre les pédales de frein et d'embrayage. Je peux dire sans exagérer que les boîtes de vitesses sont à l'origine de ma vocation de traducteur.
Mon objectif étant fixé, il me restait à préciser comment l'atteindre.
J'avais trois possibilités: l'anglais, pour les enfants ordinaires, l'allemand, réservé aux fils de notables, et l'espagnol où se retrouvaient les immigrés de toute obédience. Je choisis cette dernière option, pensant - à juste titre, comme le démontrerait la suite des événements - qu'il n'y aurait guère de concurrence dans cette langue peu prisée des beaux esprits. Je ne te cache pas que les premières années furent un peu dures. L'apprentissage stérile des règles de grammaire se rit des nuances exaltantes de la langue et des infractions à la syntaxe normative qui font le style et donc l'homme. Mais je savais que mon avenir de traducteur passait par un certain nombre de contraintes.
Tu vois, une fois de plus je ne fais rien dans l'ordre, malgré mes bonnes résolutions. Quand on raconte sa vie, on commence par le début, non? C'est comme nous, si on racontait aux gens comment on s'est connus, ils voudraient d'abord savoir qui on est, d'où on vient, si nos vies ont croisé un Ferme-l'œil perché dans un arbre, une ménagerie au milieu d'une clairière ou des bandits en fuite.
Tu dois te demander d'où me viennent ces histoires. D'ailleurs, tu n'as rien à demander, c'est moi qui raconte et qui décide. Ma mère ne m'en racontait pas. Mon père encore moins. Et pour cause: il ne m'a pas connu. Ma mère a juste pris le temps de me mettre au monde avant de repartir sur les chemins pour se mettre à l'affût des passants, comme la sorcière aux bisous. Une autre histoire. Mais elle n'est plus de ton âge. D'après une autre version, je fus enlevé lors de mon transfert de la maternité à mon domicile par une louve dont on avait massacré la couvée. Élevé par une horde de loups qui avait élu domicile dans une chaumière désertée au milieu d'une clairière de la grande forêt, je partageais mon temps entre les courses à quatre pattes et les lectures avides de vieux numéros de l'Illustration trouvés dans un coffre. Une des deux versions est vraisemblable, mais il y en a d'autres...
J e n'ai pas de souvenirs d'enfance. C'est l'origine de mon désordre. Ou plutôt, je n'en ai qu'un seul: l'hôpital. J'ai oublié pourquoi j'y étais. J'y restai longtemps. Des mois, des années, je ne sais. Je ne recevais aucune visite, du moins je n'en ai pas le souvenir. Les infirmières ne cessaient de me houspiller pour que mes affaires soient toujours classées, rangées. Elles faisaient irruption dans ma chambre et d'un air rogue me reprochaient le capharnaüm qui y régnait: des livres partout, des revues, des journaux... Elles menaçaient de jeter ce qui n'était pas à sa place - une place qu'elles avaient décidée unilatéralement. Parfois un homme venait, en blouse blanche, prenait une feuille accrochée au pied de mon lit, fronçait les sourcils, disait deux mots à l'infirmière qui l'accompagnait et disparaissait sans un salut, sans un regard. Les femmes me reprochaient d'exister, les hommes m'ignoraient. Un seul, un infirmier, m'accorda des soins attentifs, trop peut-être. Mais j'ai tout oublié, comme je te l'ai dit.
J'appris à lire tout seul. Je dévorais tout ce qui était imprimé. Les notices des médicaments, les étiquettes, les journaux qui me tombaient sous la main, les livres qu'on me donnait. Ma réalité se forgea sur des pages imprimées. Peu à peu je devins l'ami d'Ivanohé, de Pinocchio et surtout des dieux de l'Olympe. Sais-tu qu'entre autres écarts de conduite, Jupiter le dieu-lapin avait eu cinq cents garçons et cinq cents filles plus ou moins clandestinement, avec la même femme. En rafale. Cela a évidemment contribué à me donner de la famille en général et de la reproduction en particulier une vision plutôt abstraite et théorique.
J'ignorais tout de l'actualité. Bien après la guerre d'Algérie, j'appris que celle-ci avait existé. Elle s'est passée de moi et je le lui ai bien rendu. Je me souviens seulement qu'en longeant la gare de Lyon un soir, j'entendis des détonations. J'eus peur et je partis en courant du côté de la Bastille. Un règlement de comptes entre gangsters, pensai-je. J'appris les massacres, les ratonnades et le vrai sens de la guerre beaucoup plus tard, quand ma capacité d'indignation était déjà sérieusement émoussée. À l'époque, j'étais déjà dans un foyer pour pré-ados, j'allais à l'école et je commençais mon premier roman. Les dix-huit pages sont restées intactes. Une belle histoire. Elle se passait au royaume des perroquets: on entrait dans leur château en empruntant un couloir éclairé par plus de cent lampes et des bandits convoitaient ce paradis pour y instaurer l'empire du Mal.
Aurore était ravissante. Je t'ai déjà dit qu'elle était blonde, mais je te le confirme. Maintenant que je bois n'importe comment, je peux bien raconter n'importe comment. Toutefois, ce n'est quand même pas un hasard si je te parle d'Aurore. Elle était le contraire de moi. Riche, brouillonne, gourmande. Elle dévorait la vie à pleine bouche, sans avoir peur de s'y casser les dents.
Quand je retournai chez elle avec ma provision d'histoires improvisées, le baiser d'accueil dura trois jours et trois nuits. J'avais peu fréquenté les femmes, hormis quelques aventures où j'avais été entraîné par des compagnons de beuverie. Rencontres sans importance où une verge mousquetait un vagin, mécaniquement, physiologie primaire. Mais cette fois, imprévisibles, les désordres du corps m'attendaient. Je découvris l'épuisement sans lassitude, le plaisir qui étonne. J'étais loin du défoulement hygiénique de mes nuits en bordée. Et soudain j'eus peur: le troisième jour, je sentis qu'en effet je me noyais, que mon existence ne m'appartenait plus. Or, j'y tenais, à cette vie, je commençais d'être reconnu sur la place des traducteurs, et je voulais davantage. J'étais un jeune homme ambitieux. Ambitieux de mener une vie dans l'ordre des choses. Et Aurore m'affolait, me chevauchant comme une walkyrie, une maille à l'envers une maille à l'endroit. De plus, je la soupçonnais de s'être glissée dans les apparences pour me donner l'illusion que je l'avais choisie, alors que c'était tout le contraire. C'est vrai, j'eus peur. Peur de voir mon petit monde en construction s'écrouler. Je décidai de l'annuler. Je ne voulais pas succomber à son charme, redevenir un petit malade, dépendre d'une feuille de maladie au pied du lit, des caprices d'un infirmier ou de n'importe quelle femme. J'épouserais Aurore, mais je l'inventerais aussi. C'est moi qui la dévorerais à belles dents. Pas question de la laisser régner à ma place. J'aboierais s'il le fallait.
Je m'enfuis à l'aube de ce troisième jour, honteux et bouleversé: je n'avais plus l'âge de mes histoires. Plus tard, je la demandai en mariage. Les célibataires n'ont aucun avenir. J'avais peu de chance qu'elle accepte: indépendante et fière, je la voyais mal la bague au doigt. Mais c'est là sans doute que l'idée du calcul s'insinua définitivement entre nous. Notre mariage: une façon de rentrer dans le rang. De donner à ma vie le profil d'une carrière. Et de mettre fin aux histoires.
Mais j'ai sauté quelques épisodes. Tu sais, le fil des événements. Tiens-moi la bouteille pendant que je change de position. On dit que l'instruction c'est l'homme, alors écoute-moi bien.