Mad Maria, la locomotive, avance lentement, ouvrant le chemin de la "civilisation" à travers la forêt amazonienne, elle roule au rythme de la construction de la voie ferrée qui va de rien à nulle part, la ligne Madeira-Maimoré. Autour de constructions aussi folles qu’inutiles gravitent des ingénieurs allemands, des financiers anglais, messagers de la modernité en cette fin de XIXe siècle, des politiciens de Rio et la douce Consuelo, qui va voir son piano à queue sombrer dans les eaux boueuses du grand fleuve en même temps que son mari.
Entre épopée lyrique et satire féroce, Marcio Souza nous raconte la construction passionnante et réelle d’un chemin de fer dont le seul effet a été la destruction de la forêt et de ses habitants.
-
« Une dénonciation implacable des «apports» de la civilisation qui ne manque pas d'humour. »A. ValadonESPACE LATINOS
1
Pratiquement tout ce qui se trouve dans ce livre aurait bien pu arriver comme c'est raconté. En ce qui concerne la construction du chemin de fer, il y a une grande part de vérité. La même remarque vaut pour la politique des hautes sphères. Et chaque fois que le lecteur se dira: "Je connais cette chanson ", il aura raison car le capitalisme n'a pas honte de se répéter.
En tout cas, ce livre n'a d'autre prétention que d'être un roman.
Alors, faites bien attention:
Finnegan ne savait pas que les scorpions commençaient à apparaître au début de l'été.
L'été dans ce pays, c'était quoi, en fin de compte?
Selon ce que Finnegan pouvait observer, l'été, c'était quand les pluies tombaient à torrents et que les maudits scorpions apparaissaient sur le sol de la baraque, au milieu des draps et des couvertures des lits de camp, cachés dans les bottillons, agressifs avec leurs pinces et leur queue dressées, figés, pareils à des excavatrices miniatures.
C'était le premier été que Finnegan passait à cet endroit et il apprenait tout seul à connaître les scorpions. Personne ne l'avait aidé. Mais il ne se plaignait pas, car cette terre lui avait déjà offert une liste impressionnante d'horreurs.
Finnegan savait que même les horreurs devaient être mesurées pour mériter quelque crédibilité, mais, apparemment, l'imagination humaine avait réservé à cette terre un tel lot de dangers et de menaces qu'il y avait vu le signe qu'un certain type de mystère se dissimulait derrière cette espèce de rideau d'exagérations.
Deux semaines, pas davantage, avaient suffi pour lui prouver qu'en fait il n'y avait là aucun mystère et que la liste était incomplète. En bon médecin, Finnegan avait cultivé jusque-là un sens de la mesure quant aux horreurs, mais cette mesure ne collait plus à la perspective des rigueurs qu'il devait affronter. Ce qu'il cataloguait comme horreur n'était ici, tout au plus, qu'une timide et légère calamité presque indolore. Le pouvoir de renouvellement des horreurs semblait inépuisable, comme les scorpions. Les tragédies déferlaient et, en quelques jours, leur sens devenait insondable. Le brave garçon que Finnegan était n'en revenait pas de cette capacité des hommes de supporter les pires extrémités. Et, plus grave encore, de rechercher délibérément ces extrêmes, en feignant de les considérer de haut, de mourir en braillant, mais tout en restant indifférents et muets devant le malheur de leur voisin.
C'est la vie.
Finnegan se demandait si, un jour, il serait capable d'atteindre cette indifférence taciturne, obstinée, fruit de l'insolence de la misère, bien différente de l'esprit d'aventure qui, avait-il cru, devait être le mobile essentiel de tous ceux qui se retrouvaient là.
Et les tragédies n'étaient même pas tragiques, c'étaient des hasards, des accidents du travail, des infortunes figées dans la chaîne du prosaïque.
Ce matin-là, Finnegan avait déjà écrabouillé quelques scorpions. Il se sentait en pleine forme, il s'était levé d'un bon pied et avait secoué vigoureusement ses bottillons avant de les mettre, faisant tomber comme d'habitude quelques répugnants visiteurs. Les carcasses broyées jonchaient le plancher de la baraque et ne tarderaient pas à être emportées par un bataillon affairé de fourmis rouges, des petites. qui faisaient également partie de l'interminable catalogue des plaies naturelles qui gravitaient autour de la plaie majeure, la plaie humaine. En fait, Finnegan n'était pas encore suffisamment sûr de lui pour avancer un jugement définitif sur le monde. C'était un jeune homme astucieux mais sans aucune expérience. Ses pensées manquaient de maturité et il ne savait pas s'il avait été vraiment faible en acceptant de venir travailler dans cet endroit.
Il regarda au-dehors: les vitres de la fenêtre étaient tellement encrassées qu'elles ne permettaient pas de voir le mouvement des ouvriers qui se mettaient en branle bruyamment dès le point du jour. Les vitrages laissaient la lumière intense pénétrer à l'intérieur de la baraque et c'était tout. La chaleur ne s'était pas encore installée, obligée comme chaque matin de lutter contre une humidité qui imprégnait tout, glaçait même les os parfois à l'aube, rendait douloureuses les articulations du corps comme celles d'un lutteur bourré de coups. Même sachant que la chaleur finirait par s'imposer, Finnegan était déjà tout habillé, comme indifférent à l'atmosphère irrespirable qui régnerait sur sa routine quotidienne, entre onze heures du matin et trois heures de l'après-midi. Revêtir sa tenue complète, c'était obéir à son règlement personnel. Par-dessus les horreurs se situait l'efficacité professionnelle, la seule arme qu'il eût trouvée jusqu'à présent pour supporter les mystères qui n'existaient pas.
Il observa l'intérieur de la baraque: la lumière ne laissait aucun recoin dans la pénombre, une clarté vraiment incroyable. Ses assistants étaient déjà sortis pour parcourir les chantiers. La baraque était pratiquement vide, mais, pas pour longtemps, il le savait. Bientôt d'autres malades viendraient se joindre au Noir barbadien, complètement prostré, respirant difficilement et brûlant de fièvre, qui agonisait là depuis la veille.
Cette baraque était l'infirmerie de l'équipe chargée du lancement de la voie sur l'Abounan. Finnegan vit le Noir bouger un bras et il s'approcha. L'homme avait les yeux grands ouverts, des yeux sombres sans le moindre éclat. Le Barbadien murmurait quelque chose que Finnegan approuva de la tête, comme s'il comprenait l'agonie que cet homme souffrait. Les doigts rudes du moribond agrippèrent la manche de sa chemise, Finnegan comprit et essaya de rapprocher son oreille de la bouche de l'autre. Il ne lui en coûtait rien d'entendre ce que le Barbadien voulait dire, même si la fièvre, qui n'était pas tombée durant la nuit, le faisait délirer.
- Je vais mourir, docteur? demanda l'homme.
Finnegan lui prit le poignet pour vérifier son pouls, mais ce geste voulait exprimer aussi sa compassion. Il resta muet, observant l'homme qui murmurait la même question.
- Alors, c'est vraiment la fin, docteur? conclut le moribond pour lui-même, ne pouvant arracher le moindre mot au médecin. Vous aussi vous êtes tombé dans le piège, ajouta-t-il en frissonnant. Vous aussi vous êtes tombé dans le piège.
Comme au son des Douze variations en fa majeur sur "Ein Mädchen oder Weibchen" de l'opéra "La Flûte enchantée " de Mozart, de Beethoven, concerto pour violoncelle et piano, un tourbillon d'eau se précipitait sur les pierres acérées de la chute principale de la cataracte du Ribeirão.
Le soleil cognait dur et des millions de gouttes de vapeur formaient des irisations et un mince arc-en-ciel. Un grand radeau, amarré par de grosses cordes, était tiré en amont de la cataracte. Il dansait sur le rythme démoniaque des eaux furieuses. Un piano à queue étincelant, tout noir, resplendissant au soleil, était fixé par des cordages sur le 'radeau.
Les hommes, pour la plupart des Indiens, s'efforçaient de résister à la violence du courant et se cramponnaient aux cordes, sur chaque rive, en faisant des efforts désespérés. Mais la force humaine était peu de chose face à ce courant, Alonso Campero courait et se démenait sur les pierres plates, il hurlait pour stimuler les Indiens.
Tout aussi agitée, sa femme, Consuelo, accompagnait Alonso qui -sautait sur les dalles. Consuelo ne criait pas parce qu'elle était complètement absorbée dans ses prières, elle avait déjà invoqué tous les saints du ciel, elle avait déjà fait tant de fois la promesse que si le piano parvenait à remonter, sain et sauf, les rapides, elle passerait le reste de sa vie à s'acquitter de ses engagements. Et toute la ferveur qu'elle vouait à obtenir une aide miraculeuse du ciel, elle la concentrait,,à présent sur le piano attaché sur le radeau.
Les Indiens faisaient tout ce qu'ils pouvaient, mais elle savait qu'il fallait bien davantage, plus que des efforts pour résister à la violence du courant, vraiment des miracles. C'est pourquoi Consuelo priait, sans répit, accrochée aux basques de son mari, le cœur aux cent coups à chaque péripétie, et un blasphème lui échappait qui entrecoupait ses oraisons quand un Indien relâchait son effort et risquait de tout perdre.
Alonso n'était pas dans son ambiance habituelle et cela le rendait nerveux et pressé. Son énervement n'était pas dû seulement au fait qu'il avait joué pratiquement tout son argent sur ce piano, car, tout de même, il restait toujours propriétaire de son petit magasin à Sucre où il vendait des partitions musicales, des cuivres pour les orphéons et un vaste assortiment destiné aux innombrables instruments à cordes de la ville. Il était énervé parce que c'était le quatrième piano à queue qu'il avait importé d'Allemagne pour satisfaire un rêve de son épouse, et que ledit piano ne pou
vait suivre le destin des trois premiers, tous perdus dans l'un ou l'autre des dix-neuf rapides mortels du rio Madeira.
L'investissement était considérable, il représentait des années d'économie, mais, pour Alonso, le pire, c'était de voir sa femme une fois de plus frustrée, larmoyante, sa beauté flétrie, car elle possédait un caractère enfantin, capable de se blesser profondément si ses rêves ne se réalisaient pas. Fils unique d'une famille espagnole, il savait le prix d'un rêve déçu.
Cet Alonso était un homme grand, cheveux noirs et fins, visage allongé aux traits harmonieux, menton bien dessiné encadrant une bouche aux lèvres épaisses mais à laquelle une fine moustache imprimait un air délicat et sensuel. Dans le corps athlétique, au thorax musclé et aux membres vigoureux, élancé néanmoins, se retrouvait cette sensualité, soulignée par les yeux bleus délavés qui donnaient au personnage un air romantique dont il ne manquait pas de jouer avec ses clientes. C'est pourquoi aucune d'elles n'aurait su dédaigner la moindre de ses suggestions sur un achat de partition, même la plus laconique, ce qui le rendait tout fier, encore qu'il mesurât mal son magnétisme viril et crût que son, invariable succès de vendeur n'était dû qu'à ses compétences en matière de, musique.
Consuelo était seule à connaître le pouvoir magnétique de son mari, elle avait été la première à succomber à son charme, sans se douter d'abord de quoi réellement était capable ce garçon toujours de bonne humeur, et ensuite comment elle s'était montrée de plus en plus intime avec lui, chaque fois qu'elle se rendait à sa boutique pour y acheter les dernières nouveautés, les airs à la mode et les leçons de piano dernier cri.
Alonso s'occupait seul du magasin depuis qu'il avait perdu ses parents et il avait l'air satisfait de ce travail peinard, spécialisé toutefois, qui le mettait en contact avec deux mondes différents, également dignes d'intérêt. Pour les dames et demoiselles de la société cultivée de Sucre, la Casa Santa Cecilia représentait un lieu où pouvaient s'affirmer leurs dons de l'esprit, car elles y trouvaient imprimées les notes de Chopin, Mozart, Beethoven et autres maîtres, pour ensuite en faire la délectation de soirées exceptionnelles, de réunions un tantinet ennuyeuses mais où elles déployaient des talents extra-culinaires et, par là même, participaient à la vie culturelle de la ville, activité privilégiée
des hommes. Sur ce versant de la société de Sucre, Alonso épanchait son romantisme, et ses clientes, enveloppées par ses regards, repartaient avec des brassées de portées, lui laissant de jolies petites sommes. Mais il y avait également un autre monde, celui des orphéons de la cambrousse, des guitaristes et mandolinistes, des gens autrement ouverts, bons vivants, rigolards, qui entraient dans la boutique juste avant la fermeture et n'achetaient pas grand-chose, des partitions de marches militaires, des jeux de cordes, des plectres, des chevilles, bref de petits achats qui, financièrement, comptaient moins par la rentrée d'argent que par le contact avec cette faune de la ville, différente, celle des noctambules, des cabarets, des bars et des kiosques du'dimanche. De ce côté-là Alonso ne se livrait guère. Il aimait recevoir, poser des questions, satisfaire sa curiosité d'homme jeune mais solitaire, qui rêvait lui aussi, aimait boire et goûtait la compagnie de femmes compréhensives.
Sorti de Son milieu habituel, Alonso était très énervé, il criait très fort pour stimuler les Indiens, sans quitter des yeux le piano.
Il n'avait plus qu'une chose en tête, à tout moment, cette sensation d'être hors du temps. Déjà pendant le dévonien, ça devait être pareil. Et qui sait, également durant le cambrien. Collier se sentait dans la préhistoire du monde.
Le brouillard était épais, tout était flou. Le froid matinal se dissipait, se changeait en buée tiède. Un corps en sueur, métallique, couleur de métal sombre, mêlé à des formes verdâtres, végétales, avançait en soufflant comme un dinosaure, ou un stégosaure, ou un brontosaure. De temps en temps, des scintillements de métal chromé, le brouillard qui se faisait plus dense à intervalles réguliers, c'était comme une respiration monstrueuse, antédiluvienne, une respiration pour hiver rigoureux, malgré la chaleur étouffante. Les insectes crissaient, frottis de métal contre métal. Le brouillard bouillait,
Collier entendait un souffle furieux, on aurait dit un sifflement rauque de serpent. Il n'était pas accoutumé au brouillard, c'était le sifflement du serpent qui le rassurait. Mais le brouillard envahissait tout et se faisait encore plus dense, il se mélangeait à la buée qu'exhalait le monstre qui avançait lentement, presque sur place, traînant son énorme
poids avec autant d'indolence que de prudence. D'autres animaux, plus petits, s'activaient fébrilement dans le brouillard.,Ce n'étaient que des mammifères, pensait Collier, ils s'activaient comme d'ordinaire à cette heure matinale, mais il était pratiquement impossible de définir quelle était leur action. Le brouillard et la buée transformaient tout en illustration de paysage préhistorique, et cela, jour après jour. Tout n'était que forme vague qui se mouvait au milieu de feuilles curieusement découpées, et l'illustration s'estompait, elle aussi, dans le brouillard. Signalant ces formes vagues en mouvement, des points de lumière jaune clignotaient. On aurait dit des lucioles voltigeant avec une irritante lenteur.
Le brouillard s'épaississait au-dessus du sol. Le monstre transpirant exhalait toujours sa buée, tout en progressant à grand-peine, crissant et grinçant. Nous étions sur la rive du rio Abounan, un matin ordinaire de 1911, c'était l'été.
A la période cambrienne déjà, ce devait être le même tableau.
Collier était en train d'affronter les pires moments d'un travail techniquement simple. N'eussent été ces trente milles de marigots et de terrains marécageux. Les hommes travaillaient dans des conditions inimaginables. Beaucoup étaient morts, car le travail était rude, ils ne seraient jamais suffisamment armés pour s'attaquer à un terrain aussi défavorable. Collier aurait aimé être loin de là, à quoi bon continuer de s exposer de cette façon ? Il savait qu'il risquait de tomber malade, ce qui, sur les rives de l'Abounan, signifiait une mort certaine. Mais les conditions de travail, c'était le cadet des soucis de ceux qui avaient formé ce projet. dément.
Collier pouvait voir un groupe de neuf Barbadiens qui transportaient un rail. Le jour perçait à présent et bientôt le soleil taperait et dissiperait les nuages.
Les Barbadiens étaient déjà en nage, leurs peaux noires luisaient et ils pataugeaient dans l'eau qui leur montait jusqu'aux genoux. Collier avait sous ses ordres cent cinquante hommes. L'objectif, c'était de lancer sur les marais du rio Abounan une ligne de chemin de fer, ce qui, à priori, ne semblait pas difficile. Les Barbadiens portaient le rail en direction de l'endroit où d'autres ouvriers creusaient des, fossés avec des pioches et des pelles.
Collier avait soif, il avait les bras pleins de cloques.
Quand il y passait la main, c'était comme s'il avait touché la peau rugueuse d'un saurien. Les bras de l'ingénieur Collier avAient été cruellement piqués par lés moustiques. Simplement parce qu'il avait oublié de mettre une chemise à manches longues. Il avait été obligé de s'enfoncer à vingt mètres dans la forêt vierge et il avait été aussitôt piqué par les insectes. Son coude droit ressemblait à une pomme talée - et saignante -, son coude gauche à une cerise trop mûre.
Le soleil cognait sur les Barbadiens qui, pour protéger leur peau au maximum, portaient des vêtements fermés et des pantalons longs, bien que sans doute ce ne fût pas la tenue adéquate pour travailler par 'une température de trente-deux degrés. Les rails étincelaient au soleil.
Collier avait soif et il sentait un léger mal à la tête. Sa plus grande crainte, c'était de tomber malade, mais personne ne savait qu'il avait peur, c'était un homme sec, renfermé, presque toujours bourru. De ses attributions faisait partie le commandement des cent cinquante manceuvres, quarante Allemands turbulents, vingt Espagnols crétins, quarante Barbadiens abrutis, trente Chinois imbéciles, plus des Portu aïs, Italiens et autres nationalités exotiques, et
.g 1 également une poignée de Brésiliens, tous stupides. Les plus qualifiés, quoique minoritaires, étaient américains. Les chefs étaient des Américains et ce projet était un projet américain. Collier, lui, était un citoyen britannique, un vieil ingénieur anglais têtu. Tous ceux qui travaillaient avec lui étaient américains, tels le jeune médecin, les responsables des machines et des feux, les mécaniciens, les topographes, les cuisiniers et les infirmiers. Collier était responsable d'eux, mais seulement en ce qui concernait la participation de chacun au déroulement des travaux, car pour le reste c'était leur affaire. L'ingénieur avait soif, il avait une sacrée peur de tomber malade, il était préoccupé par ses propres affaires.
Les Chinois travaillaient au déboisement, ils ouvraient le chemin dans la Jungle. Les Allemands s'occupaient de l'essouchement et du terrassement. Les Barbadiens étaient employés à la pose du ballast. Les Espagnols, auparavant au service de la répression coloniale à Cuba, faisaient parfois fonction de contremaîtres et formaient la milice de sécurité. Chaque homme avait une tâche bien définie, la "ournée de travail était de onze heures par jour, avec une pause pour le
déjeuner. Mais tous ces hommes présentaient le* même aspect, indépendant de leur nationalité. Ils étaient tous aussi mal vêtus, tous abattus, hâves, décrépits comme s'ils avaient été condamnés aux travaux forcés.
juste en face de Collier marchait un Barbadien. C'était un homme grand et maigre, il regardait le ciel et essuyait la sueur qui ruisselait sur sa peau. Les Barbadiens avaient des traits particuliers, mais le visage de celui-là était comme un masque purulent. Il avait les lèvres et une partie du visage envahies par une mycose qui les déformait de façon répugnante. A présent, il regardait respectueusement Collier. L'ingénieur le connaissait de longue date, c'était un bon ouvrier, un homme qui avait du respect, une grande indifférence respectueuse pour tout ce qui l'entourait, y compris Collier. La mycose était à vif à cause de la chaleur et n'arrêtait pas de lui donner un prurit intolérable. C'est pourquoi il se -grattait désespérément jusqu'à saigner.
Ce n'était pas un tableau agréable que voir un homme qui exhalait sueur et sang ou qui se grattait furieusement avec des lames de couteau aiguisées ou des épines. Cette vision du camp de travail sur l'Abounan n'avait vraiment rien d'agréable. Et c'était là que l'ingénieur Collier était venu se fourrer.
La locomotive avançait lentement, en lançant de la fumée. C'était une belle machine, qui faisait penser à un animal de la période jurassique. A l'orée de la forêt, de grands arbres crétacés, des insectes siluriens, des papillons oligocènes, des fourmis pliocènes faisaient bon ménage.
La vie bouillonnait dans cette promiscuité et les hommes devenaient fous au milieu de ce décor cénozoïque.
Tout comme les fourmis qui montaient et descendaient les branches des. arbres, il était là mais se sentait invisible. Les civilisés ne semblaient même pas s'apercevoir de sa présence. Il était perdu, seul, affamé; le pire, c'était cette faim qui semblait ne pas vouloir passer. Il dormait peu et ne s'écartait pas des civilisés, il était toujours à proximité, il ne comprenait rien à ce travail qu'ils faisaient avec une telle hargne désespérée. C'est que, même toujours à proximité, il ne faisait pas partie de ce monde qui, maintenant, envahissait les terres qui avaient appartenu à son peuple du temps des coutumes anciennes et dont les vieux parlaient avec émotion.
-300x460.jpg)

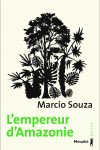
-100x150.jpg)