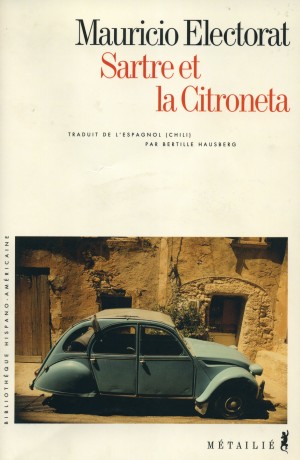Au moment où il part à Santiago du Chili pour assister à l'enterrement de sa mère, Pablo rencontre au hasard d'une promenade Nelson, le mouchard qui l'a obligé à l'exil. Ce voyage et cette rencontre réveillent ses souvenirs de militant étudiant contre la dictature de Pinochet dans les années 80.
Mauricio Electorat mêle le récit de ses années d'adolescence au difficile dialogue avec Nelson au cours d'une soirée très arrosée, où les deux déracinés qui ont partagé les mêmes expériences dans des camps opposés se retrouvent au cœur d'un pays qui n'existe plus.
Pablo nous raconte les aventures cocasses des étudiants engagés dans un parti de la gauche clandestine où ils découvrent que la fameuse résistance au régime de Pinochet tient davantage de la farce tragicomique que de l'aventure héroïque et qu'elle est très loin des idéaux de Sartre et de Camus. La réalité se charge ainsi de leur apprendre le mensonge, la trahison et l'indifférence.
L'ironie dévastatrice, l'humour et la tendresse donnent le ton dans cette construction où les plans se superposent et tiennent le lecteur en haleine d'un bout à l'autre du récit. Le roman est écrit dans une langue brillante, changeante, un feu d'artifice de styles.
Ce livre a reçu le PRIX BIBLIOTECA BREVE 2004.
-
"Un roman tendre, ironique, mélange savant de tragique et de comique, conduit par une prose dense qui emboîte les fictions les unes dans les autres : une saveur littéraire renouvelée pour un sujet déjà maintes fois traité."Hubert ArtusTRANSFUGE
-
"A mettre entre les mains de tous ceux qui, croyant bien faire, troquent leur conscience et leur générosité contre des manips pseudo-libératrices!"Arnaud de MontjoyeTEMOIGNAGE CHRETIEN
-
"Electorat fait mieux que de reconstituer le passé, il tutoie le présent en imaginant la rencontre, vingt ans plus tard à Paris, d'un fugitif et de son dénonciateur. Vraie situation hégélienne où le faux renvoie au vrai, et inversement. Telle quelle, l'intrigue captivera les plus rétifs au romanesque, mais l'essentiel est ailleurs : dans la fusion étourdissante des voix. Comme si Electorat avait refusé de priver qui que ce soit de son moi. Comme s'il n'existait d'autre vérité que plurielle."Gérard GuéganSUD OUEST DIMANCHE
-
"[...] ce livre trépidant et irrévérencieux, où l'écrivain donne libre cours à son ironie, à sa tendresse, et à son désenchantement."Ruth ValentiniLE NOUVEL OBSERVATEUR
-
"[...]ce récit sollicite et stimule sans cesse l'imagination du lecteur. Né à Santiago en 1960, installé à Paris depuis 1987, l'auteur a su puiser dans sa propre vie pour aller à la recherche du Chili perdu. Une troublante entreprise."Françoise BarthélémyLE MONDE DIPLOMATIQUE
-
"Dans ce roman d'apprentissage, au sens propre d'amour et de guerre, le comique vient tromper le chagrin des familles disloquées. Pères, mères ou oncles se dressent telles des ombres protectrices, mais démunies. C'est dans ces interstices que Electorat, sentimental, compose et imbrique le plus beau de son roman, la perte de la candeur et l'effritement de la mémoire."Philippe TretiackELLE
-
"[...] Un texte époustouflant qui frôle le chef-d'œuvre"Michel PolacCHARLIE HEBDO
-
« Deux personnes reviennent sur leur passé au Chili. [...] Dans une succession de monologues sans respiration ni retour à la ligne, Mauricio Electorat signe un roman impertinent. Son humour est une politesse redoutable pour dire un noir désenchantement. »Raphaelle LeyrisLES INROCKUPTIBLES
Après-midi d'hiver. Deux heures. Rue Simart. Un message sur l'écran de mon portable: "Appelle ton père, urgent. Un numéro de téléphone. Du Chili. Ce n'est pas celui de mes parents. C'est un portable. Il me faut trouver quelque chose à louer. J'attends devant l'adresse indiquée. Le téléphone sonne de nouveau. Allô? Oui, c'est la personne chargée de me faire visiter l'appartement de la rue Simart, elle est un peu en retard, pourrais-je repasser dans une heure? Le rendez-vous suivant est prévu rue Lamarck. Je remonte la rue Ordener. Un ciel de plomb. La pluie ne va pas tarder. Le quartier n'est pas mal. Juste derrière la Butte Montmartre. On voit des couples de touristes, des gens dans les cafés et les boutiques. Je descends les escaliers de la station Lamarck-Caulaincourt, je prends le couloir du métro et décroche le premier téléphone. Il reste trente unités sur ma carte. Je compose le numéro. Le Chili. Quel temps peut-il faire? Décembre, l'été, un soleil radieux, je regarde ma montre: deux heures de l'après-midi ici, dix heures du matin à Santiago. Allô? dit quelqu'un. Qui est à l'appareil? C'est ton cousin Roberto, je te passe ton père. Un murmure de voix. Deux secondes, mon père dit: mon fils, ta mère… et il éclate en sanglots. Que se passe-t-il? Elle a été hospitalisée hier soir, dans un état grave… un infarctus. Elle a une chance de s'en tirer? Je pose la question mais je sais qu'elle est morte. Un groupe d'adolescents espagnols sort bruyamment du métro. Pratiquement aucune, répond Julio et sa voix se perd dans un sanglot. Ma sœur lui arrache alors le téléphone des mains et dit ce que je savais déjà: elle est morte ce matin, il vaut mieux te le dire tout de suite. Merde, le sol se dérobe, un tourbillon de gens entre et sort du métro, quatorze heures cinq. Comment? Ma sœur: un infarctus. Ça va couper, je vois défiler le compte à rebours sur l'écran, appelle-moi au bureau dans une heure et demie. Montmartre. Je retrouve la propriétaire devant le numéro 70 de la rue Lamarck. Ascenseur exigu, nos nez se touchent presque, on se regarde avec un sourire de circonstance. Pas un mot. L'appartement est joli, trois fenêtres mansardées donnent sur les escaliers qui relient les rues Lamarck et Caulaincourt. La bouche du métro s'ouvre au milieu des marches et, plus haut, l'arrière du Sacré-Cœur ressemble à la poupe d'un grand bateau blanc. Ça me rappelle une gravure. Chez mes parents, il y a des reproductions de vieilles estampes de Paris, bords de Seine, paysages d'automne avec des arbres dénudés et des feuilles sur les trottoirs, comme celles qui tourbillonnent maintenant sur les marches. Mais celles-ci sont jaune vif et marron et le vent les emporte vers le bas de la rue. Ce n'est pas une gravure. Je vis à Paris depuis douze ans. Ma mère vient de mourir à Santiago. Les gravures doivent toujours se trouver dans la même pièce. Quel est le montant du loyer? Trois mille huit cents francs par mois charges comprises, dit la dame. La cuisine est pratiquement inexistante mais il y a une baignoire dans la salle de bains. Ma mère est morte. Ça m'intéresse, dis-je à celle que je suppose être la propriétaire. Je lui laisse un dossier avec les renseignements me concernant. Merci beaucoup, elle m'appellera. Dehors, il tombe une pluie languissante. Je retourne à pied rue Simart comme si j'avais tout mon temps. Je fais comme si rien n'avait changé pour ne pas savoir ou rien n'a-t-il vraiment changé? Je frappe à la porte. Un type brun, cheveux courts et lunettes rondes, me fait visiter un appartement minuscule. Une cuisine dans laquelle on entre de profil mais avec machine à laver, réfrigérateur, hotte, lave-vaisselle, tout neufs. La cuisine resplendit, d'un blanc immaculé. Un glaçon. Il y a une machine à laver, dit-il, et notez ce détail important, on peut installer un sèche-linge au-dessus car le plafond est haut et il me montre, il ne veut pas insister mais il me fait remarquer: regardez, on peut même mettre un micro-ondes sur le sèche-linge, vous vous rendez compte? Et comment! Le purgatoire doit ressembler à ça. Quatre mètres carrés d'appareils électroménagers. Il me montre la chambre? Non, je ne veux vraiment rien voir de plus. Entrez sans façon. Une moquette bleu roi traversée d'ondes bleu clair et deux lampes en forme de bois de cerf fixées au mur. J'en ai assez vu. Merci beaucoup, au revoir. Regardez, ce sont des halogènes avec variateur d'intensité, vous voulez les essayer? Non, merci. Dans la rue, il pleut toujours. Je prends le métro à la station Château-Rouge. Deux gitans jouent La Macarena avec accordéon et tambourin. Je ne peux empêcher les paroles de résonner dans ma tête: dale alegría a tu cuerpo, Macarena… Rien n'a changé.
Ça commence mal, c'est sûr, pourquoi vous dire le contraire? Ça commence même plus mal que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher un appartement à Paris, c'est pas de la tarte, je vous assure, on ne le souhaiterait pas à son pire ennemi. Vous pourriez me demander: comment, vous n'avez plus d'appartement et vous venez de perdre votre mère par-dessus le marché? Vous n'exagèreriez pas un petit peu? Enfin, que vous est-il arrivé? Pourquoi n'avez-vous plus d'appartement, venons-en aux faits, n'essayez pas de noyer le poisson. Un matin, je rentre de vacances avec mes deux enfants. Dans l'escalier, je croise un type jeune, plutôt mince, costume noir et chemise blanche. Le type marmonne un bonjour de circonstance et moi, au même instant, allez savoir pourquoi, j'ai un pressentiment, comme dans un boléro. J'ouvre la porte. Elle fume dans la cuisine. A peine a-t-elle dit bonjour qu'elle doit partir, à ce soir, il y a un gratin d'aubergines dans le four, mets le linge sale à la machine, salut. Je vais dans la salle de bains et c'est là que commencent à apparaître ce que la police appelle des preuves matérielles. Dans le cas présent, deux serviettes sur la tringle du rideau de douche. Je les palpe. Usage récent. Elle n'utiliserait jamais deux serviettes pour se sécher. Je la connais. Je retourne dans la cuisine et, en ouvrant le frigo, je tombe sur un échantillonnage complet de bières belges aux saveurs les plus dégueulasses: framboise, cerise, ananas, chocolat… Elle ne boit pas de bière. Moi, seulement de la brune. Je ne peux m'empêcher d'interpréter ce détail comme une confession. Une confession sous forme de bon coup de pied dans le derrière. Tard dans la nuit, je l'entends ouvrir la porte et s'enfermer dans la cuisine. A mon arrivée, elle fume et parle au téléphone. En me voyant, elle prend rapidement congé de son interlocuteur, raccroche, écrase sa cigarette dans le cendrier déjà plein de mégots et en allume une autre. Il faut qu'on parle. Ne me brusque pas, dit-elle. Moi, je voudrais plutôt la gifler, l'acculer, l'écrabouiller, la couper en petits morceaux, la jeter dans le vide-ordures. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces serviettes, ces bières, et pourquoi n'est-elle même pas venue nous chercher à la gare? Je vous épargne les détails macabres. Elle va droit au but: je suis follement amoureuse. Pas de moi, bien sûr. Manquerait plus que ça. D'un informaticien. Un type bien. Directeur. Et, même si elle ne le dit pas, ça veut dire pas un gagne-petit comme moi. Je demande: le type de l'escalier? Elle: quel escalier? Un grand brun avec un costume noir, je l'ai croisé ce matin au quatrième, il descendait et je montais, il venait donc nécessairement… d'ici, de "chez nous, me dis-je, mais je le garde pour moi. Je ne sais pas de quoi tu parles, réplique-t-elle. Et je réponds: de rien. Pathétique. Quelques jours plus tard, une amie commune m'appelle. Apparemment, il est mieux qu'Harrison Ford, plus séduisant même que Richard Gere. Tu m'en diras tant. Oui, oui, mieux, George Clooney, tu vois qui je veux dire? Oui, bien sûr. Eh bien, à côté de lui, c'est le Bossu de Notre-Dame. Mais revenons à cette nuit-là: amoureuse, follement amoureuse, dit-elle d'un air très sérieux en regardant la toile cirée sur la table de la cuisine. Moi: j'en ai ma claque, et elle: de quoi? Salut et bonne chance. Elle: ne sois pas ridicule. A dire vrai, si je me pose la question, je ne suis pas amoureux. Ni d'elle ni de personne. C'est dommage. Je me rappelle une chanson que chantait ma mère: tout le monde est amoureux, sauf moi. Je lui annonce: je m'en vais. Tu ne vas pas partir maintenant, tout de suite, nous avons un tas de choses à régler. Je fais demi-tour et je l'entends parler dans mon dos pendant que je me dirige vers la salle de bains. Je t'écoute, lui dis-je. Elle veut qu'on se voie la semaine prochaine pour se mettre d'accord à propos du divorce et de la pension alimentaire. Et tout de suite après: quand vas-tu venir chercher tes affaires? Je m'enferme. Ça va? J'ai un problème avec le flacon de strychnine, tu peux me passer les pinces qui sont dans la caisse à outils? Quoi? Sa voix me parvient de l'autre côté de la porte. Je répète. Et elle: idiot, toujours à faire des blagues de mauvais goût. Elle pense qu'il vaudrait mieux prendre un seul avocat, c'est-à-dire divorcer par consentement mutuel, tu m'écoutes? Oui, oui, je t'écoute, par consentement mutuel. En tout cas, ça nous reviendrait beaucoup moins cher que de prendre un avocat chacun. Tu ne crois pas? Je me regarde dans la glace. Une tête de chanteur de boléro dans un quelconque cabaret de province, à Antofagasta, par exemple, ou à Copiapó, voilà ce qui m'attend si je continue à prendre des kilos. J'aurais dû mettre à profit mes huit ans de vie conjugale pour faire de la natation, des haltères, de l'aviron, mais non. Et pourquoi pas dans un cabaret de Clermont-Ferrand, de Cadix ou de Rapa Nui? Maintenant j'en aurais la possibilité, c'est le moment idéal pour changer de vie. Elle: tu es là? Elle pense qu'il vaut mieux que chacun de nous parle aux enfants, n'est-ce pas? En attendant, elle va laisser mes affaires dans la chambre du petit. Oui, d'accord, un chanteur de boléro (souliers à talonnettes et chemise en satin à volants) se suicide dans sa salle de bains, Paris, agences de presse, à son retour de vacances le célèbre interprète Rick Palomo se tire une balle dans la tempe… Si au moins je savais chanter. Laissez-moi tranquille, monsieur l'avocat, j'essaye d'en pousser une mais je n'ai plus de voix, j'ai l'impression d'être muet, démuni devant le grand déménagement. Je ne veux pas être défendu, je préfère mourir, je l'ai tuée parce qu'elle s'est moquée de moi… Tu vas rester là longtemps? Tu peux sortir pour qu'on finisse de parler? Ah bon, parce qu'on n'a pas fini? Devant Dieu, de mon amour sincère. Tu peux te dépêcher, s'il te plaît? Elle frappe fort, violemment, de la paume de la main contre la porte. On va divorcer, tu m'entends? Elle donne des coups de pied, tape des poings. Di-vor-cer! Ne t'énerve pas, je vais sortir. Je demande au type du miroir: que peut-on faire face au directeur d'un service informatique? Réponse: rien de rien, niente di niente, nada. Et l'amour? Aphrodite, Vénus, Zeus en pluie d'or sur Danaé, jouant les cygnes devant Léda. Otra vez será, ce sera pour une autre fois, comme dit la chanson. Et, puisque nous en sommes là, ajoutez: elle m'a déjà oublié. Et moi, est-ce que je pense à elle maintenant? Non. Pour le moment, je me dis prends tes cliques et tes claques et ouste, taille la route, fous le camp. D'accord, dis-je en sortant de la salle de bains, tu connais un avocat? Elle fume, assise dans le voltaire. Elle espère et désespère. Pour une fois, tu pourrais te charger de quelque chose, tu ne crois pas? Sur un ton… que je vous laisse imaginer. Je m'approche du meuble où on range les bouteilles. Il a bu le whisky? Ne sois pas abject, il n'a bu que ce qu'il avait apporté. Je pense: ce fils de pute, ce connard, ce salaud s'est tapé le whisky, putain de sa mère, et il me laisse le frigo plein de couillonnades mais je me contente de constater: il a bu le whisky. De l'élégance avant tout. Elle ne répond pas, regarde vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la nuit ou le néant ou encore au fond d'elle-même, allez savoir. Il doit être trois heures du matin. Au moins. J'irais volontiers acheter une bouteille. Mais où? Je regarde la pendule de la cuisine: quatre heures moins vingt. Il ne me reste plus qu'à ouvrir une des bières que je n'ai pas apportées. Je choisis celle à la framboise, elle me semble moins dégueulasse. Je demande: je vous dois combien? Ne sois pas débile. J'en bois une gorgée. Santé! Elle a un goût d'adieu, de verre pilé, de mort-aux-rats.