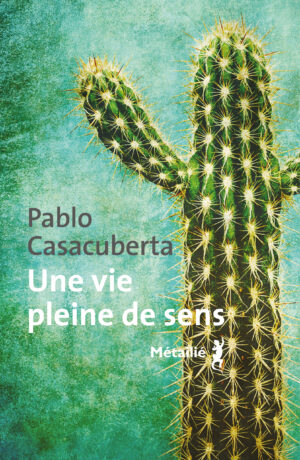David Badenbauer est un neurophysiologiste qui étudie la façon dont la communication se fait entre les synapses, et comment les cellules doivent pouvoir s’ouvrir un peu pour accueillir les informations et rester en vie.
Incurable sceptique, David parcourt un chemin accidenté de gaffes et de maladresses. Cet homme frustré se voit privé de tout, par une hostilité qu’il attribue toujours aux autres, et pratique une fuite en avant désespérée. Pour s’échapper, il a recours à une auto-ironie cruelle.
David, l’orphelin, va être expulsé de la vie qu’il s’est construite le jour où il préfère partir à Berlin pour voir son éditeur que d’assister à l’inauguration d’une exposition d’aquarelles de l’école de son fils. À son retour il retrouve la maison fermée, son compte en banque vidé, sa femme et son fils installés chez le père de cette dernière, un psychanalyste pompeux qui le déteste, et il va subir un grand divorce à l’ancienne. Mis sur la paille, il survit dans un local de stockage grâce à la bonté du propriétaire des lieux et à la bienveillance d’un rabbin qui lui apprend à perdre.
Il devra beaucoup changer pour pouvoir sortir de l’ornière économique et faire taire tous ses préjugés pour écrire un livre de commande de développement personnel très particulier. Mais tous les livres sont des livres de développement personnel, dit l’un des personnages de ce roman délirant.
Un miracle d’humour et de dérision !
Un auteur dont les livres ne vous quittent plus.
PS : Coup du hasard, au moment de la sortie de ce roman en Amérique latine, le Nobel de médecine a été décerné à une équipe qui travaillait sur ce même thème de l’ouverture des cellules dans la synapse.
-
"La vie joue bien des tours au héros de Pablo Casacuberta ! Car comment un neurophysicien aurait pu imaginer voir sa vie complètement chamboulée par les dernières volontés d'une papesse du développement personnel ? Avec virtuosité et ingéniosité l'auteur réussit une comédie loufoque parfaite pour nous faire remuer les méninges et les zygomatiques."Christophe Gilquin
-
Une petite merveille de dérision qu’orne, en couverture, un magnifique cactus ! Une vie pleine de sens est un roman dont le titre est lui-même génial. Quel sens donner à la vie de David Badenbauer, être peu commode, très légèrement ennuyeux, follement égoïste, enclin à gaffer et s’autoflageller, par ailleurs neurophysicien travaillant sur le sujet des synapses, qui finira par écrire un livre de développement personnel ? Pablo Casacuberta a la capacité incroyable, grâce à des détails, de dresser d’épatants portraits de ses personnages. Ainsi, Déborah l’épouse de David, jeune étudiante timide et bienveillante lors de leur rencontre et qui deviendra cette femme calculatrice, distante et cassante. Également, le beau-père, personnage fabuleux à haïr, psychanalyste pompeux et autosatisfait qui n’hésitera pas, au terme d’un divorce grandiose, à mettre son gendre sur la paille. C’est brillant, particulièrement drôle mais aussi révélateur de nos failles.Jean-Baptiste Hamelin
-
David, sur le papier chercheur en neurophysique, se retrouve seul et désargenté, victime d'un beau-père oppressant, abandonné par son épouse et impuissant à guider son fils adolescent. Victime pas tout à fait innocente, passé maître dans l'art de l'ironie, il n'a peut-être pas le profil idéal pour rédiger un livre de développement personnel visant à métamorphoser la vie de millions de lecteurs...Et pourtant, c'est la mission qui lui est confiée. Entre dérision et érudition, prosaïsme désespérant et questionnements philosophico-scientifiques, un roman qui invite à réfléchir sans se prendre au sérieux.
-
Ce roman délirant est un miracle d’humour et d’autodérision.David
-
Lire l'article iciSite ActuaLitté
-
Lire la chronique iciBlog America Nostra - Nos Amériques
-
"Pablo Casacuberta a la capacité incroyable, grâce à des détails, de dresser d'épatants portraits de ses personnages. […] C'est brillant, particulièrement drôle mais aussi révélateur de nos failles."Jean-Baptiste HamelinPage des libraires - Librairie Le Canet à spirales
-
"Avec Une vie pleine de sens, l’écrivain uruguayen affirme que la littérature existe non seulement pour décrire ce que nous ne comprenons pas, mais aussi ce que nous ne savons pas : elle pose, différemment de la philosophie, avec une bonne dose d’humour et une pointe de dérision, les limites du savoir potentiellement atteignable et des capacités de l’entendement humain." Lire l'article iciSite Espaces latinos
-
"Le lecteur profite joyeusement du "tourbillon d'ironie" dans lequel, pour sa part, le narrateur se débat piteusement."Mathieu LindonLibération
-
"Intelligence étincelante d’un auteur, portrait magistral de la conscience d’un personnage : le nouveau Pablo Casacuberta est un très grand roman."Damien AubelTransfuge
-
"Un héros à l'ironie revigorante et une intrigue loufoque."Béatrice SarrotL'Amateur de Cigare
-
"D'une écriture emballante, mâtinée de savoirs scientifique et biblique, de dialogues acerbes, pince-sans-rire, déchaînant trouvailles narratives souvent incongrues sinon burlesques, Pablo Casacuberta nous entraîne dans une épopée presque picaresque, toute métaphysique, avec une joie contagieuse, désarmante. Une subtile fable contemporaine."Dominique AussenacLe Matricule des anges
-
"Une lecture hautement recommandée en cas de déprime et de perte de confiance en soi !" Lire la chronique complète iciBlog Puchkinalit
-
"Une vie pleine de sens, un titre très ironique, pour un homme qui visiblement qui échoue à en trouver dans la sienne." Lire la chronique complète iciBlog Temps de lecture
-
"Avec une empathique drôlerie, Pablo Casacuberta spécule sur le peu de sens, d’attention et de curiosité, que nous pouvons – à travers la science, les mythes, le Talmud et la psychanalyse – inventer à nos vies."Site La Viduité
-
"Un livre merveilleux." Chronique à retrouver ici (en début d'émission à partir de la minute 04:30)Christilla Pellé-DouëlGrand bien vous fasse
1
J’ai cinquante-six ans. Il y a quarante ans que j’ai abandonné la maison paternelle et trente-huit que je me suis résigné à l’inexistence de l’âme. J’ai payé pour cela le prix que paient les athées : voir la durée prévue de mon existence réduite à un infime pourcentage. Mais en plus j’y ai gagné le mépris de mes parents, deux Juifs orthodoxes qui ont espacé leurs rencontres avec moi jusqu’à ne plus me voir. Le destin, cette entité qu’ils imaginaient peut-être avec une barbe et sur un trône, a voulu que la fuite de gaz d’un radiateur qu’ils allumaient au pied de leur lit les emporte tous deux dans une nuit fatidique dont ils ne se sont jamais réveillés. Malgré la rigueur et la dureté qu’ils m’avaient témoignées dès le moment où j’avais quitté l’enfance, j’ai pleuré leur mort comme s’ils avaient été des parents aimants et dévoués. Ce qu’ils ne furent vraiment pas. Leur perte me laissa dévasté et plus convaincu que jamais qu’il n’y avait ni plan ni dessein qui pût comporter, sans aller plus loin, la mort soudaine et gratuite de deux personnes qui ne souffraient pas du moindre ennui de santé. Je n’avais pas encore vingt ans lorsqu’on m’informa par téléphone qu’étant leur descendant le plus direct, je devais me rendre à la morgue pour les identifier. Une bonne partie de ma vie postérieure peut se concevoir comme la tentative de surmonter la douleur de ce jour. À leur enterrement j’ai retrouvé quelques cousins lointains qui ne me témoignèrent ni alors ni jamais aucune sympathie, de sorte que l’on peut dire, sans trop dramatiser que je me suis retrouvé très tôt dans la vie complètement seul.
Comme mes parents n’avaient pas pris soin de laisser leurs affaires financières en ordre, j’ai dépensé comme j’ai pu la maigre fortune qu’ils avaient constituée avec leur piteux atelier de chemises pour me payer des études de médecine, non tant parce qu’il s’agissait d’une discipline qui me passionnait vraiment que pour prouver à quel point ils se trompaient en me considérant comme un incapable. Naturellement, comme mon rejet de l’idée de l’âme excluait toute notion de vie éternelle, je savais que dans leur parcelle de terre ils n’étaient pas en mesure d’apprécier mes progrès, mais je mis quand même toute mon énergie à étudier et aller de l’avant. Je ne peux pas dire que ce parcours ait été facile ni agréable, car pendant les années où j’avais vécu sous leur toit, mes parents avaient réussi à installer dans mon esprit une version intériorisée et tordue de leur morale, une espèce d’homoncule qui avait le visage tantôt de l’un, tantôt de l’autre, qui me parlait à l’oreille chaque fois que ma conscience ne parvenait pas à me faire perdre confiance ou à me plonger dans le découragement.
Aussi, malgré mes efforts, j’ai été un étudiant passable. Non parce que j’étais, comme disait mon père, un âne bavard, mais parce qu’il y avait une distance infranchissable entre les matières qui m’intéressaient et les autres. La clinique m’indifférait. J’ai toujours été maladroit dans les relations avec les autres, et me charger d’un patient malade et vulnérable n’allait pas corriger cette gaucherie traditionnelle. De plus, je n’avais pas le moindre intérêt pour la pathologie. Un corps sain suscitait déjà en moi assez d’incertitudes pour ne pas ajouter à mes devoirs l’obligation de comprendre aussi ses défaillances. J’ai néanmoins suivi ces matières avec le même sens résigné de la discipline qu’un individu qui collectionne des certificats pour demander un prêt, ce qui impliqua en de nombreux cas de passer des examens avec une sensation prégnante de pénitence. Quoi qu’il en soit, au bout d’années d’entêtement, d’insomnie et parfois d’obsession, j’ai fini par réussir toutes les épreuves, ou presque, avec une note acceptable.
Mais ce furent des études solitaires. Je les ai suivies entouré de condisciples sournois et cupides, dont le rêve avoué était d’obtenir rapidement leur diplôme pour ouvrir un cabinet qui leur permettrait de remorquer tous les mois dans leur banque une petite charrette d’or. Peut-être par peur de la réaction que risquait de provoquer chez ces marchands ma totale absence d’ambition financière, j’ai traversé ces années d’université sans mentionner plus de deux ou trois fois, et seulement après avoir bu un verre, dans quelle orientation précise de travail je souhaitais faire mes armes. Les rares occasions où j’osais avouer que j’aspirais à mieux connaître les mécanismes qui rendent possible la synapse, je ne recevais comme réponse de mon interlocuteur qu’un regard condescendant, un assentiment gêné et un bredouillis qui s’efforçait, dans le meilleur des cas, de compenser par une phrase d’encouragement une vocation qui ne me permettrait pas de gagner un centime.
Tout le monde se gargarise de grands mots en parlant de l’importance de la science, spécialement lorsque la conversation porte sur la Grande Entreprise Humaine, avec majuscules, ou se limite à la liste héroïque de vaccins et de succès planétaires. Mais presque personne ne parle avec la même ferveur d’individus qui consacrent dix ans de leur vie à décrire la forme particulière en laquelle s’enroule sur elle-même une protéine, ou dans quelle mesure se raccourcissent et se détériorent avec le temps les télomères, car ce sont là des considérations qui n’incitent pas à porter un toast ni à amener quelqu’un dans son lit. Et cette routine apparemment stérile, où seul l’initié peut apercevoir après bien des années quelque lueur de progrès, a lieu la plupart du temps dans un laboratoire. Il s’agit d’un labeur répétitif, sans gloire ni éclat, qui en trois décennies de pratique quotidienne ne m’a jamais fait bondir de joie, mais qui m’a parfois au moins encouragé à sourire, de ce type de sourire qui mobilise le visage et le corps en même temps. Alors on pourrait dire que ces quelques minutes brillantes, dispersées au long de centaines de journées identiques de grisaille et d’ennui, en arrivèrent à constituer d’une certaine façon le sel de ma vie.
Mais pendant mes années d’étudiant je n’avais pas encore goûté ces rares miels, je ne faisais qu’aller de la chambre de ma pension à la faculté, de là à la bibliothèque et retour à mon lit, avec très peu de variantes les week-ends et les jours fériés. Peut-être que l’exemple le plus désincarné de cette monotonie fut le suivant : un matin de mon douzième semestre, je me suis brusquement souvenu que mon anniversaire avait eu lieu la veille sans que je m’en rende compte.
Comme cette existence spartiate n’offrait que peu d’occasions de rencontrer des femmes, je me suis inscrit dans un groupe d’initiation à la culture musicale qui se réunissait tous les jeudis. Il consistait en ce qu’un maître de cérémonie nous fasse écouter une œuvre orchestrale sur une chaîne haute-fidélité sans annoncer de quoi il s’agissait, après quoi l’assistance devait en deviner le compositeur. Je n’essayais même pas, car en plus de n’avoir aucune formation musicale, je n’avais pas l’audace nécessaire pour lever la main devant ce groupe de personnes pour la plupart beaucoup plus âgées que moi. Mais le fait de prêter attention, avec une trentaine d’individus, à un même disque diffusant symphonies ou sonates avait un indéniable pouvoir hypnotique, et pendant cet état d’exaltation je me sentais un peu plus humain et meilleur que d’habitude, aussi faisais-je en sorte de ne rater pour rien au monde ces séances, et j’arrivais au bout de quelques mois, sans jamais me risquer à intervenir, à discerner si le musicien en question était baroque, classique ou contemporain, mais sans plus.
Cette activité était gérée par la Fondation Melzer, une association de cadres juifs qui cherchait à stimuler le dialogue culturel et à offrir un espace propice pour que les laïques se rencontrent dans un contexte où ne primait pas le dogme. Pendant les années où j’ai participé à ces séances, je n’ai pas rencontré un seul Juif qui crût en Dieu, ce que, dans mon for intérieur, je vivais comme une évidente mais inavouable manifestation de supériorité intellectuelle par rapport aux associations de chrétiens. J’avais beau me méfier des arguments traditionnels que ma communauté avançait pour se considérer exceptionnelle, et refuser de partager la fierté démesurée qu’on m’avait apprise à professer de par mon origine, j’étais conscient qu’aucune association de médecins catholiques n’aurait accueilli autre chose que des dévots et des grenouilles de bénitier, aussi je ne pouvais m’empêcher de sentir que la Fondation Melzer, dont le nom rendait ironiquement hommage à un rabbin, constituait une rare oasis de sécularité au milieu de la ferveur métaphysique qui dominait l’ambiance de ma faculté. À la fin de nos séances, nous poursuivions les débats dans un café italien près de la fondation, où nous discutions passionnément des intentions présumées qui inspiraient les œuvres de compositeurs morts depuis des siècles, et même si dans ces échanges animés je n’ouvrais pas la bouche, fût-ce pour appeler le serveur, je vivais ce prolongement de nos réunions dans l’état d’exaltation d’un élève novice qui assiste à un déjeuner dans la salle des professeurs : l’intuition qu’on lui a permis de jouir d’un privilège qu’il n’a pas encore gagné. L’association comptait très peu de jeunes étudiants, de sorte que j’avais souvent l’impression que ces séances hebdomadaires étaient ce qui se rapprochait le plus de rencontres avec des oncles ou des grands-parents sages et compétents, et dans leurs discussions sur les excès de Liszt ou les peines de Chopin se glissaient des anecdotes, ou des maximes, que l’on aurait aimé entendre de nos aînés au coin du feu, un soir à la plage ou en promenade à la campagne. Mais bien que toujours captivé par les échanges et l’ambiance stimulante, j’ai commencé à remarquer que, les rares fois où manquait une participante, je sombrais dans une espèce de stupeur mélancolique, et j’écoutais alors les disques comme si le son me parvenait du pont d’un bateau lointain, dont j’étais séparé par une brume épaisse et une rumeur de vagues. En revanche, quand elle pouvait sauter son dernier cours pour arriver à temps à la séance, mon ouïe percevait nettement chaque morceau de musique comme s’il avait été composé pour moi.
C’était une jeune fille sérieuse et réservée, qui écoutait les disques en fronçant les sourcils, le regard perdu au plafond, avec l’expression inquiète de celle qui aurait découvert qu’un oiseau égaré était entré dans la salle par une fenêtre ouverte. Mais parfois, lors des brefs échanges entre deux disques, elle abandonnait son air absorbé pour éclater d’un rire chantant, très contagieux, et ces sporadiques accès de joie non seulement détendaient complètement son visage, mais aussi le mien. Bien avant de m’être rendu compte que sa présence était devenue pour moi l’attrait fondamental de ces séances, je me surpris plusieurs fois à me déplacer dans la salle, en un zigzag prétendument gratuit, de façon à me placer près d’elle. Je la regardais souvent du coin de l’œil, assise à deux chaises de distance, et je constatais alors que, de profil, elle ressemblait à une enfant. Elle avait toujours les cheveux tirés en arrière en un chignon serré, quasi dictatorial, au point qu’on ne pouvait s’empêcher d’avoir envie de la libérer de ce lien. Mais malgré la fraîcheur de son visage et son air juvénile, elle avait un aplomb et une confiance en elle-même inhabituels pour son âge. Elle levait la main au moins une fois par séance et c’était en général pour dire sans se tromper non seulement le nom du compositeur, mais souvent aussi celui de l’œuvre. Cette capacité la faisait briller parmi les plus jeunes, notamment parce qu’elle était la seule étudiante à oser prendre la parole. Je soupçonne qu’en raison de ce contraste flagrant entre son assurance et notre silence, elle devait savoir que nous l’admirions. Elle n’était pas belle à strictement parler, mais elle ne passait pas inaperçue. Du moins pour moi.
Elle s’appelait Deborah, un prénom qui lui allait très mal, car dans mon imagination cette allusion aux Écritures évoquait une matriarche sévère et distante, une sorte d’estampe millénaire qui ne la représentait pas du tout. Lorsque quelques mois plus tard je fis la connaissance de son père, un psychanalyste pédant qui se vantait d’avoir réussi une synthèse entre la pensée freudienne et le Talmud, il m’infligea, deux minutes à peine après m’avoir serré la main, un long et pompeux panégyrique sur l’origine du prénom, qu’il avait choisi en hommage à la femme qui avait exhorté les Hébreux à se dresser contre les Cananéens. Deborah, murmura-t-il pas moins de trois fois au cours de son explication. En citant des passages et des références historiques il paraissait s’élever, drapé dans sa propre solennité déclamatoire. Ce phraseur m’impressionna justement par cet irrépressible penchant à présenter chacune de ses décisions comme capitale et chargée de symboles. Mais avant même de le rencontrer j’avais déjà des réticences sur sa personne, car l’ombre qu’il projetait sur sa fille m’inspirait une méfiance que jusqu’à ce moment je ne pouvais justifier que par des pressentiments et des préjugés.
Par exemple, j’étais agacé que dans ses conversations avec des tiers Deborah l’appelle Tate. Dans ma construction imaginaire de ses motifs, il me semblait que cette perle de yiddish isolée dans une mer de langage vernaculaire était sa manière de confirmer au père que sa prétendue sagesse talmudique avait trouvé en elle un sol fertile. Mais en plus de le nommer avec cette espèce de titre nobiliaire qui paraissait excéder la simple condition de père, il était aussi manifeste qu’elle le mentionnait dans son discours plus fréquemment qu’il n’était raisonnable pour une femme de son âge. À ces petits indices, que je considérais a priori comme des signes de soumission, je pressentais qu’en faisant sa connaissance j’allais affronter un individu hors du commun et omniprésent, de ceux qui trouvent la manière de tordre le bras à toute leur famille par le seul effet habile d’un regard, et qui guettent toute manifestation de libre arbitre jusqu’à ce que le monde entier finisse par se plier à leur volonté. Bien sûr, j’étais capable de comprendre que mes suppositions étaient probablement sous-tendues par une dose de jalousie. Après tout, il s’agissait d’une femme qui me paraissait hors de portée et qui profitait de la moindre occasion pour faire référence à une figure masculine qu’elle idolâtrait. Il était compréhensible que j’éprouve, au moins sur un plan inconscient, l’impulsion de rivaliser avec Tate, ce qui expliquait peutêtre que j’affrontais toute mention de sa célèbre sagesse avec une infranchissable barrière de méfiance. Chaque fois qu’elle faisait allusion aux aventures intellectuelles de son père, j’acquiesçais et en profitais pour la regarder impunément avec la plus grande ferveur, car pendant qu’elle parlait, prêter une attention soutenue à l’éclat de ses yeux me permettait de dissimuler sous un semblant d’intérêt académique mon total ravissement. Comme elle ignorait mes sentiments, elle n’interprétait mon visage rayonnant que comme une preuve de l’admiration que pouvait éveiller l’effort paternel d’englober la psychanalyse et le Talmud dans une unique et merveilleuse combinaison formant une totalité.
J’ai tardé longtemps à lui proposer une sortie en dehors du champ de l’association. Je suppose qu’elle avait déjà trouvé très suspect que j’accompagne chacun de ses éclats de rire et que je fronce les sourcils en la voyant affectée par la moindre contrariété. J’avais beau tenter de dissimuler l’impact de sa présence sur mon humeur, j’étais devenu peu à peu une espèce de caisse de résonance de ses états d’âme.
Cette propension se fit notoire d’une manière particulièrement pathétique un jour où, pendant un intermède, elle allégua face à un des responsables de séances que l’influence de Freud sur l’œuvre de Mahler faisait quasiment du célèbre psychanalyste le coauteur de ses compositions. Il s’agissait d’un sujet dont j’ignorais tout, à commencer par le fait que ces deux figures se fussent rencontrées. Deborah termina d’exposer ses arguments, après quoi le responsable de la séance, qui était solidement rompu à l’art de répliquer aux âneries en matière musicale, lui signala que Freud avait une très pauvre culture musicale, dont la portée dépassait à peine une insistance monomaniaque sur la valeur de La Flûte enchantée, de Mozart, et que s’il avait pu avoir un certain ascendant moral sur Mahler comme mentor de sa pensée, il avait assurément peu ou pas du tout influé sur tout ce qui touchait à la mélodie, à l’harmonie, au timbre et au rythme de ses créations. À la première pause de cet échange d’arguments, j’intervins sans y être invité et j’entrepris de relativiser l’idée que la musique ne fût que “cela”, autrement dit je biffai d’un trait de plume la liste complète d’attributs perceptibles que nous écoutions si attentivement en groupe, comme si la musique n’était pas dans l’absolu un phénomène matériel, mais une espèce d’effluve mystique. Je m’exprimai avec un enthousiasme tellement étranger à ma conduite habituelle, et tellement dopé par le scepticisme que m’avait toujours inspiré la psychanalyse, que quiconque me connaissant bien m’eût demandé si j’avais de la fièvre. Cette inexplicable véhémence ne fit que couper court à la conversation, car dès que j’eus terminé mon plaidoyer, il y eut un petit flottement de perplexité, puis, dans la minute qui suivit la pause, le responsable s’excusa simplement par un sourire forcé et retourna à son poste près du tourne-disque. Deborah me regarda un instant sans faire le moindre commentaire. Je l’avais déçue. Car dans l’exposé de ses arguments il était peut-être vrai qu’elle avait fait preuve d’imprécision historique. Mais dans ma fanatique tentative de la soutenir coûte que coûte, j’avais élevé son raisonnement à la catégorie d’imposture philosophique. J’avais transformé un petit désaccord technique en une invocation voilée à l’essence, à la psyché, à l’archétype, à l’élan vital, c’est-à-dire à ce type de figure que ceux qui sont ivres de philosophie utilisent pour marquer au surligneur fluo le caractère irréfutable de leur conviction. Après ce silence compassé, elle ne me regarda plus de toute la séance.
Je ne pus l’inviter à prendre un café avant d’avoir soumis mes aspirations à l’incontournable approbation de M. Herzfeld, le nom que portait Tate pour le reste des mortels. Je me souviens encore parfaitement du soir où il est venu la chercher à la fondation. Il arriva dans une longue Mercedes couleur crème, qui se gara devant la porte, de telle façon que quiconque voulait sortir du bâtiment devait d’abord contourner cette grossière hyperbole de sa virilité. Sa manière de fermer la portière de la voiture et d’entrer dans le vestibule de la salle de réunion me rappela la démarche d’un contremaître qui annonce son arrivée dans un immeuble en construction. Le regard blasé et vague sur les plafonds, comme cherchant les fissures ou les défauts de maçonnerie, mais destiné à exprimer par des mimiques que son intérêt sur place ne tient pas fondamentalement aux personnes.
En le voyant s’approcher, je m’amusai à imaginer ce que ce phare de la psychanalyse penserait s’il apprenait la terreur qui depuis des semaines me tordait les entrailles en prévoyant les maladresses que j’allais sans doute commettre pendant notre rencontre. J’imaginais les acrobaties intellectuelles qu’il exécuterait pour intégrer dans sa lecture de mes inhibitions quelques-unes de ses inévitables références aux textes sacrés.
Comme il fallait si attendre, l’entrevue ne fut pas très prometteuse. Deborah, avec la présomption naïve que ces informations étaient susceptibles de créer une bonne impression, commença par lui expliquer que j’étais déjà en deuxième année d’une spécialisation en neurologie, puis, sans préambule, déclara que mon intention était de contribuer à élucider les mécanismes biochimiques de la synapse. Elle le formula ainsi, comme signalant incidemment que dehors il faisait chaud et que ma couleur préférée était le rouge. Cela ne fit qu’augmenter le volume de mon début de panique, car en général le mot synapse n’affleure dans les propos de personne pendant la première demi-heure d’une conversation, encore moins dès la première phrase. Néanmoins, je fus agréablement surpris qu’elle fasse état non seulement de mon orientation professionnelle, mais aussi de ce détail spécifique, auquel je n’avais fait qu’allusion lors d’une des premières séances d’audition. Mais cette surprise qui réussit à m’encourager deux ou trois secondes passée, je me tournai vers Tate et trouvai immédiatement ce même regard “compréhensif” que j’avais reçu si souvent et de tant de personnes quand je leur parlais de mes visées professionnelles, mais cette fois multiplié à l’infini et lancé depuis un très haut promontoire de sagesse et de pitié.
– Ah. Je vois. Eh bien, si vous croyez vraiment qu’un jour vous allez découvrir ce que pense ou sent un pauvre bougre rien qu’en notant les grésillements qu’échangent ses neurones, je vous conseille d’attendre assis. Cela dit, si vous aspirez à vous faire ne fût-ce qu’une lointaine idée de ce qu’un sujet garde dans sa tête, je vous suggère de vous armer de patience et de tenter simplement de converser avec lui. C’est une invention qui date de milliers d’années avant le microscope et ça fonctionne encore. – Parvenu à ce point et ne pouvant plus supporter l’éclat de son esprit, il me tapota l’épaule avec la plus grande condescendance et se tourna vers sa fille. C’était sa façon de signifier que cette partie de la conversation était close sans aucune réplique possible.
Mais ces années-là j’étais un freluquet impétueux, pas encore résigné au caractère indélébile des opinions des adultes et, après un raclement de gorge, je commençai à balbutier une défense que je n’avais pas achevé de concevoir mais que je vis jaillir de ma bouche comme une espèce d’ectoplasme maléfique, un succube émergeant de ma gorge, animé de sa propre vie et d’un très mauvais sens de l’à-propos. Lorsque j’eus terminé d’assister à ce pénible accouchement sauvage, ce que j’avais réussi à échafauder était quelque chose comme ceci :
– Eh bien, c’est justement parce que le discours que nous élaborons à la première personne sur nos processus peut se révéler aussi distant des faits réels qu’il convient que des individus comme moi, auxquels n’a pas été accordé le don de la conversation, consacrent des heures de laboratoire pour compenser leur laconisme par l’observation et des notes. Il est vrai que nous ne pouvons pas dire grand-chose sur ce que sent ou pense un sujet, spécialement quand mes professeurs surveillent les canaux ioniques d’un neurone isolé. Nous savons cependant de façon quasi certaine si ce neurone a réagi au froid ou à la chaleur, et pour le moment j’ai dû m’en contenter.
Bien que cela puisse paraître, couché par écrit, un discours compact et cohérent, en y ajoutant le ton et la prosodie qui étaient les miens à cet âge, il s’agissait plutôt d’un pataquès, d’une rafale de bredouillis et de hoquets. J’avais prononcé la phrase en trois ou quatre saccades, avec des pauses qui ne correspondaient à aucun modèle de ponctuation reconnaissable, puis je m’étais tu d’un coup, comme si au lieu d’avoir conclu mon argument, j’avais simplement manqué d’air.
Herzfeld me regarda avec un vague air d’étrangeté, comme si le passage soudain d’une mite l’avait arraché à un état de transe hypnotique, puis il dit seulement à sa fille :
– On y va ? – Rien dans son ton ne suggérait que quelqu’un venait de s’adresser à lui. Apparemment il n’estimait pas nécessaire de commenter la séquence de petits bruits qu’il m’avait entendu émettre, et une part de moi, la plus craintive, reçut ce signal d’indifférence avec un certain soulagement.
Je vis sa fille baisser la tête et s’éloigner vers la chaise où elle avait déposé son manteau. Et elle commença à ranger des papiers dans son sac avec une nervosité visible.
– Vous connaissez l’origine du prénom Deborah ? me demanda alors Herzfeld sans la quitter des yeux, et la seconde d’après il ne put résister à la tentation de répondre à sa question par un grand luxe de détails. – Comme je présume que vous êtes un laïque, de ceux qui se vantent de la distance qu’ils ont réussi à interposer avec leur origine, je vais vous expliquer l’histoire. Il s’agit de la première des prophétesses d’Israël à insister sur la lecture publique de la Torah. Dans le Talmud elle apparaît comme un modèle de sage qui, à un certain point, cesse de limiter sa propre sagesse pour devenir une conscience désincarnée. C’est pour cela que j’ai choisi ce prénom. Pour moi, la conscience n’est pas un processus corporel. On ne peut pas l’encapsuler dans la matière. Elle est signe et dessein. Nous l’empruntons, nous ne la produisons pas. Nous la canalisons mal ou bien, dans le meilleur des cas. La plupart du temps, nous l’imitons. Et quand nous la concevons comme une pure chose, c’est parce que simplement nous ne la comprenons pas.
Alors il me regarda enfin dans les yeux. Son expression était celle d’un peintre célèbre qu’un fabricant de pinceaux venait d’appeler “collègue”. Un mélange d’arrogance et de commisération, destiné à me faire savoir que nous n’étions pas sur le même bateau. Il voulait me remettre à ma place, me dire que je n’arriverais jamais à entrevoir ce qu’il avait déjà assimilé de façon définitive et totale. Qu’une vie entière de laboratoire ne me suffirait pas pour associer mes pauvres mesures avec la sagesse d’un Maïmonide. Son attitude manifestait avec la plus grande éloquence que je n’étais qu’un rat de laboratoire, ivre d’orgueil et bêtement collé à un microscope. Deborah eut la mauvaise idée de nous rejoindre à ce moment-là et de se placer entre lui et moi. Sans savoir ce qui venait de se passer, elle regarda son père d’un air dubitatif, puis se résolut enfin à ouvrir la bouche :
– Tate, à vrai dire David m’a invitée à prendre un café quand on sortirait. Je t’ai appelé avec le téléphone de l’accueil pour te prévenir mais tu étais déjà parti.
Le visage de Herzfeld s’empourpra subitement. Un réseau de veinules, jusque-là invisibles, apparurent au bord des narines comme si le sang y circulait pour la première fois. Quelqu’un osait aspirer à interagir avec sa fille unique avant même d’avoir obtenu l’accord de son père.
– Est-ce que vous allez prendre un café pour parler de cette fameuse synapse ? Ah, je parie que si ! Vous ne voudriez pas d’une bonne voix dissonante à votre table ? tenta-t-il de plaisanter, mais sur un ton amer et peu convaincant.
Deborah le regarda avec une douceur implorante sans rien dire.
– Très bien. Au retour je vais faire le plein de la Mercedes. Demain je veux le réservoir au maximum pour qu’on n’ait pas à s’arrêter sur la route de notre maison de campagne. On part de bonne heure. Ne rentre pas tard. Et sans m’adresser un seul mot, il tourna les talons et s’éloigna avec le même air blasé qu’il affichait en arrivant.