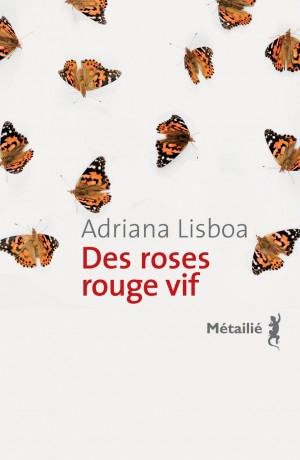Dans une fazenda isolée de l’État de Rio, près d’une carrière de pierres depuis laquelle on aperçoit la maison abandonnée que hante le fantôme d’une femme assassinée, Clarice vit seule, elle attend sa sœur, Maria Inès, qui arrive de Rio. Dans un atelier près de la fazenda, Tomas peint des tableaux médiocres. Lui aussi attend Maria Inès qu’il a aimée il y a longtemps.
Les deux sœurs ont été séparées quand l’aînée avait quinze ans, elles se sont retrouvées à la mort de leur mère puis à celle de leur père. Chacune revoit sa vie et nous découvre peu à peu leur profonde complicité, le noir passé qu’elles ont toujours occulté, le foulard orné de roses rouge vif qui a marqué leur enfance et les a projetées dans des vies qui leur sont étrangères.
Adriana Lisboa écrit un roman élégant et fascinant sur un thème classique, elle crée des énigmes et les amène à ce point du dénouement dramatique où tout jugement moral sur les protagonistes relève du domaine de l’indicible.
Un style très littéraire et original allié à une intrigue rigoureusement construite ont valu à cette romancière le Premier Prix Saramago, réservé à un jeune auteur de langue portugaise.
-
Silvana Conte
-
BRASILIDADE.COM
-
« […] le rythme du livre, sa construction, son style nous font faire un voyage haletant et onirique. »Claudine Galéa
LA MARSEILLAISE -
« Une intrigue prenante, une écriture élégante : la brésilienne Adriana Lisboa signe, avec Des roses rouge vif, le roman le plus envoûtant de la saison. Immanquable. »
Olivia de Lamberterie
ELLE -
« C’est le secret de famille qui régit ce roman adroitement construit entre passé et présent. […] la tonalité de son écriture donne un relief singulier et délicat à cette histoire. »
Anne De Saint-Amand
LE FIGARO MAGAZINE -
« L’histoire se déploie en flash-back : Clarice à 13 ans, c’est la sage, la docile. La petite sœur, 9 ans, cherche la transgression du côté de la carrière interdite, plantant des "arbres à monnaie" avec son cousin. Puis, l’adolescente part pour Rio. On est en 1965. Les sœurs se retrouvent quelques années plus tard pour l’enterrement de la mère, puis du père. Avant le rendez-vous final avec la vérité. Dans l’argile, Clarice cherche à sculpter l’oubli. Mais ce n’est pas possible. »
Véronique RossignolLIVRES HEBDO -
« Magnifique roman des moments dispersés du grandir. »
Xavier HoussinLE MONDE DES LIVRES
Un papillon, une carrière de pierres interdite
Il restait encore un peu de temps avant qu’elle n’arrive. L’après-midi estival et étouffant se décollait de la route, sous forme de poussière, et s’étirait paresseusement dans l’air. Tout était tranquille, ou presque tranquille, mou et gonflé de sommeil. Un homme aux yeux grand ouverts (et transparents tellement ils étaient clairs, chose peu commune) feignait de surveiller la route avec ses pensées. En réalité, ses yeux scrutaient d’autres lieux, ils vaguaient en lui-même et cherchaient des débris de souvenirs, tel un enfant qui ramasse des petits coquillages dans le sable de la plage. De temps à autre le présent s’immisçait, s’interposait, et il pensait j’utiliserai de la terre dans mon prochain travail. Alors le monde marron, desséché et poussiéreux se contractait à nouveau pour voir passer un blanc virginal, une jeune fille vêtue de blanc qui évoquait un tableau de Whistler. Tomás se souvenait d’elle. L’amour. Où était-il ? L’amour était comme la marque pâle laissée sur un mur par un tableau que l’on a enlevé après des années. L’amour engendra un vague interstice dans son esprit, dans la transparence de ses yeux, dans l’image vieillie de son existence. Un jour, l’amour avait crié en lui, enflammé ses viscères. Sans plus. Même la mémoire était incertaine, fragmentée, morceaux du squelette d’un monstre préhistorique enterré et conservé par hasard, impossible à reconstituer dans son intégralité. Trente années plus tard. Deux cent millions d’années plus tard. Le chien dormait aux pieds de Tomás et rêvait, sans le souvenir d’une jeune fille vêtue de blanc. De temps à autre, il gémissait. À un moment donné, il leva en sursaut sa tête blanche et noire et se mit à mordiller sa patte pour en retirer une chique. Les pintades de Jorgina, la cuisinière, s’égosillaient dans leur sempiternel caquètement qu’elle écoutait sans l’entendre. Un après-midi terne et érodé comme un vieux bout de caoutchouc, un pneu élimé. Un fossile de deux cent millions d’années. Les bougainvilliers fleurissaient de manière sauvage, presque agressive, les branches s’imposaient sans grâce ni vergogne et les épines contredisaient la délicatesse de la fleur. Ces bougainvilliers étaient déjà là bien avant l’arrivée de Tomás. Qui sait s’ils ne perdureraient pas après que, d’une manière ou d’une autre, il s’en serait allé. Le chien, qui n’avait ni nom ni maître, qui avait simplement élu cette maison comme sienne, et fait siens les restes de nourriture déposés deux fois par jour par la cuisinière sur une feuille de journal, à côté du lavoir, termina son opération de curetage de chiques et se rendormit en compagnie de ses rêves mystérieux. Comme les rêves des bébés. Tomas s’était souvent demandé quel genre de rêve pouvait fourmiller dans l’esprit d’un nouveau-né. Avait-il des souvenirs de l’utérus, faisait-il des rêves liquides et rougeâtres ? Il imagina un instant qu’un bébé rêvait du moment de sa conception comme s’il en avait été témoin, comme s’il avait accompagné pas à pas, en observateur attentif, les phases de son propre développement, un embrouillamini de cellules auxquelles les scientifiques donnaient des noms sans poésie, morula, blastula, gastrula (était-ce vraiment cela ?), un embryon, un fœtus. Dont l’émotion presque consciente était capable, depuis le début, depuis la fécondation de l’ovule, d’identifier sa mère, comme si c’était une information génétique. Son père. En était-il ainsi ? Impossible d’en avoir la certitude. De temps à autre, les yeux clairs de Tomás s’embuaient, il avait la mauvaise habitude depuis son enfance de garder les yeux ouverts, sans ciller, le plus longtemps possible, un pari cruel qu’il se faisait à lui-même et dont il sortait toujours gagnant et inévitablement perdant. Il finissait par avoir les larmes aux yeux. En cet après-midi blafard et sec, les yeux de Tomás laissèrent échapper deux filets tenus, argentés, que personne ne vit, ni le chien ni Jorgina, la cuisinière. Y avait-il des paroles cachées dans ces larmes ? Ou était-ce des larmes au-delà des mots, au-delà du monde, au-delà de l’après-midi somnolent et de l’été intense qui venait creuser avec ses doigts, ses pores, là, dans ce refuge ? Il n’était pas un homme heureux. Ni malheureux. Il se sentait équilibré, et pour cela, il avait payé le prix qui lui semblait juste, et recevait les intérêts-dividendes-correction-monétaire correspondants. Il avait renoncé à certains territoires. Abandonné l’idée d’un empire. Et ne régnait plus que sur lui-même, sur cette masure perdue au milieu de champs sans aucune importance labourés et de routes en terre qui devenaient poussière durant la saison sèche et boue la saison des pluies et ne conduisaient à aucune ambition. Quand il était venu vivre ici, il savait (même si ce n’était pas pour cette raison) que c’était la fin des rêves. Et maintenant il pensait qu’il allait peut-être utiliser de la terre dans son prochain travail, sa prochaine toile ; terre et peinture (peut-être ?). Ses pensées étaient si petites. Si petites. De la taille du sillage de parfum qu’une femme répand dans l’air. Dans le ciel très lointain, un avion passa presque sans faire de bruit, haut, il n’y avait pas d’aéroport dans le voisinage, il se dirigeait certainement vers Galeáo ou Santos Dumont, dans la capitale. Jorgina, la cuisinière, qui avait perdu la plupart de ses dents et exhibait maintenant avec orgueil un dentier très blanc, s’approcha silencieusement de Tomás et posa une tasse de café fumante et odorante sur la petite table en fer forgé de la véranda. Ce n’était pas une femme très loquace, en réalité elle avait peur des mots. Elle pensait, sans penser, qu’ils étaient traîtres comme un animal qui guette sa proie, et presque toujours injustes. Elle lança un regard sur le temps et poussa un soupir sans signification. Puis elle rentra dans la maison et regagna le fourneau où fumaient les haricots, le riz et la viande rôtie. Tomás aperçut au loin le nouveau pick-up d’Ilton Xavier qui roulait à vive allure sur la route, en exhalant de la poussière. Tous ces mouvements discrets étaient comme les signes de la respiration d’un corps endormi, rien d’autre, ils n’égratignaient même pas l’après-midi. Le café était très sucré, trop sucré, mais Tomás avait appris à l’apprécier ainsi, c’était la manière de le faire des gens d’ici, économie de café, abondance de sucre. Le chien importuné par un taon leva prestement la tête et goba l’insecte en plein vol. Tomás regarda avec indifférence ses jambes nus sous son bermuda. Sur sa peau, les marques rudes de ce lieu sans asphalte et sans béton, tels des tatouages : innombrables piqûres de moustiques, de tiques, de taons et autres bestioles, et une petite cicatrice sur le mollet gauche, laissée par l’extraction d’une larve de mouche réalisée au dispensaire de Jabuticabais. Blessures qu’il avait accumulées ses dernières années, depuis qu’il était venu vivre ici. Si près et si loin de cette jeune fille en blanc. À ses pieds, une procession laborieuse de fourmis dessinait un trait vivant sur le sol. Ni heureux ni malheureux. Un homme qui cherchait juste ce petit silence, ce larmoiement nécessaire sans aucune raison et avec toutes les raisons. La confusion entre lui-même et la poussière de la route, laissée comme une pensée, par le nouveau pick-up d’Ilton Xavier. Dans la petite pièce au sol en ciment rouge terni étaient empilés les tableaux que Cândido viendrait chercher à la fin de la semaine, toiles sans prétention dans leur intention ni par leur taille, vendues cent réais pièce et destinées à décorer les petits salons de la moyenne bourgeoisie provinciale, des cabinets médicaux ou de modestes cabinets d’avocat. D’après Cândido, le notaire de Jabuticabais en avait acheté deux. L’une était accrochée dans son étude et l’autre avait été donnée en cadeau de mariage à une de ses nièces. De temps en temps, quelqu’un commandait un portrait, le prix doublait, Cândido était satisfait, mais l’humeur de Tomás ne variait pas beaucoup, elle était uniforme comme cet après-midi sec. Dans ses paysages, il y avait toujours une route qui ne menait nulle part. Qui disparaissait derrière un arbre, dans un tournant ou dans une descente. Et dans le coin, en bas, à droite, la signature silencieuse de celui qui ne signe ses tableaux que parce que l’acheteur l’exige. Avant, quand il avait vingt ans, Tomás refusait de polluer son travail avec une signature imprévue, susceptible de perturber la composition générale, comme quelqu’un qui tousse en plein concert, comme les lumières d’une salle de projection qui s’allument avant la fin du film. Maintenant, il faisait ce que les clients lui demandaient, et pour ces derniers, une signature donnait de l’authenticité au tableau. Faisait autorité. Même la signature d’un peintre inconnu. Était obligatoire. Bref. Peu importait. Il signait son nom à la peinture noire, avec une calligraphie d’écolier du primaire. Un jour, une cliente lui avait dit : ma nièce a fait un voyage en Europe. Elle est allée Paris. Et m’a rapporté de là-bas une très grande photo, en noir et blanc, d’un homme et d’une femme qui s’embrassent dans la rue. Je ne l’accrocherai jamais dans mon salon. Par contre, tes tableaux, oui. Tes paysages sont si beaux. En plus, ce sont des peintures à l’huile, cela a de la valeur. Tomás pensa à la photo magistrale de Doisneau et sourit. Il alluma une cigarette, une spirale de fumée se déploya dans l’espace, tel un serpent ensorcelé. Et dessina une silhouette féminine éphémère qui se désagrégea dans l’atmosphère. Fatigué de tant dormir, le chien se leva, se gratta l’oreille avec la patte de derrière et, oubliant sa patte en l’air l’intervalle d’un instant précieux, il regarda au loin et aperçut quelque chose qui échappait à l’homme. Il tourna la tête et vit la porte ouverte derrière lui, il eut un pressentiment canin et sourit d’un sourire canin, ténu, presque invisible. Puis il alla s’allonger trois mètres plus loin, dans l’herbe haute et sans doute plus fraîche.