Le livre se présente comme le journal intime d’un diplomate revenu à Rio après trente années de service en Europe. Ces notes couvrent une période importante où l’esclavage est enfin aboli au Brésil. L’événement est présent en filigranes dans le roman. Il marque la fin d’un monde, tout comme l’intrigue est le signe intérieur d’une autre fin, celle des affections humaines et du temps des passions.
« Au même titre que son contemporain Eça de Queiros, Machado est incontestablement, tous horizons confondus, l’un des grands noms du roman moderne. » – Patrick Kéchichian, Le Monde
-
« Le journal intime d'un diplomate revenu à Rio après trente années de service en Europe, [... durant] une période importante où l'esclavage est enfin aboli au Brésil. L'événement est présent en filigrane dans le roman. Il marque la fin d'un monde, tout comme l'intrigue est le signe intérieur d'une autre fin, celle des affections humaines et du temps des passions. »Patrick KéchichianLE MONDE
9 janvier
Eh bien, voilà donc aujourd’hui un an que je suis rentré d’Europe. Ce qui m’a remis en mémoire cette date, pendant que je prenais mon café, c’est le cri d’un vendeur de balais et de plumeaux: “À mes balais! À mes plumeaux!” Les autres matins aussi je l’entends, mais cette fois il m’a rappelé le jour où j’ai débarqué, le jour où j’ai retrouvé mon pays, mon quartier du Catete, la langue qui est la mienne. Le même cri, oui, qu’il y a un an, en 1887, et peut-être lancé par la même bouche.
Au cours des mes trente et quelques années de service diplomatique, j’étais bien revenu quelquefois au Brésil, en congé. Mais tout le reste du temps – ce qui n’est pas peu – j’avais vécu à l’étranger. Si bien que j’ai d’abord craint de ne pas me réhabituer à la vie d’ici. Et puis cela s’est fait. Bien sûr, je garde le souvenir de gens et de choses qui maintenant sont loin, divertissements, paysages, usages, mais je ne me consume de nostalgie pour rien. C’est ici que j’ai ma place, ici que je vis, ici que je mourrai.
Cinq heures de l’après-midi
Je viens de recevoir un billet de ma sœur Rita: je le joins à ce cahier:
9 janvier
Mon frère,
Je viens seulement de me rappeler qu’il y a juste un an tu rentrais d’Europe, ta retraite prise. Il est trop tard pour aller au cimetière de Saint-Jean-Baptiste sur la tombe de notre famille, en action de grâces pour ton retour; j’irai demain; je te demande de m’attendre et de m’accompagner. Il me tarde de te revoir.
Ta vieille sœur, Rita
Voilà qui ne s’impose guère, à mon avis, mais j’ai répondu oui.
10 janvier
Nous sommes allés au cimetière. Nulle tristesse dans ce qui nous amenait, et pourtant Rita n’a pu retenir quelques larmes, comme toujours, devant la tombe où repose son mari tant regretté, aux côtés de mon père et de ma mère. Elle l’aime encore, aujourd’hui comme au jour où elle l’a perdu, voilà tant d’années déjà. Dans le cercueil du défunt elle avait fait placer une mèche de ses cheveux; ils étaient noirs en
ce temps-là; les autres, sur cette terre, ont peu à peu blanchi.
Il n’est pas mal, notre tombeau; on pourrait certes le souhaiter un peu plus simple – une inscription, une croix – mais tel qu’il est, il a belle allure. Je lui ai trouvé l’air trop neuf; ça oui. Rita le fait nettoyer tous les mois, ce qui l’empêche de vieillir. Or, je pense qu’un tombeau ancien remplit mieux son office s’il porte la marque sombre du temps, par quoi toute chose s’use. Sans cela, il paraît toujours dater de la veille.
Rita est restée quelques minutes en prière pendant que je regardais alentour les tombes voisines. Presque toutes portaient gravée, comme la nôtre, l’exhortation traditionnelle: “Priez pour lui! Priez pour elle!” Un peu plus tard, en chemin, Rita m’a confié qu’elle a pour habitude de répondre à ces demandes et de prier pour tous ceux qui sont là. Peut-être est-elle seule à le faire. C’est un être plein de bonté que ma sœur, et de gaieté tout autant.
Quant au cimetière dans toute son étendue, il m’a laissé la même impression que tous ceux qu’il m’a été donné de voir: celle d’une universelle immobilisation. Les gestes des statues, anges ou autres personnages, étaient variés mais figés. Seuls quelques oiseaux, se poursuivant ou se posant sur les branches, pépiant et gazouillant, mettaient une note de vie. Les arbustes, eux – feuillage vert et fleurs – n’étaient que silence.
En sortant, et comme nous allions déjà passer le portail, j’ai parlé à ma sœur d’une dame que j’avais aperçue pendant qu’elle-même priait. Elle se tenait debout devant une autre tombe, à gauche de notre croix. Jeune, en deuil, elle paraissait prier elle aussi, dans une attitude d’abandon et de recueillement. Son visage ne m’était pas étranger, mais je ne parvenais pas à la reconnaître. Une belle femme, en tout cas, charmantissime, comme j’avais entendu dire en Italie à propos d’autres beautés.
– Où l’as-tu vue?
J’ai indiqué l’endroit. Rita a voulu voir qui cela pouvait être. Ma sœur n’est pas seulement bonne, elle est curieuse aussi, sans toutefois mériter sur ce point un superlatif romain. J’ai suggéré que nous attendions la dame là où nous nous trouvions, près du portail.
– Non, elle peut s’attarder, allons l’observer à distance. Elle est vraiment jolie?
– C’est ce qui m’a semblé.
Nous avons fait demi-tour et, par une allée entre les tombes, nous nous sommes rapprochés, de l’air le plus naturel. Bientôt Rita s’est arrêtée:
– Mais oui, tu la connais. Tu l’as déjà vue chez moi, il n’y a pas si longtemps.
– Qui est-ce?
– La veuve Noronha. Partons, avant qu’elle ne nous aperçoive.
Maintenant en effet je me souvenais, encore que vaguement, d’une dame venue en visite à Andaraï, que Rita m’avait présentée et avec qui j’avais bavardé quelques instants.
– Veuve d’un médecin, n’est-ce pas?
– Exactement; et fille d’un grand propriétaire terrien de la vallée du Paraïba du Sud*, le baron de Santa-Pia.
Sur ce, la veuve a paru vouloir s’en aller. Elle a d’abord regardé autour d’elle, comme pour voir si elle était seule. Peut-être désirait-elle baiser la pierre tombale, le nom gravé de son mari; mais il y avait des gens alentour, sans compter deux fossoyeurs portant arrosoir et pioche, qui discutaient d’un enterrement de la matinée. Ils parlaient fort, et l’un d’eux se moquait de son compagnon: “Un pareil, tu le montais jusqu’ici, peut-être? À quatre comme toi, oui!” Il s’agissait évidemment d’un cercueil trop lourd, mais je ne les ai pas écoutés longtemps, tout occupé à nouveau de la veuve qui s’éloignait lentement, sans se retourner. Gêné par la masse d’un mausolée, je ne l’ai vue ni plus ni mieux que la première fois. Elle a descendu l’allée jusqu’au portail; un tramway passait, elle y est montée. Nous sommes sortis derrière elle et revenus en ville par le tramway suivant.
Rita s’est mise alors à me parler de la jeune femme, de sa vie, du grand bonheur qu’elle avait connu auprès de son mari, enterré ici deux ans auparavant. Leur vie commune avait été bien brève. Sur ce, je ne sais quelle inspiration maligne m’a fait risquer cette réflexion:
– Cela ne veut pas dire qu’elle ne se remariera pas un jour.
– Elle? Non!
– Qu’en sais-tu?
– Non, elle ne se remariera pas. Il suffit de savoir comment ils se sont connus, comment ils ont vécu et combien elle a souffert quand elle l’a perdu.
– Cela ne veut rien dire, elle peut fort bien se remarier; pour se remarier, il suffit d’être veuve.
– Mais moi, je ne l’ai pas fait.
– Toi, c’est autre chose, tu es unique.
Ma sœur a souri, m’a lancé un regard désapprobateur, en hochant la tête, l’air de me dire: “Tu es un vaurien.” Puis elle est vite redevenue sérieuse, parce que le souvenir de son mari la remplissait d’une vraie tristesse. J’ai relancé la discussion sur la veuve. Rita, consentant à donner un tour plus gai à la conversation, m’a invité à voir si la veuve Noronha m’épouserait; quant à elle, elle pariait que non.
– M’épouser, moi? Avec mes soixante-deux ans?
– Tu ne les parais pas; tu es si vert qu’on t’en donnerait trente.
Nous sommes bientôt arrivés chez moi, et Rita est restée déjeuner. Avant de passer à table, nous avons encore parlé de la veuve et du mariage, et elle a réitéré son pari. À quoi je lui ai répondu, en me souvenant de Goethe:
– Ma chère sœur, tu es en train de me lancer le même genre de défi que celui de Dieu à Méphistophélès; tu connais l’histoire?
– Non.
Je suis allé prendre sur un rayon de ma petite bibliothèque le volume du Faust, l’ai ouvert à la page du Prologue dans le Ciel, que je lui ai lue en résumant de mon mieux la situation. Rita a écouté attentivement le défi que se lancent Dieu et le diable au sujet de Faust, le serviteur du Seigneur, que le Malin prétend conduire infailliblement à sa perte. Rita n’a pas beaucoup de lettres, mais de la finesse et, pour l’heure, elle avait surtout faim.
– Allons déjeuner. Je ne veux rien savoir de ce prologue, ni d’aucun autre. Je répète ce que j’ai dit; à toi de voir si tu es capable de rebâtir ce qui présentement est détruit. Allons déjeuner.
Nous y sommes allés. À deux heures, Rita est repartie pour Andaraï, je suis venu écrire ces lignes et vais faire un tour en ville.
12 janvier
En rapportant ma conversation d’avant-hier avec Rita, j’ai omis ce qui avait trait à ma femme, enterrée là-bas, à Vienne. Pour la seconde fois, Rita m’a conseillé de faire venir son corps, pour qu’il repose dans notre tombeau de famille. Je lui ai redit qu’il me serait doux de l’avoir près de moi mais qu’à mon avis les morts sont bien là où la vie les a quittés; elle
a répondu qu’ils sont bien mieux auprès de leurs proches.
– Quand je mourrai, lui ai-je dit, j’irai là où elle sera, quelque part dans l’autre monde, et elle viendra à ma rencontre.
Elle a souri, et cité en exemple la veuve Noronha qui a fait venir le corps de son mari de Lisbonne, où il est mort,
à Rio de Janeiro, où elle compte finir sa vie. Elle n’a rien ajouté à ce sujet mais reviendra sûrement à la charge, jusqu’à obtenir satisfaction. Mon beau-frère me le disait déjà: c’est là sa façon de faire, quand elle veut quelque chose.
Autre point que j’ai passé sous silence: l’allusion qu’elle a faite aux Aguiar, un couple dont j’avais fait la connaissance lors de mon dernier congé passé à Rio, et que je viens
de rencontrer à nouveau. Ce sont des amis de Rita et de la veuve: dans une quinzaine de jours, ils vont fêter leurs noces d’argent. Je suis allé les voir deux fois, et le mari m’a rendu mes visites. Rita m’a parlé d’eux avec sympathie et m’a conseillé d’aller les féliciter quand ils célébreront cet anniversaire.
– Tu y rencontreras Fidélia.
– Quelle Fidélia?
– La veuve Noronha.
– Elle s’appelle vraiment Fidélia?
– Eh oui!
– Un nom n’empêche pas de se remarier.
– Tant mieux pour toi, qui remporteras une double victoire, sur la personne et sur le nom, et finiras par épouser la veuve. Mais je te répète que je n’y crois pas.
14 janvier
La biographie de Fidélia ne présente qu’une particularité: père et beau-père étaient ennemis politiques, et chefs de partis dans leur Paraïba du Sud. L’inimitié entre familles n’a pas empêché certains jeunes gens de s’aimer, mais cela
à Vérone ou je ne sais où. Et encore, pour ceux de Vérone, il se trouve des commentateurs pour dire de Roméo et de Juliette que leurs familles étaient plutôt amies, et du même parti; d’autres affirment qu’ils n’ont jamais existé, sinon dans la légende, voire dans la seule cervelle de Shakespeare.
Dans nos cités, qu’elles soient du nord, du sud ou du centre, je ne pense pas qu’un tel cas se présente. Ici, les jeunes pousses ne font que prolonger les dispositions hostiles des racines, chaque arbre grandit en espace clos, sans étendre
de branches vers l’arbre voisin, et en cherchant même à rendre stérile le sol qui le porte. Pour moi, c’est ainsi que je haïrais, si j’étais capable de haine; mais je ne hais personne: perdono a tutti, comme à l’opéra.
Quant aux amoureux du Paraïba, comment en sont-ils arrivés à s’aimer, c’est ce que Rita ne m’a pas conté, et que je serais curieux d’apprendre. Roméo et Juliette ici, à Rio, entre l’agriculture et le barreau – car le père de notre Roméo était avocat dans sa capitale – voilà de ces conjonctions qu’il serait important de bien connaître, afin de les expliquer. Rita ne m’a pas fourni de détails; il faudra que je me souvienne de lui en demander. Peut-être me les refusera-t-elle, en se figurant que je commence à soupirer pour la dame.
16 janvier
Comme je sortais de la Banque du Sud, je suis tombé sur Aguiar, qui y est fondé de pouvoir et qui arrivait. Il m’a salué très cordialement, m’a demandé des nouvelles de Rita et, pendant quelques minutes, nous nous sommes entretenus de choses et d’autres. Cela, hier. Et ce matin j’ai reçu un billet du même Aguiar m’invitant, en son nom et au nom de sa femme, à aller dîner chez eux le 24. Pour leurs noces d’argent. “Un dîner tout simple, entre amis” a-t-il précisé. J’ai su depuis que la fête n’aura rien de mondain. Rita aussi y va. J’ai décidé d’accepter, j’irai.
20 janvier
Trois jours cloîtré ici, avec un bon coup de froid et une pointe de fièvre. Aujourd’hui je vais mieux et le médecin m’autorise à sortir demain. Mais pourrai-je aller aux noces d’argent des bons vieux Aguiar? Praticien prudent, le docteur Silva me le déconseille; ma sœur Rita, qui m’a soigné deux jours durant, est du même avis. Je ne soutiens pas le contraire mais, si je me sens frais et dispos, ce qui n’est pas exclu, il me coûtera de n’y pas aller. Nous verrons bien; trois jours sont vite passés.
6 heures du soir
J’ai occupé ma journée à feuilleter des livres; relu en particulier quelques pages de Shelley, ainsi que de Thackeray. L’un m’a consolé de l’autre; le second m’a désabusé du premier; ainsi voit-on le génie équilibrer le génie, cependant que notre esprit s’initie aux diverses langues de l’esprit.
9 heures du soir
Rita a dîné avec moi; je lui ai dit que je suis sain comme une pomme, et assez solide pour aller aux noces d’argent. Après m’avoir conseillé la prudence, elle a reconnu que si je n’ai plus rien et sais me modérer à table, je peux en effet ne pas manquer la soirée. D’autant que mes yeux y seront à la diète complète.
– Je crois que Fidélia ne viendra pas, a-t-elle expliqué.
– Vraiment?
– J’ai rencontré aujourd’hui son oncle, le Conseiller* Campos, qui m’a dit l’avoir laissée aux prises avec sa névralgie habituelle. Oui, elle souffre de névralgies. Quand survient la crise, il y en a pour plusieurs jours et, avant qu’elle ne cède, il faut beaucoup de remèdes et de patience. J’irai peut-être la voir demain ou après-demain.
Rita a ajouté que les Aguiar sont consternés; ils comptaient sur elle, sa présence devait être un des charmes de la fête. Ils l’aiment beaucoup, elle le leur rend bien, et tous trois méritent qu’on les aime: telle est l’opinion de Rita, et il se peut qu’elle devienne un jour la mienne.
– Je te crois. C’est décidé: sauf réel empêchement, j’irai. Moi aussi je trouve que ces Aguiar sont de braves gens. Ils n’ont jamais eu d’enfants?
– Non, jamais. Ils sont de nature très affectueuse, Dona Carmo encore plus que son mari. Tu n’as pas idée de leur bonne entente. Je ne les fréquente pas assidûment parce que je vis très retirée, mais les quelques visites que je leur rends suffisent à me faire découvrir ce qu’ils valent, elle surtout. Le Conseiller Campos, qui les connaît depuis des années, pourrait te dire ce qu’ils sont.
– Il y aura beaucoup d’invités au dîner?
– Non, assez peu, je crois. La plupart de leurs amis viendront seulement après, passer la soirée. Ils ne sont pas fortunés, le dîner n’est que pour les plus intimes, et c’est pourquoi l’invitation qu’ils t’ont faite révèle une grande sympathie personnelle.
C’est l’impression que j’avais déjà eue quand je leur ai été présenté, il y a sept ans; mais j’avais supposé, alors, que leur amabilité s’adressait au diplomate plus qu’à l’homme. Depuis mon retour, chaque fois qu’ils m’ont reçu, la sympathie a été évidente. J’irai donc le 24, que Fidélia y soit ou non.
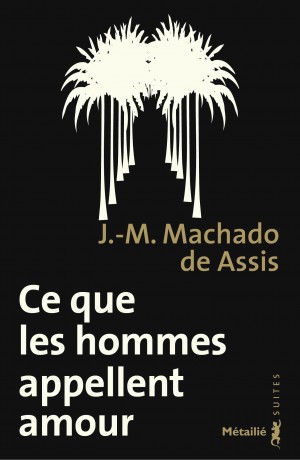







-100x150.jpg)

