A Lipanusa, île de lave noire dont le nom imaginaire évoque de fameuses îles siciliennes, débarque Salvo, un policier de la Brigade anticriminelle de Palerme, sentimental et brutal, poète et voyou. Blessé, jusqu'à l'âme, par des tueurs de la mafia, il vient se reposer chez Manio, un ami d'enfance médecin. Peu après son arrivée, Toni, un marginal odieux et violent que Salvo n'a pas hésité à tabasser est assassiné. Salvo ne peut s'empêcher d'intervenir dans l'enquête qui concluait à un accident. Tandis que la tempête isole l'île, il rencontre la belle
Iasmina et ne tarde pas à se demander s'il veut vraiment connaître la vérité. D'autant que son ami a un comportement étrange.
Le récit allie la nervosité laconique des maîtres du noir avec des dialogues qui restituent la saveur de ces parlers siciliens auxquels Camilleri, l'auteur de La Disparition de Judas, nous a habitués. Il restitue l'intense et austère beauté d'un bout du monde soumis au choc des éléments et aux passions primordiales. L'atmosphère qu'il installe devrait longtemps hanter le lecteur.
-
« Sur un sujet d'apparence classique, Di Cara réussit un huis clos oppressant, où se bousculent des personnages englués dans leur destin. »Danielle SchrammTELERAMA
Je ne sais pas.
Je ne sais pas si c'est bien de raconter cette histoire.
Je ne sais pas si c'est bien de raconter des histoires.
Certains disent que oui, que je devrais la raconter. Mais je n'en suis pas sûr. Je ne suis sûr de rien, et surtout pas de si c'est bien de raconter des histoires.
Le fait est que je ne sais pas si cette histoire m'appartient. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des histoires qui appartiennent à quelqu'un. Si quelqu'un peut revendiquer la paternité, la propriété d'une histoire. Je pense aussi que celle-là, tout le monde en a parlé, elle appartient, au moins dans l'imaginaire, à beaucoup de ceux, sinon à tous ceux qui malgré eux y ont pris part. Qui sait combien de gens, là-bas, se sont fait une idée, ont exprimé leur point de vue sur cette histoire.
Alors.
Il y a que cette histoire, je la sens à moi.
Voilà pourquoi tant d'incertitudes.
Voilà pourquoi je me demande s'il faut la raconter ou pas. Cela pourrait être un point de vue, et rien de plus. Sauf que c'est le mien.
Cette histoire, je la sens à moi.
C'est mon histoire.
J'ai un toit sur la tête. Ça, c'est sûr. C'est un plafond en maçonnerie, blanc, ou plutôt non, sale, blanc sale. En tous les cas, c'est un plafond, je vois les toiles d'araignée et une large tache de moisi.
Le bras me brûle. Le droit. A la hauteur du coude. Au creux. Une brûlure fixe, continue, gênante. Comme une piqûre. Comme quand on donne son sang.
Je me tourne, à grand peine, vers.
Un petit tube, une valve papillon, un flacon de verre, avec les mesures... 100, 200, 300... un sparadrap, une aiguille.
Je me remets à fixer le plafond.
Je tousse.
Le bras me brûle affreusement.
Le flanc aussi, ou peut-être les flancs, ou mieux le buste, le corps. Tout le corps. C'est une brûlure, une douleur diffuse qui appartient à mon organisme, à tout mon organisme. Nous sommes membres du même organisme. Tous les membres sont des organes.
Ils brûlent tous, indistinctement.
... mais que...
Je me souviens.
L'autoroute est dégagée.
Je conduis, pas tranquille, je tousse violemment, ma vue se brouille. La toux de dix jours de cigarettes sans pitié, de cafés et de nuits blanches. La toux de dix jours durs, enragés, paranoïaques. Avec la violence du stress, avec la paranoïa typique de notre travail. Irrationnelle, folle paranoïa. Une fureur, comme dit un de mes amis, un fanatisme éthique unique, difficile à comprendre.
La tête. Elle me tourne. Pleine de peur, tourbillonnante. Je ne suis même pas bourré et je voudrais l'être. Entre mes cuisses, je serre une Ceres. Je l'ai achetée dans une sandwicherie, avant d'entrer sur l'autoroute. La sandwicherie où presque chaque soir, avant de prendre la route du retour à la maison, je m'arrête pour acheter une Ceres. C'est un rite auquel je ne peux pas renoncer. Et quand ils n'ont pas de Ceres, ça me met mal. Parce que ce n'est pas la même chose, la Ceres, c'est pas la Bud, ou l'Heineken, ou la Moretti. Non. Non, non. Mais pas parce que la Ceres serait la meilleure, ou peut-être qu'elle l'est, c'est parce qu'elle, elle appartient à mon rite, à mon vaudou personnel contre toute la saleté que je suis obligé de côtoyer, contre toute la saleté que je suis obligé d'avaler.
Il y a eu dix jours absurdes.
Et puis hier et aujourd'hui.
J'y réfléchis un peu. Il n'est pas exact de dire aujourd'hui, mais je sais pourquoi je dis comme ça, parce que c'est comme si aujourd'hui, le temps s'était allongé de manière démesurée, comme s'il avait cessé de courir à sa manière et qu'il se soit dilaté jusqu'à transformer hier aussi en aujourd'hui. En réalité, c'est d'hier que je suis en train de parler, du jour précédent qui s'est étendu sur aujourd'hui jusqu'à l'envahir, jusqu'à en devenir partie intégrante, comme si ce jour avait duré quarante-huit heures.
Quelle confusion.
J'essaie de mettre de l'ordre, mais je n'y arrive pas, je suis trop... confus.
Je ferme les yeux.
Je suis en train de conduire. Je suis fatigué, je tousse, je fume, je bois la bière. Je regarde le rétroviseur, les phares, deux ou trois en file, deux plus proches, deux autres lointains. Je ralentis, je laisse l'auto la plus proche me dépasser, je la regarde défiler à ma gauche. Un couple. Un homme et une femme, il m'a semblé qu'ils se disputaient. Probable, il est normal que les couples se disputent. Je le fais moi aussi, ou plutôt je le faisais, maintenant je ne me dispute plus, je n ai plus personne avec qui me disputer. Je regrette, on s'habitue à tout, même aux disputes, c'est à elles que je pense le plus souvent.
Aux disputes.
Furibondes, exténuantes, épiques.
Je lance la cigarette par-dessus la vitre. Je me demande si ça vaut le coup d'en allumer une autre.
Je jette un nouveau coup d'œil au rétroviseur. Les autos se sont raréfiées, l'une d'elles m'a dépassé.
Je suis très tendu. J'ai peur.
Je me sens traqué, plus que d'habitude.
Ça va, je pense. Tout va bien. Personne ne me suit.
Maintenant oui, maintenant, c'est le bon moment pour une autre cigarette, je la cueille dans le paquet mou, il est presque fini, heureusement qu'à la maison j'en ai un autre en réserve. La Ceres aussi est finie. Et la sortie de l'autoroute, ma sortie, est à un kilomètre.
Je continue. Tu vois ça.
Je prends la sortie suivante, je reviens en arrière en suivant la nationale, à vitesse réduite, pour rendre impossible toute filature.
Les gars m'avaient dit:
- SaIvù, on t'escorte ?
- Non, j'ai répondu. C'est pas nécessaire, je préfère rester un peu seul, j'ai besoin de mettre de l'ordre dans mes idées et de comprendre ce que je vais faire, ce qui va se passer.
Personne ne me suit.
Je m'arrête au bar du carrefour, il est presque minuit, mais il y a un bordel de tous les diables, des dizaines d'autos et de filles, un tas de gens et des voix et des rires. Beaucoup de gens de mon âge, quelques-uns plus jeunes, et qui ont l'air de s'amuser. Sûrement plus que moi, qui ne m'amuse pas du tout, en fait. J'achète une autre Ceres. Je regarde un peu autour de moi d'un air suspicieux, bon, plus que d'habitude. Maintenant, la menace, je la sens concrète.
Je le savais, que tôt ou tard un truc de ce genre pouvait arriver. Sauf que je me berçais de l'illusion que je m'en sortirais. J'ai une frousse terrible. La frousse qu'ils me tirent dessus, la frousse de devoir tout abandonner et m'en aller. Parce que je me suis habitué au genre de vie que je mène. C'est une vie hallucinée, c'est vrai, mais ça me plaît. Ça me plaît de savoir que je fais quelque chose d'utile, que je ne gaspille pas mes énergies, que je les utilise, que je les dépense pour une cause juste, pour une juste raison.
Quel bordel. Tout le monde rit. Eh ouais, c'est samedi soir, ils s'amusent, ces cons. Et merde. Ils s'amusent.
Nous, on s'amuse jamais, je me disais. On s'amuse jamais, putain de merde, qu'est-ce que ça veut dire qu'on s'amuse jamais ? Ça veut dire qu'on va pas traîner dans des bars ? C'est vrai. Qu'on fréquente pas les discothèques ? C'est vrai. Qu'on va toujours dans le même restaurant parce que... c'est vrai.
Mais qu'est-ce que j'y peux si ma vie c'est ça, et si on est pas à Padoue ou à Ferrare ?
Je me descends une gorgée de bière, elle passe de travers, je tousse, je crache, je deviens écarlate. Une fille me regarde, elle rit.
- Et alors, qu'est-ce t'as à me mater ? je dis.
Et merde ! Le type de la nana me lance un regard mauvais. Je lui en lance un moi aussi. Et il doit l'être vraiment, mauvais, parce qu'il met un bras sur l'épaule de sa fiancée et il s'éloigne. Je te les prendrais tous à coups de pied au cul !
Va te faire foutre.
Je monte en voiture.
Je démarre sur les chapeaux de roues.
Je finis la bière. Je jette la bière par la fenêtre. Et qu'est-ce que j'en ai à branler.
Je rentre chez moi, vaut mieux.
J'habite à la campagne, pas loin de la ville. Une villa, petite mais fonctionnelle, trois pièces, une remise, jardin et emplacement pour l'auto.
J'attaque l'allée. Pleins phares.
Personne.
Parfait.
Je m'arrête.
J'ouvre la portière.
Je descends, clés à la main.
Je m'approche du portail.
Le chien des voisins n'aboie pas, bizarre.
Un frisson, une sensation glacée à la nuque.
Je me retourne... ou plutôt je ne réussis pas à me retourner tout à fait... je tends la main vers le pistolet... non, merde... je l'ai retiré de l'étui, je l'ai mis entre mes cuisses pendant que je conduisais, il est resté dans la voiture.
Le projectile me passe près, putain, près, je l'entends siffler. Je voudrais me jeter à terre, plonger dans la voiture, prendre le pistolets tirer...
Qu'est-ce que ça fait mal... qu'est-ce que ça fait mal... là... à la poitrine.
Je tombe.
Je suis mort, je pense.
-300x460.jpg)

-100x150.jpg)
-100x150.jpg)
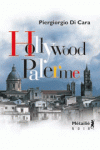
-100x150.jpg)