Au début, il y a eu l'attentat. Une explosion énorme, en plein Palerme, qui tue un juge symbole de la lutte anti-mafia et qui projette l'inspecteur principal Salvo Riccobono au milieu de la rue, à demi nu, l'arme au poing.
Une explosion qui va continuer à résonner tout au long des longues journées de ce flic de base, occupé avec son équipe à surveiller quelques-uns des membres de la Cosa Nostra. Dans les brefs intervalles que lui laissent filatures angoissées, paperasses abrutissantes, écoutes, procédures et arrestations mouvementées, l'inspecteur se plonge dans les longs aveux d'un repenti de la mafia. De cette lecture fascinée se dégage le portrait d'un grand chef mafieux aux trousses duquel Salvo va se lancer avec des sentiments mêlés.
Palermitain, commissaire antimafia, Piergiorgio Di Cara met ici à contribution son expérience de chaque jour. Avec une précision documentaire et un grand sens du rythme, de chagrins d'amour en scènes d'action, il compose une véritable plongée dans l'âme d'un homme en danger
-
"Ce troisième volet des enquêtes de Salvo Riccobono fait plus que confirmer les qualités littéraires du commissaire antimafia Piergiorgio Di Cara, de Palerme : en plongeant dans les fragilités, les angoisses et les défauts de son personnage, il ajoute une nouvelle profondeur à une série qui a déjà séduit de très nombreux lecteurs en Italie comme en France et ailleurs."Robert QuiriconiASSOCIATED PRESS
-
"Au bout d'un voyage halluciné sur les étranges autoroutes du Sud italien, se dessine le portrait de la vie quotidienne d'un commissariat de province, où Di Cara excelle à intriquer ses portraits de personnages insolites."Vincent LabaumeTOUT PREVOIR
-
"Dans le style sicilien, âpre, réaliste et violent, traversé d'éclairs d'un lyrisme douloureux, jouant avec virtuosité de l'oralité d'une langue crue et expressive très bien rendue par la traduction de Serge Quadruppani."Eric SteinerLA LIBERTE
-
"Piergiorgio Di Cara, mêlant fiction et réalité [...] et jouant avec la mythologie traditionnelle du polar, a réussi son coup : il crée des romans tout en finesse, profonds sans en avoir l'air, graves et pleins de sentiments, distrayants et très documentés sur cette mafia qu'il combat lui-même chaque jour, au péril de sa vie."Jean-Claude PerrierLIVRES HEBDO
-
"Piergiorgio Di Cara, commissaire à la brigade anti-Mafia de Palerme, fait figurer ces sublimes beignets de riz parmi les mets préférés de Salvo Riccobono, son inspecteur anti-Mafia palermitain dont il poursuit la "saga" en terre calabraise."Alain LéauthierMARIANNE
-
« L'inspecteur Salvo est aux abois depuis qu'il a assisté à l'attentat contre un juge. La scène le hante. Salvo, de filatures mouvementées en paperasserie fastidieuse, devra reconnaître son dégoût mêlé de fascination pour le chef de la Cosa Nostra qu'il poursuit. Un roman au style nerveux qui jette un œil sans complaisance sur ces flics de l'ombre. »Myriam PerfettiMARIANNE
J'avais The Wall dans les écouteurs.
Il faisait chaud. Une chaleur étouffante, profonde, africaine.
Une journée de sirocco.
La rue en bas de chez moi était assiégée par le soleil et par le vent chaud. Un souffle brûlant qui glissait le long de l'asphalte, le liquéfiant.
Je gardais les volets baissés. Et des stylets de lumière se projetaient dans la chambre.
Ombre; lumière; ombre; lumière.
Par intervalles.
Chez moi, il n'y avait personne, rien que moi.
Papa et maman étaient à la mer, dans la villa. Mon frère n'était pas là, à présent je ne me rappelle pas où il était, je crois pas qu'il était avec les parents. Peut-être faisait-il du camping, avec des amis. Ou je ne sais où.
J'étais en slip.
Seul.
Sur le divan du salon.
Les stores baissés et The WaII dans les écouteurs.
Posée sur la tablette du téléphone, une bière. Je ne me rappelle pas quelle bière, elle était en bouteille, ça je me rappelle. Elle était bien fraîche, je venais de la tirer du frigo.
J'écoutais The Wall.
Ça, c'est le souvenir bien vivant. Presque une cicatrice imprimée dans ma mémoire. C'est sûr, la mémoire, c'est étrange, on se rappelle des trucs et pas d'autres. Va savoir pourquoi. Va savoir pourquoi je me souviens que j'étais en
train d'écouter The Wall dans les écouteurs et non pas quelle bière j'étais en train de boire ou de quelle couleur était le slip que je portais, ou encore où était mon frère. Je devrais tout me rappeler de ce jour, tout. Et en fait, non.
Mais, à bien y réfléchir, je sais pourquoi je me rappelle The Wall. Pour deux raisons: la première, parce que je ne l'écoutais plus depuis un moment, l'autre, maintenant, on y arrive.
Is there anybody out there?
Is there anybody... aoudère?
Je me trompe, je sais, mais c'est comme ça que ça sonne dans mes oreilles: aoudère... le deuxième vers, avec la suspension et le t final de out... aspiré, da there, je l'entends aoudère.
Et il y avait le silence, au-delà des écouteurs, autour de moi, dans la pièce vide. Un silence envahi par le ronronnement du frigo et du ventilateur pointé sur mon ventre. Le silence des bulles de la bière, un silence hébété. Coupé par intervalles, comme les lumières et les ombres, par le gloup gloup de la machine à laver.
Je sais, je sais. La machine à laver ne fait pas gloup gloup. C'est une citation: elle est tirée d'un des romans de la série Les Feux de l'amour. Les romans de la série télévisée, j'en ai une dizaine, je crois être un des rares à les avoir.
Mais ça, ça n'a pas d'importance.
J'écoutais The Wall, et je fixais le mur devant moi.
Cloisons, portes-fenêtres avec les stores baissés, cloisons avec tableaux.
Puis, une explosion.
Mais l'appeler explosion est réductif. C'est peu, ce n'est pas exact, ce n'est pas ce que j'ai entendu, moi, ce n'est pas ce qu'a entendu la ville entière. Ce n'est pas ce qu'ont enregistré les sismographes, comme une secousse d'un tremblement de terre.
L'appeler explosion, ce serait comme de comparer un pet à un pétard.
Un coup de pistolet à un coup de canon.
Ce fut une déflagration.
Non.
Ce fut quelque chose de plus.
Ils avaient tué le Juge.
Et le mur qui donnait sur la rue s'écroula.
Le bruit ne s'était pas éteint.
Et la brume de plâtre n'était pas non plus retombée.
Tout était suspendu en l'air, en même temps que ma stupeur et ma terreur.
Puis, j'ai entendu les voix.
Ce n'étaient plus des voix humaines.
C'était une plainte déchirante.
C'étaient des cris de douleur.
C'étaient des hurlements lancinants.
C'était la fureur, l'effarement, la férocité.
C'étaient des hallucinations.
C'était la puanteur du plastique et de la chair brûlée.
C'était mêlé au son des Pink Floyd.
Je m'étais levé d'un bond. J'avais couru au balcon, à ce qui restait du balcon, parce qu'il s'était écroulé en même temps que le mur. Je m'étais levé si vite que la prise des écouteurs s'était détachée, et la musique de The Wall avait envahi la chambre et la rue. Je m'étais arrêté juste à temps pour ne pas tomber dans le vide. J'avais regardé alentour. Et j'avais vu du feu et des flammes et de la fumée et des corps qui se roulaient dans la rue et je les avais entendus hurler et vus courir comme des torches humaines, les bras levés au ciel et les cheveux en flammes. J'avais déplacé mon regard vers la droite à la hauteur de la balustrade qui pendouillait, informe, et je l'ai vu. Je l'ai vu.
C'était un corps.
De femme, mais ça, je l'ai su après.
C'était un corps de femme écrasé contre la façade de l'immeuble, au troisième étage.
Je me souviens du sang et des lambeaux de chair qui glissaient vers le bas, retenus par les murs décrépis. Des ruisseaux, des torrents de sang qui s'écoulaient très lentement, retenus par le frottement contre toute loi de la gravité. C'était comme si un peintre délirant avait aspergé de rouge mon balcon. Comme s'il s'était amusé à lancer des magmas de boue contre ma fenêtre. Sauf que ce n etaît pas de la boue.
C'était un corps.
De femme.
Une absurde chevelure blonde collée au mur à côté de moi. J'aurais pu tendre la main et la caresser. J'aurais voulu avoir le courage de le faire et de donner un dernier réconfort à ce corps démembré. J'aurais voulu me substituer à ses père, mère, frère, fiancé. J'aurais voulu pleurer et bercer dans mes bras ce qui restait de cet être, pour qu'elle se sente moins seule. Pour qu'elle voie, tandis qu'en vol rasant, elle survolait la rue et mon balcon, qu'il y avait quelqu'un là, à côté, prêt à recueillir son dernier souffle.
Pour qu'elle sache.
Probablement était-elle déjà morte tandis que depuis la terre, l'onde de choc la projetait en haut, contre le rebord de la fenêtre. C'est du moins ce que je lui souhaite, je souhaite que lui ait été épargné ce dernier terrifiant trajet qui comme dans un cauchemar la catapultait du bas vers le haut contre le ciment armé jaune du troisième étage.
J'espère que ses yeux n'ont pas vu s'approcher absurdement les moellons démolis de ma fenêtre.
Je l'espère.
J'aurais voulu la lui faire, cette caresse. En avoir le courage.
Mais je ne l'ai pas eu.
J'ai passé un pantalon et un chandail. J'ai couru en bas. Pistolet au poing.
Je suis resté immobile, impuissant spectateur de ce désastre. A m'intoxiquer de plastique et de chair brûlée, à réprimer le vomissement et à regarder autour de moi dans l'espoir (non pas que ce ne soit pas vrai, je ne suis pas si stupide) de choper quelqu'un à tuer. De croiser une de leurs patrouilles à eux, venue contrôler le résultat de leur travail, de déclencher une fusillade et mourir pistolet au poing...
Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai ce que je dis. Je regardais autour de moi, effaré, oui, le Beretta en main, tenu à la weaver, prêt à l'affrontement. Une espèce de sentinelle qui veille sur la fin de ses compagnons. Eux, ils pleuraient. L'un d'eux avait les jambes hachées menu et encore une partie du visage. Il criait. Moi, je ne savais pas quoi dire, je me sentais fou, il me semblait qu'à la musique et à la bière s'était mêlé un acide très puissant, un putain de buvard en train de me concasser l'âme. Je ne dis qu'une chose:
- Du calme collègue, ils vont arriver.
Lui, il ne m'entendit pas. Entre-temps, il était mort.
La rue n'était qu'un feu. Braise, brasier et colonnes de fumée noire et dense. Les immeubles éventrés, et toujours les Pink Floyd orchestrant basses et solo de guitare.
Puis les sirènes.
Des milliers de sirènes, antivol et ambulances, voitures de patrouille.
- Halte. Bouge pas. Ne bouge pas, fils de pute!
La voiture s'est arrêtée dans une odeur de pneus brûlés sur l'asphalte, le chef de patrouille et l'homme du rang sont descendus, pistolet au poing, eux aussi. Ils me braquent.
- Je suis un collègue! Je suis un collègue! je crie.
Ça serait le bouquet.
- Ta carte, fais-moi voir ta carte.
- J'en ai pas de carte, merde! Merde de merde, j'en ai pas. Je suis Riccobono, de la Criminelle.
- De la BRI tu es?
- Oui, de la Criminelle, bordel de putain de merde, collègue, t'arrêtes ça, oui, t'arrêtes?
Puis le boxon, pompiers, questeur , fonctionnaires, mon principal. Il me demande ce que j'ai vu. Je dis:
- Rien.
Juste après, ils m'ont interrogé. Étant donné que j'étais de la BRI, j'ai été convoqué par la Digos, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour éviter des vices de procédure; le collègue qui m'a pris sur procès-verbal était particulièrement violent, pire que si c'était moi le coupable. Comme s'il lui semblait absurde que moi, un policier, je n'aie rien vu, je n'aie rien à raconter, des déclarations en tant que témoin susceptible de donner une direction précise aux enquêtes. Moi, en fait, je n'avais vraiment rien vu. Puis le collègue m'a foutu les boules et on a failli se castagner. On nous a séparés. Votre fonctionnaire m'a maltraité, le mien l'a maltraité, lui. Bref, le bordel. Une grande confusion.
À la Criminelle, le portail était fermé. Les collègues tous en bas, dans la cour. Un étrange silence. Ils se dévisageaient, fumaient, toussaient. Les yeux éteints. Quand je suis entré, ils m'ont tous sauté dessus. Ils voulaient savoir, mais je n'avais rien à dire.
J'avais juste une nausée affreuse. Et la puanteur de chair et de plastique dans les narines, et une monstrueuse vibration dans les oreilles.
Pendant plusieurs mois, je n'ai pas pu manger de viande grillée.
-300x460.jpg)

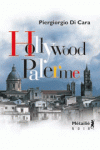
-100x150.jpg)
-100x150.jpg)
-100x150.jpg)