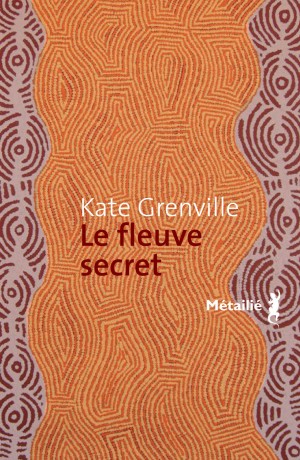William Thornhill, batelier illettré au sang chaud mais au grand coeur, vole une cargaison de bois. Il est banni en Nouvelle-Galles du Sud en 1806. Comme beaucoup de condamnés, il est amnistié après quelques années et s’installe au bord du fleuve Hawkesbury. Peut- être le gouverneur lui fait-il cadeau de cette terre, ou peut-être la prend-il simplement – l’Hawkesbury marque la limite des terres habitées à cette époque et n’obéit pas aux règles normales. Quoi qu’il en soit, il acquiert cette terre, ses premiers hectares au bord de l’eau. Tout semble le destiner à devenir riche. Il n’y a qu’un seul problème : cette terre appartient déjà à quelqu’un. Elle fait partie du territoire des Darug depuis environ quarante mille ans. Ils n’ont pas construit de barrières, de routes ni de maisons mais ils vivent sur cette terre et de cette terre, aussi clairement que Thornhill avait l’intention de le faire. Ils ne vont pas abandonner leur terre sans se battre. Les lances sont certes des armes primitives, mais les colons savent bien qu’elles peuvent tuer aussi sûrement qu’une balle de mousquet. Quand il comprend tout cela, Thornhill se trouve devant un choix impossible. Certains de ses voisins – Smasher Sullivan, Sagitty Birtles – considèrent les Darug comme à peine humains, comme des sauvages ayant aussi peu de droits sur leur terre que des chiens. Quand les Darug refusent d’être chassés, ces colons n’ont aucun scrupule à leur tirer dessus ou à les empoisonner. D’autres voisins font un choix différent et trouvent moyen de coexister avec les Darug. Blackwood a créé une famille parmi eux. Mrs Herring “leur donne tout ce qu’ils demandent”. L’hostilité entre blancs et noirs monte petit à petit. Pour finir, un groupe de colons décide de sortir régler leur compte aux Darug une fois pour toutes. Thornhill se joindra-t-il à eux ? La décision qu’il prend détermine le reste de sa vie. Le Fleuve secret plonge le lecteur dans l’expérience des limites. Qu’est-ce que cela fait – moment après moment, jour après jour – de se trouver dans cette situation ? Le récit ne juge pas les personnages ni leurs actes, il invite seulement le lecteur à se poser la question de savoir ce qu’il aurait fait dans le même cas.
Prix étrangers : Finaliste du Man Booker Prize, Commonwealth Prize for Literature, Booksellers' Choice Award, Fellowship of Australian Writers Prize
-
« Le fleuve secret, parfait roman d’aventures aux implications très actuelles sur nos réactions face à l’altérité. Passionnant!»
Marie HirigoyenLIBRAIRIE LE JARDIN DES LETTRES (Craponne) -
« Le Fleuve secret est un roman historique au savoir-faire typiquement anglo-saxon. Une écriture rythmée au style épuré, une trame romanesque simple pour ne jamais se couper du grand public, nous racontent un drame fort et violent dans lequel l’étude des personnages est aussi importante que la fresque historique elle-même. […]. Grenville s’est inspiré d’histoires familiales pour bâtir ses personnages. Sans les juger, elle les montre déchirés entre d’un côté l’espoir insensé de pouvoir se construire une vie meilleure, échapper à la misère des proscrits, et de l’autre, l’extrême dureté de ces vies imprégnées de la violence coloniale. Subtil et passionné, ce magnifique roman vous tiendra en haleine en attendant vos vacances en Australie. »
François PrévotLIBRAIRIE CLIMATS (Paris )
-
"Kate Grenville, lauréate en 2001 de l’Oranze Prize for fiction pour L’idée de perfection, nous livre ici un roman magnifique qui raconte l’histoire de William Thornhill, condamné à Londres au XIXème siècle et déporté en Australie où il cherche à annexer les terres ancestrales des Aborigènes – avec des conséquences tragiques."FINANCIAL TIMES
-
"D’un seul coup, l’auteur rend à la fois la dépendance affective de Sullivan et la compassion de Will. La relation de Will et de Sal se trouve souvent renforcée par ces aperçus psychologiques. Le couple tire un poids convaincant de la conscience que chacun a de l’autre, qui entraîne la sympathie du lecteur et approfondit la tension narrative. Ainsi, ce qui avait commencé comme un somptueux récit historique décrivant les bas-fonds de Londres à l’époque géorgienne, se transforme en un voyage profond de découverte de soi."INDEPENDENT ON SUNDAY
-
"Ce qui rend un livre comme Le Fleuve secret aussi attachant, c’est la capacité de son auteur à marier les personnages avec l’intrigue et le cadre avec la période concernée. [...] Il suffit de quelques phrases pour comprendre que la majorité des romans actuels sont minces et superficiels. Le Fleuve secret vous dégoutera peut-être pour quelque temps de lire des ouvrages moins accomplis."DAILY EXPRESS
-
"Un écrivain subtil"THE GUARDIAN
-
"Il a fallu attendre cinq ans Le Fleuve secret, mais cela valait la peine... Magnifiquement rythmé, passionné et dérangeant."THE TIMES
-
, chronique par Geneviève Bridel le 24 avril 2010Le Journal du samediRSR La 1ère
-
« Subtil, abouti, Le Fleuve secret nous immerge dans un croisement de thématiques fortes, l’exil, la nostalgie, la peur de l’autre, la fragilité de l’existence, l’espoir d’une vie nouvelle. La brutalité des conflits intérieurs et culturels est rendue à la perfection. »Isabelle FalconnierL’HEBDO
-
« Si ce très beau roman, histoire intime de la colonisation, se clôt dans le sang, sa force est de suggérer qu’un autre monde, bâti sur la compréhension, aurait été possible. »François MontpezatDNA
-
« Puissant, inspiré, dérangeant, Le Fleuve secret lance d’abord le lecteur sur la piste du roman historique fort bien mené, jusqu’à l’affronter au problème de l’Autre, dans le contexte brutal du colonialisme naissant. Et l’écriture de Kate Grenville, généreuse, efficace, laisse un écho qui dure. »Michel GensonLE REPUBLICAIN LORRAIN
-
« Elle évite le genre "roman historique à gros sabots" pour tresser un roman fort où le récit très documenté se fond avec sensibilité dans l’histoire rude et émouvante d’une famille. »Joséphine LebardPELERIN MAGAZINE
-
« Un roman historique passionnant sur la colonisation de l’Australie. »VOCABLE
-
"Somptueux western, fascinante expérience des limites : à la fois terrestres et humaines."Yves GittonX ROADS
-
« Lauréate de l’Orange Prize pour L’Idée de perfection, Kate Grenville retrace ici l’étrange destin de William Thornhill, batelier sur la Tamise, condamné pour vol au bagne en Nouvelle-Galles du Sud en 1806. Amnistié, il devient propriétaire d’une terre au bord d’un fleuve et se heurte à l’hostilité des Aborigènes. Le héros joindra-t-il un groupe de colons décidés à en découdre avec eux ? Plus qu’un récit historique, ce grand roman porté par un souffle épique est l’histoire d’un voyage intérieur. »Claire JulliardLE NOUVEL OBSERVATEUR
-
« Australienne, Kate Grenville s’est inspirée de son histoire familiale pour écrire Le Fleuve secret, un roman d’aventures dont le cœur du sujet est la colonisation britannique. […] Cousine de Dickens lorsqu’elle met en scène la misère des bas-fonds de Londres, Kate Grenville est une sorte de Douanier Rousseau dans sa peinture de la forêt australienne. On y sent une profusion proche de l’étouffement. Sa chronique des premiers pas de la famille Thornhill dans cet univers étrange est dure comme la vie des réprouvés. Elle est toutefois tempérée par l’immense tendresse qui unit William à Sal. Une tendresse qui ne les sauvera pas totalement de la violence et de la barbarie, hélas, mais les protègera en partie. »Frédérique HumblotLES ECHOS
ÉTRANGERS
Après avoir fendu les flots de l’océan une bonne partie de l’année, l’Alexander et sa cargaison de bagnards avaient enfin atteint le bout du monde. Rien ne verrouillait la porte de la hutte où William Thornhill, déporté à perpétuité en l’an de grâce 1806, passait sa première nuit en Nouvelle-Galles du Sud, colonie pénitentiaire de Sa Majesté. Pouvait-on d’ailleurs parler de porte ou de mur pour désigner un battant en écorce et une paroi de bâtons mêlés de boue ? Verrous, portes et murs étaient superflus : trois mille cinq cents lieues marines formaient les barreaux de cette prison.
L’épouse de Thornhill dormait paisiblement contre lui, sa main encore enlacée à la sienne. Blottis l’un contre l’autre, l’enfant et le bébé étaient aussi plongés dans le sommeil. Seul Thornhill ne parvenait pas à fermer les yeux sur les ténèbres étrangères. Il sentait la nuit moite, immense, pénétrer dans la case et y diffuser les bruits de sa vie propre : craquements et crépitations, bruissements intimes et, au-delà et à l’infini, le murmure de la forêt.
Il se leva et franchit le seuil sans déclencher un cri, sans attirer l’attention d’un garde : il n’entendit que la vie de la nuit. Elle l’enveloppa, chargée d’odeurs riches et humides. De grands arbres se dressaient au-dessus de sa tête. Une brise frémit entre les feuilles, puis s’éteignit, ne laissant derrière elle que la vaste réalité de la forêt.
Il était une puce sur le flanc d’une gigantesque créature silencieuse.
Au pied de la colline, l’agglomération était tapie dans le noir. Un chien poussa un aboiement empreint de lassitude, puis se tut. De la baie où l’Alexander avait mouillé, on percevait l’eau qui remuait dans son lit de terre, se gonflait contre le rivage.
Hauts dans le ciel, la lune effilée et le fatras d’étoiles étaient aussi insignifiants que des grains de riz épars. Aucune trace de l’Étoile polaire, son amie et son guide sur la Tamise, ni de la Grande Ourse qu’il avait toujours connue : il ne voyait qu’un flamboiement indéchiffrable et indifférent.
Au cours des longs mois à bord de l’Alexander, allongé dans le hamac qui représentait son unique territoire au monde, alors qu’il écoutait la mer claquer sur la frégate et tendait l’oreille pour discerner la voix de son épouse et de ses enfants dans les quartiers des femmes, il avait trouvé du réconfort à se remémorer chaque méandre de sa Tamise. L’île aux Chiens, les profonds remous de la cuvette de Rotherhithe, la brusque volte-face du ciel quand la boucle du fleuve virait sur Lambeth : il connaissait tout cela aussi intimement que son propre souffle. Ni les grognements de Daniel Ellison qui se débattait jusque dans son sommeil au creux du hamac voisin, ni le silence des femmes de l’autre côté de la cloison n’empêchaient son esprit de suivre un par un les détours de la rivière.
Maintenant qu’il écoutait les soupirs du poumon de ce vaste “ailleurs”, qu’il sentait sa plante de pieds geler sur le sol, il comprenait que la vie lui avait échappé. Il n’eût pas été pire de gigoter au bout de la corde qu’on avait mesurée pour lui. C’était un endroit, comme la mort, d’où les hommes ne revenaient jamais. Il ressentit un coup de poignard, vif comme une écharde sous un ongle : la souffrance de la perte. Il sut qu’il mourrait ici, sous ces astres inconnus, que ses ossements pourriraient dans cette terre glaciale.
Trente ans qu’il n’avait pas pleuré, depuis l’époque où, enfant affamé, il n’avait pas encore compris que les pleurs ne remplissent pas le ventre. Mais sa gorge se serrait aujourd’hui et, derrière ses yeux, la pression du désespoir faisait couler de chaudes larmes sur ses joues.
La vie lui avait enseigné que certaines choses étaient pires que la mort. Sa présence en Nouvelle-Galles du Sud comptait peut-être parmi ces choses-là.
Il vit alors, il crut d’abord à un effet de ses yeux noyés de larmes, l’obscurité bouger devant lui. Il ne saisit pas d’emblée que ce mouvement, aussi noir que la nuit, était humain. La peau de l’homme, en absorbant la lumière, lui conférait un caractère irréel, comme une construction de l’esprit. Ses yeux, enfoncés profondément dans son crâne, y disparaissaient, retirés dans leur caverne osseuse. Son visage massif apparut autour de la large bouche, du nez imposant et du pli des joues. Sans surprise, comme dans un rêve, Thornhill remarqua les scarifications sur la poitrine de l’inconnu et les reliefs distincts, vivants, qui lui parcouraient la peau.
L’homme fit un pas en direction de Thornhill et la lumière crue des astres se posa sur ses épaules. Il portait sa nudité comme une cape. Dans sa main, la lance faisait partie de lui, formait la prolongation de son bras.
Malgré ses vêtements, Thornhill se sentit nu comme un ver. La lance était grande et menaçante. Avoir échappé à la potence pour finir ainsi, la peau transpercée, vidé de son sang sous les étoiles glaciales ! Et derrière lui, leurs tendres chairs à peine dissimulées par ce battant d’écorce, sa femme et ses enfants reposaient.
La colère, sa vieille et familière compagne, vint à sa rescousse. Va-t’en, maudit sois-tu, hurla-t-il. Va au diable ! Lui qui était depuis si longtemps considéré comme un criminel, habitué à courber l’échine sous la menace du fouet, il retrouva en cet instant sa taille entière. Sa voix devint rude, autoritaire, la fureur lui embrasa les entrailles.
Il s’avança d’un air combatif. Il distinguait les éclats ciselés de la pierre au bout de la lance. Ces pointes ne transperçaient pas un homme aussi nettement qu’une aiguille. Elles déchiraient la chair. Puis l’arrachaient à nouveau en se retirant. Cette pensée ne fit qu’attiser sa rage. Va-t’en ! Il leva la main, bien qu’elle fût vide, contre l’homme.
La bouche du noir se mit alors à remuer et à émettre des sons. Il gesticulait en parlant et brandissait sa lance dans l’obscurité. Ils étaient assez proches pour se toucher.
Dans le flux de paroles, Thornhill discerna soudain des mots. Va-t’en ! hurlait l’homme. Va-t’en ! Il imitait son intonation à la perfection.
C’était insensé, comme si un chien s’était mis à aboyer en anglais.
Va-t’en, va-t’en ! Il était si près que Thornhill voyait ses yeux accrocher la lumière sous les épais sourcils et qu’il distingua la ligne droite et furieuse des lèvres. Les répliques de Thornhill s’étaient taries, mais il ne recula pas.
Il était déjà mort une fois, pour ainsi dire. Il pouvait mourir à nouveau. On l’avait privé de tous ses biens : il ne lui restait que la terre sous ses pieds nus, son petit point d’attache dans ce lieu inconnu. Il n’avait rien d’autre, hormis ces êtres vulnérables, endormis dans la hutte. Il n’allait certes pas les livrer à un homme noir et nu.
Dans le silence qui les séparait, la brise se mit à vibrer entre les feuilles. Il jeta un regard en direction de son épouse et de ses enfants, et quand il se retourna, l’homme avait disparu. Les ténèbres chuchotaient et remuaient, mais il n’y avait que la forêt. Elle pouvait dissimuler une centaine de noirs brandissant des lances, un millier peut-être, un continent entier d’hommes armés, avec des bouches menaçantes.
Il se précipita dans la case en trébuchant contre la porte et en faisant tomber des mottes de terre séchée. La hutte n’offrait aucune protection, seulement une idée de protection, mais il n’en replaça pas moins le battant d’écorce. Il s’étendit sur la terre battue aux côtés de sa famille et s’imposa de rester immobile. Mais chacun de ses muscles était bandé, en prévision d’un choc dans la gorge ou dans le ventre ; il y porta la main, craignant le moment terrible où l’impitoyable objet se logerait dans sa chair.