Après avoir échappé à une tentative d’assassinat, l’inspecteur Salvo Riccobono apprend qu’il est sur la liste noire de Cosa Nostra. Pour le protéger, on le transfère en Calabre. Malgré les souvenirs sanglants qui le hantent, il tente de retrouver un équilibre en se plongeant dans la vie quotidienne d’un commissariat de province, entre un collègue homo fin gourmet et une policière arriviste, sous le regard rusé d’un chef amateur de cigares. Jusqu’au jour où une enquête de routine sur une petite affaire de drogue va le faire affronter une autre mafia, plus féroce encore que celle de la Sicile : la ’Ndrangheta.
Ce troisième volet des enquêtes de Salvo Riccobono fait plus que confirmer les qualités littéraires du commissaire antimafia Piergiogio Di Cara : en fouillant les failles de son personnage, il ajoute une nouvelle profondeur à une série qui a déjà séduit de très nombreux lecteurs, en Italie comme en France et ailleurs.
-
« Trop menacé à Palerme, où il a été gravement blessé par la mafia, l’inspecteur Salvo Riccobono est envoyé par ses supérieurs dans la petite ville calabraise d’Averno Sullo Julio où il arrive quasiment clandestin. Il y fait le travail ingrat et quotidien de flic ; simplement, en excellent professionnel, il le réalise avec l’efficacité maximale. Au lieu donc de faire des prises sans lendemain de petits dealers, il met en place des filatures bien rangées ; et petit à petit, le voilà lancé à l’assaut d’une branche de la redoutable ‘Ndrangheta.
Dans cette troisième aventure de son héros, Di Cara, policier lui-même à Palerme, sait décrire le quotidien souvent gris de ces hommes seuls, qui ont tout des croisés modernes tout entiers attachés à leur profession. Le romancier ébauche quelques portraits rapides et accrocheurs de collègues policiers , il pointe le travail de fourmi des enquêteurs, la satisfaction du travail accompli, l’honnêteté morale de Salvo qui refuse d’aller dans un bistrot un peu louche manifestement trop connu de certains policiers, la pression au quotidien jamais relâchée, et aussi la cruauté des sbires de la mafia.
De ce récit très réussi de procédure policière, dense et attachant, on pourra aussi noter l’accent mis sur les méfaits du crime organisé et la complicité de beaucoup d’hommes politiques (il n’est que de lire les passages sur la célèbre autoroute de Reggio Di Calabre, « construite » par les sociétés mafieuses et jamais achevée). »Bernard DaguerreL’OURS POLAR -
« Son vécu transpire dans chaque page et donne ainsi à ses romans un réalisme et une efficacité redoutables. »
SUD-OUEST -
« Piergiorgio Di Cara, mêlant fiction et réalité […] et jouant avec la mythologie traditionnelle du polar, à réussi son coup : il crée des romans tout en finesse, profonds sans en avoir l’air, graves et pleins de sentiment, distrayants et très documentés sur cette mafia qu’il combat lui-même chaque jour, au péril de sa vie. »
Jean-Claude PerrierLIVRES HEBDO -
« Verre Froid, troisième volet des enquêtes des Riccobono, est un bon polar. Hyperréaliste mais joliment servi par l'écriture mélancolique de Piergiorgio Di Cara. L'auteur est commissaire à la brigade anti-Mafia de Palerme. Et on le comprend. »
Emilie LanezLE POINT
1. Verre froid
Il y a un air irréel tout autour.
Comme si c’était du verre.
Air de verre.
Froid.
Verre froid.
Pour me débusquer il y a la douce hypocrisie de l’adieu. Ce moment mélancolique et terrible des promesses vaines, qui ne seront pas tenues. Jamais. Jamais plus.
Ça ne réconforte pas de le savoir. Ça rend tout plus difficile. Énormément plus difficile.
Tu sais qu’il est inutile de s’échanger des promesses comme des cartes de visite. Se caresser les épaules et le dos en se regardant dans les yeux voilés de tristesse, où les larmes se nichent comme une myopie temporaire qui transforme la réalité. La rendant terriblement plus réelle. Vraie.
Comme une promesse vaine.
A qui n’est-ce pas arrivé ?
Tu sais que tu te trouves sur le mince fil du rasoir qui sépare la familiarité de l’étrangeté. Comme sur le bord d’un précipice.
Ici la quotidienneté rituelle, là le vide absolu. Pneumatique.
Et tu te sens féroce et cruel, enveloppé comme d’un manteau par l’hypocrite douceur de l’adieu.
Perdant.
En fuite comme un exclu.
Errant.
Suspendu dans un dernier soupir profond et chaud, avant que le gel te brûle les os.
Perdu dans la conscience qu’il y avait un tas de choses à dire et à faire avant de t’éloigner pour toujours. Et tu voudrais agripper le temps, le bâillonner et le clouer dans un éternel présent. Comme un samsara ininterrompu, où t’attendent pubs à la fermeture et restaurants et promenades et rires et discussions animées et gestes de solidarité de camarades qui resteront toujours là, irréels et confus. Invisibles malgré leur netteté. Inutiles et inconsistants comme les promesses d’un politique. Comme un contrat paraphé d’une élégante et inoffensive volute de Mont Blanc.
Il n’y aura plus de café ou de temps à perdre. Rien que de fugaces coups de fil et : excuse-moi mais j’ai à faire ; appelle-moi ; un de ces jours on ira manger un morceau ensemble ; viens nous voir, ici tu as des amis, tu le sais.
C’est ce qui se passe. Exactement ce que je sens dans l’instant où le commissaire principal, chef de la brigade criminelle, me notifie ma mutation.
Nous étions dans son bureau. Le soleil entrait en coups de sabre par la fenêtre. Cueillant une tasse de café avec le logo doré du FBI sur fond bleu. Dedans, quelques stylos. Le principal en prit un. Me donna à signer une feuille au bas de laquelle était écrit : le soussigné.
Embarrassant d’être le soussigné. Ça a l’air d’un truc bidon.
Un voile de poussière comme une fumée suspendue.
Mon patron s’agite sur le siège.
Le chef évite de me regarder.
Je signe.
– Parfait, dit-il.
– Bien, je dis.
– Beh, alors, bonne chance, Salvo. Passe vite un coup de fil, tu le sais que t’as des amis, ici.
– Je sais.
On sort.
Je n’ai pas envie d’ajouter autre chose. J’ai la sensation d’avoir une serviette dans la gorge. D’instinct, je cherche les cigarettes dans la poche. Il n’y en pas. Je ne fume plus. Du moins pour le moment.
– Où est-ce qu’ils t’ont expédié ? me demandent les gars.
– Commissariat d’Averno sullo Jonio.
– Et où c’est ?
– En Calabre !
– Putain, ils t’ont eu ! J’y ai été après la formation continue, déclare Pe’. C’est un endroit hallucinant.
Les adieux ont été rapides et coupables. Comme si chacun de nous s’était senti coupable. Moi parce que je fuyais, eux parce qu’ils restaient.
En voiture, je n’étais pas content. Pas le moins du monde.
Il pleuvait.
Des seaux. Chaque goutte un seau. Chaque seau un coup de fusil en plein dans l’âme.
Je m’arrête sur l’aire de service, la première en sortant de la ville. Je prends de l’essence et vais au bar. Un innocent café.
Je me dis.
Un café, c’est tout.
Derrière la caisse un carnaval de paquets de cigarettes.
– Un café et un paquet de Marlboro rouge souple… et un verre d’eau, merci.
Je bois le café avec une attaque d’anxiété. Une excitation étrange, comme quand, gamin, on fait le tour des putes, pour mater les cuisses et imaginer des scènes déchaînées de sexe et des orgasmes frénétiques.
Je bois l’eau.
Dans le parking, j’ouvre le paquet. La première bouffée n’a pas de conséquences. Peut-être un léger vertige, mais rien de plus. La toux arrive à la troisième ou à la quatrième, je ne me rappelle pas bien. Mais ensuite, je n’ai plus toussé. J’ai juste les mains qui tremblent quand je passe la première et que je mets le clignotant.
La radio ne garde pas la bonne longueur d’onde. Je m’énerve, et ça me contraint à fumer. Je veux dire, ça ne pouvait pas être autrement. Je ne peux pas m’empêcher de le faire. Je dois fumer, bon Dieu. La cigarette me racle la gorge. Mais il ne faut pas donner trop d’importance à ça. Lui opposer une légère résistance, voilà ce qu’il faut faire.
L’autoroute s’interrompt bientôt et débouche sur la nationale pour Messine. C’est presque un voyage dans
la mémoire, ça. C’est comme se déplacer dans le temps, quand avec l’Opel Kadett de la famille on partait se promener ou qu’on en revenait. Comme cette fois où, en rentrant de vacances à Rimini, on s’est arrêtés à Sant’Agata di Militello.
– J’avais un camarade au service militaire, dans la marine, qui était de Sant’Agata. Dieu sait ce qu’il est devenu, je ne l’ai pas vu depuis trente ans, dit papa.
– Comment il s’appelle ? demanda maman.
– Piscitello, Antonio Piscitello. J’aimerais bien le revoir.
– Bien sûr, ça serait bien. Mais va savoir s’il habite encore là, peut-être qu’il s’est installé ailleurs.
– Non, je ne crois pas. Je me rappelle que son père avait un magasin de peintures.
– Pourquoi t’essaies pas de demander à quelqu’un ?
– C’est ce que je veux faire. A qui je peux demander ?
– Bah, aux carabiniers ?
– Eh oui. Les carabiniers doivent le savoir, non ?
– C’est possible.
On s’arrête devant la caserne. Maman chantonne un air dont je ne me souviens plus et mon frère et moi nous regardons autour de nous, curieux.
Papa sort avec un carabinier. Il a un papier à la main, le militaire lui explique quelque chose.
Il monte en voiture.
– C’est fait.
Nous suivons les indications, prenons quelques traverses. Arrivons sur une place. Une église, un bar, une boucherie et un magasin avec une enseigne : Nino Piscitello Magasin de Peintures. C’est écrit.
Papa entre d’un pas décidé. Peu après, il sort avec un monsieur aux cheveux ondulés, bras dessus bras dessous.
– Ma famille, dit papa. Il nous invite à descendre.
Eux, ils pleuraient. De joie ou de douleur, je ne sais pas. Ils versaient des pleurs déchirants. D’adulte.
A vrai dire, je ne comprenais pas grand-chose.
Maman, émue, dit : “C’est normal, ils ne se sont pas vus depuis si longtemps, c’est beau.”
Je ne comprenais pas, parce que je n’arrivais pas à imaginer papa dans une autre vie. Probablement parce que pour moi, alors, n’existaient que le temps présent et au maximum
le futur proche, genre l’automne qui arrive et l’école qui commence. Je me demande si je pleurerai en revoyant mes camarades après l’été. Je ne crois pas. Je comprends bien que trois mois ne sont pas trente ans.
Nous restâmes deux nuits chez l’ami de papa. Les enfants étaient sympathiques, mais deux jours, c’est peu. Alors, je ne pleurai pas quand nous nous séparâmes.
Je ne pleurai même pas à la rentrée scolaire. Oh Seigneur, je n’étais pas heureux mais j’imagine que la nostalgie de mes copains n’y était pour rien. Je dirais que non.
La nationale pour Messine est terrifiante. Des kilomètres de virages et de rétrécissements. Dingue, c’est comme ça depuis trente ans. Je chope une série de camions qui m’obligent à avancer au pas. Nous traversons des villages aux fenêtres closes.
Je pense au pont sur le détroit. Je pense que c’est inutile. Je pense à Cosa Nostra, ’Ndrangheta* et Camorra qui aiguisent leurs couteaux et préparent les fourchettes pour le repas succulent qu’on va leur offrir là, disposé sur le détroit. Comme un porcelet avec la pomme dans la gueule et une carotte dans le cul.
Belle métaphore : le pont sur le détroit comme une séance de fist-fucking.
A un moment se détache, sur un ciel caravagesque, le profil des îles Éoliennes. Je reconnais Vulcano et peut-être Stromboli. Iles noires, volcaniques. Un élancement me traverse les poumons. Je pense à un jasmin accroché à une roche, fouetté par l’écume de la mer.
La radio continue à laisser échapper les stations.
Enfin l’autoroute. Je m’arrête à un restoroute.
Un beau restoroute. Je vais aux toilettes et pendant que je pisse, lis les inscriptions : trans’esclave lèche les pieds et fait des pompiers ; enculages garantis ; si tu es carabinier, militaire, pompier et que tu es de Naples, appelle…
Je fais le plein et achète des biscuits. Je fume une cigarette appuyé au capot. Le portable est silencieux. J’ai acheté une compile de Johnny Cash. Belle. Je fais tourner deux fois de suite Folsom Prison Blues. Qui parle d’un type qui tue un homme à Reno, malgré sa mère qui lui recommandait de ne pas jouer avec les pistolets et d’être toujours un brave garçon. Je me racle la gorge en essayant de frapper un cafard qui boite vivement vers les restes d’un sandwich. Je le manque. D’autre part, je suis un vrai cow-boy. Je frotte la pointe de mes bottines contre mes mollets et arrange mieux le pistolet dans son étui.
Le portable est toujours silencieux.
Les biscuits m’empâtent la bouche, alors au restoroute suivant, je m’arrête et achète une bouteille d’eau avec doseur. Je projette dans ma gorge un jet d’eau fraîche et m’étrangle, comme de juste. Personne ne me remarque, peut-être parce que les voyageurs sont tous concentrés sur leur mal de dos.
Journée de merde. Il pleut toujours.
L’autoroute est déserte. Elle traverse des panoramas dont je n’ai pas conscience, tellement ils glissent vite. J’aperçois des taches vertes recroquevillées sous la pluie et le vent. Des bosses abruptes et à certains égards monstrueuses, qui interrompent la succession régulière d’immeubles abusifs et de cheminées fumeuses. Des chaînes de boue balancent des éclats soudains contre des torrents de cailloux qui attendent des avalanches d’eau qui s’entassent en amont avant de se précipiter comme une rupture de digue pour faire de la place aux éboulements de terre et de souches d’arbres.
Un Vajont* malheureux et mauvais.
Johnny Cash chante d’une voix de cow-boy.
Le cendrier se remplit de mégots.
Quand j’étais plus jeune et qu’il m’arrivait de traverser de Messine à Villa, il y avait un rite auquel je ne renonçais pas : manger les arancine*. Mais ce n’est pas que j’aimais ça. Pour un Palermitain comme moi, l’arancina est plus qu’une religion, c’est une philosophie de vie, voilà. Les arancine sont notre invention, nous la revendiquons, comme un brevet. Entendons-nous bien. C’était juste que, alors, quand j’étais jeune, la chose s’imposait à nous, peut-être parce qu’elle sanctionnait le fait d’être en voyage. Je pense.
Un rite de passage.
Mais aujourd’hui, je n’ai pas envie d’arancine. Je fume deux cigarettes.
Villa San Giovanni.
La route longe les voies du chemin de fer. Des wagons graffités. Quelques immigrés me proposent des mouchoirs, des carrioles siciliennes et des CD clandestins comme eux, avec leurs visages sales et leurs pantalons larges. Le regard attentif mais détendu. L’un d’eux, assis sur le trottoir, boit une bière. J’en ai vu beaucoup entrer au supermarché pour s’acheter des boîtes de bière chaude, pour se la boire comme ça. Chaude.
Ça me donne envie à moi aussi.
Je m’arrête devant un bar déglingué et plein de fumée, prends une Ceres.
J’ai l’enfer dans la tête. L’estomac grogne furieusement. La Ceres, je la bois en hâte. La radio se dérègle.
Je ne peux que me répéter que c’est une journée de merde.
La bifurcation pour l’autoroute est dans un grand virage, d’un côté Reggio, de l’autre Salerne.
Salerne.
Ça faisait des années que je n’avais pas pris l’autoroute du scandale. Pendant que je conduis, je suis frappé par l’évidence d’une autoroute mafieuse, à laquelle des promoteurs complices et des fractions de l’État ont frauduleusement enlevé des kilomètres d’asphalte pour les transformer en comptes courants suisses et villas sur des promontoires sardes. Aujourd’hui, avec la conscience du flic, tout est d’une clarté déconcertante. J’essaie d’imaginer des gros titres en noir et blanc de journaux télé démocrates-chrétiens qui annoncent avec des flots de rhétorique du régime que : Nord et Sud sont maintenant plus proches ; un pas important vers la civilisation a été franchi. Paraphrasant presque la célèbre déclaration : “Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité.”
J’imagine les rosettes de commandeur et les écharpes tricolores qui sourient, grasses et corrompues. Poignées de mains et bras dessus, bras dessous. Le tout sur fond d’une bande d’asphalte dangereuse, qui tient en équilibre sur des ponts en danger d’éboulement, où le mortier est mêlé d’un sable de mer qui ronge le squelette de fer des piliers.
Elle me paraît pencher sur le côté. Peut-être une impression.
Peut-être est-ce moi qui penche. Ou qui m’épanche.
– Commissariat d’Averno, avait répondu le standardiste.
– Ici l’inspecteur Riccobono, avais-je dit, tu peux m’expliquer comment on arrive chez vous ?
Je me trompe d’embranchement et traverse des villages sombres d’un rouge de briques creusées sans crépi.
J’arrive à la RGC, la Route de grande communication.
Il pleut à verse.
Arrivé au centre commercial, j’appelle le 113, une voiture de patrouille vient me chercher. Ils arrivent gyrophare allumé. Un collègue me fait signe de le suivre. Ils me conduisent à une construction de quatre étages, dans une zone sombre de la périphérie. Le bâtiment est nu et triste, comme toute structure de l’administration. Rien de laïc républicain, je ne sais pas si je me fais comprendre, il ne s’agit pas de ça, à la limite, ça aurait un sens. C’est simplement un gros immeuble laid, j’imagine qu’il a été saisi à un boss* quelconque.
– Le chef vous a fait préparer une chambre à la caserne. A cette heure, il n’est plus au bureau. Il a dit de vous emmener là, vous pouvez vous présenter demain.
– Ok, je dis. Ça, c’est quoi ? je demande.
– C’est le siège du service de prévention, ici on a des logements et une cantine.
– Je comprends.
Nous entrons. L’air est imprégné d’odeurs flicardes : cigarettes et café.
Un comptoir et une armoire avec un écran de contrôle. Le collègue se lève, bâille bruyamment.
– Salut, fait-il.
– Salut. Voici l’inspecteur Riccobono, le chef avait demandé de lui réserver une chambre.
Étrange situation, on dirait un hôtel soviétique.
– Oui, voilà la clé, 1A, au premier étage, à côté de l’infirmerie, tu l’accompagnes ?
– Oui, suivez-moi.
Je soulève la valise. Le collègue voudrait la porter, ce n’est pas la peine, je dis.
La chambre est spacieuse. Un lit une place avec drap et couvertures grises portant l’inscription Police. Une armoire à deux portes. Un bureau. La salle de bains a une fenêtre qui donne sur une espèce de petit cloître, de l’autre côté des vitres dépolies et une silhouette par transparence. La pièce
est froide. Je refais le lit comme si je devais passer à l’appel d’une minute à l’autre. Je défais rapidement les bagages et débouche la bouteille de grappa. “Anesthésique !” m’avait dit Pino en me la tendant quand nous nous étions dit au revoir.
Je le remercie silencieusement et descends une solide gorgée.
Je me sens désespéré. Affligé d’une rancœur de feu qui me déchire. Le ventre gonflé. Je peux voir l’Helicobacter qui se contorsionne furieusement, qui mord, féroce, les parois de l’estomac, qui barbote avec bonheur dans la grappa, qui aspire avec volupté les volutes bleu clair du tabac que je pousse bien au fond. L’anxiété m’afflige, me fait sentir faible et malheureux. Petit. Recroquevillé en position fœtale sur la couverture grise de l’administration. La joue gauche picotée par la laine grossière. Le pouce dans la bouche.
La pièce me domine de sa pompe militaire. La pluie crépite sur les capots des Subaru garées en bon ordre sur l’esplanade. Elle se confond avec les larmes qui strient le visage.
De la pièce d’à côté arrivent des voix télévisuelles.
Je recours à l’anesthésique. Et me sens un peu mieux. Ténue mais appréciable différence. Au point que mes joues reprennent des couleurs. Je me dis qu’un autre gorgeon ne peut me faire que du bien. Étrange. Maintenant j’ai l’air d’un nourrisson de quatre-vingt-quinze kilos et d’un mètre quatre-vingt-deux.
Grappa et Marlboro.
Biberon et tétine.
Je sors de ma chambre en vacillant. Je m’éclaircis la voix et coiffe le heaume de ce putain de merde d’inspecteur de police que je suis.
En bas, au corps de garde, le collègue se met debout.
– Comment ça va ? me demande-t-il.
Il a l’accent napolitain. De Naples ou de la Campanie ?
– D’où tu es ?
– San Giorgio a Cremano. Là où est né Massimo Troisi.
– Je croyais que tu étais napolitain.
– Eh ! C’est Naples.
– San Giorgio ? Et qu’est-ce que c’est, un quartier ?
– Non. C’est Naples, Naples. Un village collé à Naples, mais c’est San Giorgio, et c’est toujours Naples !
– Je comprends.
Nous gardons un instant le silence.
– C’est comment ? je demande.
– Un village… c’est-à-dire, un village normal.
– Non, je veux dire, ici.
– Averno ? Bah, l’été c’est beau, il y a un bon paquet de touristes, ça bouge beaucoup. Mais l’hiver, c’est la mélancolie.
– Eh oui. Et pour le travail ?
– Y’a que dalle. Je veux dire, de criminalité au niveau braquages et vols, rien. Un peu l’été, mais ça, c’est parce qu’il y a les gitans. Mais pas grand-chose, quelques voitures, des trucs comme ça.
– Le chef, c’est quel genre ?
– Lequel, le nôtre ou celui du commissariat ?
– Les deux.
– Le nôtre est bien. Il est jeune, il arrive de l’école de Police, un brave garçon. Il est là depuis trois, quatre ans. Celui du commissariat, je ne le connais pas, mais d’après ce que disent les collègues, lui aussi, il est bien. Il tutoie tout le monde.
– Je comprends. Dis-moi, pour aller manger un morceau ?
– La cantine est fermée.
– Non, je voulais dire, un resto…
Le Vieux Tonneau, le restaurant, est plutôt petit. Une dizaine de tables. C’est accueillant et meublé avec goût et sobriété. Je commande une côte de bœuf et une bouteille de rouge.
On m’apporte une assiette de bruschette à l’huile d’olive et piment frais. Un serveur remplit le verre de vin dès qu’il se vide.
Dans la salle, il n’y a que moi et une tablée de six ou sept hommes et de deux femmes. D’après les propos qu’ils tiennent, il me semble qu’ils s’occupent de vêtements, de mode. Une des femmes a un fort accent milanais. Même si j’ai l’impression qu’elle le force pour se donner un air professionnel et conquérant. Les autres commensaux sont plutôt frustes, ils parlent à haute voix et sont vulgaires. L’âge est avancé, l’un d’eux fait la cour à la deuxième femme, elle a dans les vingt-cinq ans et l’air d’une top-modèle de banlieue. Elle est calabraise et les inflexions fortes, avec les t doublés, coincent un peu avec les allures de supernana qu’elle essaie de se donner. Elle mange une salade mais regarde avec des yeux brillants de voracité les assiettes des autres, qui, eux, engloutissent d’abondantes portions de pâtes. Elle dit : “Le dessert, je n’y renonce pas.” Je pense que pour l’instant, elle maudit le moment où elle s’est déclarée “au régime strict”. Putain, les plats qu’ils servent ont l’air tellement bons !
Ils sont tous un peu tristes et aveuglés par un mode de vie télévisuel qui voudrait que les top-modèles soient toutes des putains. Et les hommes minces, riches, liftés. Maintenant, ils parlent de portables, le plus jeune montre un trophée de chasse, le dernier modèle de Nokia avec télécaméra et four à micro-ondes incorporé.
– Je peux aussi naviguer sur Internet… dit-il.
Je me demande ce qu’il peut bien chercher sur Internet. Sans doute qu’il s’en sert pour charger des économiseurs d’écran de Pamela Anderson et des blagues idiotes, qu’il doit échanger avec des amis idiots. Il prend même une photo. L’idiot.
– Cheeese.
– Fromache ! lance un autre.
La top-modèle a un rire forcé, celui-là, ça doit être le boss, je me dis. Il est gros et vêtu de noir. Les cheveux (ce qu’il en reste) coiffés en queue de cheval, genre Fiorello. Non, genre Tony Renis.
– Après, tu me l’envoies, gazouille la rombière milanaise.
Je conclus le dîner sur une grappa et un tiramisu.
Je m’en vais bourré.
J’ai du mal à retrouver la route. C’est comme si les proportions, les contours avaient changé. A l’improviste, il me semble me retrouver dans la périphérie d’une grande ville, pas dans un bourg. Je ne reconnais plus les lieux. Tout me semble large et anonyme.
Il ne pleut plus. Mais l’air est froid.
J’entre dans la caserne en marmonnant un bonjour. A côté du comptoir, il y a deux gars en civil, ils se taisent à mon entrée. Je fais la première volée d’escaliers et m’arrête pour écouter ce qu’ils disent.
– C’est qui ?
– Le nouvel inspecteur.
– Mais ici, chez nous, dans le service ?
– Non, au commissariat.
Je me brosse les dents. Je réfléchis un instant sur l’opportunité d’une autre gorgée. Je suis murgé. Mieux vaut pas.
Je décide que oui.
Je dors.
-300x460.jpg)

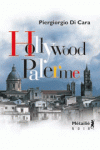
-100x150.jpg)
-100x150.jpg)
-100x150.jpg)