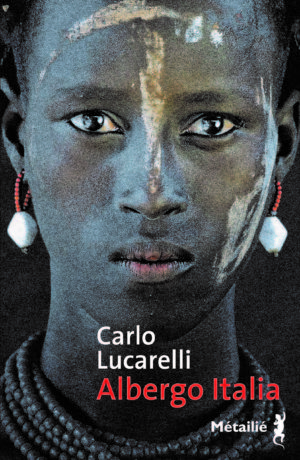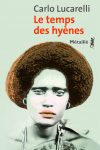« À Massaoua quand il fait chaud – et il fait toujours chaud – on peut entendre les rêves des autres. »
Dans l’air brûlant du soir, au cœur de la colonie italienne d’Érythrée, une fille des rues, mi-sorcière mi-putain, séduit un soldat de garde. Un peu plus tard, dans le palace Albergo Italia, un homme est retrouvé pendu : suicide ou meurtre ?
On retrouve ici l’atmosphère étouffante et hallucinée de La Huitième Vibration, avec un très pittoresque duo d’enquêteurs aux prises avec un classique problème de chambre close : Colaprico, le carabinier qui n’aime pas monter à cheval, et Ogbà, son adjoint abyssin, Sherlock Holmes qui s’ignore. Colaprico aura bien besoin d’Ogbà pour échapper aux pièges de Margherita, l’aventurière rousse, d’une horde d’assassins terrifiants, d’un faux géologue et vrai agent secret.
Avec l’habileté consommée du styliste et la maîtrise du grand raconteur d’histoires, Lucarelli entrelace les scènes burlesques et les moments magiques et parfumés, pour nous offrir à la fois un très plaisant polar digne des grands ancêtres et un tableau historique aux couleurs puissantes.
« Il circule dans ce court roman une légèreté exceptionnelle, une joie de raconter, une sorte de malice heureuse. » IBS
-
"Malgré cette atmosphère hors du temps, ce roman court et efficace, parfois lyrique, possède une résonance impressionnante avec notre époque." Lire l'article ici
Olivier Pène (Librairie La Machine à Lire à Bordeaux)Revue Ex Nihilo -
"Rien ne manque dans ce roman : un peu de banditisme, un peu de services secrets, un peu de mafia, un peu de sexe, beaucoup de racisme envers les peuples colonisés, beaucoup d’arrogance des colonisateurs, un peu de culture locale, beaucoup de finesse dans la narration." Lire l'article ici
ActuaLitté -
"Carlo Lucarelli excelle quand il s’agit de nous faire ressentir la chaleur, la transpiration qui dégouline, l’air raréfié du plateau, les odeurs lourdes et enivrantes de Massaoua." Lire l'article ici
Jean-Marc LaherrèreBlog Actu Du Noir -
"L'atmosphère coloniale est languissante mais le style piquant." Lire l'article ici
Jacques LindeckerDernières nouvelles d'Alsace -
"Ce très plaisant polar restitue avec brio parfums et couleurs de l'Afrique de la fin du XIXe siècle, mais aussi les tares et les travers de la colonisation. Dépaysement assuré." Lire l'article ici
L'Echo -
"Ce polar s'apprécie telle une friandise littéraire à croquer." Lire l'article ici
Fabien FrancoKaële -
"Albergo Italia est un faux polar vintage et une vraie comédie de mœurs." Lire l'article ici
Damien AubelTransfuge -
"Dans Albergo Italia, Carlo Lucarelli ressuscite une page d’histoire autour d’une intrigue policière fort attractive menée par un duo d’enquêteurs attachants." Lire l'article ici
Serge Perraudlelitteraire.com
PROLOGUE
L’AFFAIRE
Oualla, en tigrigna, veut dire “polissonne”.
Comme les gamines de la rue qui courent nues, crasseuses et sans rien aux pieds, en criant après les ânes qui portent l’eau et les t’liàn à ombrelles, jusqu’à ce qu’un vieux sorte avec un bâton pour les faire cesser, kit ! kit ! bakà !, allez-vous-en, allez-vous-en, ça suffit.
Ça veut dire aussi autre chose, ça veut dire “fille facile”, mais pas au sens de prostituée : au sens de celle qui joue, qui fait la coquette, qui couche, mais pas spécialement pour l’argent ou par métier.
Attribué à un garçon, c’est plus fréquent, comme avertissement aux filles : attention à ce ferengi, il dit qu’il va t’épouser, qu’il te traitera comme une reine, qu’il va t’emmener en Italie, et puis en fait il te prend et t’abandonne pour passer à une autre – oualla ! –, et ça vaut aussi pour les Abyssins – oualla ! – coureurs, et pour presque tous, blancs et noirs, en tout cas les hommes, ce n’est pas non plus une injure, au contraire.
Mais ça ne veut pas dire prostituée. En tigrigna, on dit galemotà et à Massaoua, où on parle beaucoup l’arabe, on dit aussi sharmutta, putain.
Elle, au contraire, c’est Oualla, et si elle va avec les hommes, c’est surtout pour jouer, même si, ensuite, elle garde l’argent et les cadeaux qu’ils lui font.
Cachée au coin d’une maison, elle tire sur l’étoffe de la fouta qui couvre son sein nu, non par pudeur, mais parce qu’elle sait que ce qui plaît au soldat maigre – elle l’appelle qourub, grenouille –, ce sont ses jambes et son makòr, son cul.
Puis, elle tousse fort, pour se faire entendre, et, de fait, le soldat se relève de la caisse sur laquelle il était assis et prend le fusil, mais sans le pointer, parce qu’il a compris que c’est un bruit volontaire et qu’il l’a même reconnue, Oualla, qui sort de son recoin et s’appuie contre le mur encore chaud de la journée, les mains croisées derrière la nuque, les jambes qui sortent droites de l’étoffe claire, les pieds nus plantés dans la poussière et ce regard indécent, qu’il imagine mais ne voit pas, parce qu’elle, si noire dans l’obscurité, au-delà de l’esplanade de l’entrepôt, elle est trop loin.
Alors, Oualla se détache du mur et s’approche, lente, les dents blanches serrées sur un bâtonnet de bois dans un sourire indécent comme son regard, et elle sait déjà qu’elle a gagné cette fois encore, parce que même si le qourub est revenu s’asseoir sur la caisse et secoue la tête, il garde les yeux sur elle.
– Non, Oualla. Pas ce soir. Il fait trop chaud.
Ce n’est pas vrai. L’air a recommencé à bouger, une haleine tiède qui sèche la sueur, la fait briller sur la peau noire de Oualla qui, très lentement, soulève l’étoffe fine sur la rondeur de son makòr.
– Non, Oualla, allez. Je ne peux pas. Si l’officier de piquet passe par ici, il me fout au trou.
Ça non plus, ce n’est pas vrai. Le dépôt militaire d’Archico est vaste, il y a des dizaines d’entrepôts et celui-ci est le dernier et le plus petit, tellement éloigné, après les bureaux de l’administration, que personne n’y passe jamais. Et, en effet, c’est toujours là que son cousin fourrier le fait mettre, de sorte que le chasseur d’Afrique Corbetta Pasquale passe toutes ses nuits de garde à dormir, hormis les fois où Oualla vient le trouver.
Parce qu’elle n’est pas si belle que ça, Oualla, une solide garçonne au visage plat, cheveux crépus comme de la laine de chèvre, noire comme le charbon, bras et jambes forts de porteuse d’eau, mais elle lui plaît. Ou mieux, elle l’excite, l’échauffe, le ’ngrifa, comme on dit par chez lui, à Macerata.
Alors, il secoue encore la tête, mais c’est plus pour lui-même que pour elle, parce que pendant ce temps il s’est levé, une main tirant sur l’étoffe du pantalon qui le serre entre les jambes, et Oualla sourit encore plus, parce qu’elle a noté le geste, elle crache dans la poussière le mawit mâché, comme une fille des rues, vraiment, et elle prend la demi-lire qu’il lui tend.
Après, quand elle retournera derrière la dune, elle laissera tomber la pièce sur le sol et l’enfoncera dans la terre de la pointe de son pied nu.
Parce qu’elle n’en veut pas, de l’argent du qouroub, elle n’a jamais aimé ça, elle va avec lui parce qu’elle est oualla, polissonne, et pas putain.
Et parce que Tesfài, qui en ce moment est en train de forcer silencieusement la porte de l’entrepôt avec sa bande de tzerakí, lui a donné beaucoup, beaucoup plus pour distraire le garde.
1
Le capitaine Colaprico n’aime pas les chevaux.
Surtout en Afrique, à la colonie, à Massaoua, où ils sont trop épuisés et trop nerveux, toujours à cause de la chaleur. Pour dire la vérité, il ne les aime pas non plus en Italie, et il n’aimait pas davantage les vieux poneys de Bardi, les chevaux de la ferme de Putignano où il était né et avait grandi quand son père servait dans les Pouilles, pas plus que le persan du manège que ce dernier l’avait contraint à fréquenter quand ils avaient déménagé à Milan (“tu verras que ça te servira, Pierino, tu verras”). Ensuite, d’élève carabinier jusqu’au grade de maréchal des logis, il n’avait plus rien eu à voir avec les chevaux pendant au moins dix ans, jusqu’à ce vieil animal de race salernitaine qu’on lui avait attribué à l’École d’aspirants au grade de sous-lieutenant, dixième sur vingt-deux justement à cause des points perdus avec l’équitation (“tu le vois, Pierino, que c’était utile ?”).
Il préférait les flancs larges comme des fauteuils des mulets de l’armée, qui trottaient droit et tranquilles, tête baissée, lui laissant le temps de penser à ses affaires, et en quatre ans de colonie au commandement de la Compagnie royale de carabiniers de Massaoua, il avait presque toujours réussi à les utiliser, avec soulagement et satisfaction. À part à Adoua, où le véloce lipizzan lui avait été bien utile, autant durant la bataille que quelques heures plus tard, lors de la retraite.
S’il n’avait pas été pressé, il aurait pris carrément un chameau pour faire les quelques kilomètres entre Massaoua et Archico, mais le gouverneur était en train de déménager la capitale de la colonie à Asmara, et on y avait aussi besoin du commandement des carabiniers royaux tout de suite.
Ainsi, quand il entre sur l’esplanade de l’entrepôt par la porte grand ouverte, le capitaine est déjà nerveux, à cause de la course et aussi parce qu’il pense à la caisse contenant ses livres de criminologie, le Lombroso, le Krafft-Ebing, le traité sur les poisons, cette nouvelle étude sur l’anthropométrie et les empreintes digitales, perdue parmi les caisses et les malles prêtes à partir pour le haut plateau, et Dieu sait où et quand il la retrouvera, à Asmara. L’adjudant Bertone le voit et court à sa rencontre, parce qu’il le connaît, le capitaine Colaprico, si ses fines moustaches sont si droites au-dessus de ses lèvres, cela signifie qu’il est en colère.
– Merci d’être venu si vite, mon capitaine.
– J’espère qu’il y a une bonne raison.
Oui, il est en colère, le capitaine, mais l’adjudant sait qu’il va changer d’idée dès qu’il verra qu’on ne l’a pas fait appeler pour un simple vol.
Colaprico est accompagné d’un zaptiè, un carabinier indigène, et à voir comme il se tient raide sur la selle, on comprend que lui non plus n’a pas beaucoup l’habitude des chevaux. L’adjudant lui passe les rênes de celui du capitaine sans même lui laisser le temps de descendre et il le charge quasiment sur son dos, l’officier, qui se détache d’un coup de la monture et saute en bas, plantant les talons de ses bottes dans la terre, parce qu’il est petit mais athlétique, le capitaine Colaprico.
Avant d’entrer, il s’arrête pour regarder la porte dégondée qui pend en travers du montant, la serrure arrachée par un pied de biche.
– Ils ont dû faire un beau boucan. Il n’y avait pas de garde ?
– Oui et non, capitaine.
– En quel sens ?
– Dans le sens qu’un soldat avait été assigné à la garde mais qu’au moment de l’effraction il n’était pas là. Il s’était éloigné avec une femme.
– Où est le soldat, maintenant ?
– Aux arrêts, mon capitaine.
– Et la femme ?
– Nous la cherchons. C’est une prostituée connue qu’on appelle Oualla. Ça signifie, justement, prostituée.
– Polissonne, dit le zaptiè en train d’attacher le cheval, mais l’adjudant ne l’écoute pas. Il pose une main sur la porte disjointe et de l’autre indique l’intérieur de l’entrepôt. Il est impatient, l’adjudant. Il pense jamme, jà, allons-y, va, parce qu’il est des environs de Salerne.
Au-dehors, le soleil cogne, mais dans le bâtiment c’est pire. Plafond bas et petites fenêtres, on dirait un four, et si, avant, la sueur coulait sous l’uniforme, maintenant elle ruisselle. Il fait sombre aussi, on n’y voit pas assez pour distinguer la forme des caisses qui remplissent la salle et puis, quand les yeux se sont habitués à cette pénombre brûlante qui sent la poussière et l’huile brûlée, on peut remarquer qu’à part une ou deux, les caisses sont toutes empilées par rangées, l’une sur l’autre, presque jusqu’au plafond.
– Mais ils n’ont rien volé ! dit le capitaine.
– C’est justement ça la question, dit l’adjudant.
Accrochées aux murs, il y a deux lampes à huile. L’adjudant en a une autre à la main et l’approche des deux caisses alignées sur le sol, ouvertes. Elles sont en bois, longues comme des caisses à fusil.
Elle sont pleines de skis.
Le capitaine en sort un, longue lame de bois clair, avec les lacets pour l’attache et la talonnière de fer, flambant neuf comme les autres dans la caisse. Il en avait eu une paire semblable quand il avait commandé une division de carabiniers dans un village des Alpes, près de la frontière de l’Empire austro-hongrois : ils arboraient, gravée à la pointe, la flamme des carabiniers royaux et d’ailleurs, sur celui qu’il tient à la main il y a la croix de Savoie, Armée royale, Corps des Alpins.
Quelqu’un a dû faire une petite confusion, pense Colaprico, puis il pense encore une bien énorme, car, à part que, de la neige, sur cette pointe de la Corne de l’Afrique, on n’en a jamais vu, les Alpins restés dans la colonie après le redimensionnement du corps d’expédition sont moins d’une compagnie, et il y a assez de caisses pour approvisionner au moins un corps d’armée.
Alors, il pense, le bonneteau, il le dit aussi et l’adjudant hoche la tête.
– C’est pour ça que je vous ai fait venir. Des choses bizarres, ici, à Archico, on en a vu passer beaucoup mais ça, dit-il en élevant les mains ouvertes vers le mur des caisses de bois, c’est trop gros. Quelqu’un est en train de déplacer des blocs de marchandise d’un endroit à l’autre et pour finir, dans la confusion, une cargaison va disparaître et on ne la retrouvera plus.
– Le bonneteau, justement. Interrogeons le fourrier responsable de l’entrepôt.
Il y a quelque chose de bizarre dans le sourire de l’adjudant, les yeux du capitaine se sont maintenant habitués à l’absence de lumière et réussissent à le remarquer.
Soulagement. Et satisfaction.
– Pourquoi ? Qui c’est ce fourrier ?
– Russo, mon capitaine.
Puis, vu que Colaprico plisse à peine le front et seulement par curiosité, l’adjudant s’approche et baisse la voix, en comptant sur ses doigts.
– Gendre d’un député à Rome, ami du général de l’intendance à Naples, en camorra avec des hommes d’affaires, des armateurs et des gens peu recommandables.
– En camorra, tu l’as dit parce que tu es napolitain ou parce qu’il l’est ?
– Parce qu’il l’est, mon capitaine, moi, d’habitude, je dis en combine. Et puis, je ne suis pas de Naples, je suis de Salerne.
Le capitaine déboutonne le col de sa veste. Le képi, il l’a déjà ôté, en lissant en arrière ses cheveux si trempés de sueur qu’après, on dirait qu’il a plongé la main dans l’eau.
– Allons-nous-en, murmure-t-il, et l’adjudant hoche la tête, si trempé lui aussi que son uniforme couleur bronze semble noir.
– Je n’ai pas bien fait de vous appeler, mon capitaine ? Même s’ils n’ont rien volé, toute l’arnaque est apparue au grand jour et du coup vous pouvez…
– Peut-être bien qu’ils ont volé quelque chose.
C’est le zaptiè qui a parlé, et l’adjudant n’y aurait pas prêté attention cette fois encore si le capitaine ne s’était pas arrêté sur le seuil de l’entrepôt, en se retournant pour le regarder.
Il est au fond de la salle, entre deux piles de caisses, et n’était le pantalon et la tunique qui dessinent une tache blanche dans la pénombre, ils n’auraient peut-être pas réussi à le voir, parce qu’il a une carnation de la même teinte que la pénombre. L’homme fait un pas en avant, entrant dans le halo d’une lampe, sa tête chauve brille de sueur sous le tarbouch grenat avec la flamme des carabiniers.
L’adjudant se rappelle deux sardines rouges sur la manche de la veste, qui y sont en effet, et il y a aussi les deux étoiles de l’ancienneté, mais putain, comment se permettait-il ?
– Ils n’ont rien volé, dit-il.
– Sauf votre respect, monsieur, moi je crois qu’en fait…
– Ils n’ont rien volé, répète l’adjudant, plus fort. C’est encore plein de caisses, tu le vois tout seul et puis qu’est-ce qu’ils en avaient à foutre, des skis ?
Et il leva un pied en le faisant pivoter sur sa cheville.
– S’il vous plaît, brigadier, dit Colaprico, quand Ogbà le bachi-bouzouk parle, moi je l’écoute toujours. Vous savez comment je l’appelle ? Le Sherlock Holmes abyssin.
Le brigadier ne dit rien et Ogbà non plus. Aucun des deux n’a jamais lu les romans d’Arthur Conan Doyle que le capitaine ramène d’Italie chaque fois qu’il revient de permission. Ogbà, en outre, a beau parler très bien l’italien – avec un fort accent et ces lettres que les Abyssins n’arrivent pas à dire, comme le p et le z qui deviennent presque un b et un s, il ne sait pas le lire, et en plus les livres sont en anglais. Mais il sait que c’est un compliment.
– Il y a deux caisses ouvertes là devant et une ici derrière, dit-il en frappant de la main ouverte une caisse au sommet de la pile, car il est très grand, mais il n’y a pas les couvercles.
Le brigadier regarde autour de lui. C’est vrai, les planches qui devaient fermer les caisses sont invisibles. Elle est bonne, celle-là, pense-t-il.
– Et alors, dit-il, tout ce bordel pour chourer trois bouts de bois ?
– Brigadier, s’il vous plaît.
Le capitaine tire sur une pointe de ses moustaches, à peine, parce qu’elle est trop courte pour bien la saisir : c’est sa manière de penser. Ogbà, au contraire, a l’habitude de retirer son fez et de le faire tournoyer autour d’un doigt, quelquefois en se frappant la paume de l’autre main avec le pompon bleu, mais pas maintenant, parce qu’il l’a déjà fait plus tôt. Et en effet, dans un coin au fond de la salle, sur une caisse, il y a une lampe allumée.
Ogbà la promène en bas du mur, près du carrelage, sous le regard attentif de Colaprico et du brigadier, tous deux baissés, les mains sur les genoux.
– Hier, le khamsin a soufflé, de la poussière partout. Elle entre par là, dit-il en montrant une fenêtre garnie d’une grille à larges mailles, puis le mur devant eux.
La poussière rouge de la route d’Archico a recouvert le crépi sec en laissant une tache blanche en forme de rectangle. Colaprico a l’impression de revoir une scène vue à Maremma, quand il donnait la chasse aux brigands : un carabinier avait tiré dans la tête d’un homme de la bande de Domenichino, et le sang qui avait giclé sur les murs de la ferme avait dessiné les contours de l’obstacle rencontré derrière le brigand, une parfaite silhouette de flasque de vin, avec même le bouchon.
– Il y avait quelque chose à cet endroit, dit Colaprico.
Puis il voit qu’Ogbà indique du doigt quatre marques nettes sur le sol de terre battue et le capitaine ajoute :
– … quelque chose de lourd.
– Un coffre-fort ! dit le brigadier, et Ogbà pense berghèz, évidemment.
Le capitaine se redresse et c’est comme s’il s’arrachait à une bulle d’eau chaude. La veste et la chemise l’enveloppent comme le drap d’un malade.
– Bon, dit-il, les voleurs envoient une femme distraire le garde et forcent la porte de l’entrepôt. Ils ne trouvent rien à voler et alors ils emportent le coffre-fort sur un brancard de planches. Bien qu’il soit assez inhabituel qu’ils fauchent un coffre-fort fermé, qui plus est dans un entrepôt militaire. Qui a tant de capacités d’initiative parmi les tzerakí de Massaoua ?
– Tesfài, dit le brigadier.
Ogbà allait le dire mais il s’est retenu, parce qu’il sait rester à sa place. Il a beau être de même grade, il n’est jamais qu’un carabinier indigène.
– J’imagine que lui aussi a déjà disparu mais tâchez de le trouver. En attendant, allons bavarder un peu avec le fourrier. Il me semble qu’il ne se laissera pas intimider par un brigadier, et ça, c’est mal, parce que notre Corps devrait toujours intimider tout le monde. Voyons comment il se comportera avec le capitaine commandant.
Ils sont sortis de l’entrepôt et là, dehors, même si c’est sous le soleil à pic d’un mois de mars qui sous ces latitudes ressemble à l’été, la différence de température est si forte qu’un instant, un instant seulement, on dirait presque qu’il fait frais.
Le fourrier en chef Mariano Russo ne se laissa pas non plus intimider par le capitaine commandant. Il resta assis immobile sous le ventilateur du bureau du brigadier qui glaçait sa sueur grasse entre les plis de sa nuque, les moustaches gonflées sur les lèvres légèrement étirées par un sourire suffisant.
En réalité, c’était moins un sourire qu’un ricanement.
Le fourrier en chef était surtout remonté contre chille muort’ ’e, ce crevard de cousin qui, pour tirer un coup, avait laissé chille strunz’ ’e, ce con de Tesfài lui retirer une des trois cartes, faisant découvrir tout le jeu. Il espérait que la putain était vérolée et lui avait refilé la chaude-pisse, à Pasqualino, et qu’on l’expédie monter la garde à la prison de Nokra ou, pire encore, dans l’enfer des voyous d’Assab.
Et puis il était remonté contre chille strunz’ de voleur abyssin qui au lieu de mieux s’informer et de voler un lot de chaussures ou de boîtes, à la limite de café et de sucre comme celui qui était là juste un jour avant, avait piqué le coffre-fort – son coffre-fort, bon sang de bonsoir ! – qui ne lui servait pas à garder ses affaires, mais celles des autres, trente lires par mois pour enterrer leurs secrets dans un trou dont personne ne savait qu’il existait.
Contre chella facc’ ’e sbirr’, cette tête de flic, en revanche, il n’était pas particulièrement remonté. Au fond, il faisait son métier et, au maximum, il réussirait à le faire renvoyer en Italie.
Parce qu’à Archico il n’y en avait pas, des preuves du jeu de bonneteau : la combine, ils la faisaient à Rome et à Naples, et quand l’enquête arriverait là-haut, elle s’embourberait et bonsoir chez vous.
Parce que le coffre-fort – son coffre-fort ! –, personne ne l’avait jamais vu et il n’y avait que le capitaine, chille fess’ ’e, ce crétin de brigadier, et un nègre, pour dire qu’il existait.
Parce que Tesfài n’était pas un imbécile et, à cette heure, il avait fui dans le Choa avec le coffre-fort encore fermé.
Et puis, il ne savait même pas ce qu’il y avait dedans, un paquet de documents d’un type d’Asmara et ceux d’un marchand grec, en tout cas rien qui puisse conduire jusqu’à lui.
Ainsi, tandis que le capitaine Colaprico – une fesse sur le bord du bureau du brigadier, bras croisés et avec ce ton léger qu’il utilisait quand il interrogeait quelqu’un, qui faisait peur à tout le monde sauf au fourrier en chef Russo Mariano – le bombardait de questions, le fourrier gardait sans faiblir le sourire, répondait trois “oui”, quatre “non” et vingt-deux “je ne sais pas”, et il quitta la caserne des carabiniers royaux d’Archico avec l’ordre de rapatriement dans la poche.
Va te faire foutre, pensa Colaprico tandis qu’il remontait sur son cheval pour rentrer à Massaoua, où l’attendait le bordel du déménagement vers le haut plateau et maintenant aussi un inutile rapport sur ce qui s’était passé, à expédier en Italie en même temps que le fourrier.
Va te faire foutre, pensa-t-il encore, et puis il le dit d’une voix forte :
– Va te faire foutre !
Juste au moment où Ogbà se plaçait avec son cheval à ses côtés, un pas en arrière, respectueusement, en haussant les épaules parce qu’il connaissait assez bien son capitaine pour savoir que ce n’était pas contre lui qu’il était remonté.
Et cela fut le début de tout.