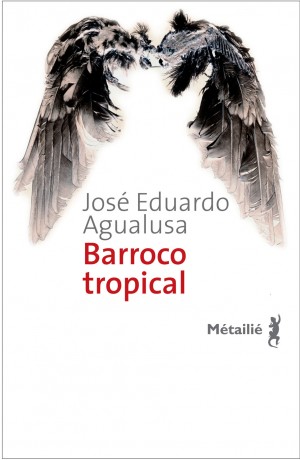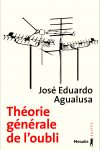Une femme tombe du ciel et s’écrase sur la route devant Bartolomeu au moment où éclate une tempête tropicale et où sa maîtresse lui annonce qu’elle le quitte. Il décide de percer ce mystère alors que tout change autour de lui, il découvre que la morte, mannequin et ex-miss, avait fréquenté le lit d’hommes politiques et d’entrepreneurs, devenant ainsi gênante pour certains, et il comprend qu’il sera la prochaine victime.
Il croise les chemins d’une chanteuse à succès, d’un trafiquant d’armes ambassadeur auprès du Vatican, d’un guérisseur ambitieux, d’un ex-démineur aveugle, d’un dandy nain, d’une prêtresse du candomblé adepte du mariage, d’un jeune peintre autiste, d’un ange noir ou de son ombre. Il explore la ville de Luanda en 2020, métaphore de la société angolaise où les traditions ancestrales cohabitent difficilement avec une modernité mal assimilée. Il s’enfonce dans la Termitière, gratte-ciel inachevé mais déjà en ruine où les riches vivent dans les étages tandis que les pauvres et les truands occupent les sous-sols.
Il nous montre une ville en convulsion où l’insolite est toujours présent et intimement mêlé au prosaïque et au quotidien, où la réalité tend à être beaucoup plus invraisemblable que la fiction.
Dans une prose magnifique cet amoureux des mots définit son pays comme une culture de l’excès, que ce soit dans la façon de s’amuser ou dans la façon de manifester ses sentiments ou sa souffrance.
-
« Barocco Tropical se distingue par son originalité, sa fraîcheur et son côté délicieusement décalé. »
Découvrez le supplément Rentrée littéraire de Lire 2011 ici.Céline et GenevièveVirgin Megastore (Les Quatre Temps, La Défense-Bayonne) -
« D’une richesse littéraire où se mêlent journal intime, théâtre, futuriste… Le tout mélangé à une bonne dose d’ironie. Les mots sont beaux chez Agualusa et ils ne sont pas compliqués. Les mots sont libres et chantent la liberté. On trouve une résonance avec le mot « baroque » dans ces personnages excessifs : souffrances, croyances, idéologies politiques, tout est dans l’excès. Certains profitent de cette peur pour asseoir leur pouvoir, d’autres ne peuvent pas vivre sans elle. Agualusa trace un portrait de la société angolaise, où les traditions ancestrales coexistent avec une modernité mal assimilée, mais cela ne se fait pas toujours sans heurts. Même si riches et pauvres se croisent, les disparités sociales se sont encore creusés dans cet avenir pas si lointain. Pour les pauvres, les ruines et la ville souterraine, pour les riches une vie dans la lumière et les étages les plus hauts des plus grands immeubles. Une belle réussite pour ce livre qui vous prend, vous touche et ne vous laisse pas en paix pendant des jours. Plus qu’un roman, une réflexion sur notre société. En espérant que le tableau dépeint par M. Agualusa ne soit qu’une dystopie et non une prémonition. »
Glaucia
-
Lire l'article entier ici.entretien avec Dominique StoenescoLUSO JOURNAL
-
Plus d'infos ici.FLUCTUAT.NET
-
Plus d'infos ici.LA CAUSE LITTÉRAIRE.FR
-
Plus d'infos ici.AFRICULTURES.COM
-
« Un roman effectivement baroque et tropical. Jubilatoire aussi. »Gérard NoëlVOSGES MATIN
-
« José Eduardo Agualusa ne manque ni d’imagination ni de tempérament. Son écriture rapide aime cerner les états convulsifs et adore les portraits insolites. »Alain FavargerLA LIBERTÉ
-
Entretien croisé avec Mia Couto à lire ici.Agnès NoëlTEMOIGNAGE CHRETIEN
-
« Lyrisme tropicaliste tempéré par l’humour »Isabelle RuefLE TEMPS
-
« Quand littérature est aussi goût splendide pour l’humanité. »Isabelle PotelAIR FRANCE MADAME
-
«L’enquête, la chronique sociale et le surnaturel se mêlent dans cette vaste fresque chorale sur l’Angola, écrite dans une langue foisonnante, où chaque personnage incarne un pan de ce pays tout entier dans l’excès, où les très riches côtoient la misère. Magnifique.»Agnès NoëlTÉMOIGNAGE CHRÉTIEN
-
« Sélection des finalistes pour le Prix du Meilleur Livre Etranger 2011 »COURRIER INTERNATIONAL
-
« Le tableau impressionniste d’une Luanda belle et féroce »Olivia MarsaudAFRIQUE MAGAZINE
-
« Accrochez-vous, c’est fou ! »Marc GadmerFEMME ACTUELLE
-
« … entre surréalisme et satire, avec les piments du réalisme magique cher aux grands Latinos. »André ClavelLIRE
Une femme tombant du ciel.
J'ai compté les secondes entre l'instant de l'éclair et celui du tonnerre – un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Puis je les ai multipliées par trois cent quarante, la vitesse du son en mètres par seconde, pour calculer la distance à laquelle était tombée la première décharge de la foudre : deux kilomètres, trois cent quatre-vingts mètres. J'ai fait ce calcul pour la deuxième, la troisième, la quatrième décharge. La tempête avançait rapidement dans notre direction. J'ai su où tomberait la cinquième décharge un instant avant que le ciel ne se déchire.
Kianda se trouvait à environ cent mètres devant moi et avançait, continuait à avancer, comme sur une scène de théâtre, poussée par la lumière. Ses chaussures s'enfonçaient dans la terre, rouge laque sur rouge éteint. Les palmiers dansaient dans le lointain. La silhouette d'un baobab se dressait encore plus loin. Kianda avançait très droite, visage levé, ses belles mains aux doigts très longs et fins croisées sur la poitrine. La lumière était une substance dorée et dense, presque liquide, à laquelle collaient des feuilles sèches, des vieux papiers, une impalpable poussière embrasée, matière soulevée par le vent entre ses bras tordus.
Mon amour continuait à avancer à la rencontre de la masse noire des nuages. Je me suis souvenu des paroles d'un critique musical célèbre, un vieil Anglais un peu excentrique, qui essayait d'expliquer son succès : “La première chose qui nous séduit c'est le contraste entre la fragilité de la silhouette, étrangement anguleuse, et la férocité hautaine du regard. La voix puissante et délicate. On a simultanément envie de la protéger et de la rouer de coups.”
Kianda est entrée dans la pluie. La robe légère en soie, d'un rouge très vif, lui a collé à la peau tout en changeant de couleur jusqu'à devenir presque violacée. Le profond décolleté dans le dos laissait voir les deux ailes bleues que Kianda s'était fait tatouer lors d'un voyage au Japon. Elles m'impressionnent toujours, bien qu'elles me soient très familières, à cause du détail des plumes et de la technique en trompe-l'œil qui crée une illusion de relief. Les ailes remuent au rythme de la respiration. La chevelure furieuse en flammes que tant de femmes tentent d'imiter s'est éteinte, elle a perdu volume et éclat, s'étalant sur le contour ferme des épaules.
J'ai ouvert la portière et je suis sorti de la voiture, une vieille Chrysler couleur pain brûlé, une pièce de collection. Un vent humide m'a fouetté le visage. J'ai crié son nom plus fort que le grondement de la tempête. Kianda s'est tournée vers moi tout en levant les yeux au ciel dans une stupéfaction muette.
(Je me rends compte en relisant ces lignes qu'elles ressemblent au scénario d'un film publicitaire. C'est le moment où le flacon de parfum devrait surgir. Il lui faudrait un nom approprié, du genre La Tempête. Mais non. À partir de cet instant le film se transforme.)
J'ai suivi le regard de Kianda et j'ai vu une femme tomber du ciel. Elle est tombée – est arrivée en tombant, nue, noire, bras écartés – presque en même temps que la foudre. La foudre a fait exploser le baobab. Un météorologue m'a expliqué il y a longtemps que les éclairs peuvent faire exploser les arbres en provoquant une soudaine ébullition de la sève. La femme s'est enfoncée dans les herbes hautes, non loin de la voiture. Le corps était enterré dans la boue. La tête était rejetée en arrière. J'ai reconnu ces yeux ouverts, très noirs, encore remplis de lumière. J'ai reculé, terrorisé. J'ai empêché Kianda de la regarder :
– Partons !
– Partir ?! Et elle ?
– Elle est morte, mon amour ! Cela n'a plus aucune importance. Tu veux appeler la police ?
– Non, non ! Pas la police. Je ne veux appeler personne. Tu sais très bien qu'il ne faut pas qu'on nous voie ensemble.
J'ai pris Kianda dans mes bras. Elle tremblait. Je l'ai emmenée jusqu'à la voiture, l'y ai assise à la place du mort et j'ai conduit en silence sur le chemin du retour à Luanda. Quand nous sommes arrivés, la nuit n'était pas encore tombée sur la ville. J'ai garé la voiture à deux pâtés de maisons de chez elle. Je me suis penché pour l'embrasser. Kianda a détourné le visage.
– Non ! Plus jamais.
Je suis sorti. Elle a pris ma place, a démarré et est partie. J'ai arrêté un taxi. Pendant de nombreuses années il n'y a pas eu de taxis individuels à Luanda ; il y avait seulement des taxis collectifs, appelés candongueiros, destinés à servir le peuple.
(Le Peuple, ou Eux, comme nous autres en Angola, les riches, ou les presque riches, appelions ceux qui n'ont rien. Ceux qui n'ont rien sont la majorité écrasante des habitants de ce pays.)
Le chauffeur de taxi était un Congolais obèse. La peau de son visage très lisse brillait comme un miroir dans la lumière cuivrée du jour finissant. Il m'a adressé un immense sourire :
– Où on va, mon petit père ?
– Je ne sais pas, ai-je avoué d'une voix blanche. – La Peur m'empêchait de penser. – N'importe où.
L'homme s'est remis à sourire :
– Pas de problème. Je vous conduis là-bas.
Une demi-heure plus tard il m'a déposé à la porte d'un petit bar. J'ai remarqué le néon qui tremblotait au-dessus de la porte : L'Orgueil grec. Le sourire du chauffeur avait maintenant la taille du globe terrestre :
– Entrez et demandez Mãe Mocinha. Elle saura vous dire où aller. Elle ne se trompe jamais.
(La femme qui tombe, cinq jours plus tôt.)
Je l'ai aperçue dès que je suis entré dans la salle d'embarquement. La femme aussi m'a vu. Elle a fixé sur moi la lumière implacable de ses grands yeux noirs, si intensément que j'ai baissé les miens. Quand je les ai de nouveau levés, elle était toujours là, assise sur un des sièges, très droite, avec l'élégance hautaine d'une princesse éthiopienne. Elle portait un manteau de fourrure, d'un luxe archaïque, et un pantalon noir pattes d'éléphant. Je me suis assis derrière elle, à deux sièges de distance, pour échapper à ce regard et pouvoir l'étudier tranquillement.
Qui pouvait-elle bien être ? Ou plutôt – qu'était-elle ? Je me suis mis à imaginer plusieurs possibilités : certainement de bonne naissance, dans une vieille famille de Luanda ou de Benguela. Un de ses aïeux avait été fonctionnaire public dans l'administration coloniale. Son père, un bureaucrate au service de la présidence ; peut-être un chef d'entreprise prospère ; un général devenu entrepreneur dans le domaine de l'exploitation minière. Elle avait fait ses études à Lisbonne, à Londres ou à New York. Éventuellement à Lisbonne, Londres et New York. Sa façon de s'habiller suggérait un goût en conflit avec les normes écologiques actuelles. Elle prenait peut-être plaisir à les défier, ou alors elle avait tellement d'argent qu'elle se sentait au-dessus du jugement des masses. Quoi qu'il en soit, j'avais la certitude de ne l'avoir jamais vue avant. Je me suis souvenu d'un des Douze contes vagabonds de Gabriel García Márquez, “L'avion de la belle endormie”. Dans ce conte, l'écrivain colombien décrit un voyage qu'il a fait à côté de la plus belle femme du monde qui ne lui a pas adressé la parole. Je voyage souvent en avion, presque tous les mois, et je ne me souviens pas d'avoir réussi à m'asseoir à côté d'une jolie femme. Je suppose que les compagnies aériennes ont reçu l'instruction de ne jamais placer les jolies femmes à côté d'un homme, quel qu'il soit, sauf s'il s'agit de messieurs d'un âge respectable et d'ecclésiastiques. Quand l'embarquement a été annoncé, j'ai attendu que la femme se lève pour me placer dans la queue. Alors, à ma grande surprise, elle s'est retournée, a pointé l'index de sa main droite et m'a demandé :
– Vous êtes Bartolomeu Falcato ?
– Je le suis la plupart du temps, ai-je confirmé, m'efforçant d'ajouter une remarque spirituelle, un commentaire joyeux, quelque chose me permettant de me ressaisir et de retrouver mon aplomb. Mais je suis disposé à être ce que vous voudrez, quand et où vous voudrez.
Je reconnais que j'aurais pu être un peu plus original. Mon ineptie n'a pas semblé l'offenser :
– Je m'appelle Núbia, a-t-elle dit d'une voix trop forte. Je savais que nous allions nous rencontrer un jour, à Lisbonne, à Luanda, quelque part dans le monde. J'en étais sûre.
Je n'ai pas osé lui demander d'où lui venait tant de certitude. En revanche, j'ai voulu savoir ce qu'elle faisait. Elle a souri d'un air évasif. Puis quelqu'un l'a appelée, elle s'est éloignée et je ne l'ai revue que dans l'avion. Elle était plusieurs rangées devant moi. Il n'y avait personne à mes côtés. Núbia s'en est aperçue et elle est venue me rejoindre. Elle a ôté son manteau de fourrure et l'a mis dans le compartiment à bagages. Elle portait dessous un simple corsage blanc, très élégant, qui laissait deviner des seins abondants et fermes. Elle a ouvert ensuite un petit sac rouge en plastique et en a sorti une pile de revues qu'elle a posées sur mes genoux :
– C'est pour que vous me connaissiez mieux.
Les revues s'appelaient Cacao, Tropical, Femme africaine, Visages et Couleurs. Núbia était sur toutes les couvertures. Sur la première, elle était habillée en mariée, en train de descendre un long escalier en colimaçon. Sur la deuxième, elle posait en bikini, allongée sur une serviette de plage avec, pour toile de fond, une mer couleur d'émeraude entre une frise de rochers. Sur la troisième, elle n'était vêtue que d'un short en jean et elle riait, un beau rire juvénile, pendant qu'elle s'efforçait de cacher sa poitrine avec ses deux mains.
– Ah, bon ! ai-je soupiré, étonné. Vous êtes donc mannequin…
– J'ai été Miss Angola il y a dix ans. Puis je me suis lancée dans une carrière de mannequin. J'ai aussi eu une émission à la télévision.
– Vous ne l'avez plus ?
– Non. On m'a cloué le bec. On ne veut pas que je parle !
Elle m'a retiré les revues des mains et les a remplacées par un gros album de photos. Qu'elle a ouvert elle-même. Les premières images montraient un défilé de miss. Núbia surgissait sur les photos suivantes, toujours avec le même sourire, à côté de la Présidente et de son mari. À côté d'un joueur de football célèbre. À côté d'une actrice de cinéma. Dans les bras d'un chef d'entreprise américain célèbre. Dans les bras de deux chefs d'entreprise nationaux prospères. Sur les genoux d'un trafiquant d'armes connu. Sur l'énorme yacht présidentiel. J'ai désigné une photo d'elle à cheval. Un peu en retrait, aussi à cheval, on apercevait un homme élégant, avec une moustache et un bouc. Le visage m'a paru familier :
– Et celui-là, c'est qui ?
– L'amant de la Présidente !
– Quoi ?!
Elle a ignoré mon ébahissement. Elle a continué à me montrer les photos. De plus en plus enthousiaste. Elle parlait presque sans reprendre haleine, de façon torrentielle, pendant que son accent changeait. On distinguait à présent, derrière la prononciation douce et dolente, caractéristique de la vieille bourgeoisie de Luanda, une autre, plus ample, plus sonore et rustique. C'était comme si une deuxième femme, une femme du peuple, essayait de sortir de la première – de la fausse –, pas comme un papillon de la chrysalide, mais comme un lézard faisant irruption d'un cocon. Je lui ai demandé son nom de famille. Elle a souri, montrant qu'elle avait deviné mon intention :
– Ma famille était très pauvre. Je ne savais même pas parler portugais. Je le parlais mal. C'est elle qui m'a appris à le parler.
Elle a montré la Présidente sur une des photos. Elle a lâché un petit rire :
– C'est une salope ! Elle restait pour épier pendant que son mari me baisait. Tu sais ce qu'ils m'ont obligée à faire ? Non, tu ne le sais pas. Personne ne le sait. Moi et les autres filles. Des orgies avec des gens importants. Des drogues…
– Je ne te crois pas !
– Si, j'ai essayé des tas de drogues. Haschisch. Héroïne. Cocaïne. Aujourd'hui, je ne me drogue plus. Dieu ne me laisse pas prendre de drogues…
– Dieu ?!
– Oui, Dieu. – Elle a baissé la voix. Elle a approché ses lèvres douces de mon oreille. – Tu sais qu'on a vu Dieu défiler sur la route côtière ? Dieu me parle. Un jour il m'a montré un de tes livres. Le lendemain, je suis allée dans une librairie et je l'ai acheté.
– Et tu l'as lu ?
– Je l'ai lu, mais je n'ai rien compris. Je l'ai lu parce que Dieu m'a dit : “Ma fille, prépare-toi. Tu es Núbia, la pute, et tu es Marie, la pure. Bénie soit la fureur de ton ventre.” Il m'a dit ça parce que je vais tomber enceinte, je vais donner au monde un nouveau sauveur…
Je l'ai regardée fixement, perplexe et effrayé :
– Et qui sera le père ?
Núbia m'a regardé, légèrement choquée :
– Le père ?! Ce sera toi, évidemment. Ça m'a été révélé par Dieu. Tu seras mon Joseph.
– Et notre fils s'appellera comment ?
– Emmanuel, bien sûr.
La question tranchée, elle a commencé à me raconter que pendant de nombreuses années elle avait été un garçon. Entre-temps les lumières avaient été éteintes dans l'avion. Il était minuit passé. Dehors, les étoiles étincelaient en silence.
– Quand j'étais un garçon, je baisais la Présidente…
J'avais cessé de l'écouter. J'avais mal à la tête. Le sommeil éteignait ma conscience, comme un black-out en ville, il y a longtemps, pendant les années de guerre, d'abord un quartier, puis un autre, de vastes étendues qui disparaissaient dans l'abîme. En même temps, des images hétéroclites jaillissaient de je ne sais quel océan caché, du tréfonds le plus lointain de mon cerveau : moi en train d'embrasser Laurentina, ma mère dansant dans une robe rose, un chien mort sur le trottoir, la gorge tranchée. J'ai lutté désespérément pour rester éveillé. J'ai fini par m'endormir, je me suis sûrement endormi car je me souviens d'avoir couru nu sur une plage à côté de Núbia, quand soudain j'ai ouvert les yeux et l'ai vue penchée sur moi. Elle avait déboutonné son corsage et dégrafé son soutien-gorge. Là, dans la nuit rapide, à onze mille mètres d'altitude, elle m'a semblé être indubitablement une divinité. Une version moderne (assez moderne, c'est vrai) de la Mère du Sauveur. Je me suis réveillé, encore tout ensommeillé :
– Qu'est-ce que tu fais ?!
– J'enlève mon corsage. Nous allons nous aimer.
– Ici ?!!
– Oui, attends un instant, j'enlève mon pantalon.
– Non, tu ne vas pas faire ça. Tu vas reboutonner ta blouse.
– Tu ne me trouves pas jolie ?
– Si, je te trouve jolie, mais je trouve aussi que tu débloques. Tu devrais parler à un psychologue.
– Je préfère parler à Dieu. Qu'est-ce qu'un psy peut me dire que Dieu ne me dit pas ?
Cet argument m'a désarmé. Núbia a pris mon silence pour un acquiescement. Elle a ajouté d'une voix moqueuse :
– Tu veux que j'aille parler à Bárbara Dulce ? N'est-ce pas une psychologue ?
– Bárbara ? C'est une psychanalyste. Une chercheuse. Une spécialiste des troubles du sommeil. Des rêves.
D'où connais-tu ma femme ?
– Je connais tout de toi…
Heureusement que ce n'était pas le cas. Elle ne connaissait même pas mon numéro de téléphone. Je lui ai donné un faux numéro, mais j'ai gardé le sien. Nous nous sommes quittés avec un baiser rapide dans la file d'attente pour la police des frontières. J'ai promis de l'appeler, j'ai insisté pour qu'elle se repose et j'ai essayé de disparaître. Bárbara Dulce m'attendait dehors et je ne voulais pas de scandale.