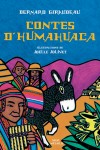« Un marin point ne meurt, un marin s’évade » Bernard Giraudeau nous a quittés le 17 juillet et nous sommes infiniment tristes.
Tous ses lecteurs qui veulent continuer l’action qu’il a menée ces dernières années pour les malades du cancer avec l’Association pour la Recherche de Thérapeutiques Innovantes en Cancérologie, créée par le Professeur Stéphane Oudard, peuvent nous adresser leurs dons par chèques à l’ordre de ARTIC, et nous les ferons suivre.
Editions Métailié
20 rue des Grands Augustins
75006 Paris
+ 33 (0) 1 56 81 02 45
Palmarès des best-sellers 2009 élus par L'Express. En savoir plus
Je suis en arrêt de jeu, sur le dos, paupières closes. Je sais que vos mains, fines, élégantes, déliées sont une harmonie, une musique pour saisir mes lettres, les déplier et les tenir comme la plus précieuse découverte de notre vie. Cette main qui repousse une mèche de cheveux reste suspendue pendant que vous lisez, attentive, les mots sacrés de ce voyageur infatigable qui a fini par s’arrêter dans votre jardin. Je vous aime depuis si longtemps, depuis avant le début.
Ces lettres qui ne pourraient jamais finir sont celles de mes mouvements géographiques et de mes voyages immobiles sur la scène. Mais probablement y verrez-vous un autre voyage plus complexe, plus hardi, plus désespéré. Voyager, dit-on, on n’en revient jamais.
Le prendrez-vous ce temps de me lire pour me prolonger un peu en vous ?
Avec un don irrésistible pour dire le clair-obscur des sentiments, Bernard Giraudeau embarque ses lecteurs, en compagnie de l’inconnue qu’il veut séduire, vers des ailleurs nés d’un imaginaire construit sur l’aventure, le désir de vivre et d’aimer.
« Il sème des grains de sagesse dans un tourbillon d’aventures. » M. Abescat, Télérama
« Il écrit pour aimer encore et voyager toujours. » J. Garcin, Le Nouvel Observateur
-
« Et le petit miracle se reproduit. Le comédien et réalisateur Bernard Giraudeau est devenu sur le tard un de ses écrivains qu’on est heureux de retrouver régulièrement en librairie. »Michel DoussotROUTARD.COM -
« Cher amour, magnifique aveu où l’homme dénudé cherche à devenir un amant qui en a fini (peut-être) des voyages, des départs, des retours, et qui, récit fait chair, n’est plus que parole, immobile et presque achevée, d’un périple dont la fin est celle de tous les hommes. »
Elisabeth Guillaud
OBIWI.FR -
LAREP.COM
-
« […] Cher amour, superbe roman-récit impressionniste des ses dix dernières années, brassage inattendu de voyages, de théâtre, de poésie et de souffrances. Où le narrateur n’a pas toujours le beau rôle. »Philippe CosteLE VIF/L’EXPRESS -
« A la fois poétique et cru, Bernard Giraudeau dévoile sa quête de l’amour et de lui-même. »
Serge BressanLE QUOTIDIEN -
« Dans ce superbe livre qui chante et enchante, il suffit de se laisser faire. »
Lucie Cauwe
LE SOIR -
« […] chaque récit croqué avec gourmandise est un enchantement. »
Frédérique Bréhaut
LE COURRIER DE L’OUEST/LE MAINE LIBRE/ PRESSE OCEAN -
« "Chère, irremplaçable, madame T…" Avec talent, Bernard Giraudeau fait partager ses aventures à travers le monde à une mystérieuse inconnue qu’il cherche à séduire. Le lecteur l’est aussi. »
Michel VagnerL’EST REPUBLICAIN -
« Tout est là en effet : dans le regard. Celui de Giraudeau est vif, gourmand, chaleureux, direct –au moment, par exemple, de faire face à son ennemi, un cancer du rein. Au fil des périples, des rencontres, des représentations aussi, il tient son cap, que fixe une citation de Pessoa : " Rien ne donne autant le sens du sacré que de regarder les gens". »François MONTPEZATDNA -
« La prose est dix-huitiémiste, le souvenir abondant, l’amour partout présent. »
CENTRE FRANCE -
« Les récits de ses pérégrinations sont entrecoupés de souvenirs de théâtre : pourquoi joue-t-on ? D’où viennent le trac, les trous de mémoire ? Jusqu’où va, pour plaire aux spectateurs, le désir de se plaire ? Giraudeau répond, avec une grande honnêteté, cherchant toujours à trouver le point d’équilibre, dans sa vie de fildefériste, entre l’horizontalité du globe-trotter et la verticalité de l’acteur. »
Jérôme GarcinLA PROVENCE -
« Un livre qu’in ne se lasse pas de reprendre pour voyager avec lui vers de contrées aussi réalistes qu’imaginées. »
Marie-Christine LutonSANTE MAGAZINE -
« Homme de théâtre et de cinéma, réalisateur, Bernard Giraudeau est également un écrivain de talent. Son dernier livre, Cher amour, nous entraîne dans tous les voyages possibles de l’existence, à travers la maladie notamment. »
Emmanuelle Friedmann
QUESTIONS DE FEMMES -
« Au fil des ces pages vagabondes, le lecteur entre dans la géographie intime d’un écrivain qui convoque ses prédécesseurs, en appelle à l’Histoire, et laisse libre cours à une curiosité insatiable pour tracer une route inédite. Passionnant. »
Muriel du BrusleFEMMES -
« Le dernier roman de Bernard Giraudeau est de ces livres rares, hors genre, qui ne ressemblent qu’à eux. Au fil d’une longue lettre, l’auteur nous emmène en voyage, saisissant des histoires, des parfums, des visages qui font la beauté de l’existence. Il y évoque aussi la maladie. Une autre facette de la vie… »
Alexie Lorca
ATMOSPHERES -
« Bernard Giraudeau, acteur devenu écrivain de marine, renoue avec sa jeunesse et puise avec bonheur dans la richesse de sa mémoire. »
Jean-Michel BarraultLIRE -
« Avec ce nouveau roman, Bernard Giraudeau nous touche une fois de plus par sa sensibilité et la qualité de sa plume. A lire pour faire un magnifique voyage immobile. »
Eric LamonTELE LOISIRS -
« Un splendide récit d’amour, généreux, poétique, par un homme apaisé qui tutoie la sagesse. »
Marie Chaudey
LA VIE -
« De ses aventures vécues à ses voyages immobiles au théâtre, l’auteur nous entraîne sur la terre de ses souvenirs. Et nous enchante par la force de sa narration et la beauté de ses mots. »
Marc GadmerFEMME ACTUELLE -
« Poétique et émouvant. »
Anne Michelet
VERSION FEMINA -
« A cette mystérieuse madame T. pour qui ses lettres sont écrites, on envie un tel ouvrage, un tel hommage. »
Isabelle LortholaryELLE -
« Il faut se laisser porter par le torrent de sa langue pleine et ouvragée, le suivre dans ses enthousiasmes et dans ses doutes. »
Jeanne De MénibusMADAME FIGARO -
« Il décrit inlassablement, cette envie de découvrir le monde, mais aussi cette inspiration permanente, insatisfaite à aimer, à être aimé… et enfin à se poser un jour dans les bras d’une femme. Dans Cher amour, il nous emmène dans la forêt amazonienne, la moiteur du Cambodge ou aux confins du Pérou. Mais il y a aussi son métier de comédien, sa passion qu’il évoque au gré de ses retours. […] Quel bonheur […] de le retrouver dans ce beau roman personnel. »
Claire ChazalLE FIGARO MAGAZINE -
« Une tempête de mots, force 10. »
Jérôme Garcin
LE NOUVEL OBSERVATEUR -
« Cher amour vibre une nouvelle fois de cette passion de la vie que partage si bien Bernard Giraudeau. Une infinité de récits s’y entrecroisent, contés avec gourmandise, portés par cet irrésistible talent pour dire l’ambivalence des émotions et des sentiments, le bonheur entre chien et loup […]. »
Michel AbescatTELERAMA -
« C’est en "homme nouveau" qu’il revient, à travers ces émouvantes épîtres, sur une existence frénétique qui a fini par lui apprendre la sagesse et l’amour. »
Alexandre Spack
LE POINT -
« Ces lettres à une mystérieuse Pénélope possèdent de la subtilité, de l’humour, de l’audace. Un art de la digression. Un talent de conteur … »
Bernard PivotLE JOURNAL DU DIMANCHE -
« Dans Cher amour, l’acteur se confesse à une mystérieuse inconnue. Il lui raconte ses voyages, évoque son attachement au théâtre et ses souffrances. »
Françoise DargentLE FIGARO LITTERAIRE -
« Bernard Giraudeau poursuit sa quête de l’instant de grâce à travers les océans. »
Emilie Grangeray
LE MONDE DES LIVRES -
« […] l’auteur écrit des lettres à une femme aimée qui n’est encore qu’un rêve. Il lui raconte ses périples en Amazonie, au Chili ou au Cambodge, et parle de son métier de comédien. Bernard Giraudeau évoque aussi le cancer qui l’a obligé à revoir ses priorités. "La maladie sans l’amour, c’est déjà la mort" pourrait ainsi être la conclusion de ces lettres bouleversantes. »
Thomas MalherDIRECT SOIR -
« Bernard Giraudeau se paie le luxe d’une écriture à contre-temps, souvent poétique, parfois lyrique ou romantique. […] Difficile à définir ou à appréhender, ce curieux roman est le roman d’un curieux. Et celui d’un amoureux éperdu de la vie. »
Renaud CzarnesLES ECHOS -
« Eprouver le monde n’est pas tenter de le régir, ne serait-ce qu’en pensée, c’est le constater pour mieux l’appréhender. Telle est la grande leçon portée par Cher amour, si leçon il y a. Rien de moins sûr, son auteur conserve cette élégance discrète qu’on lui connaît, cette humilité devant ce qui le dépasse. Et le monde nous dépasse tous. »Mathieu Lévy-Hardy
L’HUMANITE -
« Cher Amour est un livre écrit avec une grâce incroyable, une simplicité, une poésie puissantes. Du Cambodge à Richard III, de Djibouti aux femmes rencontrées, Giraudeau dessine une troublante géographie du cœur mêlée aux violences de la vie. »
Pierre VavasseurLE PARISIEN
CHERE MADAME T.
Ce qui suit vous est conté, madame T., ma chère, irremplaçable madame T., à vous et à nulle autre, à moins que vous ne souhaitiez qu’il en soit autrement. Je ne sais où vous serez, mais je devine déjà votre intérêt pour ces voyages, ces mots, ces aveux parfois. Peut-être vous mentirai-je un peu, mentir un peu c’est être très près de la vérité, mentir beaucoup serait m’en éloigner. Avec le temps l’espace entre vérités et mensonges se dissipe doucement et vous me pardonnerez si parfois j’ai repoussé cette frontière pour être au plus près de l’indicible. Je soupçonne votre sourire à certains passages, votre joue légèrement froissée, appuyée sur votre main, l’autre tournant lentement les pages, sans voracité, laissant un doigt sous la précédente comme si vous alliez la relire, mais que vous abandonnez pour la suivante. Je vous espère parfois jalouse, un peu mordue par les mots, mais jamais douloureuse. Je vous aime depuis si longtemps, depuis avant le début, voyez-vous. Ces récits sont des voyages au pays des hommes. Voyager, on n’en revient jamais. Je vous écris pour prolonger l’instant, en garder une trace, tordre le cou à la fugacité, à l’oubli, à l’“impermanence”, ceci sans succès bien sûr puisque c’est vouloir figer l’éphémère et j’aime l’éphémère, nul n’est parfait. Le prendrez-vous ce temps de me lire, pour me prolonger un peu en vous ?
A propos de temps, je me souviens d’un jour où nous regardions une montagne, une immense paroi sculptée, au pied de laquelle vivait un arbre millénaire, seul, enraciné dans les failles. Nous ne bougions pas, silencieux. Machinalement vous avez regardé votre montre et les secondes ridicules qui vous échappaient. Vous étiez revenue à la réalité de ce petit temps étriqué sans beauté, sans ailes, un temps qui soudain a heurté la roche, le tronc rugueux, et s’est désagrégé, inutile. Alors vous avez caché votre poignet, vous êtes revenue dans l’éternité et les secondes se sont évanouies comme flocons de neige sur la pierre chaude. J’ai pris votre main, j’ai frissonné.
Je ne vous écris pas ces voyages par nostalgie de l’exotisme, d’un ailleurs rédempteur, mais pour retenir des instants, des visages, des circonstances humaines et géographiques parce que là où le soleil se lève les hommes ont le même souci de vivre, de comprendre, de sourire à l’autre, d’effacer la souffrance et de donner un sens à leur existence. Les voir, les observer, les entendre est une richesse inouïe que nul ne conteste. Pourtant ce cavalier mongol en haut de la montagne, qui regarde le soleil se lever sur la vallée sans frontières, sait que le monde est là où il pose son regard et nulle part ailleurs. Il n’y a pas d’autres territoires que celui où tu poses ton regard, où la lumière, d’un doigt, te montre le chemin.
Le voyage est une aube qui n’en finit pas. Comme Jim Harrison, je trouve que c’est beau, l’aube, les aubes du monde, à Saint-Pétersbourg, au Kenya, au Mexique, partout, que ce soit avec l’éléphant qui boit, les usines qui fument, les Andes poudrées, Paris la brume derrière Belleville. C’est l’aube qui est belle parce qu’elle embellit. C’est l’annonce de l’éblouissement, la naissance de la vie incompréhensible. Tu regardes l’aube, mon amour, non, tu la vis, tu es en elle, tu t’abîmes pour renaître. Le bonheur du voyage, c’est de faire tout pour la première fois.
Vous riez parce que je vous devine, provocatrice, me proposant le voyage immobile, celui des guides touristiques, de la carte géographique, du livre proposé et qui devient alors le grand voyage, sans frontières des formes, libre de l’espace et du temps. Ce que l’imaginaire propose est plus libre, dites-vous, plus déraisonnable. Il peut prolonger la naissance du jour comme le coucher du soleil, c’est si bref la réalité, si éphémère. Comment retenir les regards et ce que le regard boit avidement. Celui qui visualise peut voyager de l’Arctique aux pentes du Kilimandjaro dans la seconde et tout ainsi, sans opacité, sans peur, sans départ ni retour glauque, tiède, avec un goût de nostalgie. Se déplacer dans le monde avec le monde en soi. Le voyage inaccompli de Pessoa, le plus beau des voyages. Peut-être, cher Fernando, mais si les yeux clos je regarde sur l’écran frontal le soleil se déshabiller lentement et me laisser dans des doigts verts et mauves, des cuisses pourpres, entre des seins de nacre éclatée, il me manquera la chair voyez-vous, la sensualité, le toucher, la morsure du soleil, le visage renversé sous la pluie, la lèvre au bord de la coupe ou sur d’autres lèvres, la peau sur la peau. Il me manquera le partage, l’émotion, le regard troublé, le rire, ce quelque chose au ventre qui vous bouffe avec bonheur et cette larme dans le coin de votre œil qui ne veut pas glisser sur votre joue. Même la réalité s’invente, elle est au-delà de votre imaginaire. Il en faut des voyages, des hasards, pour que le regard change. Mon caractère était une lame et j’avais la conscience ébréchée. Je voulais tout voir et je n’ai rien vu, ou si peu, jusqu’au jour où je vous ai imaginée. C’était au théâtre, territoire pour lequel j’ai une tendresse particulière, ce fut par hasard.
C’est fou le hasard ! C’est un drôle de phénomène, comme une présence qui vous trompe, vous ment, si vous n’êtes pas vigilant, s’il arrive comme ça sans crier gare, par hasard. Il vous fait croire qu’il est là, impromptu. Foutaises, il ne voyage pas au hasard, il sait. Ça l’amuse d’arriver à l’improviste et de laisser l’ignorant ignorer qui il est. Le hasard, c’est seulement son costume de théâtre, un déguisement. Il est bon acteur, il joue avec les crédules. Souvent il se lasse, perd patience et se transforme en destin, en fatalité, en coïncidence, en “c’est comme ça”. Parfois il disparaît et revient en “pas de chance”. Pour d’autres, ceux qui auront reconnu l’usurpateur, il n’est plus un hasard, alors, démasqué, il aura des égards, il se fera rare mais précis. Puis le regard et la conscience s’aiguisent et le hasard se déshabille.
Je l’ai démasqué alors qu’il me proposait avec malice de jouer dans une comédie. Je vous livre donc mes balbutiements à votre égard.
UN TROU DANS L’AIDE-MEMOIRE
Je suis dans une loge de théâtre, l’antichambre de la scène sur laquelle tout à l’heure je rejoindrai ma partenaire. Pour l’instant elle se maquille, rêve, raconte une histoire que j’écoute avec attention, vous délaissant pour sa voix. N’ayez crainte, je reviens vite vers vous et me penche avec bonheur sur votre absence. C’est un bonheur illusoire, éphémère, un manque, vous le comprendrez. Je dois être patient, mais c’est un mot qui n’appartient pas à mon vocabulaire, il est un peu le cousin de la sagesse et c’est une qualité qui m’évite. Parmi les voyages que je compte bien partager avec vous, il y a ceux, immobiles, du théâtre.
Je joue un séducteur un peu sot qui comptabilise ses conquêtes dans un carnet, un aide-mémoire qui le ravit et le conforte, quand un jour déboule dans le quotidien de ce collectionneur une femme qui va bouleverser ses certitudes, sa vie et un avenir qu’il croyait tracé.
Je trouvais cet homme plutôt ennuyeux, sans profondeur, mais j’aimais beaucoup le personnage de la femme que le metteur en scène ne souhaitait pas me confier, puisqu’il avait choisi Fanny Ardant. J’ai donc accepté de tomber amoureux. Ce Jean-Jacques un peu ridicule et qui se moque de lui-même vous amuserait beaucoup. Ses travers et sa lâcheté en font simplement un homme et les hommes vous amusent. L’essentiel est que cette femme soit belle, agaçante, étourdie, intelligente, pour que sa petite vie de séducteur soit foudroyée par l’amour. L’homme précis, méthodique en toutes choses et surtout dans les sentiments est soudain bousculé par le conflit entre la fantaisie et l’ordre, sujet fondamental pour l’auteur.
Pardon ? Ai-je été séduit par Fanny ? Il est difficile de ne pas l’être. Mais nous sommes au théâtre, madame. Pour que je tombe amoureux de mon personnage, c’est-à-dire de Jean-Jacques, il fallait que celui-ci soit terrassé par Suzanne, alias Fanny. Il en devenait touchant, délicat, drôle et attentif. Il acceptait soudain de fondre les certitudes et l’ordre qu’il avait établi. Il acceptait l’autre telle qu’elle était, l’amour avec toutes ses aspérités. C’est du théâtre bien entendu, mais seulement dans le raccourci des événements. Finalement ce personnage, dans son costume ordinaire, serait dans la vie parfaitement inintéressant s’il ne rencontrait pas l’auteur pour le mettre en page et l’amour que celui-ci lui impose. Il ne serait rien si le metteur en scène n’avait pas décidé de le mettre à la verticale avec un acteur pour mentor qui lui donnerait la vie. Il devient humain, tout simplement. Pygmalion eut besoin d’Aphrodite, j’ai besoin de vous, douce amie.
Suzanne, fantasque, apparemment libre, et que l’amour surprend, révèle un Jean-Jacques inattendu, un autre homme qui éclot enfin.
Soyez assez aimable pour ne pas me comparer à ce personnage. Jouer cette pièce au moment où je souhaite enfin vous écrire est probablement une bouffonnerie du hasard mais je m’en accommode comme d’une lumière dans la nuit.
L’Aide-mémoire est une comédie mais c’est un drame que je joue depuis quelques jours, alors que nous abordons les dernières de la saison.
La Comédie des Champs-Élysées est comble tous les soirs, c’est une chance inouïe, un miracle renouvelé. Il y a trois jours, alors que je tentais le vertige en explorant les bords de l’abîme, il m’est arrivé une drôle d’histoire qui fut pour moi une catastrophe et une cuisante leçon. Certains jeux sont des vols à haut risque et il y a une fin du monde pour l’acteur. C’est une illusion de croire qu’un comédien peut être en totale liberté. Il y a une ivresse dans l’extrême, il était tentant de se perdre, je l’ai fait, orgueil et vanité. On croit être l’unique manipulateur des situations et des mots et l’on ne voit pas la vague qui va nous engloutir. Ma jouissance était absolue et les rires furent cette vague. Fanny s’amusait, complice, me croyant indestructible. Après quelques voltes autour d’une valise que je tentais de remplir désespérément, me laissant aller à une fureur démesurée, il y eut un désordre dans la plongée, une désarticulation et j’ai perdu pied. Le précipice était au bout des mots et je n’avais plus de mots. J’ai chuté, j’ai eu un trou affreux, ce fut terrible. J’ai balbutié des syllabes, cherchant une phrase, n’importe laquelle accrochée à un sens. Mais plus rien n’avait de sens sinon le regard terrifié de ma partenaire. Après une éternité il y eut des toux de spectateurs, une petite agitation, un malaise. On a baissé le rideau. Les spectateurs ont applaudi, témoins d’un incident assez rare qui faisait pour eux l’exceptionnel de cette soirée et dont je n’étais pas fier. J’ai dû m’accrocher à des repères enfantins pour reprendre la pièce. J’ai eu très peur, mon amour. Tout se dérobait autour de moi. J’étais malade, honteux d’avoir glissé sur les planches par excès. C’était un cauchemar, une solitude. Chaque soir à l’approche de la scène fatidique, je commence à paniquer, je ne pense plus qu’à ça, au trou, à la faiblesse de ma mémoire. C’est ma tourmente.
C’est la première fois que je commençais réellement à m’amuser, à faire en sorte de ne pas savoir ce que j’allais dire, m’autorisant à inventer le texte écrit par l’auteur et à jongler avec les mots à ma guise. Trop peut-être. J’aime laisser la fantaisie me prendre la main et danser avec la folie jusqu’au tournis. C’est un piège, bien entendu, et le rire une chausse-trappe. Mais je ne suis pas raisonnable, je n’ai jamais été prudent, le faut-il sur une scène ? Non, mais on doit rester le maître et je n’ai pas su.
Pour la dernière, ce soir vous serez dans la salle, je l’ai décidé. Vous serez ma liberté retrouvée, ma rédemption peut-être.
Il en sera ainsi, madame, pour cette ultime représentation avant la tournée d’hiver.
JEAN-JACQUES [Hors de lui]
Je vais la foutre par la fenêtre, votre valise. Je vous avertis, si vous n’êtes pas partie dans trente secondes, je balance tout. Tant pis pour vous. Et je vous jette en robe de chambre dans l’escalier…
C’est là que l’acteur chut, mais ce soir, le précipice fut franchi avec beaucoup d’adresse. Merci Fanny, merci madame. Vous m’êtes indispensable.
Il y eut un dîner d’adieu, des rires, des compliments à noyer dans les verres et une tristesse étrange. Le bonheur parfois rend triste. Je ne vous ai pas vue, vous n’avez pas eu la patience de m’attendre, je le regrette.
Depuis quelques jours, je rêve de quitter le quai pour d’autres terres. Comme les chiens, je tourne en rond avant de trouver ma place, et je ne la trouve pas.
Le hasard se présente amicalement un soir.
Tu aimes l’aventure, me dit-il, voyager est ton chant.
Il y a une route qui traverse l’Amazonie, avec de grands cimetières.
Non merci. Cette forêt démesurée qui est le tombeau de Maufrais, Fawcett et de milliers d’autres, des curieux, des conquérants mais aussi des affamés, des assoiffés de pierres précieuses et de pépites ? Non. Je pille avec l’impatience de partager. J’aime filmer les visages, la lune, les champs de colza, le coquelicot perdu, la grâce, mais là-bas rien de tout ça, même la lune on ne peut pas la voir, ni les étoiles. C’est la forêt, la grande, celle du premier jour, l’enfer vert, semé de cathédrales ligneuses. Je n’ai aucune fascination pour cette destination, un eldorado épuisé. Et le producteur insiste : il y a des visages comme tu aimes, des visages d’enfants, d’hommes perdus, et des femmes, belles comme des orchidées qui pleurent en regardant le fleuve. Si l’imprévu génère du bonheur, un moment d’éternité, oui, mais pas si je dois finir amoureusement enlacé jusqu’à la mort par un anaconda. Quel est l’animal le plus dangereux de la jungle ? Le moustique. Ah !
A l’exemple de Conrad, je pointais mon doigt sur une carte, en disant j’irai là, mais jamais l’index n’était venu caresser cette Amérique, aucun rêve amazonien n’avait jamais troublé mon sommeil. Je suis tout de même curieux alors j’ai commencé par lire ceux qui, comme moi, mais plus illustres, avaient essayé d’écrire au monde.
Le Portugais Pedro Alvarez Cabral s’était embarqué à
[Lisbonne
En l’année 1500
Pour se rendre dans les Indes orientales
Des vents contraires le portèrent vers l’ouest
Et le Brésil fut découvert.
Un peu court. Blaise Cendrars avait ajouté quelques vers sur la chaleur, un papillon, deux Allemandes et un beau poème “botanique” sur l’araucaria. Je ne recopie pas.
Qui m’a conseillé de lire Ecuador de Henri Michaux ? Il n’a trouvé qu’un intérêt très mitigé à cette partie du monde. Il dit que les Indiens n’avaient rien à lui dire et que lui n’avait rien à dire aux Indiens, qu’il les déteste. Bon, il devait être fatigué.
Rends-toi mon cœur
Nous avons assez lutté
Et que ma vie s’arrête,
On n’a pas été des lâches,
On a fait ce qu’on a pu.
Pas de quoi s’enthousiasmer, mais il avait du courage, le monsieur poète, et son humour, féroce parfois, donne envie de se mettre au travail. Qui me parla de La Condamine, de Humboldt, mais surtout de Bonpland le Rochelais ?
Il y a peu, un jour d’encombrement parisien, je suis venu me réfugier chez un libraire. Le hasard me plongea le nez dans le beau et grand livre de Meunier Le Chant du Silbaco, la bible amazonienne. A suivre, il y eut le Géant blessé de Gheerbrant, puis dans un guide une citation de Ferreira de Castro inconnu de moi, qu’il me pardonne.
L’Amazonie était un monde à part, une terre embryonnaire, énigmatique et tyrannique, faite pour étonner, pour détraquer le cerveau et les nerfs. Dans cette forêt monstrueuse, l’arbre n’existe pas : ce terme était concrétisé par l’enchevêtrement végétal, dément, vorace. L’esprit, le cœur, les sentiments s’égaraient. On était victime d’une chose affamée qui vous rongeait l’âme. Et la forêt vierge montait étroitement la garde autour des victimes perdues dans son immensité, silencieuse, impénétrable… emprisonnant les hommes, les ravalant au rang d’esclaves, les tenant.
Ce fut une révélation. C’était magnifique, envoûtant, je prenais le risque d’être déçu et je répondis “oui” au “alors ?” du producteur. L’Aide-mémoire était dans l’oubli, Fanny je ne sais où, et je m’impatientais de partir à la conquête de ces morceaux géographiques, comme dit Joseph qui avait du goût pour la balade, ces bouts de vérités qui seraient miennes dans ce pays de l’eldorado et des légendes.
Toi madame tu restes en France, et pourtant je t’emmène en Amazonie. Là-bas rien ne débouche nulle part,
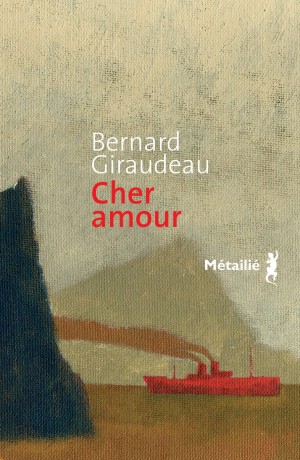




-100x150.jpg)