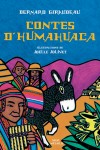Bernard Giraudeau nous embarque, au fil des amours de ses héros, de l'Afrique à l'Amérique du Sud, à la recherche de cet inconnu qui toujours fascine, avec un don irrésistible pour dire le clair-osbcur des sentiments. Son regard précis s'exprime dans une prose drue, nette, crue et poétique à la fois qui échappe à toute nostalgie.
-
« Un roman qui même la fraternité à l’aventure, un vibrant hommage à la vie et à l’amour des femmes. »BIEN DANS MA VIE -
« Goûter chaque moment, le transmettre par l’image et les mots, cet homme-là n’est pas un survivant mais un hédoniste qui fait partager ses bonheurs. »
Christine FerniotLIRE -
« Dans un roman éblouissant, cet amoureux des voyages nous emmène à la rencontre d’êtres exceptionnels… Une œuvre émouvante qui dévoile l’immense finesse de son regard. »
Brigitte KernelFEMME ACTUELLE -
« Avec [Bernard Giraudeau], on s’embarque dans une poésie des douleurs et des excès. Dans une marche hésitante vers la rédemption et la paix du cœur. C’est écrit avec une délicatesse rare. Il n’y a pas d’âge pour grandir. »
Xavier HoussinMARIANNE -
« Roman-récit qui tourne autour du monde et vous accroche au cœur de magnifiques portraits, tisse en guirlandes des amours cueillies sous différentes latitudes. »
Pierre PélotTEMOIGNAGE CHRETIEN -
« Giraudeau fait preuve d’une sensibilité, d’une justesse, d’un art du portrait qui confine à la beauté. Son style "au long cours", loin des clichés, en devient porteur, dépaysant, singulier. »
Marion RuggieriELLE -
« Pas de nostalgie dans cette écriture foisonnante qui cherche, aiguillonnée par la maladie, à tout embrasser d’un même regard : ce monde parcouru en tous sens, ces femmes aimées, ces odeurs, ces goûts. »
Violaine de MontclosLE POINT -
« Ce roman frappe, une fois encore, par son énergie, le tranchant de son humanité, il révèle une sensibilité à fleur de peau et un rare talent pour les miniatures. »
Michel AbescatTELERAMA -
« […] un excellent livre, plein de bruit, de fureur, de révolte, de cette tendresse feutrée que l'on camoufle sous une apparente rudesse. Une belle confession qui permet à Giraudeau de croiser la voie de ses idoles, Conrad, Kent, Stevenson ou Kerouac. »
François BusnelL’EXPRESS -
« La chronique vagabonde d'une existence où les femmes ressemblent à des continents, et les pays lointains, à des corps de femmes parfumés aux essences florales. »
Jérôme GarcinLE NOUVEL OBSERVATEUR -
« En véritable conteur, Giraudeau a su créer un univers, une douce atmosphère nostalgique mais pas triste. Ce n’est pas un acteur qui écrit, c’est un vrai écrivain. »
Mahammed AïssaouiLE FIGARO LITTERAIRE -
« L’Afrique, Madagascar, la Nouvelle-Zélande, l’Amérique du Sud… Les conquêtes littéraires de Bernard Giraudeau ont un parfum enivrant de bout du monde. »
Hubert LizéLE PARISIEN -
« Bernard Giraudeau publie un roman très personnel, nourri de rencontres, cherchant avec modestie à fixer le monde. »
Vanessa PostecLA CROIX -
« Entre prose et poésie, construit de mille récits, comme autant de nouvelles qui s’entrecroisent, ce roman frappe surtout par une écriture énergique et musicale, qui montre l’humanité de cet artiste aux yeux bleu lagon, toujours fidèle aux mots. »
Maud VergnolL’HUMANITE -
« De magnifiques histoires qui invitent les terriens que nous sommes à rêver d'horizons maritimes. »
Emilie GrangerayLE MONDE
Je peux voir la canopée comme des vagues immobiles auxquelles seul le vent de la montagne donne une vie de mer sombre. Il traîne des brumes alanguies que le soleil levant finit toujours par enflammer. Au-delà il y a un grand fleuve et bien au-delà la mer, la vraie, l’infinie, qui se dessine parfois comme un trait de lumière pour souligner l’indéfini du ciel. J’aime cet endroit comme une escale de paix. Je suis un égaré ayant décidé de se poser, de rester là dans chaque instant des souffles. J’écoute l’oiseau, un chant sur la page de silence. A la fin du jour il y a celui des voix de la vallée, isolées comme des notes échappées. J’apprends l’attente, celle de l’instant, celle de la pluie, des jours à venir, de la nuit, de la première étoile, celle du feu pour les repas et pour réchauffer les soirs. J’attends sans impatience, en vivant l’instant comme une éternité. Ajouté à ce bonheur, il y a l’inattendu de cette vie là-haut, les coups de vent soudains qui annoncent l’orage. Il y a alors une plainte rugueuse des écorces blessées, un bavardage précipité du feuillage sous les ailes sombres des nuages, et je me régale d’un poignard de feu, derrière les voiles d’eau. Il me semble que ces instants-là ne peuvent finir. Tous les soirs avant la noyade solaire, quand l’ombre du petit sycomore s’étire en géant, je m’assois sur le tronc couché qui barre le sentier. J’ai alors, comme le veilleur, le sentiment de garder un territoire.
J’étais petit, assis sur le bord du lit, j’écoutais ce qu’on disait, que l’âme était plus importante que le corps, l’esprit aussi, enfin les deux. L’âme, l’esprit, c’était pareil, c’est ce qu’on disait. J’écoutais. C’est le corps qui meurt, pas l’âme ni l’esprit, disait Grand-mère. Le corps n’est qu’une enveloppe sans importance qui disparaît avec le temps mais l’âme est éternelle. Elle se balade dans l’univers. Là-haut, débarrassée de son corps, elle est la parfaite lumière. J’écoutais en regardant par la fenêtre Amélie qui avait treize ans et jouait avec sa petite sœur sur le trottoir. Elle était jolie avec son âme cachée dans son corps. Je ne savais pas si son âme était belle, parfaite, lumineuse. Je ne la voyais pas. Mais Amélie était pour moi ce qu’il y avait de plus beau dans l’univers. Son corps était parfait et elle était ma lumière. Elle avait un grand cou pour poser des baisers et des cheveux blonds, doux, dans lesquels parfois, quand elle voulait bien, je cachais mon visage. Ses yeux verts me donnaient des frissons et j’aimais comme elle me regardait en caressant ma joue. Elle ne marchait pas, elle dansait, elle glissait plutôt. Elle se balançait doucement comme un épi. Et quand mon père lui parlait, elle avait les joues coquelicot. Un jour que je faisais semblant de dormir, j’avais posé ma main sur sa cuisse. Elle était dure et chaude et j’avais ressenti dans le ventre une douleur qui faisait du bien. Grand-mère répétait : “C’est pour cela qu’il ne faut pas avoir peur de la mort, le corps n’est rien, il se dissout mais l’âme reste et nous nous retrouvons tous ensemble pour une ronde éternelle des âmes.”
J’écoutais sans rien lui dire. Je pensais seulement à ce corps contre lequel je ne pourrais plus me caresser, ce corps qui me laissait poser ma bouche sur sa chemise à l’endroit où ses seins poussaient. Ça fait chaud, disait-elle. Oui, ça faisait chaud. Elle riait. “Pourquoi tu pleures ? ” m’avait dit Grand-mère. “Pourquoi il pleure, ce gosse ?” Ma mère était entrée. “Pourquoi tu pleures ?” Qu’est-ce que j’aurais pu répondre ? Que je me fichais pas mal de l’âme d’Amélie, qu’elle était parfaite et que son âme ne lui arrivait pas à la cheville qui était la plus belle cheville du collège Pierre Loti ? Je pleurais. C’était un gros chagrin irrépressible. Je ne voulais pas imaginer que le corps d’Amélie puisse se dissoudre. Je ne le pouvais pas, elle était éternelle. J’ai rien dit de mal pourtant, disait grand-mère, et elle m’avait serré dans ses bras contre son gilet gris trop rêche. A travers mes larmes, je voyais la chevelure d’Amélie, ses reins qui se cambraient sous le poids de sa petite sœur. Elle se renversait comme une gerbe. Je les entendais rire. J’aurais voulu ne pas être contre la poitrine avachie de Grand-mère, contre son gilet gris, dans cette odeur indéfinissable des fins de vie. Elle allait se dissoudre, elle, j’en étais certain. Je mourais d’envie d’aller poser ma bouche sur les épaules brunes d’Amélie, de baiser son cou, d’enfouir enfin mon visage dans ses cheveux, de poser ma main sur sa cuisse chaude, tout garder d’elle et surtout ne pas laisser échapper la petite âme qui se cachait dans cette parfaite lumière qu’était Amélie. Amélie âme et lit.
C’est à cette époque, je crois, que j’ai eu fiévreusement envie d’écrire au monde, pas aux gens, non, au monde. “Cher monde…” J’ai plusieurs fois écrit avec application, sur mon cahier d’écolier, ce début prometteur d’une lettre dont je n’arrivais pas à synthétiser le contenu d’un sens qui m’échappait encore et ne me serait peut-être jamais révélé. C’était d’une grande naïveté mais je voulais écrire au monde. C’était un élan de juvénilité désarmante. Parfois, je me plantais dans le jardin de terre noire du marais à écouter les peupliers et les poules d’eau, ou bien sur les quais face au large avec un bon vent dans la gueule et là je récapitulais ce que j’allais lui écrire. J’en avais, des choses à lui dire. Cher monde… Une voix comme un coup de fusil finissait toujours par me demander ce que je faisais, à quoi je pensais, ma mère, un copain, la voisine. Je répondais : “Rien.” Je n’aurais jamais osé dire que je pensais au monde avec ce désir fou de lui écrire une lettre, une lettre de foi et d’amour. Qui aurait compris que je voulais les bras du soleil pour enlacer la terre et serrer le monde contre moi ? Je sentais bien déjà que c’était emphatique, même si je ne connaissais pas encore ce mot. Je devinais également l’inutilité de ce courrier sans adresse. A quoi tu penses ? A rien.
Viens déjeuner. Il y avait sur la table une lettre de mon père qui était en Algérie. Son monde à lui, c’était nous. Il fait quoi, papa ? La guerre ! La guerre à qui ? Maman était restée un instant dans le vide, elle se raccrocha à “ennemi”. Il fait la guerre à l’ennemi, voilà ! C’est qui, l’ennemi ? Heu… des gens qui veulent pas être français. Je fixais la lettre de papa avec son écriture appliquée, ronde, parfaite.
Plus tard, sur les glaces du Tronador, à la frontière du Chili et de l’Argentine, je regardais le soleil se lever sur la chaîne andine et la lune de l’autre côté qui se faisait aussi grosse que lui pour se poser sur le Pacifique. J’étais resté haletant, avec une haleine en cristaux, les crampons dans une neige éternelle. Là encore, j’avais voulu écrire au monde. Il était beau, nom de Dieu ! Alors, il fallait lui dire. On oublie toujours de dire qu’on aime.
Cher monde… Mais comment lui écrire avec des moufles de haute altitude ? Un bruit de sérac et une odeur de soufre nous avaient conseillé de décamper vers la vallée des hommes. Des pans de glace s’effondraient et le volcan allait peut-être se foutre en colère. J’avais décidé de sauver ma peau que la montagne avait en appétit et j’avais remis ma lettre à plus tard. Il y eut d’autres fois bien sûr, mais il y avait toujours un incident pour me détourner de cette relation épistolaire que je voulais entretenir avec le monde. C’était un tremblement de terre en Arménie, une inondation au Bangladesh, un massacre au Rwanda, la faim en Somalie, toujours quelque chose, suffisamment pour me faire oublier cette bonne résolution qui était d’écrire au monde. Cher monde… Un soir, un peu triste, j’ai même voulu écrire à l’humanité. Chère humanité… La feuille blanche me regardait en attendant la suite. Je devais faire la grimace. Elle était tétanisée.
Quelques années plus tard, j’ai revu Amélie. La différence d’âge était moindre, j’avais vingt ans, elle vingt-six. Tu me reconnais ? Bien sûr, me dit-elle. Nous avons pris un café. Je lui ai raconté ce jour où j’avais pleuré. Elle me regarda. C’était le même regard avec des yeux verts, à mourir. J’ai compris qu’elle voulait que je pose ma bouche sur sa poitrine, ma tête dans ses cheveux et mes mains sur ses cuisses. Je l’ai aimée comme un enfant, comme un homme, comme je n’ai jamais plus aimé. Amélie, lit de mon âme, lui avais-je dit. Elle avait ri. Elle s’est dissoute un jour dans une eau claire. C’était dans un cristal d’émeraude glacé. Elle repêchait des statuettes chinoises sur une épave, une jonque du XIVe siècle. J’ai gardé une petite figurine de jade et d’ivoire. Je la caresse dans ma poche.
J’ai continué à grandir sans elle, bien sûr, avec ce don qu’elle m’avait fait dès l’enfance de cette découverte sans cesse renouvelée de l’amour. Tout au long de ma vie j’ai aimé les nuques déliées, les femmes comme des gerbes et le secret des graines dans les épis. Elle m’a éveillé petit, et initié à vingt ans. Elle s’est prolongée en moi jusqu’à ce jour. J’ai gardé de l’enfance, et d’Amélie, ils sont liés, l’amour de l’inconnu à défricher, avec la peur au ventre comme une jouissance. Ce n’est pas l’amour de l’exotisme comme dit Le Clézio, les enfants n’ont pas ce vice. Non, c’est le bonheur immédiat, sensuel, d’une ruelle de village africain, ou andin, c’est de respirer des parfums étranges et parfois reconnus, humer comme l’étalon les vastes plaines, attaquer les pentes montagneuses sous les nuées, c’est la menthe sauvage au petit matin, le thym écrasé, l’herbe fraîche à peine fauchée. J’ai gardé ce plaisir à rejoindre aux premières lueurs les landes fumeuses, les bords de mer encore mauves abandonnés par les hordes humaines. J’aime les silhouettes des arbres, l’élégance des ramures au milieu des prairies, les ombres sur les dunes sahariennes, les villages flottants sur les lacs cambodgiens. Je donnerais toutes les suites du Carlton pour un bivouac et un feu de bois sec, pour de l’eau fraîche au creux des mains à faire ruisseler sur le torse nu, pour les frissons de bonheur aux premières lueurs. Rien n’effacera sur les bancs de l’école l’attente rêveuse du dimanche à venir avec la promesse d’une immersion dans les feuillages d’automne ou celle de se droguer aux premières odeurs, retrouver les copains aux foulards bleus pour tailler des bois verts et allumer des écorces.
Quel enfant n’a pas aimé trembler, la nuit sur les pentes herbeuses, à attendre le dahu, n’a pas chanté pour se donner du courage devant les monstres de l’imaginaire, vaincre la peur en marchant bravement vers les ombres ? Je jure que j’ai cru, une nuit, au débarquement des contrebandiers sur les plages de l’Atlantique, tapi dans un creux de silice envahi par les helycrisum, harcelé par les puces de mer. J’ai vu la barque déchirer les reflets de lune et glisser sur la vague jusqu’au pied d’un géant à l’accent russe. Des lampes torches balayaient furtivement les dunes à l’affût des gêneurs avec lesquels il n’y aurait pas eu de quartier. Sur les pieds nus des pirates l’écume était phosphorescente. Un Long John Silver donnait rudement des ordres et maniait un grand coutelas. Un type avec un bandeau tenait un fusil. Il scrutait les dunes en s’attardant dans notre direction, comme s’il avait reniflé de la chair à crabe encore vivante. Même si c’était de la jeunesse, nom de Dieu, il faudrait l’éliminer si elle montrait son nez. Grouillez-vous les gars, y’a du danger, crachait-il tout bas mais assez fort pour être entendu, y’a mon nez qui me dit qu’on est peut-être pas tout seuls cette nuit. Dimitri a repéré un campement de l’autre côté des dunes, des mouflets qu’il a dit. Si je les prends, je les noie comme des petits chats. Dans les herbes, on accrochait le sable comme on pouvait en suppliant la chance. Les forbans débarquaient les caisses avec des chuchotements inquiétants et chargeaient leur trésor dans une 4L tous feux éteints qui ressemblait à s’y méprendre à celle de notre chef. Une fois les pirates évanouis, le cœur battant, nous regagnions nos tentes avec un œil sur les arrières, en se promettant de venir au plus tôt percer la coque retournée sur le sable pour couper toute retraite aux bandits. Le lendemain soir on attaquait les affreux jojos avec une bravoure exemplaire, stimulée tout le jour par la bonne action à accomplir et une morale sans faille. Les enfants se ruaient comme un seul homme sur les pirates de théâtre et le scénario s’achevait sous l’avalanche des mômes et les fous rires des grands.
Aujourd’hui, j’ai la même excitation au pied d’une échelle de meunier comme celle de ma grand-mère qui conduisait au mystérieux grenier où s’entassaient les trésors inutiles. Il y avait là les secrets de la vie d’avant, des amours éteintes, l’empreinte des gestes oubliés sur les objets aimés, les odeurs mortes dans les particules de lumière. J’avais découvert un jour, derrière un coffre et dans les toiles d’araignées que j’avais écartées non sans répugnance, des photos en partie bouffées par les souris, des clichés délavés par l’oubli, jaunis par le soleil de la lucarne avec des parties effacées, blanches, et sur lesquels une jeune fille sérieuse, endimanchée, était assise dans un fauteuil de ferme, tenant un chapeau. Elle était jolie, un peu raide. Il lui manquait un bras et un peu de son chapeau. J’étais resté un long moment dans la paix du sanctuaire, à regarder le passé de cette future vieille dame. Je la bougeais doucement dans le mince faisceau de lumière, jusqu’à la deviner s’animer avec même un sourire qui m’aurait fait pleurer. Elle ressemblait de loin à Amélie, de très loin, mais un peu tout de même. Je lui ai parlé comme jamais je n’avais osé parler à Amélie.
J’ai dormi avec elle et le lendemain j’ai demandé à ma grand-mère qui était cette fille que j’avais trouvée dans le grenier. Elle regarda le portrait avec un sourire triste. C’est moi, mon petit. Je restai sans voix en regardant stupidement l’aberration, ce qu’elle prit pour une stupéfaction admirative. Cette jeune fille qui aurait pu être Amélie avait joué elle aussi, avec ses petits seins nus qui frémissaient sous la blouse, qui sautaient pour la marelle, avec ses cheveux qui caressaient son cou, ses cuisses chaudes et cette odeur de menthe. Grand-mère était devenue une vieille femme, avec des gilets rêches, une odeur aigre et des moustaches qui me faisaient chaque fois hésiter à l’embrasser. C’était terrible, j’imaginais qu’Amélie deviendrait cela elle aussi, plus tard bien sûr, beaucoup plus tard, mais quand même. Je venais de dormir avec une jeune fille qui était ma grand-mère. J’étais horrifié. L’enfance a le mérite sublime de rester seulement curieuse de la vie. Elle en ressent magnifiquement la beauté et toute déception est un immense chagrin. Pourquoi tu pleures ? Pourquoi il pleure, ce gosse ? Allez dire la vérité… Je me suis sauvé au fond du jardin dans le cabanon, là où je me réfugiais pour gagner secrètement le chemin de glaise humide, entre les orties, qui conduisait à la forêt interdite, au ruisseau noir sous les frondaisons, au marais où s’enlisaient à jamais les enfants désobéissants. Quel délice que la désobéissance…
Qui m’a appris l’obéissance en vieillissant pour satisfaire le regard des autres ? Je veux être désobéissant et braver la raison. N’essuyez pas mon front où perle la sueur et laissez mes vêtements coller à la peau dans la nuit tropicale. N’éteignez pas les feux de racines séchées, j’aime la fumée âcre. Laissez-moi déchirer mes semelles sur la lave noire des volcans, peiner avec bonheur dans les poussières de lune d’Atacama et les éclats de mica des terres brûlées. Venez sur les sentiers des tribus ifugaos dans l’humidité verte, jusque sous les pilotis des cases. Nous resterons avec les visages froissés des vieux silencieux à écouter l’insupportable coq philippin. Je retournerai pour une caresse amoureuse poser ma main sur le rocher jusqu’à l’aspérité salvatrice pour me hisser au sommet et regarder le monde. Je n’ai pas changé, je suis passé de l’univers de l’enfance à celui des hommes avec les mêmes règles, la même curiosité. J’étais fasciné par le sillage de la barque dans les canaux sombres des marais, je l’ai été plus tard, sur l’océan, par celui des cargos. Rien ne peut me faire oublier les nuits à la passerelle avec la musique des ordres murmurés à deviner la proue fendre le bleu sombre.
Mais tout cela ne serait rien s’il n’y avait pas eu, dans mon enfance, en bas dans la cour, la vie comme un épi, une énergie claire, une proposition d’amour avec un rire qui était la musique des anges. Je ne savais pas ce qu’était un ange mais je l’imaginais ainsi, un ange avec des yeux verts, des seins comme des oiseaux et des chevilles à caresser infiniment, un ange qui ne serait jamais comme ma grand-mère, juré. Tout cela ne serait rien si une Amélie ne passait pas un jour sur votre chemin, si vous ne cherchiez pas à voir dans le village de terre rouge les reins sanglés d’une femme, à surprendre le geste en orbe qui cueille un fruit ou le regard échappé d’un voile, si au milieu des enfants qui jouent il n’y avait une jeune fille qu’un petit garçon assis sur une pierre couve des yeux comme le plus précieux trésor de l’univers. Je n’ai cessé de voyager pour tenter de deviner son regard et filmer le monde en elle et autour d’elle. Elle était la vie et mon enfance. Filmer, voilà ce que j’ai voulu faire, pour piller, pour ne rien perdre, pour retenir l’enfance, pour garder quelque chose du regard des hommes et de l’instant.
C’était naïf et présomptueux, comme de cueillir sous la tuile déplacée le rayon de soleil avec la main et le glisser entre les pages d’un livre. Croire que je pouvais figer le moment, retenir l’authenticité d’un visage, d’un acte, était dérisoire même si parfois j’avais tissé de belles histoires, mais elles n’étaient que des histoires, des contes, des esquisses de vie. Je n’avais pris que des papillons qui perdaient leur pollen dans les mailles du filet en attendant l’épingle du collectionneur. J’épinglais des instants. J’ai aimé faire cela mais je n’ai regardé le monde que dans l’étroite fenêtre de mon appareil. J’ai aimé tricher avec le vécu, j’ai inventé, recousu, sculpté autrement la réalité proposée. J’ai occulté une part de l’essentiel. J’ai filmé l’instant sans le vivre jamais. J’avais peur de le perdre.
J’étais témoin. Difficile de mettre le cœur en image. Pourtant, c’était cela aussi, parfois, la poésie, l’autre regard, le jeu des mots, des assemblages qui étaient le sens même. J’avais voyagé trop vite, dévoré le monde avec voracité, avec la peur de n’avoir jamais le temps. Le temps de quoi ? Là où je suis, j’ai le temps, je l’ai pris et je le laisse filer à son rythme à lui, tardivement je l’admets, mais il m’a fallu tout ce temps. Alors que je me noyais déjà dans la précipitation avec une frénésie inquiétante, Amélie m’avait raconté, comme à un enfant buté, l’histoire du temps enchaîné. Elle avait écrit cela quand elle donnait des cours aux enfants turbulents.
“Un jour, l’homme a attaché le temps à une chaîne. Il le mit dans sa poche en le consultant de temps en temps. De temps en temps. Puis il voulut le temps enchaîné à son poignet, croyant ainsi l’apprivoiser et le dominer. Mais c’est le temps qui enchaîna l’homme. Il oublia de lire les ombres, de reconnaître les signes. Il désapprit ce que le soleil lui avait enseigné. C’est ainsi qu’il fut pri-sonnier du temps. L’homme, autrefois, le prenait quand il le souhaitait. Le temps était là à attendre. Il était à prendre. L’homme le regardait. Il avait le temps et le temps était libre. L’homme était libre du temps et le temps était libre des hommes. Mais le temps ainsi attaché à son poignet, enfermé dans les horloges, se mit à tourner en rond comme dans une cage. On lui mit des chiffres pour ne pas le perdre. Il ne fallait pas perdre de temps. C’est ce que l’homme croyait.
Il finit par courir désespérément après lui, celui, bien sûr, qu’il avait enchaîné. L’autre n’avait pas bougé, il était toujours là à attendre et il voyait l’homme passer devant lui en courant sans le regarder, sans s’arrêter pour tenter de le voir puisqu’il avait les yeux fixés sur son poignet. Il poursuivait l’autre temps, celui qu’il avait inventé, un temps aveugle, cruel, remplaçable, un monstre enragé, virtuel, qui finit par le tuer. C’est ainsi que l’homme est devenu mortel. Avant, il s’endormait pour mourir en prenant le temps, se laissant bercer par lui. C’était un dernier mariage. Sachant que le temps était immortel, il partait avec lui sans frayeur, de l’autre côté de la vie.”
J’avais souri, amusé. Aujourd’hui, là où je suis, j’ai le même sourire et je t’aime pour cela aussi, mon amour. Je voudrais que tu voies cette lumière dorée sur les graminées. J’ai ramassé un fossile, un coquillage mystérieux que la mer a laissé il y a des millions d’années. Maintenant, j’ai du temps pour monter les silences de ce film, du temps pour choisir les images et ne rien regretter, jamais. Je tuerai la nostalgie, je raconterai des histoires, voilà tout.
Je m’appelle Marc Austère, comme l’écrivain avec la différence d’un accent très grave et d’un e final. Aucune similitude, donc, avec le scénariste de Smoke. Je suis fier de m’appeler Austère, accent grave er-eu… parce que la rime riche qui vient immédiatement aux poètes est “mystère”. Un après-midi de somnolence, à l’école primaire, suite à une interrogation au tableau dans une matière que j’avais du mal à digérer – la chimie – et à propos d’une formule avec laquelle je me battais sans succès, mon instituteur avait fait rire la classe avec : “La chimie pour Austère, c’est vraiment la galère.” Bien que la rime fût pauvre j’avais ri aussi, j’ai beaucoup d’humour…
La fois suivante, sur une autre formule, au moment où la classe allait poursuivre en chœur : “… c’est la galère”, le joyeux enseignant avait devancé les élèves en enchaînant : “La chimie pour Austère, c’est vraiment un mystère.” Ça m’avait enchanté, cet homme était vraiment formidable. A la récré, on m’appelait Marc Mystère, j’étais ravi, ce pouvait être le nom d’un héros de bande dessinée. Je signais donc M.M., comme Aime Aime. Mystère était celui de la chimie, et la chimie celui de la vie, et moi, Austère, j’étais en entier dans ce mystère de la vie, et je le suis encore. Il y eut cette chimie, cette merveilleuse alchimie parfois, mais aussi des mélanges incompatibles, des spectres, seuls visibles, d’amours idéalisés, des mirages d’amour, au hasard des rencontres.
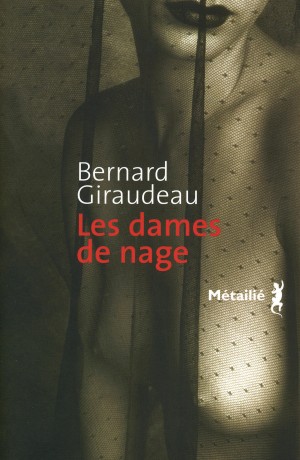




-100x150.jpg)