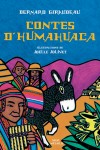Les hommes à terre sont tous un peu des marins perdus, immobiles ils voyagent vers d'indicibles aventures.
A Hô Chi Minh-Ville, Jean-Paul accompagne son père et découvre un inconnu qui n'a pas oublié sa guerre à Saïgon. A Brest, un marin raconte ses voyages à une toute jeune fille mais c'est elle qui partira. Billy, lui, n'est pas un marin comme les autres, le capitaine d'armes l'a immédiatement deviné, la dame de L'Iguaçu le sait. A Lisbonne, Diego l'Angolais, le naufragé, pêche sur les quais en attendant de reprendre la mer pour rêver ses amours dans la salle des machines. A La Rochelle, Pierre enterre Jeanne, une femme tendre qui connaissait la mélancolie des voyages, les bonheurs des retours de son Ange et l'éternité de l'amour.
Toutes ces vies racontées dans une prose précise, drue, crue, poétique et lyrique, émergent d'un imaginaire construit sur l'aventure, l'auteurs, le désir, la compassion et l'éternité éphémère que seule fait naître la mer.
Les Hommes à terre a été classé 15e Meilleur livre de l’année 2004 par la sélection RTL-LIRE
-
"Sous la belle gueule de Bernard Giraudeau, tout un monde pas toujours gai. Dans son récit épistolaire, "Le Marin à l'ancre", comme dans ce recueil de nouvelles, "Les Hommes à terre", un univers de solitude planté dans des ports du Portugal ou de France, peuplé d'hommes perdus restés à quai, de femmes douées pour les choses de la vie mais rattrapées par la mort, d'enfants rêveurs qui font du creux de leur lit des voyages extraordinaires. " Au départ, je ne suis pas un écrivain, mais un homme de thé?tre et de cinéma qui aime raconter des histoires qui emmènent vers un ailleurs. J'invente tout, sauf la mer, les femmes et les caractères humains, dont je colle des bouts ensemble. " La mer, présente à chaque page, est une passion qui remonte à loin, lorsque, dès 15 ans, Giraudeau fait l'école des mousses et, à 17 ans, son premier tour du monde sur le "Jeanne d'Arc". Quant aux femmes et à l'amour qu'elles donnent? >Depuis les premières, rencontrées dans des ports, elles l'occupent et l'obsèdent. " L'amour est un archipel composé de fragments. Il y en a d'heureux, mais jamais de sereins. " Toutes ses histoires d'amour ont maille à partir avec la mort. Diego l'Angolais raconte comment un mécano naufragé adore une femme qu'il n'a pas connu vivante ; dans "Une histoire simple", un loup de mer succombe aux charmes d'une lolita à qui il raconte ses voyages. Mais c'est elle qui finira par partir à l'aventure, et lui en mourra. "Tout homme de mon ?ge a connu cela : l'apparition d'une adolescente dont la sexualité est impossible à contenir. J'ai voulu que la mienne ne reste pas une inconnue. Elle devient ce que cet homme vieillissant n'a pu être : un grand voyageur."Comédien ou écrivain, Giraudeau navigue en eaux sombres dans la peau des autres.Isabelle LortholaryELLE
-
"Trois ans après le Marin à l'ancre, chroniques de voyages écrites sous forme de lettres à un ami disparu, le comédien-réalisateur-bourlingueur Bernard Giraudeau revient avec un recueil de cinq textes coiffé d'une épigraphe de Louis Brauquier : "J'aime les grands cargos arrêtés dans les rades, Qui ne se mêlent pas à la vie de la ville Et libèrent le soir des marins éperdus." Giraudeau et la mer : une histoire d'amour, une romance sans fin. Enfance à La Rochelle, adolescence à bord de la Jeanne d'Arc, puis, plus tard, réalisation du film Les Caprices d'un fleuve, rôle-titre dans Les Marins perdus d'après Jean-Claude Izzo? Homme pressé qui "court pour ne pas tomber", Giraudeau est aussi un excellent observateur. Quelqu'un qui sait accrocher son regard bleu aux décors, embrasser les êtres, deviner les destins, imaginer naufrages et occasions ratées. Voici, sous sa plume alerte et précise, Hô Chi Minh-Ville, La Rochelle, Brest, Lisbonne, Buenos Aires : des noms magiques et des paravents derrière les quels se consument des histoires d'amour impossibles, d'inutiles sacrifices, des secrets de famille touchants. Un père et un fils font l'ultime voyage vers l'Indochine. Entre eux, du temps accumulé, des silences lourds, des questions sans réponses. "Comment ôter la rouille sur les mots justes et clairs, sans déchirer, sans faire mal ? Elle est là, la souffrance. Comment marteler sans blessure ? Comment dire sans heurter ?" Ailleurs, un marin raconteur d'histoires inocule le virus de l'ailleurs, du voyage au long cours, à sa belle-fille. Cette Lise, qu'il surnomme "bébé koala", est comme une flamme : il veut bien s'y réchauffer mais redoute de s'y brûler. "Le marin apprend à se méfier des murmures, des frôlements, des baisers volés et des larmes à la fonte des cœurs au départ des navires. La mer enseigne aux marins des rêves que les ports assassinent." Giraudeau s'attarde donc sur les hommes à terre. Là où ils sont le plus vulnérable. Dans les villes, les rêves d'horizons lointains, de possible bonheur, s'égratignent et se brisent au contact du réel. Loin de l'eau, les marins tanguent sur le pavé, s'écorchent à la grisaille. Billy est de ceux-là. Sur son bateau, il ne redoute rien. "Il n'aimait pas la violence des hommes, il aimait celle de la mer, sentir que la mort pouvait à tout instant avoir un ultime caprice." Lors d'une escale à Buenos Aires, Billy trompe la mer avec une femme mystérieuse : "Elle ne fumait pas comme les autres phalènes et ne demanda pas à boire. Elle ne battait pas des ailes. Elle était posée, délicate." Comme une lame prête à trancher dans la vie? Plus loin, Giraudeau évoque Diego l'Angolais, "frère de la nuit", amoureux d'un fantôme cap-verdien. Il raconte la belle histoire de Jeanne et de son Ange, timide marin Breton, à La Rochelle. Il est à l'aise avec ses mots, comme il l'est avec ceux des autres, à la scène ou à l'écran. Il a le sens de la formule mais n'en abuse pas. Ne se regarde pas écrire. Ne répugne pas aux images crues. Ce qui touche le plus dans son univers, c'est une certaine mélancolie. Saudade suintant des ruelles de l'Alfama, dans une Lisbonne qu'il aime et dépeint jusque dans sa saleté, ses bruits, ses odeurs. L'un des narrateurs, double à peine déguisé, dit : "J'aime les errances attentives, les voyages éveillés. Je fouille la terre, derrière les ombres, les murs, au-delà du regard de cette femme qui fixe le temps suspendu." On est bien dans l'univers de Giraudeau. Comme on l'est chez l'Arturo Pérez-Reverte du Cimetière des bateaux sans nom. Des hommes fiers. Solitaires. Fraternels. Drôles. Après des chroniques, des nouvelles, des contes pour enfant, un scénario chilien, l'artiste Giraudeau n'a plus qu'un mot à ajouter à sa déjà belle panoplie : roman."Bruno CortyLE FIGARO LITTERAIRE
-
« Il vous embarque, Bernard Giraudeau, vous tire vers le large, vous serre dans ses filets. Avec un don irrésistible pour dire le clair-obscur de la vie et capter l'éternité des émotions. »Michel AbescatTELERAMA
Silence. Il réfléchit. Il se lève. Il ouvre un tiroir. Il prend quelques photos et les met dans sa poche. Il regarde si on ne l'épie pas. Qui donc l'épierait? Il sourit. Il est fatigué, malade. Il a un cancer du poumon. La bronchite chronique le fait tousser. Il part en voyage avec son fils. Il y a si longtemps. Il est heureux. Tous les deux en complices, comme pour une fugue. Le père et l'enfant. L'enfant a quarante ans. Il doit faire un film en Indochine, c'est le Viêtnam maintenant. Oui, il sait! C'est un film sur Saïgon aujourd'hui. Il sourit. Ça va faire drôle de revoir cette ville. Il a une bouffée, un sanglot étouffé. Son fils lui a dit: je t'emmène si tu veux! Il a n. J'aimerais bien. Il s'arrête. Silence. Non, elle ragasse à l'étage. Elle passe la serpillière, ici on since, dit-elle, c'est comme ça; après ce sera le repassage, le marché, les carreaux, les draps à plier. Elle s'enivre d'activité. Une énergie déconcertante. Quand le corps bouge, l'esprit se repose. Elle ne veut pas réfléchir sur sa vie. Elle ne sait pas, ne peut pas. Une enfance partagée entre la grand-mère et l'absence des parents. Une tendresse de vieux pour une enfance solitaire. C'était bien quand même. Et puis la guerre, la rencontre, le mariage sans savoir que la vie s'apprend un peu avant. Il faudrait le temps de déchiffrer l'autre, l'homme. Il faudrait de l'expérience pour apprivoiser les différences et se reconnaître enfin. Il faudrait. Maintenant, c'est trop tard. Alors elle ragasse, la vaisselle qu'on change de place, les casseroles qu'on bouscule. L'éponge est véloce, elle ne laisse aucune chance aux taches. Il grimace un sourire. Il a arrêté la chimio. Il n'a pas mal. Il est seulement fatigué, sans forces, sans désir. Alors, prolonger quoi? Une absence de vie? Seulement, depuis quelques jours, au fond du cœur ou du ventre, dans son dos parfois, revient quelque chose d'oublié, qu'il croyait à jamais éteint. Une petite décharge électrique, une délicieuse peur qui l'oblige à se plier un peu. C'est une douleur sublime, une excitation ressurgie de la jeunesse, un affole ment du sang. Il regarde la petite valise sur le canapé cassé du garage. La voiture reste dehors. C'est elle qui conduit. Elle n'y croit pas, à ce voyage. Elle a peur qu'il meure là-bas. C'est de la solitude dont elle ne veut pas. Il est trop fatigué pour ce voyage, ça va le tuer. Il a failli s'étouffer en entendant ça. C'est pas le voyage qui tue, c'est l'attente. Elle l'avait regardé sans trop comprendre. Le fils avait promis que tout irait bien. La petite valise est ouverte. Il y a déjà quelques chemises, un pantalon léger, des chaussettes, ses savates, deux ou trois caleçons donnés sans conviction. Elle n'y croit pas, elle le répète sans cesse. Elle fait et dit tout sans cesse d'ailleurs. C'est ça qui fatigue à la longue.
Elle s'envole parfois, elle oublie. Elle vit à côté depuis longtemps. Elle a tout de même à cœur de servir. C'est son rôle de femme. Il ne lui viendrait pas à l'idée de contester cette tâche. Cet homme fut son mari. Elle parle souvent au passé. Est-ce qu'on se connaît trop? Non, jamais. On tente de se reconnaître et on finit avec un inconnu. La petite valise est neuve avec des roulettes. C'est Jean-Paul qui l'a achetée. Elle est légère, suffisante pour quelques jours. Lui portera le reste si nécessaire. Il n'y a rien de vraiment nécessaire. Elle avait hoché la tête. Il faut ce qu'il faut. Il faut quoi? Ben ce qu'il faut! On trouve tout là-bas. Bien sûr. Il avait regardé par la fenêtre. Le soleil n'arrive plus qu'une heure par jour. Ils ont construit un immeuble en face. C'est curieux, cette absence de droit au soleil. C'était l'heure et le soleil s'était posé sur la toile cirée. Il avait cligné des yeux. Ce n'est pas ce qui manque, le soleil, là-bas. Il s'était absenté. C'est une force qu'il a, le père, de s'absenter. Une surdité soudaine. Elle s'énerve et lui est furieux qu'on le ramène là où il est. Il regarde toujours la petite valise comme un fragment d'une autre vie. C'est ça, le voyage, un fragment d'une autre vie. Il regarde autour de lui comme un aveugle. L'outillage, des caisses, des choses inutiles qu'il faudrait ranger un jour. Pourquoi? Il ouvre un tiroir de l'établi. Il coince ce bon Dieu de tiroir. C'était l'établi de son père. Il avait une petite menuiserie dans le marais, au bord du Mignon. C'est un établi en chêne et peuplier, avec un étau en acacia. Bon à brûler quand je ne serai plus là. Dans le tiroir, sous les clous, il soulève une planchette. Il y a une grosse enveloppe grise avec des fleurs de cambouis. Avant de la prendre, il regarde vers l'escalier qui monte à l'étage. Elle ragasse toujours. Il se décide et la glisse dans un petit porte-documents bleu entre deux chemises. Voilà. Il faudra penser aux affaires de toilette et aux médicaments. Elle s'en occupera bien sûr. Il faudra prendre aussi les lettres de Jean-Paul, celles de la fête des pères quand il était loin, en Indochine, en Algérie et après, ici. Il a toujours aimé les endroits où les guerres l'ont envoyé. Ce n'est pas la guerre qu'il aimait. Il aimait l'Allemagne, l'Indochine, l'Algérie, le Maroc. Ici, c'est bien mais sans couleur.
Un jour, il avait osé dire qu'il était heureux pendant la guerre. La liberté était mariée avec la mort. Il s'est évadé plusieurs fois des camps de prisonniers. C'était ça, le sens du mot liberté Pour la patrie? Ouh! Il y a de l'enfance à vouloir tenter, essayer, goûter. Il aimait se laisser éclabousser par le bonheur de n'être pas dans le troupeau, le cul dans l'herbe d'un fossé avec le bruit des bottes sur la route et lui qui grimaçait avec un rire étouffé. Qui pourrait comprendre qu'il n'a abandonné le déminage que pour rassurer sa famille? Il n'a pas peur d'avoir peur. Il a peur de la laideur, de la solitude lui aussi. Il a peur du non-sens. La vieillesse confirme la solitude de la mort. C'est cette peur-là qui fait mal, elle seule. Non, ce n'est pas la guerre qu'il aime. On n'apprivoise pas le bonheur à coups de canon. Mais là où il y a eu la guerre, il a été heureux. C'est dégueulasse de dire ça. Non, c'est dégueulasse que ce soit comme ça! Ça le ronge. Non, ce n'est pas la guerre qu'il aime, c'est la vie, le pari de vivre, la liberté remise en question, le compagnonnage. Il voudrait que tout le monde s'aime, que tout soit beau et l'eau claire pour toujours. Il a compris que c'était trop enfantin, ce rêva-là. Alors, il est plus déçu que les autres. Ça le fait pleurer en silence au fond du jardin. La mort d'un enfant le submerge jusqu'à la paralysie. Il en est ainsi pour le bonheur des autres. Simone aussi croyait que la vie était une succession de petits bonheurs, de rires, d'égratignures, de chagrins passagers, avec au loto de la chance la même vie que Sissi. La réalité s'est chargée d'une lourde besogne et les voilà côte à côte à tricoter l'ennui. Elle ne veut pas qu'on parle de ça. Elle fait l'idiote. Elle a du travail. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux qu on y fasse? C'est la vie. Non, ce n'est pas ça la vie, avait-il répondu. Ça lui tape dans la poitrine à n'en plus finir. Alors il tousse jusqu'à vomir. Un jour, un enfant pleurait. Pourquoi tu pleures? C'est pas ma vie, avait répondu le bout de chou.
Lucien avait souri, ébranlé. Ils avaient fait un tour de brouette pour oublier.
- Je vais te gêner là-bas.
- Mais non. Pendant deux jours, je t'abandonnerai pour aller dans le Nord faire des repérages. Comment tu te sens?
- Mieux, bien mieux. C'est drôle. Le plaisir, c'est mieux que la chimio. Trois semaines, c'est pas si long.
-Non, non c'est très bien. Je t'attends.
Le lendemain Simone l'accompagne à la gare. Ils passent par le port. La mer est basse. Il y a de la vase dans le canal au pied du quai Maubec. La grosse horloge est grise. Les mouettes ferment leurs gueules. Trois petits bateaux de pêche accrochés au quai se serrent pour ne pas basculer. Il aime bien les fanions des casiers, comme des flammes de couleur, les coques bleues et rouges. Il s'arrête devant le bassin à flots pour regarder un vieux ketch en acajou. Il n'a jamais navigué. Il aurait aimé. Son enfance a glissé sur les lentilles d'eau du marais, sans vagues. C'était loin, ce sillage noir derrière la pigouille de la mère. La grande perche de bois patinée par les mains terreuses s'enfonçait silencieusement. Des bulles remontaient à la surface et crevaient avec une odeur de chiotte. Il aimait ça. Les grands peupliers avaient le langage du vent, un bavardage qui berçait la somnolence de l'été. C'était loin.
- Il faut y aller. Tu vas rater le train.
- Des trains, on en rate beaucoup dans la vie.
- Qu'est-ce que tu racontes!
- Celui-là, je ne le raterai pas.
Sur le quai, ils se regardent. Au revoir. Des banalités. Il cherche dans le regard de Simone quelque chose pour le retenir. Il ne trouve pas, mais le cœur est gros. Elle pleure. Elle arrange le col de sa veste pour faire quelque chose, ne pas être inactive.
- Tu n'es pas fatigué?
- Non.
- Fais attention.
- A quoi?
- T'es bête.
Au moment du départ, ils se sourient. Il y a des éclats de tendresse à travers la vitre sale, des éclats dans les taches de lumière, furtifs, éphémères comme des papillons malades. Un geste, et le train glisse doucement pour ne pas déranger. Elle le suit du regard, bien après qu'il disparaisse. C'est un train qui n'en finit pas, un train qui n'en finit jamais. Puis elle repart en brodant sa vie à elle, celle qu'elle n'a pas eue à cause de la guerre et de l'absence d'amour. Elle avait su mettre un voile sur cette mauvaise peinture un peu trop brillante dont le vernis s'était écaillé jusqu'à n'être plus qu'un cadre. Simone vivait dans un cadre vide. Elle a horreur du vide, comme des silences ou de l'attente. C'est sans couleur. Elle est du présent, un présent sans condition, infini. Le passé est une rive qu'elle laisse derrière elle et le futur une île trop lointaine. Elle a peur de la stérilité des hypothèses. Elle avance sans aborder jamais. Alors elle a compensé avec ses enfants et une activité fébrile, obsessionnelle.
Lui, par la vitre, cherche dans ses souvenirs au-delà des hangars, des tours du port ou de l'église Saint-Sauveur. Retour dans le marais, la pêche aux anguilles, la chasse à la perdrix. Pas pour tuer, pour se promener. Il y a des parties effacées du temps, des fragments perdus du puzzle, des brumes capricieuses. Le reste est comme un archipel du désordre avec l'incertitude du vécu, entre le rêve et l'imaginaire. C'est un film qui a beaucoup souffert. Et maintenant il y a une petite peur qui lui grignote le ventre. Il regarde son marais disparaître. Il se souvient du prunier dans le jardin au bord de la rivière. Sa mère voulait y transporter le lit et mourir là. Avant l'hiver, disait-elle. Elle a fini dans un hospice chez les bonnes sœurs. Il imaginait la barque noire glissant entre les saules avec le lit à rouleaux, l'édredon et la couverture au crochet. Sa mère apaisée sur l'oreiller de duvet laissait les dentelles d'ombres et de lumières lui caresser le visage. Une fois sous l'arbre, autour du chevet on étalait les nappes pour le dernier banquet avec des rires d'enfants étouffés. Des gamins s'accrochaient aux branches et une pluie de fruits rouges et noirs fouettait les draps. Le jus pourpre s'étalait en grandes taches sombres. Hélène avait les paumes tournées vers le ciel avec de drôles de stigmates
-300x460.jpg)




-100x150.jpg)