Lorsque Jean Dimare débarque à Rio de Janeiro après avoir fui Marseille, le 1er janvier 1921, il découvre une ville extraordinaire qui le séduit par le foisonnement des sensations qu'elle éveille tandis que le regard d'un Indien croisé au hasard le met en garde. Recueilli par un oncle providentiel, il va s'inventer un passé et se créer un avenir. Devenu João Domar, il découvre l'innocente passion de sa tendre cousine, avant de conquérir la femme fatale qui lui fera oublier toute morale. Il grimpe jusqu'au sommet de ses rêves pour en dégringoler et devenir tour à tour bicheiro, chef de gang, trafiquant d'alcool, maquereau, avant que l'édification de la statue du Christ au sommet du Corcovado et l'amitié de l'Indien ne le mettent sur la voie de la rédemption. Naissance du samba, cérémonies de macumba, palais présidentiels ou favelas, João assistera et participera à la construction d'un Brésil métis au sein duquel il croisera les grands fondateurs de la musique brésilienne, l'architecte Landowski ou encore BIaise Cendrars, mais, surtout, le peuple de Rio, dans toute sa vitalité, ses cultures blanches, noires ou indiennes, sa saudade et son humanité.
Avec le premier tome de cette trilogie brésilienne, Jean-Paul Delfino nous offre une saga enlevée et flamboyante, fidèle à l'Histoire à travers des personnages attachants et hauts en couleur qui nous transmettent le souffle d'un Brésil vivant et chaleureux. Une invitation à l'aventure, au rêve et à la découverte.
Prix Amerigo Vespucci 2005
Prix littéraire Gabrielle d'Estrées 2005 (Chambray-lès-Tours)
-
Corcovado a été considéré par la presse brésilienne comme étant un " hymne d'amour à Rio ". Je dirai que c'est bien plus. Ce livre est un hymne à la vie, où qu'elle soit. Un exemple émouvant d'" anthropophagie culturelle ". Alors, si vous aimez les polars, lisez ceux signés Jean Paul -Delfino . Si vous voulez savoir plus sur le Brésil, lisez Delfino. Si vous aimez la musique brésilienne, lisez-le ! Et même si vous n'allez pas à Rio, lisez Corcovado, de Jean-Paul Delfino.Marilia De LarochePCA HEBDO
-
L'ambition de Joao rappelle les grands héros balzaciens : Lucien de Rubempré (Les Illusions perdues) ou Rastignac (Le Père Goriot).MUZE
-
"Une fresque superbe, parfois violent, qui fait découvrir l'âme du Brésil.PELERIN MAGAZINE
-
« «Quitter Marseille?» Ce docker sans histoires a eu le geste qu'il ne fallait pas sur la personne qu'il ne fallait pas [l'obligeant à s'embarquer pour le Brésil]. Le livre, à l'image de son héros, est aimanté par le Corcovado [...], un Christ de quarante mètres, dont la conception, la gestation [...] scanderont la vie de tout un pays et le parcours individuel et expiatoire du jeune Marseillais. Un axe imaginaire autour duquel tourne un récit qui peu à peu s'emballe, au rythme de musiques qui n'avaient pas encore conquis nos oreilles et nos cœurs. »Alain NicolasL'HUMANITE
1
Toutes les quatre secondes exactement, une goutte de pluie finissait de suinter du plafond et s'écrasait au pied du lit. Malgré l'étroitesse de la ruelle Jeanne d'Arc, des paquets d'orage venaient battre la fenêtre. De véritables gifles d'eau douce qui crépitaient sur la vitre dans un tempo anarchique, selon les caprices des bourrasques. Mais à l'intérieur, dans ce meublé livide du quartier de la Fosse, la chute d'eau se produisait implacablement, toutes les quatre secondes. Sans retard. Sans précipitation inutile. Un chronomètre qui tuait le temps avec méthode.
Dans une nouvelle claque de pluie, plus violente que les autres, Jean Dimare ouvrit les yeux. Un jour blafard pénétrait avec nausée la chambrette et tapissait de gris les murs spongieux, gorgés d'humidité, cloqués de lèpre. Au plafond, des auréoles noirâtres figuraient des lunes mortes, des étoiles avortées. Ses vêtements, une veste de grosse toile bleue, un pantalon en velours côtelé et une chemise élimée au col, traînaient leurs ombres au pied du lit, entassés sur une chaise.
Il inspira profondément. L'air visqueux sentait tout à la fois le tabac gris, les remugles du caniveau tout proche, l'absinthe, l'amertume de l'iode, et le rance des plâtres et des poutres en train de pourrir par plaques entières. L'odeur âcre du sexe pratiqué avec violence, à la sauvage, flottait encore.
Jean Dimare tira sur sa poitrine la mince couverture de laine. Pendant que les gouttes continuaient à dépecer le temps, il songea à sa nuit. Une sale nuit de décembre, glaciale, qui avait même réussi à forcer tous les mendiants, clochards, vagabonds, galeux et pouilleux à déserter le quartier réservé de la Fosse et à aller tambouriner aux portes des hospices. Sans ce froid piquant, inhabituel en ce mois de décembre 1920, cette crasse des bas-fonds de Marseille n'aurait jamais quitté les abords du Vieux-Port. Ils étaient depuis toujours le ciment de la Fosse. Ils grouillaient dans cette plaie ouverte, mélange de maquereaux à la petite semaine, de putains en fin de course, de trafiquants en tout genre, d'arnaqueurs et de pandores qui ne connaissaient d'autre loi que celle de la rue. Le visage noirci par le soleil des quais, ils traquaient le pigeon, celui dont la bourse était pleine et qui ne demandait qu'à se faire plumer. Tout était bon pour les cueillir sur les débarcadères et les diriger dans cet écheveau de ruelles où des rades de misère fourmillaient de mangeuses d'hommes. Turques, Italiennes, Africaines, Espagnoles, Portugaises, Arabes, Chinoises égarées, Indiennes, filles perdues de tous les pays du monde, accoucheuses d'anges, méchantes comme la gale, truqueuses, voleuses, acariâtres, buveuses sans soif, sacs à foutre et à désespoir, broyées par la vie, laminées jusque dans leurs chairs, elles tapinaient avec un mélange de rage et de défaitisme, les pieds solidement ancrés dans la fange de la Fosse. Elles avaient oublié leur passé. L'avenir n'existait pas.
La plainte aiguë d'un gabian réussit à se frayer un espace dans l'orage qui crevait sur Marseille.
Jean Dimare se tourna sur le côté. Sous la lumière avare, il devina les formes rondes de Jacotte. C'était du moins le prénom qu'elle lui avait donné, juste après l'accident. Les cheveux crépus et emmêlés débordant en une balle de chanvre noir sur la couverture, elle dormait encore, un sourire aux lèvres. Il l'avait rencontrée la veille, vers dix-huit heures. Dans la grande salle éclairée au gaz du café Le Brûleur de Loups, elle était venue lui taper une cigarette alors qu'il avalait un rhum. Vêtue d'une robe de couleur rouge vif, un châle jaune sur les épaules, le visage maquillé à faire peur, Jacotte avait attendu qu'il lui roule une pincée de tabac. En guise de remerciement muet, elle s'était penchée en avant et lui avait laissé toucher du regard sa poitrine opulente et ferme, naturellement bronzée, qui semblait vivre de sa vie propre dans l'échancrure du corsage. Il l'avait alors invitée à prendre place à sa table.
Comme elle s'installait, le garçon, un grand escogriffe aux cheveux soigneusement plaqués en arrière à la Rudolf Valentino, la saisit au bras avec fermeté:
- Barre-toi. Et va tapiner à la Fosse, dans le quartier des roulures...
Visiblement aguerri à ce genre de pratiques, le bistroquet avait parlé fermement, mais d'une voix blanche, de façon à ce que la rare clientèle de cet établissement du quartier du Vieux-Port n'entendît rien. Le garçon avait de larges mains en battoirs et tordait le bras de la femme avec un plaisir évident. Les yeux de Jacotte s'emplirent instantanément de larmes. Jean Dimare se redressa. Le menton haut, l'oeil étincelant, il grinça sur le même ton:
-Présentez tout de suite des excuses à cette jeune femme...
- Qui t'es, toi? Un sale Rital ou un pourri d'Espagnol?
- Je suis français.
- Avec ton accent de métèque? Allez, cassez-vous tous les deux,. et sans faire d'embrouilles. Sinon, j'appelle les cognes.
Jean abandonna quelques sous sur le marbre de la table. Il enfila son béret, se dirigea vers la sortie. Tout aurait dû s'achever ainsi. Sans heurt. Mais le garçon, plus par cruauté que par bêtise, coinça soudain Jacotte dans le renfoncement d'un box et se mit à peloter ses fesses et ses seins, un gloussement gras dans la gorge. La putain de la Fosse poussa un cri strident. Au même instant, un violent coup de tonnerre éclata sur la ville. Les murs vibrèrent. Les flammes des lampes, dans les suspensions, firent trembler les ombres. Le garçon continua à palper à pleines mains les hanches et les seins de Jacotte, les yeux fixés sur Jean Dimare. Celui-ci sentit son sang d'Italien mêlé de Portugais bouillonner dans ses veines. En trois enjambées, il fut sur le serveur et lui asséna un violent coup de tête au niveau du thorax. L'homme partit en arrière dans une grimace de douleur. Les quelques clients entendirent alors la colonne vertébrale du garçon craquer net contre l'arête du comptoir. Un éclair d'acier qui frappe l'une des flèches d'un grand voilier sur le Vieux-Port. Et le corps qui s'affale, livide, brisé. La tête qui vient frapper le sol de tomettes rouge sang.
Un nouveau roulement de tonnerre, lugubre, recouvre le tintement de la clochette en cuivre de la porte d'entrée. Et les quelques clients qui se mettent à hurler à l'assassin, au meurtrier.
Mais Jean et Jacotte ne sont déjà plus là. Ils courent à perdre haleine, main dans la main, sur les larges trottoirs de la Canebière. La nuit finit de s'affaler sur Marseille. Dans les premières gouttes de pluie glacée qui cinglent leurs visages, ils remontent l'avenue, tranchant les rues perpendiculaires, évitant de justesse les voitures, les tramways, les carrioles, bousculant des passants et des chiens. Le souffle court, ils bifurquent brusquement sur leur gauche, dans un entrelacs de ruelles aveugles, et retournent vers le Vieux-Port par des chemins détournés, courant toujours plus vite, sans jamais se lâcher la main, et finissent enfin par plonger dans les artères noires de la Fosse où l'eau de pluie jaillit en cataractes, emportant sur son passage les souillures et les immondices du quartier réservé.
Quand les premiers sergents de ville arrivent au Brûleur de Loups, à l'instant précis où l'honorable docteur Grassin constate le décès, Jean chevauche déjà le corps doré de Jacotte, dans son meublé fétide, et se mêle à elle dans le glissement frénétique de leurs deux peaux trempées de sueur et de pluie. Elle sent l'écorce de citron. De ces petits citrons verts qui poussent sur les flancs des collines surplombant Menton. Il jouit en elle en même temps qu'un terrible grondement de tonnerre semble vouloir ouvrir la ville en deux.
Les gouttes continuaient à se succéder, au même rythme lancinant. Au plafond, l'eau formait une petite flaque luisante qui grossissait et finissait par accoucher d'une larme. Immanquablement, celle-ci se détachait et explosait avec un bruit sourd sur les carreaux disjoints du sol.
Du haut de ses vingt-trois ans, Jean Dimare ne se sentait pas l'âme d'un meurtrier. D'un assassin. Ces deux mots tournaient pourtant dans sa tête comme, les dimanches aux beaux jours, le grand Carrousel dans les jardins du palais Longchamp. Ni assassin, ni meurtrier. Tout cela n'était que des mots. C'était juste la faute à pas de chance.
Jacotte émit alors dans son sommeil un petit sifflement de bien-être. Il alluma un mégot de gris. À quoi pouvait-elle bien rêver, à cet instant précis? Tout ce qu'il savait d'elle, c'était son corps. Un ensemble généreux, qui se mouvait avec langueur sous les doigts. Jean se retourna et l'observa avec attention. Il y avait certainement longtemps qu'elle n'était plus une fille, mais une femme qui faisait de la retape un pis-aller, en attendant des jours meilleurs. Elles disaient toutes cela. Bientôt, elle finirait pourtant par lâcher l'amarre à ses rêves. Elle sécherait sur pied, se viderait de sa force. Claquerait sans l'ombre d'un doute dans l'un des estaminets graisseux de la Fosse, ou au coin d'une rue jonchée de déjections. Toutes les putains du quartier réservé crevaient jeunes. Toujours trop jeunes. De désespoir. De trop d'alcool. De syphilis. De trop d'amour donné.
Jacotte finirait ainsi. Puis, direction la fosse, la fosse commune, cette fois. Un drap. Et de la terre. Auparavant, elle aurait fait l'amour avec l'humanité entière, puisque toute l'humanité se retrouvait à Marseille.
Il n'était pas encore minuit quand, sans bruit, Jean Dimare se leva et s'habilla avec ses vêtements trempés. Avant de partir, il déposa deux fois le prix d'une passe sur la chaise. À la Fosse, tout se payait. Toujours. Et Noël approchait.
Le lendemain, la même pluie persistante continuait à dégoutter sur Marseille. Comme Jean l'avait prévu, la mort du serveur n'avait pas fait plus de trois lignes dans la rubrique des faits divers du Petit Marseillais. Ici, sous le regard bienveillant de Notre-Dame-de-la-Garde, on mourrait souvent de mort violente. Les rixes étaient légion, les coups de sang faciles. Pour un oui ou un non, on s étripait avec une lame, une dague, un cran d'arrêt, un katana chinois, voire un tesson de bouteille. On se lardait pour une femme, une pièce refusée sur la place des Tapeurs, une noce impayée, une promesse non tenue, un bout de rousse ou de haschich barboté, un regard de travers. Un morceau de pain ou un kil de rouge.
À six heures quinze, en descendant du tramway qui, tous les jours, l'emmenait de la Belle de Mai à la place de la Joliette, Jean Dimare avait l'esprit clair. Il pensait beaucoup plus au long corps ambré et fuselé de Jacotte qu'au cadavre, sans doute déjà enterré, du serveur. Après tout, il l'avait bien cherché, s'était-il dit une bonne fois pour toutes en quittant la Fosse, après sa nuit d'amour. Puis, il avait payé pour tous. Tous les autres. Ceux qui ne crachaient que du mépris aux visages des milliers d'hommes et de femmes qui avaient quitté leur pays pour mendier, à Marseille, une nouvelle patrie.
L'un des contremaitres toucha Jean Dimare à l'épaule, du bout de sa canne. Tous les jours, ou presque, Jean trouvait de l'embauche comme docker. De taille moyenne, trapu, solide, ne rechignant jamais à la besogne, il avait rapidement su séduire par son mutisme naturel et son respect de l'ordre établi. Respect du patronat, à qui il devait les vingt francs quotidiens, nécessaires à sa survie. Respect aussi des syndicats, sans qui il n'y avait pas d'embauche possible, et qui tenaient leurs bureaux sur le terre-plein de la Joliette, face à la toute-puissante Compagnie des Docks. Pour tous, Jean Dimare était un parfait aconier. Il buvait peu, ne jouait pas. Se battait rarement. Il avait gravi rapidement l'infernale échelle sociale des dockers et des hommes de peine. Après avoir pataugé dans l'huile de poissons et crevé ses poumons dans les immenses tas de houille venus de France, de Roumanie, de Pologne ou encore de Hongrie, il avait successivement été affecté au déchargement des sacs de chaux, de plâtre, de salpêtre, de blé. Et, enfin, à celui des caisses et des ballots, place que l'on réservait aux aristocrates des docks de Marseille.
Ce matin-là, un gros cargo tout pétaradant de suie et de vapeur, en provenance de Saïgon, entrait à l'accostage sur le môle D. Cette longue baleine d'acier noir, chargée jusqu'à la gueule, allait ouvrir ses entrailles à une armée d'aconiers qui, par la force des bras et des reins, des grues et des palans, grignoteraient sans fin son ventre chaud, jusqu'à ne plus laisser, sur les eaux sales du port, qu'une carcasse de tôle vide qu'il faudrait bourrer à nouveau de marchandises hétéroclites avant de la lâcher sur toutes les mers du globe.
Dans le froid et la pluie, Jean Dimare s'attela à la tâche. Vers la fin de la matinée, La Foudre, un bon papa bien tranquille que la Compagnie acceptait encore de faire travailler malgré ses cinquante-cinq ans passés, vint le rejoindre. Les contremaîtres avaient une absolue confiance en lui, tout comme les syndicats. Sec et noueux, le visage brûlé par trois coups de foudre qui n'avaient pas réussi à l'abattre, il était toujours au courant de tout, fouinait et furetait sans cesse, régulait la cadence des vols et des menus larcins sur les docks, de façon à maintenir au mieux une instable paix sociale entre les cols blancs de la Compagnie et les aconiers.
Attentif au ballet des palans, il posa à terre son guinchou, le crochet qui sert à attraper les filins soulevant les caisses, et s'approcha de Jean:
-Dis, petit, t'es au courant pour l'histoire du Brûleur de Loups?
Son accent sicilien râpait les mots comme une machine à carder la laine. Sans cesser de téter son mégot, il observait Jean Dimare par en dessous, son unique sourcil en bataille froncé. Sans attendre la réponse, La Foudre reprit à voix plus basse:
- Si par hasard tu savais qui a fait le coup, dis-lui quelque chose de ma part...
-Quoi?
- Dis-lui que le serveur, c'était un de la famille Talsimoki.
-Talsimoki? Vassilis Talsimoki?
- Exactement. Et dis-toi bien que c'était pas un petit serveur de rien du tout. La famille Talsimoki, elle a lancé une vendetta. Comme chez nous, le sang par le sang...
La Foudre cracha à terre. Avant de récupérer son guinchou et se remettre au travail, il lâcha, plus doucement encore:
- On est pays, petit. Siamo paese. Et celui qui a crevé le fils Talsimoki, il devait avoir une bonne raison. Là-dessus, j'ai rien àdire. Mais un jour ou l'autre, il risque de se retrouver avec le sourire berbère. Alors, si tu le vois, dis-lui qu'il vaut mieux qu'il parte. Loin. Quitter Marseille. Et plus jamais revenir. Mai più.
Le ventre noué, le corps glacé de sueur, Jean Dimare regarda le vieux s'éloigner d'un pas lourd dans les flaques et la boue. Puis il se retourna, d'instinct. Derrière lui, les dockers s'activaient ferme. Chaque jour, des nouveaux arrivaient, d'autres partaient. Marseille était une ville de passage. Ceux qui parvenaient à faire souche étaient rares. Ils s'accrochaient bec et ongle à cette chance. Ils défendaient leur territoire à la rage. Leur fils serait marseillais. Car un fils, pour tous ces apatrides, c'était l'avenir. Un commencement de racines. Et Jean avait tranché dans celles de la famille grecque des Talsimoki. il ne connaissait de celle-ci que la réputation sulfureuse du patriarche, Vassilis. Chaque fois qu'un mauvais coup faisait la une des journaux, les piliers de bars reparlaient invariablement de cette tribu, officiellement respectable et respectée.
Dans un nuage de vapeur, certains aconiers le fixèrent avec insistance, le regard vide. Contre une bonne somme, n'importe lequel d'entre eux l'aurait égorgé en toute discrétion dans un coin de hangar. Ils n'étaient plus que des bêtes de somme qui vidaient des norias de navires et de cargos de leurs chairs pour nourrir Marseille, et se nourrir eux. Si La Foudre était au courant, c'était que Jacotte avait dû parler. À cette heure-ci, toute la Fosse devait savoir. Et la famille Talsimoki ne tarderait pas à l'apprendre, elle aussi. À la pause, Jean Dimare serra furtivement La Foudre dans ses bras et lui raconta tout. Obéissant aux conseils du vieux, il ne termina pas sa journée. Sur ses gardes, la main étreignant fort dans sa poche une lame qui ne le quittait jamais, il abandonna les docks, remonta à pied à la Belle de Mai, récupéra le peu d'argent qu'il avait réussi à économiser, fit son baluchon et attendit la nuit pour rejoindre le port. Il savait que le Chile, un long-courrier de la Compagnie des messageries maritimes, appareillait le lendemain. Direction Buenos Aires, via Rio de Janeiro.
En attendant le lever du jour, il prit bien soin de ne jamais rester immobile, attablé à un bar ou assis sous un porche. Le béret enfoncé sur son crâne, il arpenta une dernière fois les rues de Marseille, sa ville, qu'il abandonnait pour sans doute ne plus jamais revenir. La Foudre avait promis d'envoyer le lendemain un câble à ses parents. Eux non plus, dans leur temps, n'avaient pas réussi à faire souche à Marseille. Comme lui, son père s'était échiné à la Joliette, pendant que sa mère avait commencé par faire les dattes avant de trouver à se placer dans un petit restaurant de la rue du Loisir. La guerre était venue. Quitte à crever de faim, ils étaient retournés finir leur vie dans le petit hameau du père, perdu du côté de Florence. Retourner chez les siens n'avait même pas effleuré la cervelle de Jean. Il savait que, là-bas, il n'y avait rien. Ni pain, ni travail. Juste des pierres à manger. Et Jean Dimare s'était juré de réussir.
Quand le soleil se décida enfin à diffuser un jour sale à la face de Marseille, il se trouvait sur la grande corniche surplombant la plage des Catalans. Accoudé à la rambarde, il s'accorda un court instant pour adresser une prière à Notre-Dame-de-la-Garde. Puis il se retourna vers la mer.
Rio de Janeiro était là. Elle l'attendait.
De l'autre côté du monde.
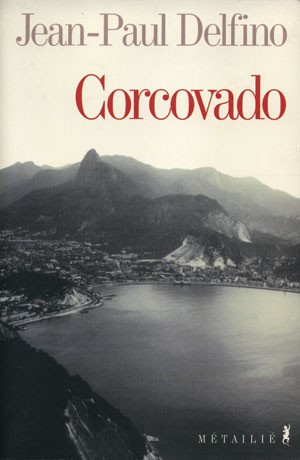



-100x150.jpg)




