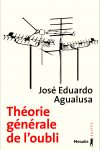Les morros et les favelas de Rio sont en flammes, la police, sous couvert de répression du trafic de drogue, a mitraillé une procession religieuse et tué des enfants. Le jour approche où cette guerre va descendre sur la ville et les beaux quartiers du bord de mer. Francisco, un ancien colonel de la sécurité en Angola, installé au Brésil pour fuir les pièges d’un amour féroce et les tourments de sa mémoire, prépare ce jour en vendant des armes. Un journaliste angolais plonge dans cet incendie à la recherche de réponses aux questions que peu de gens veulent bien se poser. Émeutes ou révolte d’esclaves ?
J.E. Agualusa crée dans une prose limpide des personnages inoubliables, Jararaca, le jeune chef de bande charismatique, Catiavala, le colonel à la voix de Nat King Cole, Euclides, le journaliste nain, Jacaré le rappeur fou de drogue, Anastacia la spécialiste de l’ayahuasca et des vagins dentés, Florzinha la belle vénéneuse, Monte le tortionnaire rédacteur de discours présidentiels…
Un grand roman littéraire dans lequel l’actualité rejoint les mythes.
-
, chronique de Benjamin BertonFLUCTUAT.NET
-
, chronique de Laurence de BourbonEVENE.FR
-
, Anita Fernandez, le 1er mars 2007Le Jardin d'OrphéeRADIO LIBERTAIRE
-
, Marlène Alves Perreira, le 1er mars 2007LusitaniaRADIO ALIGRE
-
, Joseph Mace-Scaron, le 27 janvier 2007Jeux d'épreuvesFRANCE CULTURE
-
« En inventant une guerre ethnique dans un pays loué pour son métissage, José Eduardo Agualusa joue au Boomerang avec l’Histoire. Un jeu subtil, coloré, digne d’un drame antique. »Dominique AussenacLE MATRICULE DES ANGES -
« Agualusa manie les mots avec adresse, finesse. Souvenirs, illusions et idéaux rencontrent dureté, violence et cynisme ; De la guerre civile en Angola à la politique fiction au Brésil, il n’y a qu’un pas. Vite franchit.
Julie CoutuCHRONIC’ART -
« Avec une écriture à la violence sourde, il porte la parole des exclus, des révoltés qui exigent la décolonisation du Brésil, et oblige à regarde en face l’horreur glacée de l’histoire. Il y a quelque chose d’envoûtant dans ce roman désabusé, dans lequel réconciliation et rédemption ne sont que de vains mots. »
Sandrine FillipettiLE MAGAZINE LITTERAIRE -
« Roman très cinématographique, esthétique et politique à la fois, auquel Rio offre sa fascinante géographie et ses sortilèges, La guerre des anges secoue violemment le mythe brésilien en écornant la belle image d’un métissage doux et fraternel où le racisme n’existerait pas et interroge sans ménagement l’identité créole du pays. »
Véronique RossignolLIVRES HEBDO -
« Dans cette peu conformiste fiction, les émeutiers déferlent de leurs taudis sur les beaux quartiers de Rio. L’espoir et la peur sur un rythme de samba. »
Claude Michel ClunyLE FIGARO LITTERAIRE
RIO DE JANEIRO, MORRO DA BARRIGA,
VINGT NOVEMBRE,
QUATRE HEURES DE L’APRÈS-MIDI.
Des hélicoptères tournent au loin dans le ciel, agitant les eaux mortes de la lagune. Francisco Palmares les regarde à travers les lentilles de ses jumelles. Il les compte: quatre… six… neuf. Il les voit fondre sur le Morro* da Barriga, vers l’endroit même où les derniers insurgés ont cherché refuge. A cette vitesse, ils seront bientôt au-dessus d’eux, en train de cracher du feu. Une frénésie désespérée d’ailes s’élève autour des appareils. Des bandes affolées de cormorans, d’aigrettes, de canards s’élancent contre les pales et le sang gicle et coule, soufflé par un vent violent, jusqu’à se répandre sur l’asphalte brûlant en une pluie de fin du monde. Sur la mer, sur l’étroit ruban d’océan que l’on aperçoit de là, l’ombre lourde d’un navire de guerre avance. Alors, un hurlement lumineux fend l’azur très pur de l’après-midi dans une courbe élégante et atteint le premier hélicoptère. L’explosion tord le ciel, l’étire, le contracte, aspire avec violence tout l’air, entraînant avec elle les deux hélicos qui viennent derrière. Un des appareils réussit à retrouver l’équilibre, mais l’autre plonge en faisant des tonneaux en direction des immeubles pointus en contrebas et se désintègre – et désintègre tout aux alentours – dans un grand et long tonnerre de flammes.
– Mon Dieu! Alors, c’était donc vrai. Vous avez des missiles…
Francisco reconnaît la voix. Il se retourne et aperçoit Jorge Velho, sa chemise blanche éclaboussée de sang, une AK-47 en bandoulière. Il le salue:
– Bienvenue dans le mauvais camp de la guerre, doutor.
L’autre sourit avec tristesse:
– Ce n’est pas le mauvais camp, colonel. C’est simplement le camp qui va perdre.
MORT ET RÉSURRECTION
D’EUCLIDES MATOSO DA CÂMARA
RIO DE JANEIRO, FOIRE DE SÃO CRISTOVÃO,
DIX-HUIT HEURES QUINZE MINUTES.
(un mort heureux)
Il l’avait aperçu bien des années auparavant, allongé dans un cercueil d’enfant, ses petites mains croisées sur la poitrine. Il lui avait paru être un mort heureux. Il le revoit maintenant avec le même air de fête que le jour de l’enterrement, le même nœud papillon couleur safran, le même costume léger et élégant en pur lin. La différence? Il est vivant. C’est impossible et pourtant il est vivant. Le colonel Francisco Palmares s’appuie à une table. Il tremble. Il avait insisté pour le veiller lui-même. Il avait versé des larmes authentiques sur son cercueil. Il l’avait accompagné à pied, tenant une des poignées de la bière, jusqu’au cimetière sur le Haut des Croix. S’il ne le trouve pas identique en tout point au petit homme qu’il a vu mort, qu’il a vu être mis en terre, c’est parce que depuis lors le temps a passé et qu’Euclides Matoso da Câmara a vieilli. Sa moustache, épaisse et incurvée, est grisonnante. Le haut de son front s’est dégarni. Le colonel cherche un endroit où se dissimuler. Il ne veut pas qu’Euclides le découvre. Que dit-on à un défunt, à un ancien défunt, pis encore, à un type que d’une certaine façon on a tué? Il se tapit derrière une baraque de gâteaux. De là, il arrive à épier l’autre. Que lui dira-t-il?
– Laisse-moi serrer tes vieux os!…
Macabre. Le mieux serait encore de l’inviter à boire un demi. Ils se souviendront de leur dernière conversation. Francisco Palmares n’a pas oublié cette rencontre. Il pourrait reproduire presque mot pour mot ce qu’ils s’étaient dit alors. Euclides n’avait pas voulu accepter ses conseils. Il lui avait offert une belle rascasse (prétexte ingénu pour donner le change aux petits gars du ministère) et un billet d’avion pour Lisbonne. Euclides l’avait reçu avec son habituelle insouciance empreinte d’affabilité, drapé dans une robe de chambre en soie:
– Un cadeau de Cunha, avait-il déclaré, il l’a fait faire à Singapour.
Le colonel se souvient même de cela. Il n’oublie jamais rien. La robe de chambre était rouge (“incandescente”, l’avait qualifiée le journaliste, qui aimait à se moquer de lui-même) et ornée d’un dragon crachant du feu. Le journaliste l’avait fait entrer, ils avaient bu une caipirinha*, parlé de dragons. Euclides avait déclaré que le mythe des dragons était un phénomène universel, lié au séjour des dinosaures sur terre:
– Les mythes ne sont rien d’autre que des souvenirs dégénérés, corrompus par le passage des siècles, d’événements très anciens.
Des dragons ils passèrent aux vampires:
– La légende des vampires, avait dit Euclides, a peut-être surgi à la suite d’une épidémie de rage. Les malades de la rage souffrent de photophobie, ils évitent la lumière, ils se cachent dans l’obscurité. En plus, ils attaquent à l’improviste, mordent et transmettent le mal de cette façon.
Et des vampires, comme s’ils répétaient une pièce de théâtre, ils s’acheminèrent vers le sujet de la réincarnation:
– Si tu pouvais avoir une nouvelle vie, lui demanda Francisco Palmares, qu’aimerais-tu être?
Le journaliste caressa sa grosse moustache. Une moustache à l’ancienne, de gentilhomme du XIXe siècle, épaisse et légèrement recourbée, en guidon de bicyclette. Il sourit:
– J’aimerais être simple comme les grenouilles dans les mares.
C’était un vers de Lídia do Carmo Ferreira. Le colonel l’avait lu deux ou trois jours plus tôt dans le Jornal de Angola:
Eu queria ser simples como as rãs nos charcos/ ver de longe partirem os barcos/numa manhã qualquer./Meu Deus, deixa-me repousar um pouco./ Quero inexistir-me sem sobressalto,/diluir-me no ar líquido que a manhã destila./Meu Deus, deixa-me ser a brisa que agita neste instante/as folhas das palmeiras,/a brisa que houve/e já não há.
J’aimerais être simple comme les grenouilles dans les mares/regarder de loin les bateaux prendre le large/un beau matin./Mon Dieu, laisse-moi me reposer un peu./Je veux inexister sans sursauter,/me diluer dans l’air liquide distillé par l’aube./Mon Dieu, laisse-moi être la brise qui agite en cet instant/le feuillage des palmiers,/la brise qui a soufflé/et qui déjà ne souffle plus.
Cela aurait pu être une prière. Plus tard, au cimetière, lorsque le cercueil fut mis en terre, Cunha de Menezes lui confia en pleurant comme un enfant que ç’avait été là les dernières paroles de son ami. Il l’avait trouvé dans la rue, à quelques mètres de chez lui, grièvement blessé. Il était mort dans ses bras. Francisco Palmares sortit de là soulagé. Il avait l’impression qu’on venait de lui arracher une dent sans anesthésie. Monte l’attendait dans la jeep.
– Tu en as mis du temps! dit-il. Tout s’est bien passé?
Le colonel ignora la question. Il finit par parler, mais ce qu’il dit ne ressemblait pas à une réponse:
– Pourquoi craindre la mort? La mort est juste une belle aventure.
Monte sourit:
– Peter Pan !
– Peter Pan ?! Non, non, je pensais à un type qui s’appelle Charles Frohman. Il voyageait à bord du Lusitânia, un paquebot de croisière anglais, coulé par un sous-marin allemand pendant la Première Guerre mondiale. Mille deux cents personnes ont perdu la vie. Frohman, un producteur de spectacles célèbre, a essayé d’encourager un groupe de passagers en criant cette phrase. On pense que ce furent ses dernières paroles.
Monte haussa les épaules:
– Peter Pan, j’en suis sûr, a dit la même chose.
Il faisait chaud, trop chaud, et l’air était lourd, chargé d’une odeur douceâtre de viande brûlée. Une odeur de chair humaine en train de griller. Ils approchèrent d’un groupe de jeunes gens aux cheveux noués de rubans rouges et armés de mitrailleuses. Les jeunes dansaient autour d’un brasier. L’un d’eux fit signe à la jeep de s’arrêter. Monte freina à proximité du brasier et alors seulement le jeune homme reconnut l’homme maigre et triste qui, bien que n’étant pas militaire, n’exhibant jamais ni documents ni galons, avait accès à tous les cabinets. Au ministère, on l’appelait dans un murmure le Grand Inquisiteur. Effrayé, il se mit au garde-à-vous:
– Salut, chef! cria-t-il. On est en train de brûler les bandits!
Francisco Palmares se souvint d’une image qu’il avait vue il y a longtemps dans une chapelle dans le nord du Portugal, représentant un groupe de pécheurs brûlant dans le feu de l’enfer. Certains levaient le visage, d’autres baissaient les yeux, mais tous semblaient indifférents à l’horreur. Les flammes leur mordaient-elles les chairs? On avait plutôt l’impression qu’ils étaient exposés à la brise fraîche du soir. On sentait peut-être une tristesse résignée sur ces visages. Aucun, toutefois, n’exprimait la peur et encore moins la souffrance. Les bandits présentaient une expression identique. Ils étaient morts, bien entendu, contrairement aux pécheurs ils étaient vraiment morts. Parfois, les flammes laissaient entrevoir des yeux ouverts, des mains tordues, mais aussitôt après elles s’élevaient dans une fulgurance féroce qui donnait l’impression que les morts avaient déjà disparu.
– Vous pouvez me retourner. Je suis bien grillé de ce côté-ci.
Une autre phrase célèbre. La dernière, d’après la légende, prononcée par saint Laurent, alors qu’il rôtissait au-dessus d’un brasier, sur l’ordre de l’empereur Valérien. L’empereur, ennemi des chrétiens, avait ordonné au saint de lui livrer les trésors de l’église. Saint Laurent avait répondu qu’il avait besoin d’un certain temps pour les réunir tous. Huit jours plus tard il se présenta à l’empereur en traînant à sa suite un groupe de mendiants:
– Voici les trésors de mon église.
Une belle histoire. Francisco l’avait entendue pour la première fois de la bouche de sa grand-mère, une aristocrate dévote de saint Laurent. Il s’en souvint et, incommodé, agita l’air de sa main droite, comme s’il réussissait ainsi à éloigner à la fois la pestilence, la chaleur, la peur et le fantôme de la vieille Violeta Rosa. Monte regarda sa montre:
– Quand ils se réveilleront en enfer, ils ne remarqueront même pas la différence.
Cette phrase agaça le colonel. Il prit un rouleau de billets de banque et le lança aux jeunes:
– Je ne sais pas comment vous supportez cette chaleur. Achetez-vous de la bière.
Il remarqua alors un entassement de corps à côté du brasier. Un des jeunes l’arrosait d’essence.
– Ce type là-bas, ce n’est pas le général Catiavala?
Monte suivit son geste du regard:
– Mais si! C’est ce bandit en personne! On raconte qu’il a acheté aux Irakiens un poison puissant et qu’il voulait l’introduire dans le réseau d’eau potable pour assassiner toute la population de Luanda.
Francisco Palmares en fut irrité:
– Des bobards! Moi, je sais, tout le monde sait, que c’est toi-même qui as inventé cette absurdité.
Il ouvrit la porte et sauta du véhicule:
– Cet homme est vivant! cria-t-il. Vous ne voyez pas que cet homme est vivant?!
Le garçon qui avait arrosé les corps d’essence sourit. Francisco aperçut ses dents magnifiques:
– Nous l’avons mal tué, chef, mais le feu finira le boulot…
Le colonel lui asséna un violent coup de pied, il arracha le général au tas de cadavres, le prit dans ses bras et le porta vers
la jeep.
– On va le déposer à l’hôpital militaire, ordonna-t-il, et ensuite on ira au ministère.
Monte haussa les épaules. Il savait qu’il était inutile de discuter avec Francisco. Ils s’arrêtèrent à l’hôpital, laissèrent le général aux urgences et se dirigèrent vers le bâtiment du ministère. Le colonel prit congé avec un signe de tête et alla directement dans son bureau. Il voulait communiquer lui-même la nouvelle au Vieux. Il composa un numéro secret, mais l’appel aboutit au ministère des Pêches. Il refit le numéro et un type quelconque prit l’appel en hurlant en lingala, pendant que derrière lui Papa Wemba chantait Maria Valência. Il dut refaire le numéro encore cinq fois. Finalement, la secrétaire personnelle du Président décrocha. Francisco alla droit au but:
– Ici le colonel Palmares. Dites au camarade président qu’Euclides Matoso da Câmara a été enterré aujourd’hui. J’ai assisté moi-même à l’enterrement.