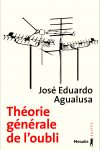À Luanda, à la fin de la guerre révolutionnaire, Félix, le bouquiniste albinos, crée de faux passés qu’il vend aux nouveaux riches qui ont assuré leur avenir. Il leur faut donc transmettre à leurs enfants un bon passé. Félix leur construit des généalogies flatteuses, des portraits d’ancêtres, des mémoires brillantes. Il en vit bien, jusqu’à l’arrivée d’un mystérieux étranger à la recherche d’une identité angolaise. Alors, dans un vertige, le passé envahit le présent et tout bascule.
La jeune photographe obsédée par la lumière retrouve, elle aussi, un passé, de même que le gecko qui rêve sur le mur, tout un réseau irrationnel se met en place et l’impossible arrive.
Satire féroce et pleine d’humour de la société angolaise, ce Marchand de passés est surtout une réflexion sur la construction de la mémoire et ses ambiguïtés.
-
« C'est une voix étrange qui raconte l'histoire de Felix Ventura, bouquiniste et albinos vivant à Luanda, en Angola [dans] ce roman qui est, entre autres, une histoire d'amour, un récit un rien fantastique, un polar onirique et une vraie satire politique, [...] à l'écriture éblouissante. »Michéle GazierTELERAMA
UN PETIT DIEU NOCTURNE
Je suis né dans cette maison et j’y ai grandi. Je n’en suis jamais sorti. Lorsque vient le soir j’appuie mon corps contre le cristal des fenêtres et je contemple le ciel. J’aime voir les flammes hautes, les nuages au galop et, au-dessus, les anges, des légions d’anges, qui secouent les étincelles de leur chevelure, en agitant leurs grandes ailes en flammes. C’est toujours le même spectacle. Tous les soirs, pourtant, je viens jusqu’ici, et je m’amuse et je m’émeus comme si je le voyais pour la première fois. La semaine dernière Félix Ventura est arrivé plus tôt et m’a surpris à rire pendant que là dehors, dans l’azur agité, un énorme nuage courait en rond, comme un chien, tentant d’éteindre le feu qui lui embrasait la queue.
– Ah, c’est incroyable! Tu ris?
L’étonnement de cette créature m’a irrité. J’ai eu peur mais je n’ai pas bougé un muscle. L’albinos a ôté ses lunettes noires, les a rangées dans la poche intérieure de sa veste, puis il l’a quittée, lentement, mélancoliquement, et accrochée avec soin sur le dossier d’une chaise. Il a choisi un disque de vinyle et l’a placé sur le vieil électrophone. Berceuse pour un fleuve, de Dora la Cigale, une chanteuse brésilienne qui, je pense, a connu quelque notoriété dans les années 70. Ce qui m’amène à le supposer, c’est la pochette du disque. C’est le dessin d’une femme en bikini, noire, jolie, avec de larges ailes de papillon attachées dans le dos. « Dora, la Cigale – Berceuse pour un fleuve – le grand succès du moment. Sa voix brûle dans l’air. Ces dernières semaines, c’est elle qui a été la bande-son du crépuscule. Je connais les paroles par cœur.
Rien ne passe, rien n’expire
Le passé est
un fleuve qui dort
et la mémoire un mensonge
aux mille formes.
Dorment les eaux du fleuve
et en mon sein dorment les jours
dorment
dorment les blessures
les agonies,
dorment.
Rien ne passe, rien n’expire,
Le passé est
un fleuve endormi
Il semble mort, c’est à peine s’il respire,
réveillez-le, et il bondira
dans un grand cri.
Félix a attendu que s’éteignent, en même temps que la lumière, les dernières notes du piano. Ensuite, presque sans faire de bruit, il a tourné l’un des canapés de façon à se trouver face à la fenêtre. Enfin il s’est assis. Il a allongé ses jambes avec un soupir:
– Popílas! Bon sang! Alors, Votre Bassesse rit? C’est une nouvelle extraordinaire…
Il m’a semblé abattu. Il a approché son visage et j’ai vu ses pupilles injectées de sang. Son souffle m’a enveloppé. Une chaleur aigre.
– Affreuse peau que la vôtre. Nous devons être de la même famille.
Je m’y attendais. Si j’avais pu parler, j’aurais été grossier. Mon appareil vocal, cependant, ne me permet que de rire. Alors, j’ai tenté de lui jeter à la figure un éclat de rire féroce, un bruit qui puisse l’effrayer, l’éloigner de là, mais je n’ai pu émettre qu’un faible gargouillis. Jusqu’à la semaine dernière l’albinos m’a toujours ignoré. Depuis ce moment-là, depuis qu’il m’a entendu rire, il arrive plus tôt. Il va à la cuisine, revient avec un verre de jus de papaye, s’assoit sur le canapé et partage avec moi la fête du couchant. Nous faisons la conversation. Ou plutôt, il parle, et moi j’écoute. Parfois je ris et cela lui suffit. Je crois que déjà un fil d’amitié nous lie. Les samedis soirs, pas tous, l’albinos arrive en tenant une fille par la main. Ce sont des filles sveltes, grandes et flexibles, aux jambes d’échassier. Certaines entrent craintivement, s’assoient au bord d’une chaise, en évitant de le regarder en face, incapables de dissimuler leur répulsion. Elles prennent un rafraîchissement, à petites gorgées, et ensuite elles se déshabillent en silence et l’attendent allongées sur le dos, les bras croisés sur leurs seins. D’autres, plus hardies, s’aventurent seules dans la maison, évaluant l’éclat de l’argenterie, la qualité des meubles, mais elles reviennent vite au salon, effarouchées par les piles de livres dans les chambres et les couloirs, et surtout par le regard sévère des messieurs en haut-de-forme et monocle, le regard moqueur des bessanganas, ces bourgeoises traditionnelles de Luanda et de Benguela, le regard ébahi des officiers de marine portugais dans leur uniforme d’apparat, le regard halluciné d’un prince congolais du XIXe siècle, le regard de défi d’un célèbre écrivain noir américain, qui posent tous pour l’éternité au milieu de cadres dorés. Elles cherchent un disque sur les rayonnages,
« T’as pas du kuduro, mec?
et comme l’albinos n’a pas de musique angolaise, kuduro ou kizomba, ni Banda Maravilha ni Paulo Flores, les grands succès à la mode, elles finissent par choisir ceux dont la pochette est la plus colorée, invariablement des rythmes cubains. Elles dansent, brodant des petits pas sur le plancher, tout en faisant sauter un à un les boutons de leur chemisier. Leur peau parfaite, très noire, humide et lumineuse, contraste avec celle de l’albinos, rose, sèche et rugueuse. Moi, je vois tout. Dans cette maison je suis comme un petit dieu nocturne. Pendant la journée, je dors.
LA MAISON
La maison vit. Elle respire. Je l’entends, toute la nuit, qui soupire. Les larges murs de pisé et de bois sont toujours frais, même lorsque, en plein midi, le soleil fait taire les oiseaux, souffrir les arbres, fondre le goudron. Je rampe le long des murs comme un acarien sur la peau de son hôte. Je sens, quand je les enlace, un cœur qui bat. Peut-être le mien. Peut-être celui de la maison. Peu importe. Il me fait du bien. Il me transmet de la sécurité. La Vieille Espérance amène parfois l’un de ses plus jeunes petits-enfants. Elle les porte sur son dos, bien attachés avec une étoffe, selon l’usage séculaire du pays. Elle fait tout son travail ainsi. Elle passe le balai, ôte la poussière des livres, fait la cuisine, lave le linge, le repasse. Le bébé, la tête collée à son dos, sent son cœur et sa chaleur, se croit de nouveau dans l’utérus de sa mère et dort. J’ai avec la maison une relation semblable. Lorsque vient le soir, je l’ai déjà dit, je reste dans le salon, collé aux vitres, à regarder mourir le soleil. Après la tombée de la nuit je vagabonde dans les autres pièces. Le salon s’ouvre sur le petit jardin, étroit et mal entretenu, dont l’unique charme provient de deux glorieux palmiers impériaux, très hauts, très hautains, qui se dressent chacun à une extrémité, veillant sur la maison. La pièce est attenante à la bibliothèque. On passe de celle-ci au couloir par une large porte. Le couloir est un tunnel profond, humide et sombre, qui donne accès à la chambre, à la salle à manger et à la cuisine. Cette partie de la maison est orientée vers le verger. La lumière du matin effleure les murs, verte, douce, filtrée par la haute ramure de l’avocatier. Au fond du couloir, à gauche en entrant, si l’on vient du salon, s’élève péniblement un petit escalier dont l’élan est brisé par deux paliers. Si l’on monte, on arrive à une espèce de grenier mansardé, que l’albinos fréquente peu. Il est rempli de caisses de livres. Moi non plus, je n’y vais pas souvent. Des chauves-souris dorment sur les murs, la tête en bas, enveloppées dans leurs capes noires. J’ignore si les geckos font partie du régime des chauves-souris. Je préfère ne pas le savoir. C’est la même raison – la terreur! – qui m’empêche d’explorer le verger. Je vois, des fenêtres de la cuisine, de la salle à manger ou de la chambre de Félix, la mauvaise herbe qui pousse sans retenue entre les rosiers. Un immense avocatier s’élève, touffu, juste au milieu du jardin. Il y a encore deux grands néfliers, chargés de nèfles, et une bonne dizaine de papayers. Félix croit au pouvoir régénérateur des papayes. Un haut mur ferme le jardin. Son sommet est surmonté de tessons de verre, de couleurs variées, pris dans du ciment. D’ici, d’où je les vois, on dirait des dents. Ce féroce artifice n’empêche pas que, de temps à autre, des enfants sautent le mur et volent des avocats, des nèfles et des papayes. Ils posent une planche sur le mur et se hissent ensuite jusqu’en haut. Cela me semble une tâche trop risquée pour si peu de profit. Peut-être ne le font-ils pas pour goûter les fruits? Je crois qu’ils le font pour goûter le risque. Demain le risque aura peut-être, pour eux, le goût des nèfles mûres. Imaginons que l’un d’eux devienne démineur. Dans ce pays le travail ne manque pas pour les démineurs. Hier encore j’ai vu à la télévision un reportage sur le processus de déminage. Un dirigeant d’une organisation non gouvernementale a déploré que les chiffres soient si imprécis. Personne ne sait, au juste, combien de mines ont été enterrées dans le sol de l’Angola. Entre dix et vingt millions. Il doit probablement y avoir plus de mines que d’Angolais. Supposons, donc, que l’un de ces enfants devienne un jour démineur. Chaque fois qu’il rampera
à travers un champ de mines lui viendra à la bouche la
lointaine saveur d’une nèfle. Un jour il sera confronté à l’inévitable question, lancée, avec un mélange de curiosité et d’horreur, par un journaliste étranger:
– À quoi pensez-vous lorsque vous désamorcez une mine?
Et l’enfant qui est encore en lui répondra en souriant:
– À des nèfles, mec.
La Vieille Espérance, elle, pense que ce sont les murs qui font les voleurs. Je l’ai entendue le dire à Félix. L’albinos l’a dévisagée, amusé:
– Voilà-t-il pas que j’ai une anarchiste à la maison! D’ici peu je vais découvrir qu’elle est en train de lire Bakounine.
Il a dit ça, et ne lui a plus prêté attention. Elle n’a jamais lu Bakounine, bien sûr; d’ailleurs, elle n’a jamais lu aucun livre, elle sait à peine lire. Toutefois, peu à peu j’apprends beaucoup de choses sur la vie, en général, ou sur la vie dans ce pays, c’est-à-dire la vie en état d’ébriété, en l’écoutant parler toute seule, tantôt en un doux murmure, comme si elle chantait, tantôt à voix haute, comme si elle pestait, tout en faisant le ménage. La Vieille Espérance est convaincue qu’elle ne mourra jamais. En 1992, elle a survécu à une tuerie. Elle était allée chez un dirigeant de l’opposition chercher une lettre de son fils cadet, en service à Huambo, quand a éclaté une
violente fusillade. Elle a insisté pour sortir de là, elle voulait rentrer dans son quartier, mais on ne l’a pas laissée faire.
– C’est de la folie, la vieille, faites comme si c’était la pluie. Ça va passer bientôt.
Ça n’a pas passé. La fusillade, comme une tempête, s’est intensifiée, durcie, est montée en direction de la maison. Félix m’a raconté ce qui s’est passé cet après-midi-là:
– Une troupe braillarde est arrivée, une bande d’émeutiers bien armés, complètement ivres; ils sont entrés de force dans la maison et ils ont tabassé tout le monde. Le commandant a voulu savoir comment s’appelait la vieille. Elle lui a dit, Espérance Job Sapalalo, patron, et il a ri. Il s’est moqué, l’Espérance est la dernière à mourir. Ils ont aligné le dirigeant et sa famille dans le jardin et les ont fusillés. Lorsque le tour de la Vieille Espérance est venu, il ne restait plus de balles. Ce qui t’a sauvée, lui a crié le commandant, c’est la logistique. Notre problème, ça sera toujours la logistique. Puis il l’a mise dehors. Maintenant elle se croit immunisée contre la mort. Peut-être qu’elle a raison.
Cela ne me semble pas impossible. Espérance Job Sapalalo a une fine toile de rides sur le visage, les cheveux tout blancs, mais sa chair est toujours ferme, et ses gestes sont sûrs et précis. À mon avis, elle est le pilier qui soutient cette maison.
L’ÉTRANGER
Félix Ventura étudie les journaux pendant le dîner, il les feuillette attentivement et si un article l’intéresse, il le coche au stylo, à l’encre violette. Il finit de manger, et ensuite il le découpe soigneusement et le garde dans un fichier. Sur l’une des étagères de la bibliothèque, il y a des dizaines de ces fichiers. Sur une autre dorment des centaines de cassettes vidéo. Félix aime enregistrer les journaux télévisés, les événements politiques importants, tout ce qui peut lui être utile un jour. Les cassettes sont rangées par ordre alphabétique, suivant le nom de la personnalité ou de l’événement auxquels elles se rapportent. Son dîner se résume à un bol de caldo verde, une soupe spécialité de la Vieille Espérance, une infusion de menthe et une grosse tranche de papaye, assaisonnée de citron et d’une goutte de Porto. Dans la chambre, avant de se coucher, il enfile son pyjama avec une telle solennité que je m’attends toujours à le voir nouer autour de son cou une cravate sombre. Ce soir, la stridulation de la sonnette l’a interrompu au moment de la soupe. Cela l’a fâché. Il a plié le journal et s’est levé avec effort pour aller ouvrir la porte. J’ai vu entrer un homme grand, distingué, au nez aquilin, aux pommettes saillantes, avec une grosse moustache, recourbée et lustrée, comme on n’en porte plus depuis un siècle. Ses yeux, petits et brillants, semblaient prendre possession de tout. Il portait un costume bleu, démodé, qui lui allait cependant bien, et tenait dans sa main gauche une serviette de cuir. Le salon s’est assombri. C’était comme si la nuit, ou quelque chose de plus endeuillé encore que la nuit, était entré en même temps que lui. Il a montré une carte de visite. Il a lu à haute voix:
– Félix Ventura. Assurez à vos enfants un meilleur passé. Il a ri. Un rire triste, mais sympathique: c’est vous, je présume? C’est un ami qui m’a donné cette carte.
Je n’ai pas réussi à deviner son origine à son accent. L’homme parlait doucement, avec un mélange d’intonations variées, une subtile âpreté slave, tempérée par le miel suave du portugais du Brésil. Félix Ventura a reculé:
– Qui êtes-vous?
L’étranger a fermé la porte. Il s’est promené dans le salon, les mains croisées derrière le dos, s’arrêtant un bon moment devant le beau portrait à l’huile de Frederick Douglass. Finalement il s’est assis sur l’un des fauteuils et, d’un geste élégant, a invité l’albinos à faire de même. On aurait dit que c’était lui le maître de maison. Des amis communs, a-t-il dit, et sa voix s’est faite encore plus suave, lui avaient indiqué cette adresse. Ils lui avaient parlé d’un homme qui trafiquait les souvenirs, qui vendait le passé, secrètement, comme d’autres font de la contrebande de cocaïne. Félix l’a regardé avec méfiance. Tout l’irritait chez cet étranger, ses manières douces et autoritaires à la fois, son discours ironique, sa moustache archaïque. Il s’est assis dans un majestueux fauteuil de rotin, à l’autre bout de la pièce, comme s’il avait peur d’être contaminé par l’amabilité de l’autre.
– Puis-je savoir qui vous êtes?
Cette fois non plus, il n’a pas obtenu de réponse. L’étranger a demandé la permission de fumer. Il a sorti de la poche de sa veste un étui d’argent, l’a ouvert et s’est roulé une cigarette. Ses yeux sautillaient de droite à gauche, distraitement attentifs, comme ceux d’une poule qui gratte dans la poussière. Il a laissé la fumée se répandre et l’envelopper. Il a souri avec une chaleur inattendue:
– Mais dites-moi, mon cher, qui sont vos clients?
Félix Ventura s’est rendu. Toute une classe, la nouvelle bourgeoisie, a-t-il expliqué, recherchait ses services. C’étaient des entrepreneurs, des ministres, des propriétaires terriens, des trafiquants de diamants, des généraux, des gens, enfin, dont l’avenir était assuré. Ce qu’il manque à ces gens, c’est un bon passé, des ancêtres illustres, des parchemins. En bref: un nom qui évoque la noblesse et la culture. Il leur vend un passé neuf sur papier. Il trace leur arbre généalogique. Il leur donne des photographies de leurs grands-parents et de leurs arrière-grands-parents, des messieurs de belle prestance, des dames des temps anciens. Les entrepreneurs, les ministres, aimeraient avoir pour tantes ces dames-là, a-t-il poursuivi, en désignant les portraits sur les murs – de vieilles dames drapées dans leurs étoffes, d’authentiques bessanganas -, ils aimeraient avoir un aïeul au port illustre d’un Machado de Assis, d’un Cruz e Sousa, d’un Alexandre Dumas, et lui leur vend ce rêve innocent.
– Parfait, parfait. (L’étranger a lissé sa moustache.) C’est ce qu’on m’a dit. J’ai besoin de vos services. Je crains d’ailleurs que cela vous donne pas mal de travail.
– Le travail rend libre, a murmuré Félix. Il l’a peut-être dit pour provoquer, pour tester l’identité de l’intrus, mais si telle était son intention il en a été pour ses frais, car l’autre s’est contenté de hocher la tête en signe d’assentiment. L’albinos s’est levé et s’est dirigé vers la cuisine. Il est revenu peu après en tenant à deux mains une bouteille de bon vin rouge portugais. Il l’a montrée à l’étranger. Il lui a tendu un verre. Il a demandé:
– Puis-je savoir votre nom?
L’étranger a examiné le vin à la lumière de la lampe. Il a baissé les paupières et bu lentement, attentif, heureux, comme s’il suivait le vol d’une fugue de Bach. Il a posé son verre sur une table basse, juste devant lui, un meuble d’acajou au plateau de verre; finalement, il s’est redressé et a répondu:
– J’ai eu beaucoup de noms, mais je veux les oublier tous. Je préfère que ce soit vous qui me baptisiez.
Félix a insisté. Il avait besoin de connaître, au moins, les occupations de ses clients. L’étranger a levé la main droite, une grande main, aux doigts longs et osseux, en un geste de vague refus. Puis il l’a baissée et a soupiré:
– Vous avez raison. Je suis reporter-photographe. Je recueille des images de guerres, de la faim avec ses fantômes, de catastrophes naturelles, de grandes calamités. Considérez-moi comme un témoin.
Il a expliqué qu’il avait l’intention de se fixer dans le pays. Il voulait davantage qu’un passé décent, une famille nombreuse, oncles et tantes, cousins et cousines, grands-pères et grands-mères, y compris deux ou trois bessanganas, bien que déjà tous morts, naturellement, ou vivant en exil, il voulait davantage que des portraits et des récits. Il lui fallait un nouveau nom et des papiers angolais, authentiques, qui prouvent son identité. L’albinos l’écoutait, atterré:
– Non! a-t-il enfin articulé. Ça, je ne le fais pas. Je fabrique des rêves, je ne suis pas un faussaire… De plus, excusez ma franchise, il serait difficile de vous inventer toute une généalogie africaine.
– Ça alors! Et pourquoi?
– Eh bien… vous êtes blanc!
– Et alors? Vous êtes plus blanc que moi!
– Blanc, moi?! (L’albinos s’est étranglé. Il a sorti un mouchoir de sa poche et s’est essuyé le front) Non, non! Je suis noir. De pure race. Je suis un autochtone. Vous ne voyez pas que je suis noir?
Moi, qui étais resté tout le temps à ma place habituelle, près de la fenêtre, je n’ai pas pu m’empêcher d’éclater de rire. L’étranger a levé le visage comme s’il flairait l’air de la pièce. Tendu, en alerte:
– Vous avez entendu ça? Qui a ri?
– Personne, a répondu l’albinos, et il m’a montré du doigt: c’est le gecko.
L’homme s’est levé. Je l’ai vu s’approcher et j’ai senti que ses yeux me transperçaient. C’était comme s’il regardait droit dans mon âme (ma vieille âme). Il a hoché la tête en silence, perplexe:
– Vous savez ce que c’est?
– Pardon!?
– C’est un gecko, oui, mais d’une espèce très rare. Vous voyez ces rayures? Il s’agit d’un gecko tigre, ou gecko tigré, un animal timide, encore peu étudié. Les premiers spécimens ont été découverts il y a une demi-douzaine d’années en Namibie. On pense qu’ils peuvent vivre vingt ans, peut-être plus. Leur rire est impressionnant. N’avez-vous pas l’impression que c’est un rire humain?
Félix a acquiescé. Oui, au début lui aussi avait été troublé. Puis il avait consulté quelques livres sur les reptiles, qu’il avait trouvés ici même, dans la maison, il avait des livres sur tout, des milliers, il les avait hérités de son père adoptif, un marchand de livres anciens qui avait quitté Luanda pour Lisbonne peu de temps après l’Indépendance, et il avait découvert que certaines espèces de geckos peuvent produire un son assez fort, ressemblant à un éclat de rire. Ils sont restés un bon moment à parler de moi, ce qui m’a mis mal à l’aise, parce qu’ils le faisaient comme si je n’étais pas là. En même temps, je sentais que ce n’était pas de moi qu’ils parlaient, mais d’un être d’une autre espèce, d’une vague et lointaine anomalie biologique. Les hommes ignorent presque tout des petits êtres avec lesquels ils partagent leur foyer. Les rats, les chauves-souris, les cafards, les fourmis, les acariens, les puces, les mouches, les moustiques, les araignées, les vers de terre, les mites, les termites, les punaises, les charançons, les escargots, les scarabées. J’ai décidé qu’il valait mieux que je m’occupe de ma vie. À cette heure-là, la chambre de l’albinos s’emplit de moustiques, et je commençais à avoir faim. L’étranger s’est levé, est allé jusqu’à la chaise où il avait posé sa serviette de cuir, l’a ouverte et en a tiré une grosse enveloppe. Il l’a remise à Félix, lui a dit au revoir et s’est avancé vers la porte. Il l’a ouverte lui-même. Il a salué de la tête et il est parti.
UN BATEAU REMPLI DE VOIX
Cinq mille dollars en gros billets.
Félix Ventura a déchiré l’enveloppe d’un geste rapide, nerveux, et les billets ont jailli, comme des papillons verts, ont voltigé un moment dans l’air nocturne, puis se sont éparpillés sur le plancher, sur les livres, les chaises et les canapés. L’albinos était affolé. Il a même ouvert la porte, prêt à poursuivre l’étranger, mais dans la nuit immense, sans vie, il n’y avait personne.
– Tu as vu ça?!… (C’est à moi qu’il s’adressait.) Et maintenant, qu’est-ce que je fais?
Il a ramassé les billets un à un, les a comptés et les a rangés. Ce n’est qu’alors qu’il s’est aperçu qu’il y avait un mot dans l’enveloppe. Il l’a lu à haute voix:
– Cher monsieur, j’ai l’intention de vous remettre cinq mille dollars supplémentaires lorsque je recevrai tout le matériel. Je vous laisse quelques photos de moi, genre photo d’identité, à utiliser sur les documents. Je repasserai d’ici trois semaines.
Félix s’est couché et a essayé de lire – la biographie de Bruce Chatwin, de Nicholas Shakespeare, dans l’édition portugaise de chez Quetzal. Au bout de dix minutes il a posé le livre sur la table de chevet et s’est levé. Il a tourné dans la maison jusqu’au lever du jour en murmurant des phrases sans suites. Ses petites mains de veuve, tendres et minuscules, voletaient au hasard, autonomes, pendant qu’il parlait. Sa toison crépue, coupée court, irradiait autour de sa tête, formant une aura miraculeuse. Si quelqu’un l’avait vu de la rue, par les fenêtres, il aurait pensé qu’il assistait à un prodige.
– Non, c’est absurde! Je ne le ferai pas.
[…]
– Pour le passeport, ce ne serait pas difficile, même pas risqué, et ce ne serait pas cher. Je peux le faire, pourquoi pas? Il faudra que je le fasse un jour, c’est le prolongement inévitable de ce jeu.
[…]
– Attention, meu camba, mon ami, attention aux chemins que tu choisis. Tu n’es pas un faussaire. Ne te précipite pas, invente une excuse, rends-lui ses dollars et dis-lui que ce n’est pas possible.
[…]
– On ne crache pas sur dix mille dollars. Je passe deux ou trois mois à New York. Je vais faire les bouquinistes de Lisbonne. Je vais à Rio, aux rondes de samba, je vais dans les bals, dans les librairies d’occasion, ou à Paris acheter des disques et des livres. Il y a combien de temps que je ne vais plus à Paris?
[…]
L’agitation de Félix Ventura a perturbé mon activité cynégétique. Je suis un chasseur nocturne. Lorsque j’ai localisé mes proies, je les poursuis, les forçant à monter jusqu’au plafond. Une fois en haut, les moustiques ne descendent plus. Je cours alors autour d’eux, en cercles
de plus en plus fermés, les acculant dans un coin, et je
les dévore. L’aube se levait quand l’albinos, qui s’était jeté sur l’un des canapés du salon, m’a raconté l’histoire de
sa vie.
– Je pense toujours à cette maison comme à un bateau. Un vieux navire à vapeur qui fend avec peine la boue épaisse d’un fleuve. La forêt immense. La nuit tout autour.
Après avoir dit cela, Félix a baissé la voix. Il a montré d’un geste vague les livres vagues:
– Il est rempli de voix, mon bateau.
J’entendais la nuit glisser au-dehors. Des jappements. Des serres griffant les vitres. En regardant par les fenêtres il ne m’était pas difficile de deviner le fleuve, les étoiles tournoyant sur son dos, des oiseaux farouches s’échappant entre les branchages.
Le mulâtre Fausto Bendito Ventura, marchand de livres anciens, fils et petit-fils de marchand de livres anciens, avait trouvé un dimanche matin une caisse devant sa porte. À l’intérieur, couché sur plusieurs exemplaires de La Relique d’Eça de Queiros, se trouvait une petite créature toute nue, très maigre et délavée, aux cheveux de mousse incandescente et au sourire pur et radieux. Veuf, sans enfants, le marchand de livres avait recueilli l’enfant, l’avait nourri et élevé, persuadé qu’un dessein supérieur avait tramé cette improbable intrigue. Il avait gardé la caisse, ainsi que les livres qui se trouvaient à l’intérieur. L’albinos m’a raconté cela avec fierté:
– Eça a été mon premier berceau.
Fausto Bendito Ventura s’était fait marchand de livres pour s’amuser. Il s’enorgueillissait de ne jamais avoir travaillé de sa vie. Il sortait le matin tôt se promener dans le centre-ville, malembe-malembe, plan-plan, très droit dans son costume de lin, en chapeau de paille, nœud papillon, la canne à la main, saluant amis et connaissances en touchant légèrement de l’index le bord de son chapeau. Si par hasard il croisait une dame de son âge, il lui dédiait la lumière d’un galant sourire. Il soufflait: Bonjour, poésie. Il adressait des compliments piquants aux serveuses des cafés. On raconte (c’est Félix qui me l’a apporté) qu’un jour un envieux l’avait provoqué:
– Finalement, monsieur, que faites-vous les jours ouvrés? La réplique de Fausto Bendito, tous mes jours sont désœuvrés, cher monsieur, je les promène, déclenche encore aujourd’hui des applaudissements et des éclats de rire dans le cercle raréfié d’anciens fonctionnaires coloniaux qui, lors des après-midi exténués de la glorieuse Brasserie Biker, persistent à éluder la mort, en jouant aux cartes et en se racontant des anecdotes. Fausto déjeunait chez lui, faisait la sieste, puis s’asseyait sur la terrasse pour jouir de la brise fraîche du soir. À cette époque-là, avant l’Indépendance, il n’y avait pas encore le haut mur qui sépare le jardin du trottoir, et le portail était toujours ouvert. Il suffisait aux clients de gravir une volée de marches pour avoir libre accès aux livres, en piles innombrables, disposés au hasard sur le solide plancher de la mansarde.
Je partage avec Félix Ventura un amour (sans espoir, en ce qui me concerne) pour les mots anciens. Ceux qui ont élevé Félix Ventura dans ce sentiment ont été d’abord son père, Fausto Bendito, et ensuite un vieux professeur de ses premières années de lycée, un individu au tempérament mélancolique, grand et tellement mince qu’on aurait dit qu’il marchait toujours de profil, comme une gravure égyptienne. Gaspar, c’était son nom, s’émouvait que certains vocables soient délaissés. Il les découvrait abandonnés à leur sort, en un lieu désert de la langue, et s’efforçait de les sauver. Il les employait avec ostentation et persistance, ce qui en consternait certains et en déconcertait d’autres. Je crois qu’il a gagné. Ses élèves ont commencé à employer ces mots, d’abord pour se moquer, et ensuite comme un argot privé, un tatouage tribal qui les distinguait des autres jeunes de leur âge. Aujourd’hui, m’a assuré Félix, ils sont encore capables de se reconnaître entre eux, même lorsqu’ils ne se sont jamais vus, aux premiers mots qu’ils prononcent.
– Je tremble encore quand j’entends quelqu’un dire édredon, un affreux mot d’importation, au lieu de courtepointe, qui me semble à moi, et je suis sûr que vous en serez d’accord, un mot très beau et très noble. Mais je me suis déjà habitué à soutien-gorge. Strophium possède une autre dignité historique. Il sonne, toutefois, de façon un peu étrange, vous ne trouvez pas?
RÊVE N° 1
Je traverse les rues d’une ville inconnue en me faufilant au milieu de la foule. Je croise des gens de toutes races, de toutes croyances et de tous sexes (très longtemps j’ai cru qu’il n’en existait que deux). Des hommes en noir, aux lunettes noires, portant des serviettes de cuir. Des moines bouddhistes, qui rient très fort, gais comme des oranges. Des femmes diaphanes. De grosses matrones avec des chariots de courses. De maigres adolescentes, en patins à roulettes, oiseaux vifs slalomant à travers la foule. Des écoliers en uniforme, en file indienne, celui qui est derrière tenant la main de celui qui le précède, devant une institutrice, une autre derrière. Des Arabes en djellaba et calot. Des chauves qui promènent en laisse des chiens tueurs. Des policiers. Des voleurs. Des intellectuels absorbés. Des ouvriers en bleu de travail. Personne ne me voit. Pas même les Japonais, en groupes, caméra au poing, leurs yeux bridés attentifs à tout. Je m’arrête devant les gens, je leur parle, je les secoue, mais ils ne s’aperçoivent pas de ma présence. Ils ne me parlent pas. Il y a trois jours que je fais ce rêve. Dans mon autre vie, lorsque j’avais encore forme humaine, cela m’arrivait assez fréquemment. Je me rappelle m’être réveillé la bouche amère et le cœur plein d’angoisse. Je pense qu’à cette époque-là, c’était une prémonition. À présent, c’est peut-être une confirmation. De toute façon cela ne m’affecte plus.