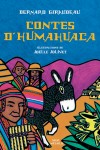Roland est paralysé, cloué dans son fauteuil roulant. Bernard, lui, a été marin et court le monde. Pendant plusieurs années, il a écrit à son ami, le faisant ainsi participer à ses aventures sportives, théâtrales, cinématographiques et personnelles. Il a voyagé pour lui. Loin du tourisme et de l'autocomplaisance, ces lettres forment un récit hors du commun, mêlant les souvenirs du marin de dix-sept ans qui découvrait, dans l’innocence, le monde des ports et les femmes (la petite infirme de Diego Suárez, la prostituée de Kobe, la dame de Balboa...) aux réflexions et aux sentiments de l’homme qu’il est devenu. Et qui se cherche de la Transamazonienne à la Patagonie et à l’Afrique, sensible aux injustices, aux parfums, à la sensualité, aux femmes.
Chronique d’une amitié sans pathos qui rêvait d’une fugue aux Marquises, ces lettres nous révèlent un regard précis et original servi par le style à la fois brutal et lyrique d’un homme qui court par peur de tomber.
-
Il paraît qu'il est fatigué, sous le bronzage du dernier voyage en Afrique. Le cancer au creux des reins; les médicaments, les dix kilos envolés. Et pourtant il joue, charmeur et charmant. Du grand Giraudeau sur toile cirée, entre deux scènes du prochain film. Encore une histoire d'hommes et de bateau, sur le Vieux-Port, à portée de calanques. Il y va «rêver », muscles à l'arrêt. Un regard sur la mer, un regard sur la falaise. Grimpeur et marin, il n'a jamais su ce qu'il préférait, la vague sous la quille ou le rocher au bout des doigts. La maladie, «avertissement», l'oblige à ralentir: «C'est une très bonne chose~ qui me prévient d'une dérive. J'étais dans la suractivité.» La tête chauffe déjà d'un projet de roman. Il a découvert l'écriture qui «embellit la vie», les mots précis comme des épissures et les phrases comme autant d'escalades. Cancer, n'est-ce pas un tropique? « Un nouveau bateau », assure Giraudeau, « un de plus». Il s'y attendait. Jusque-là, c'était grand beau. Un grain et on repart, racontait Bernard à Roland. Son ami était arrimé à un fauteuil roulant, le centre de myopathes pour horizon, et lui courait le monde. «Moi qui bouge, toi qui restes», Bernard peignait ses voyages, le «marin à l'ancre» rêvait. A sa mort, il avait lu du pays. Quatre cents lettres, dix ans de baroud, plus les souvenirs. Un jour, le centre a renvoyé les lettres, Bernard Giraudeau a décidé d'en faire un livre (1) juste après le premier janvier. Quand à son tour; il s'est retrouvé à l' ancre. Il a toujours voulu distancer la « réalité » synonyme d'ennui. Elle l'a toujours rattrapé, changeant de visage. Deux tours du monde sur la Jeanne, à dix-huit ans, et c'était déjà la «routine». Une pièce qui se prolonge, un tournage qui s'attarde, et c'est l'appel du large. Il ne tient pas en place. «Même dans un endroit magnifique j'ai envie d'être ailleurs, dit-il, il n'y a rien de plus émouvant que l'esquisse d'une terra incognita.» Un jour, il veut se poser et écrit à Roland: « je vais bâtir un nid dans lequel je serai incapable de rester» C'est une maison de vacances dans un jardin clos de l'île de Ré dix ans plus tard. Marie Dubois est souvent là, étourdie par sa vitalité contagieuse: «Quand il court sur 1a p1age, c'est comme un fou. Quand il part à la pêche au bar, il en ramène dix, et il faut les manger» Enfant, à La Rochelle, Bernard Giraudeau a beaucoup attendu son père, militaire de carrière dans l'infanterie. Des jours à guetter les lettres, «très belles», qui arrivaient d'Indochine, puis d'Algérie. Un jour, le père annonce son arrivée, une permission. Bernard voudrait lui plaire. Le gazon est trop haut, mais il n'y a pas de tondeuse. Alors il prend des ciseaux, et coupe, brin par brin, jusqu'à obtenir la brosse qu'il voyait sur la tête paternelle. Il déteste parler de cette période, dit qu'il a une «gomme à la place du cerveau » et puis lâche, comme une affaire trop souvent entendue: «J'étais odieux, c'est sûr, agressif coléreux. Le môme chiant qu'on a envie de gifler.» La vie, le bonheur, c'était les camps de Louveteaux, dans les pertuis charentais ou le Marais poitevin. Il se souvient parfaitement d'une expédition à l'île de Ré, de contrebandiers, de bagarres... Il continue avec ses enfants, «on campe on mange ce qu'on attrape » pour leur tricoter des souvenirs indélébiles. Il lisait Stevenson et London, Nicolas Bouvier maintenant. La psychologie, le quotidien de cinéma d'auteur, c'est pas son truc. Il aime les Raid Gauloise, et partir avec les «grands»: Berardini pour la grimpe, Bourgnon pour la voile. Marie Dubois: «Tout est démesuré chez lui c'est la fuite en avant, toujours, toujours. Je me demande comment il va réussir à ne plus se lancer dans des rêves.» Ses rêves, Giraudeau y pénètre souvent. A quinze ans, il signe pour sept ans dans la marine. Il était l'aîné, le père était sous-officier, l'arrière grand-père cap-hornier, la famille protestante. Il n'y a peut-être rien à comprendre, il s'ennuyait, c'est tout. Et se révoltait contre tout, sauf l'armée. «Curieux, non? Encore aujourd'hui, bien qu'à gauche, je n'ai rien contre les militaires.» Militer aussi est un métier à risques, un prétexte à l'adrénaline, hors vacances à l'île de Ré, non loin de Lionel Jospin qu'il «aime bien »: Bernard Giraudeau est invité aux Philippines, un dîner officiel, sous Marcos. Au dessert, il passe un texte d'Amnesty International sur les droits de l'homme à Imelda, épouse du dictateur. Elle n'a pas apprécié. «Il y a un moment où il faut devenir acteur », dit-il. Acteur ? « je veux dire agir, s'engager, réaliser» Tout se mélange, de toute façon, sa vie est «un grand film d'aventures » Un sommet en Patagonie, un documentaire sur la transamazonienne, un long métrage sur l'île de Gorée, un rôle déjanté avec François 0zon ... tout est bon pour expédier la «réalité» aux antipodes. Côté professionnel, il a tout osé: danse, musique, théâtre, peinture. Coté coeur c'est plus compliqué. L'amitié avec Roland qu'il n'a jamais emmené aux Marquises, qu'i1 a «trop peu vu», reste une belle histoire inachevée. Quant à l'amour au long cours, c'est son fantasme de matelot éduqué dans les bordels: « La femme idéale est une inconnue, mythique et multiple. Pour nous les marins, les femmes sont comme la houle, elles disparaissent comme une algue qui vous caresse le visage?~» Il ajoute «L'imaginaire qui travaille, ça occulte ce qui est là. » La petite prostituée de Kobe qui passe, nue, coiffée de son pompon rouge de mataf. Comme la compagne qui se lasse. Bernard Rapp, pour son film Une affaire de goût, cherchait «un prédateur-séducteur. Mais pas un salaud, un mec avec une souffrance, une vraie faille». Il a choisi Giraudeau sans bouts d'essai. Séducteur, l'affaire est entendue au premier regard coulé bleu lagon. Prédateur: «Il prend énormément de place», explique Elisabeth, sa sœur cadette. «Il est toujours en mouvement, exigeant sur tout et dans tous les domaines. » A dix-huit ans, il a quitté la Jeanne avant la quille, déçu d'avoir compris que le matelot ne deviendrait jamais capitaine: «Je voulais le diriger, ce bateau, il n'y a que ça qui m'intéressait. Mais j'étais mal parti, avec mon brevet de mécanicien » Quelques années plus tard, après quelques pas de danse à La Rochelle, il obtenait un premier prix de théâtre au conservatoire de Paris. «Partout où il passe il veut réussir, diriger, régner», explique Bernard Rapp. Giraudeau lui-même se trouve «casse couilles», information vérifiée sur les plateaux, où il sème des souvenirs contrastés, jamais indifférents: «Glacial, odieux, mutique», et « drôle, généreux, passionné». Une attachée de presse parle de «petits soucis caractériels», c'est tout dire. La faille? Les amis connaissent ses silences, ses colères, ses absences. Lui s'annonce «désespéré» chronique. Les hommes et leur misère, sa propre «vanité », il n'est pas le père qu'il faut... Giraudeau a toujours en travers de la gorge un goût amer «d'inachevé». Il se lève, une main sur les reins: «Je vais prendre le temps de parcourir le monde au pas du cheval.» Le rêveur a des appétits de «Sagesse»Pascale NivelleLIBERATION
-
On dit les comédiens narcissiques, égoïstes, vaniteux. On oublie leur fragilité. On les confond toujours avec leurs rôles. C'est plus simple. Du coup, un comique sur pellicule devrait toujours sourire dans la « vraie vie ». Un salaud, raser les murs. Une gueule d'amour ne peut être que « beau, beau et con à la fois ». Bernard Giraudeau, comme d'autres avant lui. a été victime de son physique. Il en a joué aussi. De Bilitis (1976) à L'année des méduses (1984). en passant par La Boum (1980), il en a séduit et charmé des femmes... et sans doute quelques hommes. Après Rue Barbare, adaptée de Goodis, Les Spécialistes et Les Longs Manteaux, il est devenu un acteur physique, un « rouleur de carrure » comme dirait Lavilliers qui en connaît un rayon. Du grain à moudre pour les colleurs d'étiquettes. Fausse piste. En 1987, avec Poussière d'ange, Giraudeau prend des risques. Jette par-dessus bord les clichés qui lui collent à la peau comme des ventouses. Se fait plaisir. Et nous régale avec ce personnage décavé, défait, frère en désespoir du Maurice Ronet du Feu follet, en dérive alcoolique du Delon de Notre histoire. Il n'arrêtera plus de nous surprendre. Ce boulimique d'émotions, ce gourmand d'intensité, cet homme pressé qui « court pour ne pas tomber » sera désormais sur tous les fronts : théàtre. cinéma, réalisation de films de cinéma, de télévision, de documentaires. Il sera Diderot, Vahnont, St-Exupéry, casque bleu à Sarajevo, homo cynique et révolté pour Nicole Garcia, manipulateur pour Rapp, odieux pour Ozon. Toujours juste, étonnant, touchant. Aujourd'hui, on découvre qu'il écrivait également. Des chroniques de voyage. Qu'il adressait sous forme de lettres à l'ami rencontré en 1987, Roland, cloué dans son fauteuil par une maladie incurable. C'est lui « le marin à l'ancre » du livre. Jusqu'au départ de Roland, jusqu'à sa délivrance, le 24 décembre 1997, Giraudeau restera fidèle à cette amitié virile. Ou qu'il aille dans le monde, et il ne s'est pas privé de voyager, il n'oubliera jamais Roland, « l'empêcheur de pourrir en rond ». A Roland, le confident, l'acteur raconte tout. Ce qu'il fait, ce qu'il voit (les rizières de Hady, le désert d'Atacama, l'île aux Orchidées et son cimetière de, pirates), les gens qu'il rencontre, ses coups de gueule (contre Imelda Marcos, les narco-trafiquants), ses coups de coeur, ses souvenirs de marin embarqué sur la Jeanne-d'Arc à l'âge de quinze ans, les bars, les filles. l'amour glauque, les rixes, les repérages pour des films à venir, les lectures, les erreurs, le dialogue inachevé avec le père. Il l'apostrophe. le tance, le provoque. C'est un jeu. Les formules sont belles : « Chez toi, l' attente n'est pas passive, même si elle est imposée. EIle est acte. (...) Moi, l'attente m'échauffe, m'impatiente. Je veux tout ce que tu rêves. Je veux le mouvement toujours. Je m'enivre d'une valse chaotique. Je tente toutes les vibrations. J'ai des excitations denfant, des peurs délectables. Tu comprends ça, toi! » l'lus loin :« Ilfaut vomitl'ignorance et la bét~îe, reconquérir, lucide, le vertige, le grand vertige. » Plus loin : « il faut vomir l'ignorance et la bêtise, reconquérir, lucide, le vertige, le grand vertige. » A chaque retour à Paris, Giraudeau passe voir son ami. « Il ne me retenait pas, confie l'acteur dans la voiture qui l'emmène de son hôtel près du Vieux-Port au port autonome où il tourne, sous la direction de Claire Devers, Les Marins perdus., adaptation du roman de Jean-Claude Izzo (1). On goûtait le moment présent, on parlait de l'essentiel, de projets. » Parce que l'aventure, comme l'a dit Paul-Emile Victor, c'est du temps volé à la mort, Bernard et Roland font un rêve : fuguer ensemble aux Marquises sur les traces de Cook, Melville, Stevenson, London. Gauguin, Segalen. Et surtout de Brel, que Roland a connu et perdu en 1979, huit ans avant de rencontrer Bernard. Le grand Jacques a écrit une chanson sublime, Les Marquises, dont les derniers mots semblent avoir été écrits pour ce Roland au courage exemplaire. : « Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise, aux Marquises. » Livre de vie et d'espoir, émaillé d'images fortes, d'évocations de Michaux, Cendrars, Chatwin, St-Exupéry, LeMarin à l'ancre a été un vrai travail d'écriture, de mise en forme que l'acteur a pris très au sérieux : « Il a fallu tout reprendre, tailler, éliminer toutes les choses inutiles. Au départ, il y avait beaucoup plus de lettres. Avec Anne-Marie Métailié, on a supprimé celles qui n'apportaient rien. Et jai réécrit. Lentement. Je suis un laborieux. » Le long de la jetée, L'Aldébaran inventé par Izzo est là, qui attend l'acteur. Giraudeau joue le rôle de Diamantis, commandant en second de ce cargo coincé à quai. Un homme fatigué à la recherche de son passé et d'une femme à qui il n'a eu le temps de dire ni je t'aime ni adieu. Un tournage difficile pour l'acteur opéré il y a quelques semaines d'un cancer du rein. .Un coup dur qui l'a contraint à arrêter, le 31 décembre dernier, Becket d'Anouilh dans lequel il triomphait au Théâtre de Paris. «J'ai peut-être repris an peu tôt » avoue l'acteur amaigri et affaibli par l'opération. Sur le plateau, l'équipe technique le ménage, l'entoure, le respecte. Entre deux prises, Giraudeau parle avec les uns, rigole avec les autres, s'interroge sur les films à venir. sur Becket qu'il doit reprendre à la fin de l'année. Il évoque le scénario qu'il écrit d'après Mirage d'amour avec fanfare, le très beau roman du Chilien Hernan Rivera-Letelier. Bref, il a des projets plein la tête. Dans ces yeux clairs passent aussi des ombres ; celles des absents qui ne le quittent jamais: « Mon père est là, par le manque et Roland, par la présence.»LE FIGARO LITTERAIRE
-
« Ces lettres qui ont permis à un corps pétrifié de vibrer, de chanter et de danser, les voici. Elles sont belles, justes, fortes. Elles illustrent l'idée de Saint-Exupéry selon laquelle on ne devrait écrire que dans l'urgence. [...] émouvant et exaltant. Un livre palpitant. »Jérome GarcinLE NOUVEL OBSERVATEUR
Roland avait une grosse tête douce et intelligente. Il portait des lunettes. Son corps était petit, ramassé, torturé. Il vivait dans un fauteuil électrique qui était sa deuxième peau, son char, sa Formule 1. Une fois corseté, plaqué, sanglé, il était apparemment droit et prêt à l’abordage, le menton en étrave. Il tirait alors son cou vers le haut, vers les autres, ceux qui étaient debout. Le visage de travers, une cigarette au coin de la bouche, il allait pêcher des regards et des sourires. Il puisait la vie sans relâche.
Mon ami Roland était échoué sur le carrelage de Saint-Jean depuis l’enfance. Il fut l’artisan de notre rencontre en 1987. Il bougeait encore les doigts d’une main droite qui commençait à s’engourdir. Il était en sursis depuis plusieurs années et sa survie était exceptionnelle. Il ne voulait plus “voyager” seul, les yeux clos. Je l’ai donc “emmené” là où j’allais en écrivant des lettres que vous lirez peut-être. Nous avons partagé mes voyages jusqu’à sa mort, en 1997. Il avait cinquante-trois ans.
Son char sillonnait les couloirs de l’institut pour aller de sa chambre située au deuxième étage jusqu’aux salles de classe du rez-de-chaussée. Il enseignait à de jeunes “soldats” aussi handicapés que lui. Ces dernières années, il ne bougeait plus que légèrement la tête mais son regard et son rire étaient et demeurent les plus belles réponses à mes lettres. On comprendra qu’elles ne puissent figurer ici mais c’est très regrettable. Un soir, à son initiative, comme toujours, il a proposé d’aller réellement aux îles Marquises, sans son fauteuil, lui sur mon dos, comme un sac, heureux de partager physiquement pour une fois une aventure avec moi. Le pari fut pris. Ce fut un rêve de plus, un voyage improbable pour ce marin à l’ancre qui est parti un matin de décembre à Hiva-Oa sans moi.
Février 2001
Roland,
C’est une lettre sans destination, une lettre réflexe, une lettre morte. Notre dernier rêve aurait vraiment pu nous emmener aux Marquises. Il aurait pu, mais peu importe. Non, cela importe, cela aurait importé au-delà de tout.
La vie a été une drôle de bagarre, mon vieux Roland.
Toi qui savais déjà enfant que le dictionnaire que tu portais était bien trop lourd pour toi et qu’un jour ce serait la couverture de ce dictionnaire qui serait trop lourde, tu as compris que les rêves étaient ta seule chance de survivre. Aussi lyriques et insensés soient-ils, ils t’aideraient à aller plus loin, bien plus loin que prévu. Tu n’aurais jamais dû aller jusque-là, c’était imprévisible pour le commun. Ta curiosité et ta soif te faisaient parfois oublier ce que tu avais sous les fesses. Tu as croisé des femmes et reconnu l’amour. Drôle d’histoire, mon pote. Tu ressentais pareil que nous, tu pleurais pareil, tu aimais pareil et personne ne le voyait. La différence fait peur, à toi aussi. Tu l’as dit : “ Je suis handicapé, le valide me fait peur, je suis homme, la femme me fait peur. Ceux qui tentent de me rassurer sont des tricheurs. Si vous pouviez voir à l’intérieur de chez moi, vous seriez surpris de voir que c’est comme chez vous et en rien je ne diffère. J’étais un petit prof comme un colonel sur son char. J’ai emmené mes troupes de bancals vers des études chaotiques. En avant toute, sans désarmer jamais, avec les pertes d’une guerre impossible : les mômes qui lâchent, ceux qui prennent un mauvais rhume, un coup de pompe, ceux qui s’accrochent une dernière fois avec le regard avant de s’endormir pour de bon. ”
Un jour, tu as voulu m’offrir un déjeuner dans un petit restaurant facile d’accès. Tu as signé un chèque de la main encore valide. Je savais que ce serait ta dernière signature et que tu allais écrire désormais avec un bâton dans la bouche sur les touches de ton ordinateur.
Tu as vécu au deuxième étage de Saint-Jean entre les photos de tes amis, les livres que tu ne pouvais pas lire et la musique, celle des poètes, Brel, Ferré, Brassens.
Il y avait toujours des visiteurs : des petits bonshommes à roulettes, avides de ton énergie, les enfants rieurs du premier étage. Les “mal faits”, les “pas finis”, qui ne marchent plus qui ne parlent plus mais rient encore. Il y avait des amis, ceux de l’extérieur, ceux qui bougent, les “pressés”, les “pas le temps” qui venaient te voir pour apprendre à souffler, toi qui n’en pouvais plus de mal respirer. Tu étais l’empêcheur de pourrir en rond. Tu générais des idées et il te fallait une volonté opiniâtre pour n’en concrétiser que quelques-unes. Les objectifs les plus simples occupaient tout ton temps. Tu entraînais avec toi la vie de Saint-Jean. Tu savais brasser, braver l’immobilisme, terrasser la capitulation. On a eu besoin de toi, toujours.
Toi que j’appelais le marin à l’ancre, toi qui quittas la rive en regardant ton fauteuil comme une peau sombre échouée sur le varech, comme une épave ensablée, te voilà quelque part, ta gauloise au bec, l’œil sur tout, même l’invisible, avec ta force, ta lucidité, ta folie, ton amitié, ton impossible colère, ton secret.
J’ai peint comme j’ai pu les voyages que tu voulais faire avec moi et puis un jour tu as désarmé, tu t’es rendu. C’était trop lourd. Tu me l’as dit avec un regard puis tu as ajouté : j’ai peur, et moi, ton ami, j’ai compris que tu allais partir pour te débarrasser de ce corps encombrant et que la seule peur que tu éprouvais était celle de faire ce voyage tout seul, sans nous.
B.
Fin avril 1992
J’ai vu sur le ruban rouge, loin devant, un vélo. Pas une maison de caboclo alentour, et pourtant il y avait un vélo. Le déhanchement du cycliste prouvait l’effort et la régularité du souffle. L’instinct commandait de ralentir, d’autant que la surprise était émouvante : une femme pédalait. La monture à deux roues semblait fragile. Une magnifique paire de fesses ondulait, elle se balançait voluptueusement autour d’une selle étroite, à peine visible, deux fesses telluriques, fascinantes, à peine couvertes par une économie de tissu. Le short en solde avait fini en une torsade bleue partageant deux formes parfaites, rondes, pleines, généreuses. Imagine cela après des jours de solitude amazonienne. Imagine le plus beau cul d’Amérique du Sud, des fesses offertes devant nous sur un vélo de facteur bricolé avec une selle de course et un guidon en bois. Des fesses qui nous occultaient le paysage. Des fesses d’une présence inouïe, des fesses brunes, chaleureuses, fermes, insolentes, des fesses pour se perdre, des fesses à revenir en enfance, des fesses qui épuisent le soldat, qui sécurisent, qui étouffent le vorace, ravissent le gourmand, des fesses qui provoquent l’admiration, la dévotion, la foi en somme. Roland, nous avons suivi de près cette merveille. La fille a fini par se tourner. Elle souriait, haletante. Elle retenait adroitement un fagot de cannes à sucre. La bicyclette hésitait dangereusement entre les ornières. Une danse sur la Transam. Nous étions éblouis. Nous avons doublé lentement avec l’ostensible intention d’en profiter. Ça n’a duré que le temps d’un égarement. Une sente invisible sur la droite cachait la fin du rêve.
Les deux fesses disparurent dans la verdure avec le rire d’une femme joyeuse. Une femme avec un pouvoir pareil ne peut-être que joyeuse.
Nous étions un peu ivres de cette vision fessue, un peu tristes d’être exclus, comme rejetés.
Je pensais qu’il était impossible de ne pas te signaler une telle rencontre. J’espère que tu apprécies mon petit carnet de voyage.
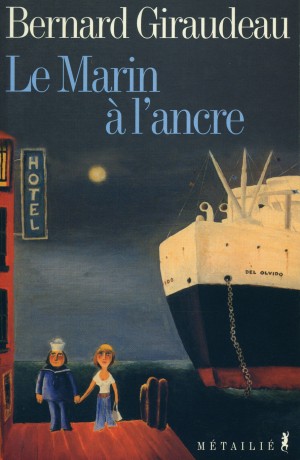




-100x150.jpg)