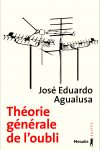A sa mort, le célèbre compositeur angolais Faustino Manso a laissé derrière lui sept veuves et dix-huit enfants. Sa plus jeune fille, Laurentina, metteur en scène de cinéma et documentariste, essaie de reconstituer la vie agitée du musicien.Dans ce roman, la réalité et la fiction se côtoient et marchent d’un même pas, la première nourrissant la seconde. Sur les terres que parcourt Agualusa, la réalité est presque toujours plus invraisemblable que la fiction. L’auteur et les quatre personnages de son roman voyagent ensemble de Luanda, capitale de l’Angola, aux étendues désertiques de Namibie, semées de villages fantômes, jusqu’au Cap, en Afrique du Sud. Puis ils remontent vers Maputo, au Mozambique, vers la petite île magique où est mort le poète Tomas Antonio Gonzaga. Dans leur périple, ils parcourent des paysages à la frontière des rêves dont émergent des personnages extraordinaires.
Agualusa écrit un roman sur les femmes, la musique et la magie, dont les pages annoncent la renaissance de ce continent africain, détruit par les guerres mais béni par la musique, la force toujours renouvelée de ses femmes et le pouvoir secret de très anciens dieux.
-
Auteur angolais de souche portugaise, Agualusa nous livre ici un troisième roman à cheval entre le documentaire, le carnet de voyage et la recherche généalogique.
-
Entretien de José Eduardo Agualusa avec Sophie Ekoué le 26 décembre 2009 EcouterLittérature sans frontièresRFI -
« La veine éminemment cinématographique du roman n’est donc pas la moindre de ses qualités. Agualusa nous offre un roman sur la féminité, la musique et la magie, annonçant la naissance d’un continent broyé par les guerres, par la magie de la musique et la force renouvelée de ses femmes, fondée sur le pouvoir de très anciens dieux. »
Gaston-Paul Effa
LE REPUBLICAIN LORRAIN -
« […] on trouve ici l’Afrique pour un voyage initiatique sur les traces d’un musicien angolais imaginaire, Faustino Manso. Luanda, Namibie, Le Cap, Maputo, île Mozambique, magie, réel, renaissance, spectres des guerres et de l’apartheid : l’histoire se déroule sur fond de musique omniprésente, de jazz, de contrebasse, de danse. Agualusa réinvente à sa façon un réel merveilleux, jongle entre récits et narrateurs et joue de cette thématique de la mémoire qui dominait déjà ses précédents romans. »
Julie CoutuCHRONIC’ART -
« […] l’écriture s’attache surtout, avec bienveillance et parfois humour, à la beauté, à la vitalité, à la paradoxale douceur qu’il débusque partout. »
Véronique RossignolLIVRES HEBDO -
« […] le rythme cinématographique du texte et son style proche de la prose poétique lui confèrent un pouvoir d’envoûtement auquel il est difficile de résister. »
Bernard Quiriny
LE MAGAZINE LITTERAIRE -
« Récit, journal intime, carnet de voyage, correspondance fragmentée, traversé de songes, Les Femmes de mon père confirme les vastes talents de José Eduardo Agualusa, journaliste angolais, agronome de formation, vivant entre le Brésil, le Portugal et l’Angola. »
Thierry ClermontLE FIGARO LITTERAIRE
Oncócua, dans le sud de l’angola.
Dimanche 6 novembre 2005
Je me suis réveillé en suspens dans une lumière oblique. Je rêvais de Laurentina. Elle parlait avec son père qui, allez savoir pourquoi, avait la tête de Nelson Mandela. Il était Nelson Mandela et il était le père de Laurentina, et tout ça semblait parfaitement naturel dans mon rêve. Ils étaient assis à une table en bois sombre, dans une cuisine identique en tout point à celle de mon appartement de la Lapa à Lisbonne. J’ai aussi rêvé à une phrase. Cela m’arrive souvent. La voici :
Avec combien de vérités fabrique-t-on un mensonge ?
La lumière très pure, filtrée d’abord par un grillage très fin fixé à la fenêtre, puis par la moustiquaire entourant le lit, se glissait en un torrent dubitatif qui communiquait son propre doute à la réalité. J’ai tourné la tête et j’ai aperçu le visage de Karen. Elle dormait. Quand Karen dort, elle redevient jeune, comme, je suppose, avant la maladie (la malédiction).
Nous sommes à Oncócua, dans un petit dispensaire géré par une organisation non gouvernementale allemande. Oncócua, comme tant d’autres agglomérations angolaises, a été planifiée avec de larges avenues, afin de pouvoir devenir une grande ville dans l’avenir. L’avenir, toutefois, a pris du retard. Peut-être n’arrivera-t-il jamais. Je me suis levé doucement et j’ai regardé par la fenêtre. Une énorme montagne en forme de cône parfait flottait à l’horizon. Deux femmes mucubal avançaient sans bruit. La plus grande ne devait pas avoir plus de seize ans, elle avait une taille de guêpe et des bracelets multicolores à ses fins poignets dorés ; en la voyant je me suis souvenu d’un vers de Ruy Duarte de Carvalho : Les seins, fragiles aiguillons sur la plaque de la poitrine. Ruy Duarte a écrit de beaux vers sur les seins des jeunes filles mucubal. Je le comprends très bien. Si j’étais poète, je n’aurais pas d’autre thème. La deuxième femme avait le torse couvert d’une étoffe verte et jaune. Elle boitillait.
– Elles sont jolies, n’est-ce pas ?
Cheveux châtains ébouriffés, Karen était assise sur le lit. Je lui ai dit :
– J’ai rêvé de Laurentina…
– Vraiment ? C’est bien. Les personnages commencent à exister à partir du moment où ils nous apparaissent en rêve.
– Dans mon rêve elle était indienne. Une fille avec des cheveux lisses, de grands yeux, une peau très sombre.
– Ce n’est pas possible. Peut-être seulement à moitié indienne, n’oublie pas que son père est portugais…
– Son père ? ! Lequel ?
– Bonne question. Faustino Manso était de Luanda, mulâtre ou noir. Celui qui l’a adoptée était portugais et son père biologique…
– Ne pensons pas à ça…
– Tu as raison, n’y pensons pas. Qui diable était le véritable père de Laurentina ?
(Mensonges primordiaux)
Je ferme les yeux et instantanément je retourne à l’après-midi où ma mère est morte. Mon père m’a accueillie à la porte de la chambre :
– Elle est très agitée, a-t-il murmuré. Essaie de la calmer.
Je suis entrée. J’ai aperçu ses yeux fiévreux dans la pénombre :
– Ma fille !
Elle a glissé une enveloppe dans ma main :
– On m’appelle. Je dois partir. Ceci est pour toi, Laurentina. Pardonne-moi…
Elle n’a plus reparlé. Mandume est apparu plus tard. Je me souviens de l’avoir vu agenouillé au pied du lit, tenant la main de ma mère. Mon père, debout, nous tournait le dos. Mon père, ou plutôt l’homme que je croyais être mon père jusqu’à cet après-midi-là. Maintenant il est assis devant moi. Il a un visage sec, anguleux, avec des pommettes saillantes. Sa chevelure est fournie, grisonnante, coiffée vers l’arrière. Il a sûrement répété sa question de nombreux soirs d’affilée dans sa chambre de veuf :
– Avec combien de vérités fabrique-t-on un mensonge ?
Le regard fixé sur un point quelconque derrière moi, il demeure silencieux un moment, puis ajoute d’un ton emphatique :
– Avec beaucoup de mensonges, Laurentina, beaucoup ! Pour qu’un mensonge fonctionne, il doit se composer de nombreuses vérités. (Yeux brillants, humides. Il sourit tristement.) Notre mensonge était un bon mensonge, un mensonge composé de nombreuses vérités, qui toutes étaient heureuses. Par exemple, l’amour qu’éprouvait Doroteia pour toi était vraiment un amour de mère. Tu le sais, n’est-ce pas ?
Je le regarde, étourdie. Je me lève et me dirige vers la fenêtre. De là j’aperçois la cour illuminée par le soleil. Le figuier, que j’ai sauvé sur un tas d’ordures il y a des années en le sortant d’une petite carafe brisée pour le replanter dans un énorme pot en terre cuite, se plaît bien à côté de la haute cheminée en briques qui divise la cour. Il a beaucoup grandi et il est devenu tout tordu, comme c’est le propre des figuiers. La bougainvillée au fond a déjà perdu toutes ses fleurs. Janvier tire à sa fin. Un mauvais mois pour mourir, même à Lisbonne, où surgissent fréquemment, égarées et somnolentes comme des coquelicots éparpillés dans un champ de blé, deux ou trois journées splendides d’été.
Mon père aurait aimé que je sois un garçon. Jusqu’à ce que j’aie douze ans, ignorant les protestations de ma mère, il m’achetait des pantalons courts et des bérets, et il jouait au ballon avec moi. Nous sommes très attachés l’un à l’autre. Nous l’avons toujours été.
– L’Ile, papa, comment est le temps à cette époque-ci au Mozambique ?
La question ne le surprend pas. Je crois qu’il se sent soulagé de pouvoir changer de sujet. Il soupire.
– En janvier, dit-il, il fait d’habitude très chaud sur l’Ile. La mer est d’un vert lumineux, l’eau est chaude, ma fille, elle atteint trente-cinq degrés, une soupe d’émeraudes. (Il sort une pièce de monnaie de sa poche.) Tu te souviens ?
– Bien sûr que je me souviens.
J’attrape la pièce. Vingt réis. Elle est très usée, mais je réussis encore à lire la date sans difficulté : 1824. Mon père a trouvé cette pièce sur une plage de l’Ile, le premier jour où il est arrivé là-bas, le jour même où il a fait la connaissance de ma mère. Doroteia avait quinze ans ; Dário, quarante-neuf. C’était le 18 décembre 1973. Je suis née deux ans plus tard. Je pense à cela, à ma naissance, et une révolte subite s’empare de moi. J’ai conscience que ma voix devient plus aiguë et que je suis sur le point de pleurer. Je ne veux pas pleurer*.
– J’essaie vraiment de comprendre comment vous avez pu me cacher une chose pareille pendant tant d’années ! Peux-tu me l’expliquer ?
Dário s’est recroquevillé comme un petit garçon. Dans mon bureau, une photo encadrée de Nelson Mandela est accrochée à un des murs et, à côté, une autre de mon père. La ressemblance entre les deux, malgré la différence de race, impressionne les gens.
– J’ai souvent parlé de ta naissance avec ta mère. Je voulais te mettre au courant, mais Doroteia m’en empêchait. Il y a des vérités, me rétorquait-elle, qui mentent plus que n’importe quel mensonge. Ta mère, ta mère biologique, n’a pas voulu te garder. C’était une gamine de quinze ans, fille d’un des hommes les plus riches de l’Ile, un commerçant indien. Elle était tombée amoureuse d’un musicien angolais venant de Quelimane qui était passé par là et elle se retrouva enceinte. Entre-temps l’homme était reparti. Pour autant que je sache, il était retourné à Luanda et la gamine est devenue folle de chagrin. Elle a cessé de s’alimenter. Le père a voulu la tuer quand il a découvert qu’elle était enceinte, il a voulu la chasser de chez lui, une vraie folie, mais la mère s’est interposée. Le père espérait qu’elle mourrait en couches. Elle et l’enfant. Il estimait que ce serait la meilleure solution pour tout le monde.
– Te souviens-tu du nom de ce musicien ?
– Bien sûr que je m’en souviens, Lau. Je me souviens aussi du nom de la gamine, c’était encore une gamine, ta mère biologique : elle s’appelait Alima. Le musicien, lui, tout le monde le connaissait. C’était une personnalité très populaire à l’époque…
– Populaire comment ?
– Populaire, ma fille, comme on est populaire ! Il avait enregistré plusieurs disques, des singles, et ses chansons passaient souvent à la radio. C’était un homme distingué, élégant, je me souviens de l’avoir toujours vu tiré à quatre épingles. Un type noir, peut-être un mulâtre foncé, vêtu d’un costume en lin blanc, avec un mouchoir dépassant de la poche de son veston, du côté du cœur. Ah, c’est important, des souliers bicolores et sur la tête, toujours bien droite, un beau panama…
– Comment s’appelait-il ?
– Faustino. Faustino Manso. Une personnalité, ce Faustino Manso.
(Lettre de Doroteia à Laurentina)
Chère fille,
Je t’appellerai fille jusqu’à la fin.
Il y a quelque chose qu’il faut que tu saches et je veux que tu l’apprennes par moi, car si tu ne l’as pas su avant, c’est de ma faute, le courage m’a manqué.
Tu n’es pas sortie de mon ventre. Le jour même où tu es née, j’ai perdu une petite fille. Une autre femme a accouché dans la chambre d’une clinique modeste dans laquelle je me trouvais sur l’île de Mozambique. L’accouchement s’est mal passé et la femme n’a pas survécu. Les parents de cette femme m’ont demandé si je voulais prendre l’enfant et j’ai dit oui. Dès que j’ai jeté les yeux sur toi, je t’ai aimée comme si tu étais ma vraie fille.
Voilà ce que je voulais te dire. Pardonne-moi de ne pas te l’avoir dit plus tôt.
Aide ton père. Je me fais du souci pour lui. Dário est incapable de vivre seul. Nous nous sommes parfois querellés. Je pense avoir été souvent trop dure avec lui. Mais je l’aime beaucoup, tu comprends ? Il a été le seul homme de ma vie. J’ai toujours eu du mal à accepter qu’il ait aimé d’autres femmes avant moi. Pire encore – pendant qu’il était avec moi. Mais les hommes sont ainsi.
Tu as été ce que la vie m’a donné de mieux.
Ta mère,
Doroteia
(Ne pas aimer est un péché)
Une coïncidence malheureuse. Je ne sais pas comment l’appeler. Faustino Manso, mon père, est mort hier après-midi. En débarquant, j’ai acheté le Jornal de Angola à l’aéroport. La nouvelle, brève, sèche, se trouve dans la page culture :
– Le Seripipi voyageur est mort : Faustino Manso, quatre-vingt-un ans, est décédé hier à l’aube à la clinique Sagrada Esperança, sur l’île de Luanda, après une longue maladie. Manso, que ses admirateurs appelaient le Seripipi voyageur, fut un musicien très populaire pendant les années 60 et 70, pas uniquement en Angola, mais dans toute l’Afrique australe. Il a vécu dans plusieurs villes angolaises et aussi au Cap, en Afrique du Sud, et à Maputo, qui s’appelait alors Lourenço Marques. Il est revenu à Luanda où il était né, en 1975, immédiatement après l’Indépendance. Il a été fonctionnaire à l’Institut national du livre et du disque pendant de nombreuses années. Il laisse une veuve, Mme Anacleta Correia da Silva Manso, ainsi que trois enfants et douze petits-enfants.
Les pages de la nécrologie sont plus éloquentes. Quatre faire-part mentionnent le nom de Faustino Manso. Le premier est signé par Anacleta Correia da Silva Manso. C’est le plus long. La photo elle aussi est un peu plus grande et plus récente. Il dit :
“Tu es parti sans un dernier adieu, mon mari, le soleil s’est éteint dans ma vie. La voix magnifique s’est tue : qui chantera désormais pour moi pendant que je brode ? Tu m’as trompée, tu m’avais promis que tu resterais avec moi jusqu’à ce que ma fin arrive et que tu me donnerais la main pour que je n’aie pas peur. Maintenant, c’est de la peur que je ressens. À la fin tu m’as de nouveau abandonnée et le voyage est si long. Je ne sais pas si je parviendrai à te pardonner.”
Le deuxième est signé par les trois enfants, N’Gola, Francisca (Cuca) et João (Johnny). La photo montre Faustino Manso serrant une guitare dans ses bras.
“Cher père, nous nous sommes connus tard, mais heureusement pas trop tard. Tu es parti, mais tu nous as laissé tes chansons. Aujourd’hui nous chantons avec toi : Aucun chemin n’a de fin loin de tes bras.”
Le troisième et le quatrième faire-part m’ont prise au dépourvu. Je me suis assise, étourdie, sur ma valise. J’ai demandé à Mandume d’aller m’acheter une bouteille d’eau. Je crois m’être rendu compte de la chaleur seulement alors. Elle montait du sol, humide et dense, elle se collait à la peau, s’enroulait dans les cheveux et était acide comme l’haleine des vieillards. Une certaine Fatita de Matos, à Benguela, signe le seul faire-part sans photo. Le texte est court, mais explicite :
“Ne pas aimer est un péché. Ne pas aimer jusqu’au bout de l’amour est un péché encore plus grand. Je ne me repens de rien, Tino, mon seripipi. Repose en paix.”
Sur le dernier faire-part, mon père pose pour la postérité, dans la vigueur de ses trente ans, assis à une table de bar. Une bouteille de bière est posée devant lui. On en distingue l’étiquette : Cuca. Pendant que j’écris ces lignes, moi aussi je bois une Cuca. Elle est bonne, très légère et fraîche. Je relis le texte :
“Père chéri, embrasse maman quand tu la rencontreras. Leopoldina a attendu cette caresse si longtemps. Dis-lui que vous manquez à ses enfants, à vos enfants, mais qu’ils pensent à vous tous les jours et que votre exemple de courage et d’honnêteté nous guide et nous guidera toujours. Notre village est plus triste sans la gaieté de ta contrebasse. Qui en jouera à présent ? Tes enfants : Babaera et Smirnoff.”
Les parents de Mandume se sont mariés à Lisbonne en 1975, tous deux avaient vingt ans. Marcolino faisait des études d’architecture et Manuela voulait être infirmière. Ils devaient être assez naïfs et le sont encore aujourd’hui. Manuela m’a dit :
– À l’époque nous étions tous nationalistes, on aurait dit une maladie. Nous haïssions le Portugal. Nous voulions finir nos études et retourner dans la tranchée solide du socialisme en Afrique.
Manuela m’a fait écouter de vieux disques en vinyle de musique angolaise. Plusieurs chansons font état de la tranchée solide du socialisme en Afrique. Littéralement, sans la moindre ironie. La bureaucratie portugaise n’a pas accepté que le premier enfant du couple s’appelle Mutu, en hommage à un roi du plateau central d’Angola : Mutu-ya-Kevela. Il est devenu Marcelo à des fins officielles et Mutu pour la famille et les amis les plus proches. Mandume, le cadet, s’appelle en réalité Mariano, et Mandela, le plus jeune, Martinho. En 1977, année où Mandume est né, les deux frères de Marcolino ont été fusillés à Luanda, après avoir été accusés de participation à une tentative de coup d’État. Marcolino a été bouleversé. Il n’a plus jamais parlé de retourner là-bas. Ses études terminées, il a trouvé un emploi dans le bureau d’un architecte, lui aussi natif d’Angola, il a demandé la nationalité portugaise et s’est consacré entièrement à son travail. J’ai fait la connaissance de Mandume il y a sept mois. Ce sont ses yeux qui m’ont d’abord attirée chez lui. L’éclat de ses yeux. Ses cheveux, séparés en petites tresses dressées en l’air, lui donnent un air de rebelle qui contraste avec la douceur de ses gestes et de sa voix. J’aime le regarder marcher. La disharmonie n’existe pas dans le monde où il se meut.
– Comme un chat ?
Aline, dans un souffle, lèvres humides, penchée sur la table. “Si on dit que quelqu’un avance doucement, les gens pensent aussitôt à un chat.” Non, chère Aline, Mandume ne ressemble pas à un chat. Il y a chez les chats, dans leur façon de se déplacer, une espèce d’arrogance, un dédain impérial de la pauvre humanité, et cela n’a rien à voir avec Mandume. Il est à la fois humble et plein de défi. C’est du moins ainsi que je le vois. Cela vient peut-être de mon regard. C’est peut-être de l’amour. Aline a ri, je me souviens qu’elle a ri lorsque je lui ai parlé pour la première fois de Mandume. Elle a un joli rire. C’est ma meilleure amie.
– Et Mandume, ça veut dire quoi ?
Mandume ? Ah, un autre roi. Un chef cuanhama qui s’est suicidé pendant une bataille dans le sud de l’Angola contre des soldats allemands. Mandume, mon Mandume, ne s’intéresse pas beaucoup au personnage historique à qui il doit son nom. Quand je lui ai demandé comment il s’appelait, il m’a dit :
– Mariano. Mariano Maciel.
Et c’est Mário, le technicien du son, un homme petit, pâle, très blond, avec des cheveux clairsemés mais longs, qui a rétorqué en souriant :
– Alias Mandume, le noir le plus blanc du Portugal.
Une phrase malheureuse. J’ai réagi avec violence :
– Ah oui ? Et c’est censé être un compliment ?
C’était censé être un compliment. Aujourd’hui je suis tentée de me rallier à l’avis du pauvre Mário et je me suis même servie de la même phrase contre Mandume. Il y a des moments où je me sens vraiment amoureuse de lui. À d’autres, cependant, je le déteste presque. Le mépris qu’il affiche à l’égard de l’Afrique m’agace. Mandume a décidé d’être portugais. C’est son droit. Je ne crois pas, toutefois, que pour être un bon Portugais, il faille renier tous ses ancêtres. Je suis certainement une bonne Portugaise, mais je me sens aussi un peu indienne ; finalement, je suis allée en Angola chercher ce qu’il peut y avoir d’africain en moi.
Mandume m’a accompagnée à contrecœur.
– Tu es devenue folle ? Qu’est-ce que tu vas faire en Afrique ?
En fin de compte, il est venu pour me sauver de l’Afrique. Il est venu pour nous sauver. C’est un amour, je sais, il faut que je sois plus patiente avec lui. De plus, il aime ce qu’il fait. Il passe son temps à me poursuivre avec sa caméra vidéo. Je lui dis de filmer ceci ou cela, il fait semblant de le faire, mais tout à coup je m’aperçois que c’est moi qu’il filme.