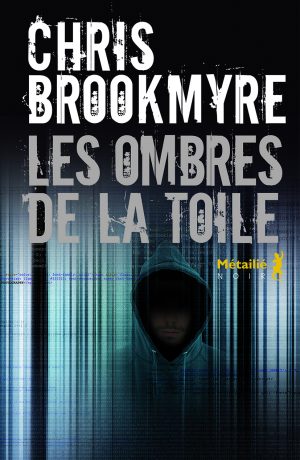« Depuis le début, je craignais que cette histoire ne me mène en prison. Eh bien, j’avais raison. Bon, je spoile pas grand-chose, hein ? Ce qui compte surtout, c’est comment j’ai terminé ici. »
Ils se méfient l’un de l’autre mais vont devoir s’allier pour survivre.
Comment, à dix-neuf ans, peut-on renoncer à l’université alors qu’on a un vrai talent pour l’informatique ? Parce que votre mère est en prison pour trafic de drogue ? Pour céder au chantage qui vous pousse à l’espionnage industriel ?
Et comment, alors qu’on était un brillant journaliste d’investigation, retrouver sa crédibilité après une énorme erreur ? En travaillant pour un nouveau site d’information en ligne, mais sous la menace d’une source anonyme ?
Une association entre gens à problèmes peut-elle aboutir à des solutions ? S’engouffrer dans les zones les plus périlleuses d’Internet est peut-être une issue.
Chris Brookmyre construit un thriller implacable sur le contraste entre la vie sur la Toile et la « vraie » vie. Il fait monter le suspense à des niveaux presque insupportables et nous manipule jusqu’à un dénouement machiavélique. Une expérience de lecture inquiétante, jouissive.
-
"Ce roman est une véritable réussite du début à la fin sans temps mort. Brookmyre tisse sa toile pour mieux nous piéger. Je n’y connais pas grand chose en cybercriminalité et espionnage industriel mais même si parfois c’est un peu confus pour moi, je n’ai pas pu décrocher. J’adore la relation presque "filiale" entre Jack et Sam. Et puis ça va vite, de l’action, des rebondissements, on vibre avec les personnages. Du très grand art. Un mélange d’ Eric Ambler, Blake et Mortimer et Maurice G. Dantec".Alain Broutin
-
"Encore une fois, Chris Brookmyre nous emporte dans un thriller rythmé et palpitant dont il a le secret. Au coeur de son intrigue ? Une affaire d'espionnage industriel orchestrée par un hacker sans scrupules. Et plus les fils se nouent et se dénouent, plus les pages de tournent avec frénésie."Christophe Gilquin
-
"Dans cet exquis roman policier mené de main de maître, Chris Brookmyre, écrivain écossais, nous plonge dans les méandres complexes de l’espionnage industriel et du piratage informatique. Autour de deux personnages tranchés, complémentaires et captivants, Les ombres de la toile dessine une cartographie glaçante d’un engrenage aux ramifications nombreuses et pernicieuses. Un polar documenté et électrisant !"Anne-Sophie Poinsu
-
"Le problème avec le thriller c’est qu’on sait exactement ce qu’on veut y trouver mais qu’on a tout de même besoin et envie d’être surpris. Same but different. C’est exactement ce que nous offre Chris Brookmyre avec ce nouveau roman traduit en français chez Métailié. On l’avait découvert et aimé avec Sombre avec moi il y a un an ou deux chez le même éditeur et on retrouve ici avec bonheur le même sens du récit et cette capacité à construire des intrigues haletantes. L’intrigue nous emmène cette fois dans l’univers des hackers. Que ceux et celles qui auraient comme moi des difficultés à poster une simple photo de vacances sur facebook ne fuient pas, parce que le roman ne vise absolument pas un public de geeks. C’est davantage la confrontation entre la vraie vie et l’existence sur la toile qui est au cœur du propos. L’un des deux personnages principaux, Sam, une gamine de 19 ans en proie à une situation familiale pour le moins difficile, peu sûre d’elle dans la vraie vie devient buzzkill, hacker redouté dès qu’ elle ouvre un ordi. Victime d’un chantage de la part d’un inconnu sur la toile, elle va elle-même pousser un vieux de la vieille du journalisme à devenir son complice dans une grosse affaire d’espionnage industriel. Le roman est rythmé, le personnage de la jeune hackeuse –qui est aussi la narratrice- est complexe et attachant, il y a le minimum syndical de rebondissements et on découvre (je découvre en tous cas) un univers dont j’ignorais à peu près tout. Tout à fait recommandable, donc."Yves Martin
-
"Les ombres de la toile est un thriller de son temps, totalement ancré dans son époque, ses caractéristiques, ses angoisses, ses obsessions. Connecté, rythmé, original, transgressif, mais aussi humain." Lire la chronique iciBlog Emotions
-
"Un roman étonnant sur les coulisses du hacking, du piratage informatique et de l’espionnage industriel." Lire la chronique iciSite Addict Culture
-
"Une intrigue intense, des rebondissements palpitants, des personnages attachants : voici les ingrédients de ce thriller 2.0 qui ravira sans aucun doute les amateurs de suspense et d’action." Lire la chronique iciBlog L'oeil noir
-
"Si vous cherchez une lecture hautement addictive, n’hésitez pas !" Lire la chronique iciBlog Livr'escapades
-
"Une lecture passionnante aux nombreux rebondissements et aux twists incessants." Lire la chronique iciSite Les obsédés textuels
-
"L’écrivain de Glasgow est un technicien hors pair, une plume sachant dérouler une intrigue avec humanité et tension. Le contre-la-montre de la narration procure l’adrénaline nécessaire et fait des Ombres de la toile, un polar moderne, réaliste et original."Christophe LaurentSettimana (Corse Matin)
-
"Chris Brookmyre signe un technothriller captivant autour d’une jeune hackeuse et d’un reporter sur le retour, beau duo improbable." "Ce roman captivant présente toutefois des défauts mineurs, par exemple d’inutiles secrets de famille augmentés par la symbolique pesante de l’atavisme - le trop-plein étant l’ennemi du bien. Mais cela n’entame guère l'immense plaisir pris à la lecture des Ombres de la toile, où le suspense est tendu comme le fil du funambule tout au long d’une aventure vouée à chaque instant à précipiter la chute des héros."Macha SéryLe Monde des Livres
-
"On dévore avidement ce pavé de plus de cinq cents pages tant il tient en haleine." Lire la chronique iciSite Zibeline
-
"Pour les fans de Chris Brookmyre, c’est une lecture indispensable. Pour ceux qui ne connaissent pas son style, mélange d’humour, de critique sociale et d’action, ce roman est une excellente introduction à son oeuvre et à son personnage."Jérôme DejeanPAGE DES LIBRAIRES
-
"Brookmyre échafaude une intrigue retorse à plaisir sur un fond de réalisme robuste : quels que soient les milieux traversés ou effleurés (médias, banques, hacking, inégalités sociales made in UK...) le roman ne perd jamais sa veine documentée, ce caractère old-school, mais pas désuet, de miroir du monde."Damien AubelTransfuge
AU BOUT DU BOUT
Il n’a jamais vu un froid si froid, pénétrant et impitoyable. Un froid qui l’enveloppe complètement, comme l’étreinte d’un spectre, et qui le broie.
Ses membres sont paralysés, des spasmes saccadés les parcourent encore, minuscules échos des convulsions qui l’ont réduit à l’impuissance, et il voit son souffle étranglé, comme guindé, s’échapper de sa bouche en fines volutes. La douleur palpite encore dans tout son corps, de ses organes internes jusqu’au bout de ses doigts. Ses oreilles bourdonnent, et des explosions dansent dans ses yeux comme un feu d’artifice miniature.
La température est si basse qu’il a l’impression que l’air a des milliers de dents qui lui cisaillent la peau, mais le pire, c’est ce qu’il y a sous lui. Le sol est comme un immense radiateur inversé, aspirant sa chaleur par tous les points de contact, et comme il est allongé à plat sur le dos, cela équivaut à près de la moitié de la surface de son corps.
Penché sur lui, son assaillant le contemple à travers le visage au sourire inexpressif d’un masque blanc à la Anonymous.
Il lui semble apercevoir un éclat fugitif au creux d’une main gantée de noir, l’espace d’un court instant, puis plus rien. Difficile à dire, au milieu de tous les éclairs qui agitent son champ de vision, conséquences de la décharge envoyée par la matraque électrique.
– Je veux que tu saches pourquoi il t’arrive ça, et je veux que tu comprennes pourquoi ça arrive maintenant.
Il y a tellement de colère dans la voix, une colère qui trahit des années de haine ; des années d’attente.
Comment a-t-il pu ne pas voir venir cette trahison ?
Comment a-t-il pu foncer tête baissée dans ce piège ?
– Tu as cru que tu t’étais réinventé, pas vrai ? Que t’avais rétabli pour de bon ta réputation ? Je voulais te laisser toucher du doigt cet avenir meilleur. Je voulais te laisser croire que tu allais redevenir ce que tu étais avant… avant de t’enlever tout ça.
Tout là-haut, sur le mur, il repère l’objectif sombre d’une caméra de surveillance, et, en la voyant, une évidence plus froide encore que le sol s’empare de lui. Il comprend, trop tard, la signification de ce masque, sa fonction pratique
plutôt que symbolique. I
C’est le masque qui vient confirmer que ce qu’il a cru
entrapercevoir est bel et bien une lame.
C’est le masque qui lui fait comprendre qu’il est sur le point de mourir.
CELLULE DE LIAISON (I)
Depuis le début, je craignais que cette histoire ne me mène en prison. Eh bien, j’avais raison.
Bon, je spoile pas grand-chose, hein ? Je veux dire, cette partie-là, nous la connaissons déjà toi et moi. Ce qui compte surtout, c’est comment j’ai terminé ici.
Je vais tout te raconter, et pas question d’édulcorer les choses pour ménager qui que ce soit. Il faut que je sois totalement honnête, si je veux de l’honnêteté en retour. Je te préviens tout de suite : une grande part de ce que je m’apprête à te raconter sera difficile à entendre, mais j’ai besoin que tu comprennes certaines choses sur moi. Tu vas me détester pour ce que j’ai pu faire ou dire à certains moments, et ce ne sera pas toujours flatteur pour toi non plus, mais il est important que tu saisisses à quoi toute cette histoire a pu ressembler, de mon point de vue à moi.
Ce qui ne veut pas dire, d’ailleurs, que je ressens la même chose aujourd’hui ni que j’avais raison de penser ce que je pensais alors. C’était comme ça, c’est tout – tu comprends ?
Je pourrais commencer à un tas d’endroits, mais il faut que je fasse attention. Certains choix pourraient donner l’impression que je lance des accusations, alors qu’il n’en est rien. Je sais qui est responsable de tout ce qui est arrivé. Plus la peine d’essayer de tromper qui que ce soit. Alors je ne remonterai pas jusqu’à l’enfance, ni jusqu’à la mort de mon père, ni même jusqu’au jour où la police a fait une descente dans l’appartement et a trouvé une grosse cargaison de came et un flingue. Parce que ça n’a rien à voir avec tout ça, enfin, pas vraiment. Pour moi, tout a commencé
il y a quelques semaines, alors que je me trouvais dans une salle d’attente, en train de regarder une bombe à retardement humaine.
LA VOYANTE
Je sais que l’homme va exploser plusieurs minutes avant que l’incident n’arrive. Ce n’est qu’une question de temps. Il est assis en face de moi dans la salle d’attente, il n’arrête pas de bouger sur le banc en plastique, ses membres sont dans un état d’agitation permanent ; des sursauts brusques, des mouvements convulsifs battant un code que je ne sais que trop bien déchiffrer. Sa tête est une boule de cheveux hirsutes, ses locks empêtrées fusionnant avec une barbe assez fournie pour équiper tout un bus de hipsters. Son regard se pose sur moi toutes les deux ou trois secondes, ce qui m’inspire un mélange de gêne et de peur, même si je sais qu’il n’en a pas après moi en particulier. Ses yeux n’arrêtent pas de mitrailler la salle dans tous les sens, sans jamais se fixer plus d’une seconde sur quoi ou qui que ce soit, comme une mouche qui ne se pose pas assez longtemps pour qu’on puisse l’écraser.
Pour éviter de croiser son regard, je fixe un point sur le mur au-dessus de lui, là où une série d’affiches me dévisagent froidement. Elles semblent toutes destinées à menacer les gens, à part celle qui les encourage à dénoncer leurs voisins. “Le filet se resserre”, annonce l’un de ces posters. “Fraudeurs aux prestations sociales : notre technologie vous suit à la trace”, prévient un autre. “Savez-vous que vous êtes suivi ?” demande un troisième. Tous comportent des portraits photographiés d’en haut, selon un angle abrupt qui donne l’impression que les gens sont minuscules et acculés dans un coin, plantés à l’intersection de plusieurs cercles concentriques. Pour bien enfoncer le clou, une autre affiche montre une flèche venue se planter dans le mille : “Fraudeurs, vous êtes ciblés.”
Même moi qui n’ai rien fait de mal, je me sens intimidée, coupable. Le simple fait de m’asseoir ici me donne l’impression d’être une criminelle. J’ai longuement répété les mots que je m’apprête à prononcer, je les ai retournés dans tous les sens devant le miroir de la chambre. Je connais mes arguments par cœur, et je me suis efforcée d’anticiper les réponses probables des fonctionnaires. Je me sentais en pleine possession de mes moyens en quittant l’appartement et j’ai continué de me motiver durant tout le trajet, mais à présent je me dis que c’est foutu d’avance. Que je perds mon temps. Je voudrais m’en aller, partir en courant, mais je ne peux pas. J’ai besoin de cet argent. J’en ai désespérément besoin.
Je jette un coup d’œil vers le guichet. Au-dessus de la femme qui tient la réception est affiché un poster où l’on peut lire : “Au Royaume-Uni illégalement ? Rentrez chez vous ou vous risquez l’arrestation.” Un texte en gras annonce qu’il y a eu “86 interpellations la semaine dernière dans ce quartier”. Il n’y a pas d’êtres humains sur ce poster, mais s’il y en avait, je sais à quoi ils ressembleraient : ils me ressembleraient à moi.
Je pense aussitôt à la “Nation Unie” paternaliste, chère au parti conservateur. À leur projet de “Grande Société”.
Je sais quelle affiche ils voudraient imprimer, en réalité. On y lirait ces mots : “T’es pas assez blanc pour vivre ici ? Eh bien alors, va te faire foutre ! Retourne chez les sauvages !”
Une femme ressort des salles d’entretien et se dirige d’un pas traînant vers la porte d’entrée, sans relever les yeux. On devine que ça ne s’est pas très bien passé pour elle. Elle est bientôt suivie d’un des membres du personnel : un type blanc aux cheveux gris.
Une Chinoise est également en charge des entretiens. L’heure de mon rendez-vous est déjà dépassée d’une demiheure, et le type aux cheveux gris et elle sont sortis deux fois de leur bureau depuis que je suis là. Je les observe attentivement.
J’espère que j’aurai la Chinoise. Elle a l’air détendue, bien qu’un peu fatiguée. Le type aux cheveux gris est comme un ressort compressé.
Il appelle un nom et l’agité de la salle d’attente se lève. Il se dirige vers les salles d’entretien en suivant Cheveux Gris, qui l’a à peine regardé. Une partie de moi est soulagée que Cheveux Gris soit maintenant occupé, car je dois être la suivante, mais la partie de moi qui déchiffre les gens sait qu’un drame ne va pas tarder à se produire.
La Chinoise sort de nouveau et je me redresse sur ma chaise, priant pour qu’elle appelle mon nom. Mais ce n’est pas le cas.
D’autres personnes viennent nous rejoindre et occupent les places libres sur les bancs. Nous sommes une douzaine dans la salle et la seule à parler est une femme, dans un coin, qui essaie d’empêcher son fils de donner des coups de pied. J’ai pourtant la sensation d’une cacophonie grandissante, qui amplifie mon anxiété. Ces gens ont beau ne rien dire, je sens toutes leurs tensions, leur colère, leur peur, leur souffrance.
J’ai toujours eu un don pour deviner l’état d’esprit véritable des gens, en dépit de ce que leur visage et leur voix s’efforcent d’exprimer. J’arrive à lire leurs expressions, leurs micro-gestes, leur langage corporel, le ton qu’ils emploient. Ça me vient si naturellement qu’il m’a fallu longtemps pour me rendre compte que tout le monde ne distinguait pas ces choses-là.
Parfois, ce don est une bénédiction mais, ce jour-là, c’est comme s’ils étaient tous en train de me hurler dessus. Je suis dans une salle pleine de désespoir, où tout me dit que mes efforts sont voués à l’échec.
J’entends un vacarme de voix masculines qui va s’intensifiant, à peine assourdi par les murs très fins. L’un des deux hommes s’emporte de plus en plus, l’autre parle d’une voix basse mais insistante, autoritaire. Le premier hausse le ton, l’autre ne se dérobe pas. Une force inarrêtable, contre un objet indéplaçable. J’entends un bruit strident, comme une chaise raclant le sol. Une alarme retentit et, tout à coup, des employés que je n’ai jamais vus surgissent des bureaux voisins et se précipitent vers la salle d’entretien. L’un d’eux est un agent de sécurité. J’entends plusieurs chocs sourds, des bruits de pied heurtant des meubles, des voix criant de rage ou de panique, ou bien hurlant des ordres. Une voix tonitruante demande au type agité de se calmer. Autant essayer d’éteindre un incendie avec de l’essence à briquet.
Je suis terrifiée. Je sens les larmes couler sur mes joues. Je voudrais m’en aller mais je sais que si on appelle mon nom et que je ne suis pas là, j’aurai tout foutu en l’air.
Les cris se font plus forts, les mots enragés de l’agité dégénérant jusqu’à n’être plus qu’un rugissement, qui cède lui-même la place à un gémissement assourdi une fois sa rage épuisée. Aussitôt après, l’homme est raccompagné dehors. Il a l’air sonné et engourdi, comme s’il ne savait plus très bien où il se trouve. Il pleure.
Cheveux Gris reste planté là à le regarder s’en aller pendant quelques instants et laisse échapper un long soupir, appuyé d’une main ferme contre l’encadrement de la porte. Quelqu’un lui demande s’il veut faire une pause. Il fait non de la tête. Il est évident qu’il en aurait besoin, mais ce qu’il veut, je le perçois clairement, c’est évacuer sa frustration, exercer son pouvoir. Il disparaît dans la salle d’entretien puis en ressort au bout de quelques secondes.
– Samantha Morpeth, aboie-t-il.
MÉCHANTS
Cela ne prend qu’une poignée de minutes ; moins de temps qu’il n’en a fallu pour maîtriser l’homme agité.
Je m’assois, séparée de Cheveux Gris par un bureau qui porte désormais sur un côté plusieurs traces, des marques de semelle. Je suis assez près de lui pour lire son badge. Assez près pour sentir sa sueur.
Il s’appelle Maurice Clark. Son visage ressemble à une porte qu’on viendrait de claquer. Des papiers sont éparpillés sur le plancher de son bureau, l’air de cette pièce semble encore perturbé par la fureur de l’agité. Je devine qu’on pourrait en dire autant de l’intérieur du crâne de ce Maurice Clark. Si je lui demandais de répéter mon nom, qu’il vient tout juste d’appeler, il l’aurait sans doute oublié.
– À cause du changement de situation de votre mère, elle n’a plus droit à l’allocation Aidant familial. Raison pour laquelle les versements ont été suspendus. C’est très simple.
Il dit tout cela avec délicatesse, mais je décèle une touche de mépris. La délicatesse n’est en fait qu’un moyen de mieux faire passer la pilule.
– Oui, mais c’est moi qui devrais toucher cette allocation désormais, et le transfert n’a pas été fait.
Toute ma préparation et mes répétitions n’ont servi à rien. Dès que j’ouvre la bouche, ma voix donne l’impression de remonter du fond d’un puits : timide et étouffée, manquant de conviction. C’est toujours la même chose quand je suis confrontée à des gens comme lui : des gens investis d’une autorité, des gens en colère, des gens agressifs. Je suis incapable de gérer ce genre d’affrontement. Aussitôt, je me ratatine et je m’efface.
Par contraste, Maurice Clark semble gagner en volume sonore, en stature et en fermeté.
– Le transfert n’a pas été fait parce que vous non plus, vous n’avez pas droit à cette allocation.
– Mais c’est moi qui…
– Mademoiselle Morpeth, les règles sont très claires : à partir du moment où vous travaillez ou étudiez à plein temps, vous ne pouvez pas solliciter cette aide.
– À plein… mais je suis juste au lycée.
Au moment même où les mots sortent de ma bouche, étriqués et rauques, je sais qu’ils ne serviront à rien.
Clark m’enveloppe d’un regard qui me fait comprendre que je viens justement de confirmer ce qu’il disait. Il s’en fiche. Il a mal. Il est contrarié. La seule chose que ce type a envie de faire, là, maintenant, c’est dire non. Même s’il existait un moyen pour lui de m’aider, il n’en ferait rien.
Toutes les choses que j’étais censée dire deviennent comme des gribouillis illisibles dans mon esprit, et le papier sur lequel ils sont écrits est en train de brûler. Je sens les larmes couler à nouveau. Je suis nulle. Je suis pathétique. Une putain de victime.
Je quitte le bureau des allocations avec la même démarche vaincue que la femme de tout à l’heure, comme si je portais ce foutu Maurice Clark sur mes épaules. Mais en ressortant dans la rue principale, un coup d’œil à mon portable m’apprend que, malgré mon peu d’envie de le faire, je vais devoir accélérer le mouvement. Au bout du compte, j’ai attendu près de trois quarts d’heure un entretien de deux minutes, et maintenant je suis en retard. La Loxford School se trouve à une bonne demi-heure d’ici, et il est déjà quatre heures moins vingt-cinq.
Instinctivement, je me demande à quelle heure passe le prochain bus, puis me rappelle que je n’ai plus les moyens de m’offrir ce luxe.
Toutes les implications commencent à se dessiner. Je me sens accablée sous leur poids, mais ralentir le pas est tout à fait exclu. Cheveux Gris a énoncé clairement la chose : si je veux toucher l’allocation Aidant familial, je vais devoir laisser tomber l’école. Je ne pourrai pas passer mon examen de fin d’année, mais ça ne changera rien, finalement, étant donné que la fac n’est plus, de toute manière, une option envisageable.
C’est peut-être une fausse impression, mais il m’a semblé que ce type aurait pu me dire autre chose. Dans un bon jour, il l’aurait peut-être fait. À moins qu’il ne soit toujours aussi con.
Je baisse la tête, écouteurs en place. J’élimine le monde alentour tandis que je me précipite au long du trottoir, slalomant entre les gens sortis faire du shopping, les poussettes et des troupeaux entiers d’employés de bureau en pause cigarette. Je ne relève la tête qu’une fois arrivée au carrefour. C’est là que je les vois : Keisha, Gabrielle et toute la bande. Pire encore : elles m’ont vue. Je ne peux pas changer de trottoir pour les éviter. Je sais qu’elles traverseraient aussi, et le fait qu’elles m’aient vue m’enfuir aggraverait mon cas. Genre, tu cours, alors elles doivent te rattraper. C’est la règle.
Je regrette de ne pas avoir Lilly avec moi. Là, elles ne m’auraient pas embêtée. Mon Dieu, c’est tellement pathétique de se planquer derrière elle. Mais bon, ce ne serait pas la première fois.
Je lis la joie mauvaise sur les traits de Keisha, même à vingt mètres de distance. Je n’ai pas la force de supporter ça aujourd’hui, en plus de tout le reste, et je n’ai pas le temps de me laisser intercepter. Je ne peux pas arriver en retard.
Mais, alors, les dieux me sourient. Un bus ralentit à l’approche du feu rouge et, sans réfléchir, je saute à bord. Comme il reprend sa course, je vois Keisha et Gabrielle qui me regardent depuis la rue avec une expression de satisfaction sadique au visage. Elles ont très bien compris ce qui vient de se passer.
Le bus me dépose devant l’école de Lilly avec un peu d’avance, mais en jetant un œil à travers le portail, je ne peux pas m’empêcher de calculer ce que cela m’a coûté : ce que j’aurais pu acheter avec le prix du trajet, prélevé sur ma carte d’abonnement. À partir de maintenant, je n’aurai plus la moindre marge. Mais ce qui me fait vraiment mal, ce n’est pas ce que ce trajet en bus m’a effectivement coûté : c’est de m’être défilée devant Keisha et ses harpies. Ça, c’était une dépense évitable. L’impôt du lâche.
Je regarde sortir les premiers enfants, leurs fauteuils roulants qui émergent de la grande porte à double battant et s’engagent sur une rampe en pente douce. Les autres ne vont pas tarder à jaillir d’une autre sortie, qu’une barrière sépare du parking. Je suis toujours stupéfaite de la patience de tous ces gosses, alors que plusieurs d’entre eux sont chargés à bord de minibus, les plateformes hydrauliques hissant lentement leurs fauteuils, l’un après l’autre. Moi, je ne pourrais pas supporter ça : être aussi impuissante, attendre une éternité tous les jours, contempler tout ce temps perdu. L’un des minibus se dirige vers la garderie du Nisha Leyton Centre, un centre de jour qui accueille les adultes
en difficulté d’apprentissage.
Je me rends compte alors qu’une autre tâche m’attend sur la longue liste de choses dont je dois m’occuper de toute urgence. Il va falloir que je trouve un boulot, et ils ne courent pas les rues, ceux qui me permettront de me barrer vers quinze heures trente tous les jours pour pouvoir venir me planter là, consciencieusement, devant le portail de la Loxford School, et récupérer ma petite sœur.
Être là pour Lilly pourrait être le titre de ma courte et ennuyeuse autobiographie. Pas de doute, j’ai l’impression que c’est l’histoire de toute ma vie.
Nous avons tellement été trimballées à droite et à gauche dans notre enfance que c’était déjà difficile de trouver ma place et de me faire des amis à chaque nouvel endroit. Alors, avec Lilly qui me suivait partout… Les autres gamins ne m’ont jamais considérée comme un individu : ils voyaient d’abord la petite fille trisomique, et sa grande sœur faisait juste partie du package.
Parfois, je leur disais : “C’est ma demi-sœur”, par souci de me distinguer d’elle. J’en ai toujours eu honte par la suite et, encore aujourd’hui, ça fait mal de m’en souvenir. De toute façon, c’était débile : la moitié des gosses avec qui j’allais à l’école avaient des frères et sœurs nés de pères et de mères différents.
Lilly apparaît, portant un carton à dessin – celui-ci prend le vent et elle doit se concentrer pendant quelques secondes pour assurer sa prise. Je vois Lilly avant qu’elle ne m’ait vue. Je préfère toujours ça car je peux savourer le moment où elle réagit. Son visage s’illumine comme si elle ne m’avait pas vue depuis des jours, et alors, l’espace d’un instant, j’ai l’impression d’être la personne la plus importante dans la vie de quelqu’un.
Ces derniers temps, cet instant-là ne dure que jusqu’à ce que je me rappelle que c’est effectivement le cas. Désormais, Lilly n’a plus que moi.
– J’ai dessiné Batgirl. Elle se bat avec Harley Quinn. Lilly adore les comics, en particulier les super-héroïnes.
Elle fait le geste d’ouvrir le carton à dessin, mais je la coupe dans son élan en l’entraînant vers le passage piéton.
– Tu me montreras ça quand on sera à la maison. Il y a un peu trop de vent ici.
– Il est pas terminé. Je le finirai à la maison. J’ai besoin de nouveaux feutres. On peut acheter des nouveaux feutres ?
J’aimerais pouvoir répondre oui.
– Cassie est revenue à l’école aujourd’hui, après sa gastro ? Un changement de sujet suffit généralement. Lilly oubliera les feutres jusqu’à ce qu’elle soit à la maison, où elle se débrouillera avec ceux qu’elle a déjà ou, plus probablement, commencera un nouveau dessin.
– Oui. Elle va mieux.
Lilly ne dit rien pendant à peu près cent mètres, visiblement perdue dans ses pensées. Assez longtemps pour que je me fasse la réflexion que la question ne vient pas, cette fois. Mais elle finit par venir.
– Maman est rentrée à la maison ?
Je réprime un soupir, tâchant de ne rien montrer de ma frustration. Tous les soirs, nous devons en passer par là. Fait-elle semblant de ne pas comprendre ? Est-ce une manière de protester ? Alors je repense au temps que Lilly a mis à comprendre, pour son papa.
– Non, elle n’est pas encore rentrée. Elle ne rentrera pas avant longtemps. Elle te l’a dit, tu te rappelles ? Quand on est allées la voir.
– Mais pourquoi elle est là-bas ? Pourquoi elle rentre pas à la maison ?
– Parce qu’ils ne la laissent pas sortir.
– Pourquoi ils la laissent pas sortir ?
Je m’autorise un soupir. C’est ça ou je crie.
– Parce qu’elle est en prison, Lilly.