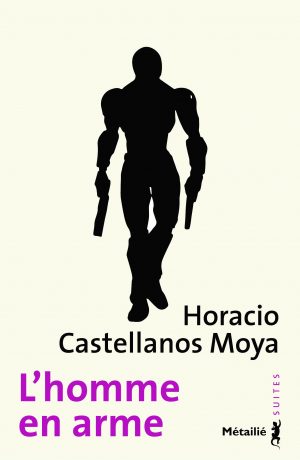Surnom : Robocop.
État de service : sergent dans le corps d’élite du bataillon Aca-huapa.
Démobilisé à la fin de la guerre civile en 1991 après les accords de paix au Salvador.
Juan Alberto García, ancien d’un escadron de la mort, souffre de son retour à la vie civile. La guerre est terminée sur le papier, mais en fait elle se poursuit dans les ténèbres de cette société opaque, et Robocop, qui ne connaît d’autre métier que celui de tuer, devient l’homme de main de diverses factions rivales.
Acide et haletante confession d’un homme sans âme pris dans l’engrenage d’un système corrompu.
Avec L’Homme en arme, Horacio Castellanos Moya dépeint sans pitié et avec un humour noir cruel les convulsions d’une société pourrie par la guerre et les injustices.
1
Les gars du peloton m’appelaient Robocop. J’ai fait partie du bataillon Acahuapa, des troupes d’assaut, mais, la guerre finie, on m’a démobilisé. Alors je me suis retrouvé comme l’oiseau sur la branche : à moi je n’avais que deux fusils Ak-47, un M-16, une douzaine de chargeurs, huit grenades à fragmentation, mon pistolet neuf millimètres et un chèque équivalent à trois mois de mon salaire, qu’on m’a donné comme indemnité.
Je suis arrivé au grade de sergent grâce à mes qualités ; mon école a été la guerre. Les instructeurs américains m’ont apprécié : ils m’ont envoyé une fois au Panama, suivre un cours intensif d’un mois ; une autre fois je suis allé à Fort Benning pendant deux mois, suivre un entraînement destiné aux gradés et aux sous-officiers. Mais quand le temps de la démobilisation est arrivé, quand nos chefs et les terroristes se sont mis d’accord, on m’a jeté à la rue. Pas de la même manière pourtant que le reste des hommes, à qui on n’a même pas dit merci. Nous, nous formions le corps d’élite, c’était nous qui étions les plus craints, qui avions stoppé et fait reculer les terroristes partout où nous les avions affrontés. Voilà pourquoi la démobilisation de notre bataillon a été un événement solennel qui a eu lieu en présence du président de la République, du ministre de la Défense et d’autres hautes autorités ; il y a eu un défilé, un passage en revue des troupes, des tirs d’artillerie et des discours où l’on reconnaissait notre intrépidité, le courage dont nous avions fait preuve pour la défense de la patrie, ce que nous signifiions pour les forces armées.
Les gars du peloton m’appelaient Robocop, mais dans mon dos. Devant moi ils devaient se mettre au garde-àvous et me dire “sergent”, et pas uniquement parce que c’était moi le chef, mais parce que aucun d’entre eux, que ce soit à poings nus, à l’arme blanche ou à l’arme à feu, n’avait jamais pu me battre ; et qu’aucun d’entre eux ne m’avait été supérieur en tactique et en intelligence. C’est pourquoi c’était moi qui donnais les ordres, même si au-dessus de moi il y a toujours eu un lieutenant, un capitaine ou un major commandant la compagnie – en réalité plusieurs lieutenants, capitaines et majors qui sont morts ou ont été mutés tout le long de la guerre.
J’ai été avantagé. Je ne suis pas un paysan mal dégrossi, comme la majeure partie de la troupe : je suis né à Ilopango, un quartier pauvre, mais dans la capitale ; et je suis allé à l’école jusqu’en troisième. Je suis remarquable pour autre chose que ma taille et ma corpulence. J’ai participé aux principales batailles contre les unités les mieux entraînées des terroristes ; aux opérations spéciales les plus délicates, celles qui impliquaient de s’enfoncer jusqu’aux profondeurs de l’arrière-garde ennemie. Je n’ai jamais été capturé ou blessé. Beaucoup d’hommes sous mes ordres sont morts, mais ça fait partie de la guerre – les faibles ne survivent pas.
J’ai passé huit ans à combattre, tout le temps dans le bataillon Acahuapa. La guerre finie, il y a eu une campagne pour discréditer notre corps, qui s’est poursuivie alors qu’on avait déjà été démobilisés. C’était de la propagande de terroristes : ils nous ont pris pour cible parce que nous les avions remis à leur place. On a aussi utilisé pour nous harceler le fait qu’une unité du bataillon a participé à l’exécution de prêtres jésuites espagnols. Mais le haut commandement nous avait choisis pour cette opération justement parce que nous étions les plus efficaces.
Je ne raconterai pas mes aventures au combat, je veux seulement qu’il soit clair que je ne suis pas un démobilisé quelconque.
2
Me convertir en civil a été difficile. Dès que le cessez-le-feu a été décrété, nous avons su que notre démobilisation était imminente. Je n’y ai pas cru. Les négociations me semblaient un stratagème et j’avais donc supposé que toutes ces parlottes des accords de paix constituaient une trêve, et qu’au bout de quelques semaines nous allions reprendre le combat, pour en finir une bonne fois pour toutes avec la subversion. C’est ce que j’avais expliqué à mes hommes. Mais j’ai peu à peu compris que je me trompais : la guerre était finie.
L’atmosphère était lourde dans les baraquements ces jours-là. Malgré les réunions au cours desquelles les chefs nous expliquaient les portées positives de la paix et présentaient des perspectives pour notre avenir, j’ai compris que ma vie était sur le point de changer, comme si j’allais soudain me retrouver orphelin : les forces armées avaient été mon père et le bataillon Acahuapa, ma mère. Je n’arrivais pas à m’imaginer converti du jour au lendemain en un civil, en un type au chômage.
Je me souvenais du moment où l’on m’avait recruté, au milieu de l’année 1983 ; j’avais vingt ans et je travaillais comme vigile dans l’usine de sous-vêtements féminins où ma mère avait été ouvrière. Je revenais de mon travail quand un barrage militaire a arrêté le bus à la sortie de Mejicanos : les soldats nous ont fait descendre et nous ont demandé des papiers d’identité, il y a eu fouille à la recherche d’armes ; ensuite, à moi et à trois autres types, ils ont donné l’ordre de monter dans un camion militaire. Dans la caserne San Carlos, après des tests et des examens, quand l’officier a constaté que je mesurais un mètre quatre-vingt-dix et pesais quatre-vingt-quinze kilos, il a donné l’ordre de m’affecter au bataillon Acahuapa.
Maintenant les chefs disaient que certains parmi les démobilisés allaient passer à différentes unités, que d’autres pourraient trouver du boulot dans les agences privées de sécurité et qu’il y avait aussi la possibilité de suivre des “cours de réinsertion” qui nous permettraient d’apprendre un métier. Mais la chose allait être plus difficile.
3
Je n’ai pas de famille dans le pays. Ma mère et mes deux sœurs ont filé aux États-Unis dès le début de la guerre, et quand elles ont appris que j’étais entré dans le bataillon Acahuapa elles n’ont rien voulu savoir de plus à mon propos. Elles ont adhéré à un comité de solidarité avec les terroristes, à Los Angeles. Mon seul parent était mon cousin Alfredo, à qui j’avais loué une chambre chez lui, dans les environs de Soyapango, pour y garder mon peu d’affaires le long de la guerre.
Alfredo était employé au ministère de l’Agriculture, et aussi indicateur de police. Quand on m’a démobilisé, je suis allé chez lui, avec mon sac à dos et le chèque, et je lui ai annoncé que j’allais occuper la chambre louée, je n’avais pas où aller. Il a dit qu’il n’y avait pas de problème et qu’il m’aiderait même à trouver du travail. Ce premier soir, étendu sur le grabat, avec la certitude qu’il n’y avait pas de retour aux baraquements, je pensais que grâce à Dieu j’avais eu la bonne idée de mettre de côté des fusils et des grenades, parce que maintenant ils allaient me servir à m’en sortir.
Les premiers jours ont été bizarres. J’avais l’argent de l’indemnité, mais je ne savais pas quoi faire. Les contacts avec mes compagnons étaient coupés. Je suis allé une fois au ministère de l’Agriculture avec Alfredo ; on nous a dit que la place de gardien était déjà occupée. Je passais mon temps allongé sur mon grabat, à ne rien faire, ou chez la niña Chole, à boire de la bière. Je me rendais aussi à La Piragua, un bordel à deux rues de chez Alfredo, où je me suis lié avec Vilma, une fille brune, menue, à la chair ferme et avec d’énormes fossettes. La troisième fois que je me suis retrouvé avec elle, elle m’a demandé de lui prendre une chambre pour qu’on dorme ensemble après le travail, mais les femmes sont traîtresses dans l’âme et je n’allais pas dépenser le peu d’argent que j’avais pour elle. C’est à La Piragua que j’ai rencontré Bruno Pérez, alias Pichojo, un type qui était passé dans mon unité et avait été mis dehors un mois avant la démobilisation générale. Il m’a dit qu’il faisait partie d’une association de démobilisés qui réclamaient leur indemnisation ; il m’a invité à les rejoindre. Je lui ai répondu que j’avais reçu un chèque équivalent à trois mois de mon salaire, dont il ne restait presque plus rien. Bruno a assuré qu’on m’avait donné une misère : en réalité, d’après les accords de paix, on aurait dû me verser un an de salaire ; je ne devais pas me laisser escroquer, les chefs s’étaient mis dans la poche le fric et avaient à peine réparti quelques miettes à certains d’entre nous. Je lui ai dit que je ne voulais pas participer à un mouvement contre les chefs des forces armées, qu’on pouvait considérer ça comme une trahison ; et que faire de la politique ne m’intéressait pas non plus. Bruno m’a dit d’y réfléchir, surtout à partir du moment où je n’aurais plus de fric, et qu’il viendrait me chercher ici-même, à La Piragua.
4
Mon cousin Alfredo était marié avec Guadalupe. Elle m’avait traité avec respect, avec sympathie même, tout le temps que j’avais fait partie du bataillon et que je leur avais rendu visite une fois tous les deux mois. Mais dès que j’ai été démobilisé et que j’ai emménagé chez eux, j’ai remarqué un changement dans son attitude : dans sa façon de me regarder, de s’approcher de moi. J’ai pensé que ça n’avait pas d’importance. Elle travaillait comme secrétaire dans un cabinet médical. Alfredo et elle partaient ensemble, tôt le matin, et revenaient déjà bien tard, toujours ensemble. Un beau jour elle a dit qu’elle allait rester à la maison, qu’elle avait mal à la tête, qu’elle avait un peu de fièvre, qu’elle était sûre que d’un moment à l’autre la grippe allait la mettre sur le carreau. Au milieu de la matinée elle m’avait mis dans son lit. Elle criait, possédée, que jamais elle ne s’était fait baiser par un homme aussi grand et aussi costaud que moi, qu’Alfredo était un pauvre type, incapable de la foutre enceinte, et qu’elle voulait avoir un enfant, que ça pressait. La semaine suivante il y a eu de nouveau un jour où elle s’est arrangée pour ne pas aller au travail, et elle a crié comme l’autre fois qu’Alfredo ne la satisfaisait pas, qu’elle avait besoin d’un vrai homme comme moi, quelqu’un qui la mette enceinte. La troisième fois, je m’en suis allé tôt le matin avec Alfredo, prétextant un entretien pour un emploi, mais en réalité j’allais retrouver Bruno et d’autres démobilisés : ils devaient m’expliquer leurs actions visant à se faire payer l’indemnité, telle qu’elle était prévue, par la hiérarchie des forces armées. J’y suis allé avec méfiance, comme si j’étais en train de me jeter dans un piège.
5
Nous étions environ une centaine de démobilisés des forces armées, réunis sur un terrain de basket, dans une école primaire située à l’extérieur de Mejicanos. Bruno m’a présenté ; une demi-douzaine des types qui étaient là avaient combattu sous mes ordres. C’était un ex-sergent du bataillon Belloso, du nom de Patiño, qui était le leader, ce que j’ai trouvé louche, parce que ce corps avait une réputation lamentable : une fois, les terroristes les avaient fait reculer jusqu’au Honduras ; ce n’était pas possible que ce ne soit pas quelqu’un de l’Acahuapa qui commande, ai-je dit à Bruno. Mais en écoutant le type j’ai compris qu’ici ce n’étaient pas le courage ou les capacités guerrières qui comptaient, mais au contraire le baratin, et nous, les gars de l’Acahuapa, nous étions les meilleurs combattants, pas des politicards.
Patiño a dit que l’assemblée devait prendre des décisions sur les relations avec le mouvement des infirmes de guerre et l’association des ex-guérilleros. Ça m’a déplu que l’on puisse envisager de s’allier avec nos ennemis. Je n’ai pas quitté la réunion parce que Bruno m’a prévenu que les autres pourraient penser que j’étais un infiltré des chefs qui nous avaient volés. Ensuite il a demandé la parole et dit que d’après lui c’était une trahison d’établir des relations avec ceux contre qui nous avions risqué notre peau pendant tant d’années, que cela discréditerait notre mouvement auprès des forces armées. Un groupe parmi les assistants l’a applaudi. Mais Patiño lui a tenu tête : les véritables traîtres, c’étaient les chefs militaires et les politiciens qui nous avaient lâchés et avaient fait main basse sur l’argent que la communauté internationale avait envoyé pour nous, et que la même chose était en train d’arriver aux ex-guérilleros et aux handicapés de guerre, qui n’avaient pas reçu un seul centavo malgré les promesses, et que le mieux était que nous unissions nos forces pour exiger ce qui nous revenait. J’ai compris que Patiño était un infiltré des terroristes et que l’état-major devait aussi compter de nombreux mouchards dans ce groupe. Mais, au point où j’en étais, je n’avais plus d’argent et j’avais besoin de cette indemnisation d’un an de salaire. C’est pourquoi, le lendemain matin, comme il avait été convenu entre nous, j’ai participé à la prise des bâtiments de l’Assemblée législative. Nous nous sommes concentrés sur plusieurs points proches de l’objectif et, de manière synchronisée, nous avons désarmé les gardiens et nous sommes emparés du bâtiment avec la plupart des députés à l’intérieur. C’était du gâteau. Je m’étais spécialement préparé pour ne pas être reconnu au cas où le gouvernement déciderait de représailles. J’ai enfilé une chemise de garde national et recouvert mon visage d’un passemontagne noir. J’avais mon neuf millimètres caché sous la chemise et une barre de fer avec laquelle j’ai fait voler en éclats des portes vitrées et menacé les députés qui avaient couru se réfugier au dernier étage. J’aurais bien voulu leur flanquer quelques coups, surtout aux ex-terroristes maintenant en cravate, mais l’occasion ne s’en est pas présentée. Ma mission consistait à rester sur la terrasse du bâtiment, afin d’éviter que les députés soient évacués par hélicoptère. Ce que je n’imaginais pas c’était l’impact que j’aurais sur la presse. Mon passe-montagne noir a été la sensation de la journée. Les photographes et les cameramen braquaient leurs appareils sur moi. Je suis apparu dans les bulletins d’informations télévisées et j’ai fait la une des principaux quotidiens du pays. Je me suis transformé en symbole des démobilisés ; et personne n’a su mon identité. L’idée du passe-montagne, je l’avais prise à un terroriste du Chiapas, célèbre à cette époque-là.
Patiño a eu une entrevue avec une commission de députés et des envoyés du gouvernement. Ils ont tous dit que l’indemnisation due nous serait versée, le problème était qu’en ce moment le gouvernement n’avait pas de liquidités, mais dès qu’arriverait le prochain versement de la communauté internationale nous aurions notre argent. Je continue encore à attendre le reste de mon indemnité.
6
Ma relation avec Guadalupe est devenue compliquée. Elle assurait être amoureuse de moi, qu’elle abandonnerait Alfredo, que j’étais l’homme de sa vie. Elle avait beau être maigre, avoir la peau blanche et les dents en avant, elle baisait voracement. Mais ça ne m’intéressait pas de nuire à Alfredo.
Il n’y avait qu’une façon de me débarrasser de Guadalupe. Je suis allé à La Piragua, où travaillait Vilma, et lui ai dit que je voulais louer une chambre pour qu’on vive ensemble, le problème était qu’en ce moment il ne me restait plus rien de l’argent de l’indemnité, mais dans quelques jours j’allais faire une excellente affaire. Elle en a été toute retournée, et elle a dit de ne pas m’inquiéter, le premier loyer elle le paierait, ensuite ce serait mon tour. J’ai donc emménagé dans une chambre dans le centre de Soyapango. Elle se trouvait dans une vieille auberge, mais avec porte donnant sur la rue. Bruno a déniché une voiture pour transporter mes affaires et mes armes. J’ai expliqué à Alfredo que je m’en allais vivre avec une femme, que je le remerciais de son hospitalité, qu’il pouvait compter sur moi pour ce qu’il voudrait. Il a dit que sa maison était toujours la mienne, et de ne pas manquer de venir leur rendre visite. Guadalupe, de mauvaise humeur, m’a dit au revoir avec une moue avant de s’enfermer dans sa chambre.
7
Bruno a été surpris quand il a découvert mes trois fusils et les grenades. Il a demandé si les armes appartenaient au bataillon. Je lui ai expliqué que je les avais récupérées sur des terroristes morts, au moment de l’offensive qu’ils avaient lancée en novembre 1989 ; je les avais cachées dans un terrain vague et quelques semaines après j’avais pu les prendre et les ramener chez Alfredo. Bruno a dit qu’avec ce petit arsenal on pourrait réaliser des coups pour avoir de l’argent. C’était ce que je pensais faire. Nous avions besoin d’une voiture, de trouver un objectif et de dresser un plan d’action. Nous devions commencer par la maison d’un de ces types pleins de fric où nous pourrions trouver du liquide, des bijoux et des objets de valeur, que Bruno se chargerait de vendre par l’intermédiaire de l’un de ses grands amis, son compadre.
Un vendredi, au milieu de l’après-midi, à l’entrée de Ciudad Delgado, nous avons mis la main sur une Volkswagen Golf toute neuve. La bonne femme qui la conduisait nous a suppliés en balbutiant de ne pas la tuer. Bruno a pris le volant. Nous avons abandonné la conductrice deux rues plus loin et nous nous sommes dirigés vers ma piaule. Nous avons fourré dans la voiture les deux fusils Ak, enveloppés dans un sac de toile, et j’ai glissé deux grenades dans ma veste en jean. Nous avons mis le cap vers l’ouest de la ville, là où vivent les types riches. Nous sommes montés par le Paseo Escalón. À l’heure qu’il était, la bonne femme avait dû déjà porter plainte à la police pour le vol de sa voiture. J’ai demandé à Bruno de prendre une des rues latérales, avant d’arriver au rond-point Masferrer. J’ai retiré les fusils de leur sac ; ils étaient montés, huilés, depuis la nuit précédente. Je lui ai dit de ralentir. Nous roulions presque au pas entre ces demeures. J’avais le fusil sur mes cuisses, attentif, attendant un pâté de maisons sans gardien. Vers l’extrémité de la rue, qui butait sur un ravin, il y avait quelques maisons plus petites sans murs d’enceinte ni gardiens. Une domestique, un tuyau à la main, arrosait le gazon, la porte du garage entrouverte. J’ai sauté de la voiture, à toute vitesse, le fusil en avant. Je lui ai dit que si elle n’obéissait pas elle était une femme morte. Elle est entrée dans la maison avec le canon planté dans les côtes. Je lui ai demandé combien il y avait de personnes dans la baraque. Elle a répondu qu’il n’y avait que les deux patrons, de pauvres gens âgés, et m’a supplié de ne pas lui faire de mal. Je lui ai donné un coup de crosse au niveau du cervelet. J’ai fait irruption dans le salon : une petite vieille tricotait sur le sofa. Je lui ai ordonné de se mettre debout et de me donner tout l’argent et les bijoux si elle ne voulait pas que je la tue. La vieille dame a dit quelque chose, à voix haute, comme si elle alertait quelqu’un d’autre, dans une langue que je n’ai pas comprise. Un vieillard corpulent a traversé le couloir d’une pièce à une autre. J’ai cru que l’individu voulait s’échapper. Mais quand je me suis approché de la porte il m’a reçu avec un coup de feu qui a sifflé à mon oreille gauche. Je me suis jeté au sol. J’ai rampé jusqu’à la chambre. Le vieux s’était retranché derrière le lit. Mon assaut ne lui a laissé aucune chance : je lui ai vidé la moitié d’un chargeur dans la poitrine. Je glissais le calibre quarante-cinq dans ma ceinture quand j’ai entendu la rafale dans le salon. Bruno a dit que la vieille avait essayé de fuir. Je lui ai dit qu’il fallait que nous partions, avec un tel boucan nous allions avoir du mal à nous en sortir. Et ça a été le cas : du coin de la rue un gardien nous a tiré dessus avec un fusil à canon scié. Quelques rues plus bas nous avons décidé de changer de voiture ; le type de la Nissan en est resté tremblant comme de la gelée. Nous avons pris la direction du centre-ville. Bruno était déçu : autant d’efforts pour un calibre quarante-cinq.
8
Je n’ai fait pas long feu avec Vilma. Les putes sont exigeantes, capricieuses. Elle quittait le bordel à l’aube, arrivait dans la chambre pour dormir avec moi jusqu’à midi, puis s’en allait chez sa mère où l’attendait sa petite morveuse. Une nuit j’en ai eu assez.
À ce moment-là, Bruno et moi avions fait deux coups, suffisants pour que je m’en aille loin de cette pute et de ce coin. J’ai loué une maison du côté de San Ramón, au pied du volcan, rien que pour moi. Les choses commençaient à aller mieux. En plus, j’ai conservé une des voitures, grâce à Néstor, le compadre de Bruno, qui nous achetait la marchandise, qui était propriétaire d’un garage et avait de bons contacts. Il m’a obtenu une immatriculation propre, a repeint la voiture en bleu et maquillé la carte grise. Je me suis trouvé vite fait propriétaire d’une Honda Civic, modèle 89.
Notre travail s’est spécialisé. Chaque semaine nous acquérions une voiture de luxe, dernier modèle, sur des indications précises, que nous remettions à Néstor, lequel la faisait disparaître à travers ses réseaux. Mais nous ne pouvions pas agir de but en blanc : les voitures appartenaient à des types pleins de fric toujours entourés de gardes du corps, et, en plus, elles avaient les vitres teintées. Il nous fallait observer et vérifier longtemps, jusqu’à ce que nous soyons sûrs que l’objectif était vulnérable, et alors nous passions à l’action. Nous cherchions le moment où le véhicule était conduit par une femme ou par des jeunes gens désarmés. Néstor nous a prévenus que nous travaillions pour un réseau puissant et que les opérations devaient être propres, sans effusion de sang. La règle était de ne pas poser de questions. On me payait deux mille colones par voiture ; Bruno recevait la même somme.
9
C’est à cette époque que j’ai rencontré Saúl, un sergent de première ligne, avec qui j’avais effectué l’opération la plus audacieuse de la guerre. Il s’agissait de liquider l’étatmajor des terroristes dans le district de Chalatenango. Le haut commandement a choisi une douzaine de combattants parmi les meilleurs, dont Saúl et moi, et nous a amenés en hélicoptère jusqu’à la caserne El Paraíso. L’opération était secrète. Les terroristes avaient relâché leurs lignes de défense, confiants en l’imminente signature de la paix. Le plan était simple, mais risqué. Le chef de l’état-major terroriste, le commandant Isaías, avait donné une conférence de presse la veille à San José Las Flores et, selon les rapports des services de renseignements, il devait mettre le cap vers Las Vueltas dans les deux jours. Nous devions nous infiltrer jusqu’à la route qui relie les deux agglomérations et tendre une embuscade au camion dans lequel les chefs terroristes étaient conduits. Nous devions marcher toute une nuit dans les lignes arrière de l’ennemi et sortir de la zone avant qu’on nous encercle. On nous a projeté des diapositives de la tête d’Isaías, et d’autres du camion, pour éviter les erreurs. Ils étaient quatorze terroristes, dont le chef, à voyager dans le camion, sans éclaireurs ni arrière-garde, très sûrs d’eux, à quatre heures du matin. Ils n’ont pas eu l’occasion de réagir : le tir de deux lance-grenades M-79, de deux mitrailleuses .30 et de nos fusils les a foudroyés en quelques secondes. Nous sommes même descendus les achever – Saúl a donné le coup de grâce à Isaías – avant de suivre notre plan de retraite. Pas un seul d’entre nous n’a eu ne serait-ce qu’une égratignure. Nous avons été reçus comme des héros à la caserne.
Saúl, je l’avais rencontré cette fois-ci dans une brasserie appelée Las Arcas, avant midi, quand il y avait à peine quelques clients. Il m’a salué, l’air content, il avait un peu grossi, mais avait gardé son profil d’Indien et ses petits bras de reptile. Moi, j’étais seul, luttant contre la gueule de bois. Il a parlé du bon vieux temps. Je lui ai dit que je n’avais pas de travail fixe, que je m’en tirais comme je pouvais, bricolant ici et là, la réinsertion avait été difficile. Saúl m’a raconté qu’il était en train de travailler avec le major Linares – qui avait été aussi mon supérieur dans le bataillon –, tous deux effectuaient des opérations spéciales, secrètes, organiquement détachées de l’institution, mais toujours dans le combat. Je lui ai demandé de m’en dire plus. Il a répondu qu’il ne pouvait pas, que c’était délicat, à moins que je ne trouve de l’intérêt à y participer, à parler avec le major Linares pour que luimême me l’explique. J’ai réfléchi un moment. Il n’y avait pas d’urgence, m’a-t-il dit, il ne s’agissait que de gagner quelques pesos de plus avec des choses qu’on savait déjà faire. Nous nous sommes mis d’accord sur un nouveau rendez-vous, dans cette même brasserie, à la même heure, deux jours plus tard.