Exilée à Marseille après avoir été sauvagement torturée par la police politique brésilienne, Lucina est enfin autorisée à revenir à Rio. La ville a changé, la dictature contrôle tout, même la géographie, à travers la spéculation. L'insouciance et la foi dans l'avenir sont en voie de disparition, de nombreux musiciens sont partis à Londres ou à Paris. Lucina découvre l'existence des pivetes, ces gamins des favelas que poursuivent les Escadrons de la Mort dirigés par Paulinho Domar, son premier amour devenu tortionnaire. Elle va tomber amoureuse de Thomas et déchaîner la jalousie de Paulinho.
Sur la toile de fond d'une ville qu'il aime passionnément, l'auteur mène avec tendresse ses personnages en les mêlant avec talent au petit peuple gouailleur de Rio. Dans l'atmosphère trouble de la fin de la dictature, trahisons, générosité, humour, saveurs, douleurs et passions se croisent au son des sambas tristes de Baden Powell.
-
, Marlene Alves Perreira, émission du 9 juin 2007RADIO ALIGRE
-
, Anita Fernandez, émission du 9 juin 2007LusitaniaRADIO LIBERTAIRE
-
, Maud de Bohan, émission du 28 mai 2007Le Jardin d'OrphéeFRANCE 3 MEDITERRANEE
-
, Thibault Gaudry, émission du 11 mai 2007C'est mieux le matinRADIO BLEU PROVENCE
-
, Mathilde Auvillain, émission du 8 mai 2007Livre comme l'airRADIO NOTRE DAME
-
, François Castang, émission du 31 mai 2007A portée de motsFRANCE MUSIQUE
-
« Un style langoureux et dénué d’effets les happe tous dans un tourbillon romanesque de haute qualité, à même de faire ressentir le tumulte de l’Histoire. »Hubert ArtusOPTIMUM -
« Dans le roman Samba Triste, qui achève sa trilogie brésilienne, Jean-Paul Delfino fait revivre les dernières années de la dictature militaire, celle de la décomposition. Passionnant et instructif. »
François EychartLES LETTRES FRANÇAISES -
« Ce bon petit roman fait découvrir l’histoire du Brésil depuis trente ans, ainsi que les méthodes sordides du SNI (les anciens services secrets brésiliens) et la montée en puissance du leader syndical Lula. Le tout relevé par les recettes savoureuses de la vieille mère de Lucina, qui le disputent en saveur aux engueulades de son anarchiste de père. »
Claire LesegretainLA CROIX
Je dédie ce livre à toutes les femmes et tous les hommes, victimes de la dictature économique, qui survivent dans une société où le verbe avoir l’emporte sur le verbe être et où la liberté individuelle s’arrête où commence la liberté d’entreprise.
“Ils se tenaient tous réunis, inquiets, mais seuls néanmoins, sentant qu’il leur manquait quelque chose, non seulement un lit chaud dans une chambre bien close, mais encore les mots tendres d’une mère ou d’une sœur qui feraient fondre leur frayeur. Ils se tenaient tous entassés et quelques-uns tremblaient de froid sous leurs chemises et leurs culottes en lambeaux.”
Jorge Amado, Capitaines des sables
PROLOGUE
Peu à peu, les voyageurs s’éveillaient. Dans le ventre bourdonnant du Boeing 737, ils sortaient du sommeil, un à un, les traits tirés par une mauvaise nuit, les cheveux en bataille, le visage hâve, cireux. Déjà, les premières cigarettes s’allumaient, les hôtesses chargeaient leurs chariots chromés de pots de café, de thé, de chocolat, de plateaux de viennoiseries en tout genre, de pichets de jus de fruits. Onze heures de voyage non-stop, depuis Paris et en direction de Rio de Janeiro. L’excitation du décollage et des premiers instants avait cédé le pas à une douce somnolence, bercée par le ronronnement grave des réacteurs. Jusqu’à tard dans la nuit, les voyageurs avaient joué à la dînette : apéritifs, repas, digestif, café, nouvel en-cas. Puis, les ampoules des plafonniers avaient insensiblement décliné, baignant l’habitacle d’une lumière jaune pâle. Et les voyageurs s’étaient assoupis.
– Maman, c’est bientôt qu’on arrive ?
Sans consulter son bracelet-montre, Lucina répondit à voix basse à la question ensommeillée de son fils :
– Dans une heure et dix minutes, mon amour.
– C’est long, pour aller au Brésil…
– Dors encore un peu. Je te réveillerai quand on arrivera.
Le petit Jorge esquissa un sourire dans sa somnolence et replongea sa tête le plus loin possible entre le sein droit et le bras de sa mère.
Derrière le hublot, le soleil commençait, lui aussi, à sortir de la nuit. On ne voyait encore que des panaches de nuages, d’un blanc bleuté, que la carlingue de l’avion survolait souplement. Çà et là, des faisceaux de lumière rougeoyante tentaient timidement de se frayer des chemins dans cette masse cotonneuse, cette étoupe céleste en suspension qui masquait au regard, plusieurs centaines de mètres plus bas, l’océan Atlantique.
Par la force des choses, Lucina avait appris à attendre. Lorsqu’elle avait fui le Brésil et s’était réfugiée à Marseille, elle avait su qu’il lui faudrait tout d’abord découper le temps qui passe en années avant de pouvoir imaginer reprendre pied à Rio de Janeiro. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. Puis, cet appel téléphonique de son père Zumbi, qui résonnait toujours à son oreille, alors qu’elle était en plein service au restaurant Chez Toine, sur le cours Julien, à Marseille. Au bout du fil, la voix de Bartolomeu, hilare, baignée de rires et de larmes, de murmures, de cris de joie, de délivrance. Ça y est ! La lettre est arrivée ! Une autorisation spéciale d’entrée sur le territoire brésilien, délivrée par le SNI* ! Avec le petit Jorge, ils peuvent rentrer au Brésil ! Ce n’est pas encore une amnistie à proprement parler, non. Le général Garrastazu Médici voit des terroristes communistes partout et il leur livre une guerre acharnée. Une sacrée ordure, celui-là… Mais c’est sûr, ils peuvent revenir sans crainte ! Dans le combiné, Lucina entend Elis, sa double mère, mère maternelle et Mère de saints, qui remercie en yoruba tous les dieux de l’Afrique. Et la voix de João, son parrain, qui hurle qu’il va lui envoyer les deux billets d’avion.
En ce 12 janvier, dans le restaurant du cours Julien, les mangeurs ne se sont aperçus de rien et continuent à parler, à rire et à bâfrer dans le claquement des couverts sur les assiettes et la sérénade corse qui coule des haut-parleurs. Mais Lucina n’entend plus. Les jambes coupées, le souffle court, le torse broyé par l’émotion, elle voit son univers qui tangue autour d’elle, se disloque par pans entiers, se gondole, plonge sous ses pieds et ressurgit aussitôt.
Ça y est…
Des images éclatent dans son crâne. Rio de Janeiro. Santa Teresa. Le Christ Rédempteur, au sommet du Corcovado. Ses années d’enfance, d’insouciance sucrée, fluide comme un lait de coco. Son père, le fier et rigolard Bartolomeu Zumbi, peintre, tireur de plans et joueur de cavaquinho**_. Sa mère, Elis la sage, Elis la douce, Elis qui sait lire l’avenir dans les cauris et parler aux orixas*. Et son parrain, João Domar, qui, comme elle, avait quitté Marseille pour se réinventer une vie au Brésil, dans les années 1920.
Ça y est…
À toute vitesse, le voyage dans le temps se poursuit. Ses études d’architecture, ses activités au sein de l’UNE**, son José et ses longs cheveux de bohème. Puis, images noires et violentes, glaciales, insoutenables, solarisées à l’extrême : son arrestation par les agents armés du SNI, son José froidement assassiné, son fils que l’on estropie pour la vie, sa fuite clandestine vers la France. Tout à reconstruire, à recréer.
Ça y est…
Et ces cinq années passées à Marseille, ville métisse comme Rio, ville populaire et forte en gueule comme Rio, ville pourtant étrangère à l’étrangère qu’elle fut, mais ville maternelle qui l’a aussitôt prise contre son sein, l’a nourrie, a fait refleurir dans son âme le désir de continuer à vivre et à lutter contre tous les pourris et les salauds du monde entier, les multinationales, les politiciens véreux, les militaires, les lâches du quotidien qui transforment l’Amérique latine, l’Afrique ou l’Asie en continents de tortures et de morts au nom de la toute-puissance de l’argent et au gré des décideurs intouchables des USA.
Oui, cette fois, ça y est…
Les cristaux de glace qui bordaient les hublots ont disparu. Serrant fort contre elle son petit Jorge, Lucina écarquille les yeux et se tord le cou pour ne rien perdre de ce Brésil qui, à ses pieds, va commencer à prendre forme. Les vrombissements des réacteurs se sont maintenant assourdis, le Boeing 737 pique lentement du nez, pénètre sans peine dans l’épaisse couche des nuages, planant au-dessus de l’océan Atlantique. Alors, un large virage sur la gauche, profond et moelleux. La sensation que le ventre se soulève et que l’on entre, tout en douceur, dans un univers en apesanteur.
– Rio de Janeiro, atterrissage imminent. Nous vous prions de bien vouloir éteindre vos cigarettes et attacher vos ceintures…
Le Brésil, son pays, n’est plus loin maintenant. Lucina ne voit encore que l’immensité du ciel bleu, pur, où le soleil aveuglant lui fait cligner des yeux. Elle brûle d’envie de se lever et de traverser l’allée moquettée pour observer sa ville par les hublots opposés mais, déjà, l’avion retrouve son assiette. Alors, brusquement, se dressant dans tout le vert profond de la forêt de Tijuca, rayonnant dans la turquoise du ciel, jaillissant au sommet de la pierre blanche qui le propulse sur le toit de Rio de Janeiro, le Christ Rédempteur fait son apparition. Il est là, si près qu’il donne la sensation que l’on pourrait le toucher de la main, que l’avion a manqué de peu s’écraser contre sa masse monumentale. Le Christ Rédempteur, dessiné par Bartolomeu Zumbi, s’est levé ce matin pour accueillir, en personne, Lucina Zumbi, la petite reine de la cité.
À cet instant-là, ce furent des larmes de joie et de délivrance qui firent briller les yeux de la jeune femme. Dans les exclamations poussées par les voyageurs, elle sourit. Une nouvelle vie, déjà sa troisième, allait enfin pouvoir débuter, aujourd’hui…
URUBUS
1
Lorsque la porte de l’avion s’ouvrit dans un bruit d’huile chaude et de fer, quand Lucina, après avoir salué l’hôtesse, s’engagea sur la rampe d’escaliers menant au tarmac surchauffé par le soleil de janvier, au moment même où elle posa enfin ses pieds sur la terre du Brésil, après cinq longues années d’absence, il lui prit une soudaine, une irrépressible, une délirante envie de crier de joie et de danser, d’esquisser quelques pas de samba, son petit Jorge agrippé à sa poitrine. Et, si elle n’avait pas vu, avançant à sa rencontre d’une démarche martiale, deux policiers militaires en civil, elle l’aurait sans doute fait. Dans la lumière crue qui se réverbérait sur le bitume, Lucina s’arrêta brusquement de marcher. Impassibles, les yeux masqués par de larges lunettes noires, chacun arborant une épaisse moustache, les deux hommes, de même taille et de même corpulence, vêtus d’un semblable costume noir et de chaussures vernies, fondirent droit sur elle. Sans lâcher son fils, Lucina tenta de maîtriser au mieux la panique sourde qu’elle sentait maintenant monter dans son ventre. À un mètre d’elle, les deux hommes stoppèrent net. Celui de droite remonta un bref instant ses lunettes de verre fumé sur son front, détailla la jeune femme des pieds à la tête puis, sur un ton plus affirmatif qu’interrogatif, il grinça :
– Vous êtes Lucina Zumbi. Je suis le lieutenant Augusto Lima et voici mon collègue, Alberto da Monte. Veuillez nous suivre.
Malgré la panique qui la gagnait, Lucina répliqua, tout aussi froidement :
– Que me voulez-vous ? Mes papiers sont en règle et je…
– Taisez-vous, aboya-t-il tout en montrant rapidement sa carte officielle. Nous sommes des lieutenants de la police militaire et je vous ordonne de nous suivre.
– Et mes bagages ? Qui est-ce qui va s’en occuper ? Et mes parents ?
D’un geste, le lieutenant fit un signe à une hôtesse qui, aussitôt, le rejoignit en courant. Après un bref conciliabule à voix basse, le policier lâcha :
– Cette personne va s’occuper de tout. Puis, sur un ton chafouin, il ajouta : et elle va s’occuper aussi de votre fils…
Comme l’homme avançait sa main vers le petit Jorge, la panique jusqu’alors contenue s’empara de Lucina. Les yeux soudain exorbités, tremblant de la tête aux pieds, elle arrima encore un peu plus son fils contre son torse et, sous les regards intrigués des voyageurs finissant de quitter le tarmac, elle gronda :
– Non… Tout, mais pas ça…
– Mademoiselle, soyez raisonnable. L’hôtesse va s’en occuper et le remettre à vos parents.
– Non, je vous dis ! Mon fils reste avec moi !
Le lieutenant tendit à nouveau sa main et saisit l’avant-bras du petit Jorge. Alors, Lucina se mit à hurler de toutes ses forces :
– Ne le touchez pas ! Vous me prendrez pas mon fils ! Salauds ! Lâchez-le ! Mais lâchez-le !
Terrifié, le petit Jorge se mit à crier et à pleurer, à se cramponner à sa mère tandis que les policiers utilisaient maintenant la force pour arracher l’enfant à Lucina. Alors, deux gardes en tenue arrivèrent au pas de course et, sans ménagement, ils parvinrent à tordre les bras de la jeune femme et à la désolidariser de son fils. Maintenant dépoitraillée, hors d’elle, Lucina continuait à crier d’une voix suraiguë :
– Jorge ! Jorge ! Salauds ! Pourritures ! Rendez-le-moi ! Mais rendez-le-moi, je vous dis ! Vous n’avez pas le droit !
Ses hurlements se perdirent dans les vrombissements d’un long-courrier s’apprêtant à décoller. Au plus fort du vacarme, ceinturé par l’un des policiers en tenue, le petit Jorge, suivi de près par l’hôtesse, fut emporté, gigotant et hurlant, jusqu’au hall d’arrivée de l’aéroport. De leur côté, les deux lieutenants menottèrent Lucina les mains dans le dos et la tirèrent dans le sens opposé, en direction d’une voiture noire qui les attendait, moteur allumé sous le soleil brûlant.
Le chauffeur de la voiture de police banalisée conduisait vite, zigzaguant entre les voitures, klaxonnant à tout moment, les yeux dissimulés, lui aussi, par des lunettes de verre fumé. Il s’agissait d’un métis, avec un visage taillé à coups de serpe et un menton fuyant, qui ne décrocha pas un mot durant les quarante minutes que dura le voyage. À l’arrière du véhicule, Lucina, encadrée par les deux lieutenants qui empestaient l’eau de toilette bon marché, s’était terrée dans un mutisme total. Elle savait pertinemment que les deux cerbères n’auraient pas répondu à ses questions. Avec leurs grands airs et la fierté évidente avec laquelle ils laissaient entrevoir le holster plaqué contre leur chemise, ils n’étaient rien. Des porte-flingues, des petites frappes, mais rien de plus. Ils ne faisaient qu’obéir aux ordres et crânaient avec une morgue de gamins bien trop vite montés en graine.
Débarrassée de ses menottes, les bras croisés sur sa poitrine, ballottée par les brusques coups de volant, Lucina ne pensait, à cet instant précis, qu’à une seule chose : son fils. Elle, elle était déjà passée par la maison de la torture de la rue Barão da Mesquita. Elle avait connu les séances d’interrogatoires, brûlures de cigarettes, étouffements, simulations d’exécution, gégène, viol collectif. Elle en portait encore les marques sur elle, des cicatrices qui jamais ne s’effaceraient. Sur son sein gauche, une longue estafilade abandonnée en guise de signature par l’un de ses tortionnaires l’attestait, pour le restant de son existence.
Parvenue à l’embouchure de l’avenue Rio Branco, la voiture stoppa sa course à un feu rouge, à côté d’une Fusca blanche dans laquelle deux jeunes femmes parlaient et riaient, insouciantes dans cette resplendissante matinée d’été. La peau bronzée, vêtues de chemisiers de couleurs vives, âgées d’à peine une trentaine d’années, elles tournèrent un instant leurs visages vers Lucina et, lorsqu’elles croisèrent son regard, leurs sourires s’éteignirent subitement. Quand le feu passa au vert, la conductrice mit plusieurs secondes avant d’enclencher la première.
Quelques minutes plus tard, après avoir avalé à une vitesse toujours très vive la quasi-totalité de l’avenue ensoleillée, la voiture banalisée s’immobilisa devant la porte d’un commissariat, situé à l’angle de l’avenue Almirante Barroso. Alors, toujours sans un mot, les deux lieutenants sortirent du véhicule, empoignèrent chacun un bras de Lucina et, de façon énergique, pénétrèrent dans l’immeuble, salués par deux policiers en faction. Passé une porte située au fond de l’accueil, ils prirent des escaliers menant à un sous-sol empuanti par une odeur âcre d’humidité, enfilèrent un long couloir violemment éclairé par des plafonniers grillagés rejetant une lumière crue, passèrent sans s’arrêter devant plusieurs portes et, finalement, firent entrer Lucina dans l’avant-dernière pièce, d’une légère bourrade dans le dos. Puis, sans un regard pour elle, ils ressortirent aussitôt, fermèrent la porte à clé et, peu à peu, remplaçant le martèlement des talons de cuir frappant le sol, le silence revint.
En tremblant légèrement, Lucina sortit une Gauloise filtre de sa poche de chemise et l’alluma. La pièce, sommairement meublée de deux chaises et d’une table en fer supportant une machine à écrire et un cendrier vide, semblait propre. Sur les murs et sur le sol, aucune tache, aucune trace de sang. Hormis une blatte avançant pesamment sur le carrelage jaune pâle du sol, il n’y avait ni mégot, ni cendre, ni papier. Un miroir rectangulaire, sur un pan de mur, semblait vouloir offrir plus d’espace à ce lieu anonyme et froid.
Après une attente de deux heures environ, un nouveau bruit de pas, plus lent cette fois, se fit entendre dans le couloir. Ceux-ci s’interrompirent devant la porte et Lucina devina le murmure de deux hommes parlant à voix si basse qu’elle ne put rien saisir de leur conciliabule. Enfin, l’un des deux individus s’éloigna, la clé tourna dans la serrure et, à l’ouverture de celle-ci, un petit homme fit son apparition.
– Donc, si je comprends bien, vous êtes mademoiselle Zumbi, Zumbi Lucina ?
L’homme assis devant elle pouvait avoir dans les cinquante ans, le crâne déjà abondamment dégarni, la peau blanche, le dos prématurément voûté. Vêtu d’un costume sans chic, le col de chemise élimé, il émanait de l’ensemble de sa personne une lassitude perpétuelle, un ennui et une morosité que rien ne semblait pouvoir dissiper. Luiz Faldas, comme il s’était présenté, était un agent du SNI, le Syndicat national d’information.
D’une voix morne, il demanda à nouveau :
– Eh bien ? Êtes-vous, oui ou non, mademoiselle Zumbi Lucina ?
– Oui, c’est bien moi. D’ailleurs, vous avez mon passeport, non ?
Luiz Faldas examina entre ses doigts humides les papiers de la jeune femme et les reposa sur la table de fer, tout en haussant mollement les sourcils et en marmonnant :
– Les papiers, vous savez… il y en a des vrais et il y en a des faux.
– Mais les miens sont vrais !
– Et qu’est-ce qui me le prouve ?
– Mais regardez ! Ils portent le tampon de la préfecture de Marseille. Et la lettre d’autorisation spéciale d’entrée sur le territoire, signée par le SNI, c’est faux, aussi ?
Pour toute réponse, l’agent sembla épousseter de la main l’air devant lui et, après un moment de silence, il tira de la poche intérieure de sa veste une boîte de pastilles à la menthe. Sans gourmandise, il en déposa une sur sa langue chargée, puis ouvrit un dossier cartonné rouge portant un nom de code sur sa couverture. Tout en soufflant, il examina les premières pages, des procès-verbaux pour la plupart, et finit par refermer le tout, les yeux toujours aussi inexpressifs et ternes au-dessus de deux cernes violets. Avachi plus que jamais sur sa chaise, Luiz Faldas finit par lever son regard sur la jeune femme lui faisant face. Sans ciller, d’une voix blanche et monocorde, il lâcha :
– Mademoiselle Zumbi Lucina, il faut que vous sachiez que vous êtes revenue au Brésil à titre exceptionnel. Et je ne vois d’ailleurs pas vraiment qui a signé cette autorisation, ni pourquoi.
– En tout cas, je suis ici.
– Pour l’instant, mademoiselle. Pour l’instant…
Lucina avala péniblement sa salive, puis demanda :
– Et mon fils ? Où est Jorge ? On l’a bien remis à mes parents ?
L’agent épousseta à nouveau l’air de sa main et leva les yeux au ciel pour signifier son ignorance et son désintérêt le plus total. Puis il sortit du tiroir de la table plusieurs liasses de formulaires vierges doublés de papier carbone, en inséra minutieusement un exemplaire dans la machine à écrire, fixa Lucina de son regard torve, puis questionna :
– Bien… Alors, dites-moi maintenant quels sont vos noms, prénoms, âge et profession…
L’interrogatoire de Lucina dura toute la journée et une partie de la nuit. De sa voix incroyablement lasse, Luiz Faldas posa, sans jamais se départir de son calme, les mêmes questions sur les raisons de la fuite de Lucina en France, ses activités clandestines avant son départ, la nature de ses activités à Marseille, les raisons de son retour, l’adresse du lieu où elle allait résider à Rio, ses perspectives de travail.
Le seul moment où l’agent du SNI perdit un peu de sa neutralité et de son calme, ce fut lorsqu’il grogna entre ses lèvres grasses :
– Mademoiselle Zumbi, je n’aime pas les communistes et j’aime l’ordre…
– Mais je ne suis pas communiste et je ne l’ai jamais été !
Sans prêter attention à la réponse spontanée de Lucina, il enchaîna aussitôt un inquiétant :
– Et depuis que le général Garrastazu Médici a pris la tête de la République, il ne fait pas bon être communiste, en ce moment.
– Mais puisque je vous dis que…
Le plat de la main de Luiz Faldas claqua avec violence sur la table de fer. D’une voix glaciale, il martela alors :
– Taisez-vous ! Si ce n’était que de moi, je vous collerais au trou sur-le-champ ! Vous avez peut-être des appuis en haut lieu, mais laissez-moi vous dire une bonne chose : je ne vous lâcherai pas…
Lucina baissa la tête et l’agent du SNI poursuivit, plus posément :
– De toute façon, si vous ne voulez pas d’ennui, il vous faudra, chaque lundi matin, aller pointer au poste de police du centre-ville. Et je vous conseille aussi d’obéir scrupuleusement aux actes institutionnels récemment votés, les AI-13 et AI-14. Tout individu sera puni de bannissement si, je cite de mémoire, il se comporte comme un élément nocif ou dangereux pour la sécurité nationale. Évitez donc de frayer avec des éléments subversifs…
Après s’être douloureusement raclé la gorge, il continua son monologue, sur le même ton lisse :
– Quant à l’AI-14, il condamne à la peine de mort tout individu ayant trempé dans des complots de guerre externe psychologique, révolutionnaire ou subversive, tout ceci toujours de mémoire, bien entendu…
Quand, les traits tirés et la peau encore plus hâve que lors de son arrivée, Luiz Faldas signifia à Lucina que l’interrogatoire était terminé, il bava encore une ultime phrase, un sourire pervers accroché à ses lèvres :
– Mademoiselle Zumbi Lucina, l’amour, le sourire et la fleur, c’est fini, pour le Brésil. Aujourd’hui, je vous rappelle qu’il n’y a plus qu’un seul mot d’ordre, dans notre pays : le Brésil, aimez-le ou quittez-le…
Lorsque Lucina, totalement hébétée, sortit du commissariat, aux alentours de vingt-trois heures, elle flageolait sur ses jambes. Physiquement, jusque dans sa chair, elle se sentait salie par les mots que Luiz Faldas avait prononcés. Comme une somnambule, elle rejoignit l’avenue Rio Branco et reçut en plein visage une bourrasque surgie de l’océan qui la pétrifia un instant, la laissant tremblante. Malgré la chaleur moite et salée de la nuit, elle grelottait et serra ses bras sur sa poitrine, tout en arrivant devant les arches blanchies de Lapa. Les tempes brûlantes, elle parcourut encore quelques dizaines de mètres à pied devant les luxueux buildings de l’avenue où, par bouquets, les néons des boutiques scintillaient et vous sautaient à la face, écœurants de couleurs criardes et de slogans vous pressant d’acheter à tout prix.
Au niveau de la rue Evaristo da Veiga, alors qu’elle s’apprêtait à héler un taxi pour rejoindre la maison de ses parents, à Santa Teresa, elle sursauta soudain. Un gamin, les pieds nus, le short trop court et le tee-shirt déchiré, venait d’apparaître à la faveur d’un lampadaire. Il avait à peu près l’âge de Jorge, son fils. À bout de bras, il tenait entre les mains une petite boîte de carton contenant deux cigarettes et trois chewing-gums. Comme Lucina, instinctivement, reculait, il prit un air pitoyable et, les yeux brillants, il miaula de sa voix d’enfant :
– Achetez-moi un truc, madame. S’il vous plaît, c’est pour manger. J’ai faim…
Très élégant dans son costume de coton noir et sa chemise blanche, Paulinho Domar da Cunha écoutait gravement, les yeux mi-clos dans la pénombre de son bureau, le compte rendu de l’interrogatoire. Luiz Faldas, cravate légèrement desserrée, rapportait point par point les informations livrées par Lucina. Lorsque l’agent du SNI referma le dossier, il conclut en ces termes :
– Pour moi, monsieur, cette femme n’est pas plus communiste que terroriste. Elle a peut-être été du côté des rouges, dans le temps, mais plus aujourd’hui.
– Qu’est-ce que vous en savez ?
Luiz Faldas se gratta pensivement la nuque, puis répondit :
– Elle est passée par la maison du Barão da Mesquita. Elle a failli en crever et je suis à peu près sûr qu’elle ne touchera plus à la politique.
– Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, vous l’ignorez ?
– Non, monsieur, mais maintenant elle a un gosse. Et ça change complètement la donne. Si vous l’aviez vue, cet après-midi… Dès que j’ai levé la voix, elle s’est effondrée. Une vraie gamine…
Paulinho laissa s’écouler un instant de silence. Puis, après s’être servi un verre d’eau, il se leva et, passant derrière la chaise de l’agent du SNI, il se mit à arpenter son bureau à pas lents. D’un ton faussement amical, il demanda :
– Mon cher Luiz, savez-vous pourquoi je suis votre supérieur hiérarchique et pourquoi vous, vous êtes mon subordonné ?
– Non, monsieur.
– Tout simplement parce que c’est moi qui ai créé le SNI et que c’est encore moi qui ai participé de très près, à São Paulo, à la création de l’OBAN et coordonné tous les Doi-Codi* qui ont suivi dans notre pays, y compris celui-ci que je dirige…
Comme Faldas ne répondait pas, Paulinho poursuivit :
– Et il y a surtout une chose, mon cher Luiz, qui nous sépare et nous séparera toujours_: j’ai des informations que vous ignorez et dont vous n’avez absolument pas la moindre idée. Cette Mlle Zumbi, que vous trouvez si inoffensive, figurez-vous qu’elle ne se contentait pas d’élever son fils et d’exercer le métier de serveuse de restaurant, à Marseille…
– Et que faisait-elle, monsieur ?
Paulinho se plaça derrière la chaise de son interlocuteur, les mains sur le haut du dossier, et répondit d’une voix grave :
– Elle accueillait des réfugiés politiques venus du Brésil, mais aussi de toute l’Amérique latine. Et elle les aidait, au sein d’un réseau clandestin composé d’autres activistes subversifs.
Immédiatement, Luiz Faldas se retourna et, sa curiosité piquée au vif, il demanda :
– Mais alors, pourquoi avez-vous signé cette autorisation exceptionnelle lui permettant de revenir au Brésil ?
De sa démarche posée, Paulinho Domar retourna s’asseoir à son bureau. Les mains jointes devant sa bouche, il laissa s’écouler quelques secondes de silence, puis il répondit :
– Le SNI et le SDECE*, dans le cadre du plan Condor, travaillent main dans la main. Depuis le jour où Lucina Zumbi a posé le pied à Marseille, elle a été constamment surveillée par les services secrets français qui m’ont régulièrement tenu au courant de ses activités.
– Mais ça ne me dit pas pourquoi vous l’avez fait revenir, monsieur…
Paulinho but à lentes gorgées son verre d’eau. Après s’être essuyé les lèvres du revers de la main, il reprit :
– J’y viens. Si j’ai fait revenir cette femme à Rio, c’est parce qu’elle nous sera beaucoup plus utile ici que là-bas…
Luiz Faldas fronça les sourcils en signe d’incompréhension et, avant qu’il ne formule une nouvelle question, son supérieur lui coupa la parole :
– Cette femme a été une activiste de la première heure, au sein de l’UNE. Actuellement, nous tenons les étudiants mais nous savons, de source sûre, que des groupuscules révolutionnaires sont en passe d’être réactivés. Et Lucina – pardon, Mlle Zumbi – va à nouveau entrer en contact avec les rouges des universités, soit parce qu’elle en fera la démarche, soit parce qu’elle sera contactée par ceux-ci…
Un silence lourd envahit la pièce obscure où ne brillait, sur le bureau, que la lampe de travail de Paulinho. Luiz Faldas sortit de la poche intérieure de son costume un mouchoir roulé en boule et sécha la sueur qui couvrait son visage. Puis, sentant que l’entretien touchait à sa fin, il se leva, resserra machinalement son nœud de cravate et lâcha :
– J’ai compris, monsieur. Comme je l’ai déjà dit à cette femme, je ne la lâcherai pas d’une semelle et je vous tiendrai personnellement au courant de tous ses faits et gestes.
– J’y compte bien, mon cher Luiz. Et maintenant, vous pouvez disposer…
– Merci, monsieur…
Sur ces mots, l’agent du SNI tourna les talons et quitta la pièce. Resté seul, Paulinho, songeur, se mit à classer les dossiers empilés devant lui. Après le départ pour Marseille de Lucina, il avait d’abord sombré dans une douloureuse période de dépression. À une consommation d’alcool excessive, il avait ajouté la prise de somnifères chaque soir puis d’excitants dès le saut du lit pour pouvoir continuer à être efficace au sein du SNI. Avec son épouse Wendy, les disputes s’étaient multipliées, les menaces de retour aux USA avec ses fils s’étaient faites plus fréquentes. Un jour, Wendy était partie, sans un mot, sans même une lettre d’explications. Paulinho n’avait rien fait pour les retrouver et, depuis deux ans et demi, il vivait seul à Ipanema, dans son appartement de l’avenue Borges de Medeiros, sur les bords de la lagune Rodrigo de Freitas.
Au lendemain d’un coma éthylique qui l’avait fauché dans une arrière-salle du night-club le Night and Day, il avait pris la ferme résolution de ne plus toucher à une seule goutte d’alcool et, après des mois de cauchemars et de tremblements nerveux, il était parvenu à sortir de cette impasse. Aujourd’hui, Paulinho Domar da Cunha passait les trois quarts de son temps à son bureau, à traquer les terroristes qui grouillaient, disait-on, sur l’ensemble du territoire. Après dix-sept ou dix-huit heures de travail, il regagnait son appartement et se couchait pour s’engloutir dans un sommeil de brute, un sommeil sans rêve.
Avant d’éteindre la lampe de cuivre, Paulinho ouvrit le tiroir central de son bureau, souleva un épais dossier et, pendant quelques secondes, regarda pensivement une photo de Lucina, prise huit ans plus tôt, lors de la manifestation des Réformes. Aujourd’hui, il était descendu à plusieurs reprises dans la petite pièce attenante à la salle d’interrogatoire, dans le sous-sol du commissariat. Derrière le miroir sans tain, il l’avait observée longuement. Elle, elle n’avait pas changé. Lou…
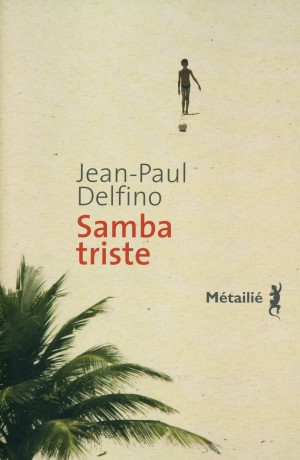



-100x150.jpg)




