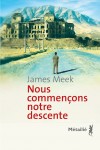1919. Sibérie. Le long de la voie du Transsibérien, Jazik occupée par une légion tchèque, attend l’offensive des rouges. La ville est dominée par une secte religieuse sous la conduite de Balashov. Arrive Samarin. Il sort de la forêt et raconte s’être évadé d’un bagne et être poursuivi par un cannibale. Anna Petrovna, une jeune veuve, s’intéresse à ce nouveau venu. Un chamane de la région est assassiné et la peur et la folie s’abattent sur la ville. Le pervers capitaine Matula rêve de fonder un royaume dans ce bout du monde glacé, nomme un tribunal pour juger Samarin et affronte Mutz, le lieutenant plein d’humanité. Dans une grange piaffe un étalon noir. Les rouges arrivent.
Des personnages exceptionnels d’intensité et de grandeur. Et J. Meek combine avec un exceptionnel talent de conteur le charme des grands romans russes au rythme d’un thriller moderne.
«Un roman de premier ordre et peut-être suis-je en dessous de la vérité.» – Jim Harrison
«Envoutant. […] Vraiment un grand livre.» – Irvine Welsh, The Guardian
« Le meilleur livre et le plus original que j’aie lu depuis des années. » – Louis de Bernières
Best-seller en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, ce roman traduit dans 27 pays sera adapté au cinéma par Johnny Depp.
-
Meek se révèle un conteur de talent. Il dépeint un monde en pleine mutation et pose habilement les questions de l’endoctrinement, des croyances et des idéaux. Son roman est baroque et foisonnant.(Page des libraires)
Sandrine Maliver-Perrin -
1919. à Jazyk, village perdu le long du Transsibérien, des légionnaires tchèques cohabitent tant bien que mal avec les membres d'une secte bizarre. Les Rouges ne sont pas loin. Arrive Samarin, évadé d'un camp de prisonniers. Il prétend être poursuivi par un cannibale? Voici un roman qui se passe d'épithète : un roman au sens fort du terme. Rempli de bruit et de fureur, de personnages complexes, cocasses, inquiétants, où se mêlent intrigue policière, tension psychologique, reconstitution historique. Jim Harrison, Louis de Bernières et Irvine Welsh ont encensé ce best-seller international que Johnny Depp portera.
-
« Un acte d’amour parvient à raconter un pan de l’histoire de la Russie qu’on n’avait jamais lu, mais il réussit en plus à faire se croiser, parler, aimer, haïr, dévorer, des personnages de chair et de sang, d’espoir et de folie. Comme le faisait Dostoïevski. Et avec un suspense haletant en prime. »Guy DuplatLIBRE Belgique -
« Ecrit dans un style vif, parfois teinté d’humour, il rend le récit envoûtant et beau. Un roman signé par un écossais, qui n’a rien à envier à la grande tradition de la littérature russe. »
BIEN DANS MA VIE -
« Sans doute très influencé par les grands classiques russes, Dostoïevski en tête, Meek surprend par l’intensité philosophique de ses analyses. Tout en restant un intarissable conteur. »
André ClavelLIRE -
« Voici, sous la signature d’un écrivain-journaliste écossais, un roman des plus singuliers. Y affleurent une culture historique et psychologique de la Russie comme un réel génie romanesque faisant de cet incroyable Acte d’amour une œuvre magnifique. »
Jean-Christophe BuissonLE FIGARO MAGAZINE -
« C’est un roman exceptionnel, qu’on ne lâche pas, qui ne vous lâche pas. […] C’est colossal. Un train d’enfer. Un paradis de lecture. » »
Philippe TrétiackELLE -
« Certains premiers romans sont appelés à faire date. C’est le cas de celui de l’Anglais James Meek, dont Un acte d’amour impose d’emblée l’immense talent et l’éclatante ambition. »
Alexandre FillonMADAME FIGARO -
« Le roman de James Meek […] est une puissante réflexion sur la machine à détruire qu’est l’homme, dans sa folie sanguinaire comme dans sa quê te d’inaccessible paradis. »
Claire JulliardLE NOUVEL OBSERVATEUR -
« Tout l’art de James Meek est dans ce mélange d’horreur et de sentiment, d’histoire et de mythe. »
Christine FerniotTELERAMA -
« James Meek, auteur britannique (Ecosse), nous livre dans Un acte d’amour une terrifiante et majestueuse épopée. »
« Tout l’art de James Meek est dans cette atmosphère étouffante et lumineuse qui règne sur toutes les pages. Avec des scènes d’une violence inouïe, avec des interrogations troublantes… des rencontres improbables, des retournements de situation extraordinaires. »
André Rollin
LE CANARD ENCHAINE -
« Salué par Jim Harrison et Irvine Welsh, Un acte d’amour nous entraîne en Sibérie en 1919, dans une ville occupée par des militaires tchèques : une ville étrangement sans enfants, contrôlée aussi par une secte… »
LES INROCKUPTIBLES -
« Roman historique […], roman d’aventure, thriller, bande dessinée […], Un acte d’amour est un formidable hommage au grand roman russe, qui, de Tolstoï à Pasternak, a fait rêver des générations de lecteurs. […] On peut le lire comme un excellent suspens mais aussi une belle réflexion sur ces formes d’amour, de Dieu, des autres, de sa patrie, qui conduisent au sacrifice. »
Bruno CortyLE FIGARO LITTERAIRE -
« Roman d’action captivant, récit historique dans la Russie de 1919, réflexion politique, Un acte d’amour du Britannique James Meek est hanté par le sentiment amoureux et ses énigmes. »
Franck NouchiLE MONDE DES LIVRES -
« Nous sommes à l’aube de la Révolution russe, mais c’est une aube grosse de notre savoir désenchanté. »
Maryline DesbiollesLIBERATION
SAMARIN
À l’âge de douze ans, bien des années avant qu’il ne surprenne dans le cartable d’une fille l’odeur puissante
de la dynamite, mêlée aux senteurs des livres de cours et de l’eau de Cologne, Kyrill Ivanovich Samarin exigea de son oncle le droit de changer de nom. Il ne voulait plus être un Ivanovich. L’Ivan du patronyme, son père, était mort quand il avait deux ans, peu après sa mère. Depuis ce jour, il était élevé par son oncle, Pavel: alors, pourquoi ne pas s’appeler Kyrill Pavlovich? Quand son oncle lui rétorqua qu’il ne pouvait rien y changer, que c’était dans l’ordre des choses, que les pères défunts avaient des droits et qu’on leur devait le respect, le garçon sombra dans un silence courroucé, pinça les lèvres et regarda ailleurs, respirant bruyamment par le nez. Son oncle avait appris
à reconnaître ces symptômes. Ils apparaissaient plusieurs fois l’an, quand l’un des amis du garçon le laissait tomber, quand on lui demandait d’éteindre sa lampe de chevet et de dormir, ou quand il s’interposait pour empêcher son oncle de corriger un domestique.
Ce qui survint ce jour-là n’avait rien de familier. Le garçon regarda fixement son tuteur, se fendit d’un large sourire puis éclata de rire. Ses yeux brun sombre plantés dans ceux de son oncle et ce rire – pas encore un rire d’homme car sa voix n’avait pas mué, mais plus vraiment celui d’un enfant –, tout cela était fort troublant. “Oncle Pavel, reprit le garçon. Voudrais-tu bien désormais m’appeler Samarin et rien d’autre, jusqu’au jour où je serai libre de choisir mes noms?”
C’est ainsi que depuis le jour de ses douze ans, en famille, on ne prononça plus que son patronyme, comme s’il vivait à la caserne. L’oncle adorait son neveu. Il le gâtait à la moindre l’occasion, même s’il n’était pas facile de satisfaire Samarin.
L’oncle de Samarin n’avait pas eu d’enfant et il était si timide en présence des femmes qu’on n’aurait su dire
s’il appréciait leur compagnie. D’un rang modeste, il
avait bâti une immense fortune. C’était un architecte entrepreneur, un de ces individus bénis des dieux dont
le savoir-faire concret n’offre aucune prise à la suffisance, à la corruption ni à la bêtise des puissants qui patronnent leurs activités. Et au fil du temps, les gens de Raduga, la ville des bords de la Volga où vivaient Samarin et son oncle, avaient fini par ne plus considérer son neveu comme un malheureux orphelin. On l’appelait schastlivchik, le chanceux.
L’excellente réputation dont jouissait l’oncle de Samarin aux yeux de l’aristocratie conservatrice tenait également à son peu d’intérêt pour la politique. Aucun cercle libéral ne tenait salon chez lui, il n’était pas abonné aux journaux de Saint-Pétersbourg et refusait de rejoindre les rangs des associations réformistes, malgré leurs sollicitations continuelles. Il lui était bien arrivé, par le passé, de soutenir une cause. Au cours du fol été 1874, bien avant la naissance de Samarin, il était de ces étudiants partis battre la campagne en bons missionnaires, pour encourager les paysans à la rébellion. Les paysans ne comprenaient pas un traître mot de ce qu’on leur racontait et, pensant que les étudiants se payaient leur tête, ils les renvoyèrent chez eux, d’abord du bout des lèvres puis, finalement, par la force. L’oncle de Samarin échappa de peu à l’exil sibérien. Son amour-propre ne se remit jamais de cette humiliation. Chaque mois, il écrivait une longue lettre à une femme qu’il avait connue alors, exilée en Finlande. Quand il ne restait plus qu’à la poster, il la brûlait.
Samarin tenait de son oncle dans le domaine de la politique, mais aussi dans ses rapports avec les femmes. À la fin de sa scolarité, il mena des études d’ingénieur à l’université locale, sans jamais participer aux nombreux débats, groupes de discussion et autres cercles marxistes semi-clandestins, très prisés des étudiants radicaux. Il n’aimait pas non plus s’afficher ni partir en manœuvres aux côtés des militants antisémites qui traînaient sur les marches de l’université et s’extasiaient devant les caricatures de juifs au nez crochu et buveurs de sang popularisées par les almanachs des colporteurs. Il lisait beaucoup; son oncle lui procurait tous les livres qu’il désirait, dans plusieurs langues. Il fréquentait les soirées dansantes et, adolescent, passa la majeure partie de ses étés à Saint-Pétersbourg. Lorsqu’un ami l’interrogea sur les étiquettes en allemand, en français et en anglais accrochées à ses malles, il répondit avec un sourire qu’il était moins onéreux d’acheter ces étiquettes que de voyager à l’étranger. Il avait une foule d’amis, ou plutôt, bon nombre d’étudiants le considéraient comme un ami même si, à bien y penser, la plupart d’entre eux auraient pu compter sur les doigts d’une main les heures passées en sa compagnie. Les femmes l’appréciaient parce qu’il dansait bien, ne cherchait pas à se soûler au plus vite dès qu’il y avait à boire et écoutait avec un réel intérêt ce qu’elles lui disaient. Il avait l’art de consacrer toute son attention à une femme, et à elle seule, ce qui
la comblait d’aise sur le moment, et lui laissait ensuite l’impression que ce temps passé ensemble, aussi bref fût-il – et il l’était généralement –, était un temps précieux que Samarin aurait pu, aurait dû consacrer à de plus nobles tâches. Le fait que personne ne sache au juste de quelles tâches il pouvait bien s’agir ne faisait que renforcer cette impression. En outre, il s’habillait avec élégance, hériterait un jour d’un vaste patrimoine, et il était intelligent. Tout, en lui, suggérait le souci de ne jamais dévoiler les mille richesses de sa personnalité, par égard pour ceux qui, dans son entourage, étaient bien moins lotis que lui: sa vivacité d’esprit, sa force, son physique. Il était grand, un peu austère, avec d’épais cheveux bruns mi-longs et des yeux qui passaient brusquement d’un détachement serein à une attention extrême.
On prêtait une oreille distraite à ceux qui parlaient d’autres Samarin, pas parce qu’on les soupçonnait de jalousie, mais parce que leurs insinuations semblaient par trop étranges. Ces insinuations recevaient le même traitement que les entrefilets des journaux rapportant des faits divers troublants advenus dans quelque ville de province semblable à Raduga, mais jamais à Raduga même: on les lisait avec intérêt mais sans trop y croire, et on se gardait bien d’en tirer la moindre conclusion. Il y avait notamment celui qui avait vu Samarin, à quinze ans, en train de se promener avec son oncle. C’était, prétendait-il, le neveu qui parlait en faisant de grands gestes, comme s’il était en train d’expliquer quelque chose, tandis que l’oncle grisonnant l’écoutait en silence, approbateur, les mains derrière le dos, dans une attitude qui ressemblait fort à du respect.
Les campagnes étaient alors en proie à une grande agitation. Les paysans incendiaient des manoirs, furieux des indemnités qu’il leur fallait encore verser aux propriétaires terriens, en échange du simple privilège d’avoir
été affranchis du servage quarante ans plus tôt. L’oncle
de Samarin était chargé de superviser la reconstruction des manoirs. Accompagné de Samarin, il rendait visite aux représentants de cette petite noblesse en train de s’éteindre. Un témoin affirmait, mais c’était sa parole contre toutes les autres, qu’il avait surpris une conversation entre l’oncle et le neveu le jour où ils avaient rencontré une famille noble des plus modestes, qui avait tout perdu dans l’incendie. Et les deux compères en riaient ouvertement. “J’ai d’abord entendu rire le garçon, puis l’oncle s’y est mis à son tour!” Voilà ce qu’affirmait le témoin.
En 1910, à l’âge de vingt et un ans, Samarin rencontra Yekaterina Mikhailovna Orlova, que tout le monde appelait Katya. Elle étudiait dans la même classe que lui et se trouvait être la fille du recteur de l’université. Ils faisaient de longues promenades. Dans les soirées, ils discutaient en aparté, dansaient ensemble. Au début du printemps, le père de Katya exigea que cette relation cesse immédiatement. Samarin, expliqua-t-il, l’avait humilié devant tous les étudiants de dernière année, à l’occasion de son allocution annuelle. Alors qu’Orlov invitait les étudiants à mesurer la chance qu’ils avaient d’être jeunes au moment où la Russie était en passe de se transformer en une démocratie prospère et éclairée, Samarin était parti d’un grand éclat de rire. “Pas un ricanement, non, ni un gloussement, insistait Orlov. Un beuglement, un rugissement, tel un fauve égaré sur nos terres académiques.”
Orlov profita des vacances pour emmener sa fille dans la maison de campagne d’un des riches parrains de l’université. Samarin apprit qu’un étudiant devait rendre visite à Katya pour lui lire ses poèmes. Samarin prévint l’étudiant qu’elle préférait les hommes vêtus de couleurs claires. Or, peu après que les deux hommes se furent engagés sur la route de campagne menant à la maison, Samarin à bicyclette et l’autre à cheval, eut lieu un bien étrange accident. Le cheval, réputé docile, désarçonna le poète à l’endroit exact où la route traversait une mare de boue, profonde et détrempée. Le costume blanc de l’étudiant et son imperméable anglais d’un impeccable beige dégoulinaient d’une fange nauséabonde et il s’était foulé la cheville. Samarin l’aida à se remettre en selle et le poète rebroussa chemin. Samarin offrit d’aller lui-même délivrer ses vers. Puis il rejoindrait leur auteur pour le raccompagner, en parfait chaperon, jusqu’à la ville. Le poète accepta. Ils se séparèrent.
À un kilomètre de la maison de campagne, Samarin posa pied à terre et marcha, poussant la bicyclette d’une main et tenant les poèmes de l’autre. C’étaient des vers fortement inspirés des poèmes de jeunesse d’Alexander Blok. “Lune”, “ténèbres”, “amour” et “sang”, ces mots revenaient très souvent. Chaque fois qu’il terminait un poème, Samarin s’arrêtait, déchirait la feuille en huit carrés parfaits et jetait le tout dans le fossé qui courait au bord de la route. En l’absence de vent, les bouts de papier se dispersèrent à la surface des eaux de débâcle.
Un gardien était posté près du portail. Pour lui, tous les étudiants avaient la même tête: quand Samarin se présenta comme le poète, il ne lui vint même pas à l’idée que le jeune homme pût mentir. Samarin demanda si Katya pouvait le rejoindre près du pavillon, au bord de l’étang, et le gardien alla chercher la jeune fille. Samarin poussa sa bicyclette jusqu’au pavillon, un édifice en bois pourri et affaissé qu’une mousse d’un vert resplendissant s’était accaparé. Il posa son vélo contre un arbre et s’assit au sec dans un recoin des escaliers. Il fuma quelques cigarettes, observa un escargot qui s’évertuait à gravir le bout de sa botte, plongea la main dans un massif d’orties jusqu’à sentir la brûlure sur sa peau. Le soleil fit son apparition. Katya traversa l’herbe haute et humide. Elle portait un long manteau brun et un chapeau à large bord. Apercevant Samarin, elle sourit. Elle se baissa pour cueillir quelque chose. Elle vint s’asseoir à côté de Samarin, un bouquet de perce-neiges à la main. Samarin lui conta les mésaventures du poète.
– Je ne suis pas censée vous voir, dit Katya.
– Il m’a confié ses poèmes, répondit Samarin. Je les ai perdus. Ils n’étaient pas bons. Mais j’ai là un texte que j’aimerais vous lire. Voulez-vous une cigarette?
Katya secoua la tête:
– Vous vous êtes mis à la poésie?
– Ce n’est pas moi qui l’ai écrit, fit Samarin, tirant de la poche intérieure de sa veste un petit livre plié en deux. Et ce n’est pas de la poésie. J’ai pensé que ça vous intéresserait. J’ai entendu dire que vous vouliez devenir terroriste.
Katya se pencha en avant et partit d’un rire franc.
– Kyrill Ivanovich! Ce que vous pouvez dire comme bêtises! (Elle avait des petites dents d’une absolue perfection.) Jamais à court de plaisanteries.
– Terroriste. Que vous inspire ce mot? Parce qu’il va falloir vous y habituer. Terroriste.
– Soyez sérieux! Soyez sérieux. Vous ai-je jamais parlé de politique? Vous savez mieux que personne quelle créature insouciante je fais. Terreur, rien que le mot me déplaît. À moins que vous ne pensiez au jour où nous avons fait exploser des feux d’artifices dans le dos des pauvres gens qui pêchaient sur la glace, le soir du nouvel an. J’ai perdu le goût de ce genre d’idioties. Je suis une jeune femme bien élevée, à présent. La mode, voilà un bon sujet de conversation! Il vous plaît, mon manteau? Papa l’a acheté pour moi à Pétersbourg. Il est joli, non? Bon. Assez. (Katya posa les ?eurs sur la marche, près de Samarin. Les tiges étaient broyées là où elle avait serré le poing.) Pas étonnant que Papa ne veuille plus que nous nous voyions, si c’est pour vous moquer de moi. Mais, lisez, allez.
Samarin ouvrit le livre et lut. Il lut longuement. D’abord, Katya le regarda avec l’étonnement que l’on devine sur le visage des gens à qui l’on dit tout haut des mots qui correspondent aux plus secrètes de leurs pensées. Ou bien encore, avec la stupéfaction d’une femme à laquelle l’homme qui la courtise fait des avances obscènes sans qu’elle s’y attende. Mais au bout d’un moment, Katya plissa ses grands yeux bleus et la dernière touche de rouge s’effaça de son visage pâle et lisse. Elle se détourna de Samarin, ôta son chapeau, repoussa les fines mèches blondes qui étincelaient sur son front, lui prit une cigarette et se mit à fumer, appuyée sur son avant-bras.
– “La nature des révolutionnaires véritables ne laisse aucune place au romantisme, à la sensiblerie, à l’extase ni à l’enthousiasme”, lisait Samarin. “Elle ne s’accommode pas davantage de la haine ni de la vengeance personnelle. La passion révolutionnaire, qui devient chez eux un état d’esprit quotidien, doit être à chaque instant associée à une attitude froidement calculatrice. Partout et quelles que soient les circonstances, ils ne doivent agir en fonction de leurs penchants individuels, mais selon ce que prescrit l’intérêt général de la révolution.” Écoutez ce passage, Katya: “Si un camarade est en difficulté, les révolutionnaires qui envisagent de lui porter secours ne doivent pas écouter leurs sentiments personnels, mais penser avant tout au bien de la cause révolutionnaire. Par conséquent, il leur faut soupeser d’une main l’utilité de leur camarade et, de l’autre, l’énergie révolutionnaire que coûterait inévitablement une telle opération. Ils privilégieront celle de ces deux considérations qui a le plus de poids.”
– Qu’est-ce que j’ai à voir avec ce drôle de texte? demanda Katya.
– On raconte qu’ils vont vous confier un engin et une cible.
– Mêlez-vous de ce qui vous regarde.
– Ne faites pas ça. Je suis persuadé que leur but est de vous sacrifier, pour vous inscrire au registre des pertes bon marché.
Katya lâcha un rire bref et clair.
– Poursuivez votre lecture.
Samarin reprit:
– “Le révolutionnaire s’inscrit dans le monde de l’État…”
Expirant la fumée de sa cigarette, les yeux dans le vague, Katya le coupa net.
– “Le révolutionnaire s’inscrit dans le monde de l’État, des classes et de la soi-disant ‘culture’, et s’il s’inscrit dans ce monde, c’est seulement parce qu’il croit en sa destruction rapide et définitive”, récita-t-elle. “Il n’est pas révolutionnaire s’il ressent de la pitié pour quoi que ce soit dans ce monde. Il devra être capable de ne reculer devant l’annihilation d’aucune situation, d’aucune relation, d’aucun individu appartenant à ce monde. Tout et tous doivent lui être également odieux, sans distinction. Et tant pis s’il possède dans ce monde une famille, des amis, des êtres aimés: il n’est pas révolutionnaire s’il retient sa main.” Voilà. Et maintenant, si vous êtes de la police, sortez votre sif?et.
– Je ne suis pas de la police, répondit Samarin. Il referma l’opuscule et le tapota sur son genou. J’aurais tout aussi bien pu le perdre avec la poésie, n’est-ce pas? Vous connaissez par cœur le catéchisme du parfait révolutionnaire. Félicitations.
Il baissa légèrement la tête et sa bouche se tordit en un sourire qui refusa de prendre. Ce fut une grimace. Katya jeta son mégot dans les mauvaises herbes et se pencha pour saisir l’expression de doute sur son visage, une expression qui ne lui était pas familière. Samarin détourna légèrement la tête, Katya se pencha un peu plus, il lui tourna le dos, elle accompagna son mouvement. Le souf?e de Katya se posa un instant sur la joue de Samarin, qui se redressa et regarda autour de lui. Katya fit un petit bruit de gorge, mélange de dédain, d’amusement et de surprise. Elle posa la main sur son épaule et il se tourna vers elle, la regarda dans les yeux, presque à bout portant. Si près que chacun pouvait distinguer chez l’autre les filaments de l’iris et le noir hublot des pupilles, et se demandait ce que cherchaient à exprimer ces filaments et ces pupilles.
– C’est curieux, dit Katya. J’ai l’impression de vous voir pour la première fois tel que vous êtes vraiment.
Sa voix était celle de l’intimité. Pas un chuchotement, non, mais un murmure paresseux, sans effort, un ronronnement fêlé. Samarin esquissa du doigt l’invisible sur les lèvres de la jeune fille.
– Pourquoi est-ce si insupportable? demanda Samarin.
– Quoi?
– De regarder la partie regardante de celui qui vous regarde?
– Si cela vous est insupportable, pourquoi le supporter?
– C’est juste, dit Samarin. Il posa ses lèvres sur les siennes. Leurs yeux se fermèrent et ils s’enlacèrent. Leurs mains se promenaient juste comme il faut dans le dos l’un de l’autre tandis qu’ils s’embrassaient avec une avidité croissante, marquée. Ils étaient au bord de la violence, des morsures et du sang, quand ils entendirent quelqu’un appeler. Katya repoussa Samarin et ils restèrent assis à s’observer, le souf?e lourd et la mine sombre, tels deux mangeurs d’opium dans les vapeurs d’un ?acon de laudanum qu’ils auraient renversé par terre en se disputant.
– Il faut que vous partiez, dit Katya. Du regard, elle désigna le livre. Là. Dedans. Avez-vous lu l’article 21 du chapitre 2?
Samarin feuilleta quelques pages, mais avant qu’il ne trouve l’article, Katya se mit à réciter, marquant de courtes pauses pour avaler de grandes bouffées d’air:
– “La sixième catégorie, d’une importance capitale, est celle des femmes. On peut la diviser en trois groupes principaux. D’abord, ces femmes frivoles, écervelées et insipides que nous utiliserons éventuellement comme les troisième et quatrième catégories d’hommes. Ensuite, les femmes qui s’illustrent par leur passion, leur talent et leur dévouement, sans être néanmoins des nôtres parce qu’elles n’ont pas encore accédé à la compréhension révolutionnaire véritable, concrète et étrangère aux passions: on se servira d’elles comme des hommes de la cinquième catégorie. Enfin, il y a les femmes qui sont des nôtres à part entière, c’est-à-dire qu’elles ont été totalement initiées et qu’elles adhèrent sans réserve à notre programme. Il faut considérer ces femmes comme le plus précieux des trésors. Nous ne pouvons nous passer de leur concours.”
Samarin ne revit Katya que des mois plus tard. Un matin, il vint l’attendre à la gare. L’université ne disposait que d’une maigre bibliothèque et, de temps à autre, les autorités envoyaient de Penza un train aménagé, avec des étagères de livres et des pupitres, qui permettait aux étudiants de consulter des ouvrages spécialisés. Samarin disposait chez lui de tous les livres dont il avait besoin, mais dans l’étouffante chaleur de mai, quand la bibliothèque ambulante arriva, il était là, dehors. Katya apparut dans une robe blanche, la tête découverte, un grand cartable aux trois quarts vide à la main. Sa peau claire était brûlée par le soleil. Elle paraissait plus mince, plus anxieuse, et avait la tête de quelqu’un qui a mal dormi. Un vent brûlant sif?ait dans les rangées de peupliers, autour de la gare. Samarin héla Katya. Sans se retourner, elle monta dans le wagon-bibliothèque.
Samarin s’assit sur le quai de la gare, sans quitter le wagon des yeux. Les peupliers mugissaient dans la brise. Quelque chose brûlait en ville, une fumée noire s’élevait au-dessus des toits. Le vent était si fort et si chaud que l’orage semblait imminent, mais le ciel était encore dégagé, à part cette fumée. Assis sur son banc, Samarin observait les allées et venues des étudiants. Le banc était à l’ombre du toit de la gare, à l’abri du vent, mais les planches du toit se mirent à trembler. Les étudiants avançaient à travers des nuages de poussière, les yeux fermés; les femmes retroussaient d’une main leur jupe, et de l’autre protégeaient leur chapeau. Samarin sentit l’odeur de l’incendie. Les nuages commençaient à s’amonceler. Épais, ils s’ébrouaient devant ses yeux. Il n’y avait plus personne sur le quai. L’air empestait la poussière, la fumée et l’ozone. Tout s’assombrit. Le ciel était un plafond bas. Le dernier étudiant se rua hors du wagon. Samarin se leva, l’appela. L’étudiant fit le tour du wagon en courant, puis traversa les rails avant de s’élancer à travers champs, col relevé. Sans s’arrêter, il jeta un bref regard à Samarin par-dessus son épaule. L’étudiant vit sur son visage un message du futur. Un signe qu’il espérait ne plus jamais revoir. Tout ce qu’il voulait, c’était regarder une dernière fois Samarin dans les yeux, pour pouvoir dire plus tard: “J’ai vu Samarin ce jour-là.”
Katya n’était pas ressortie. Samarin monta dans le wagon. La salle de lecture était déserte et les bureaux vides, à l’exception d’un exemplaire des Principes de base de la vapeur que Katya avait consulté et des notes qu’elle avait prises. Elle avait composé un poème:
Elle aimait comme les suicidés aiment le sol vers lequel ils tombent
Le sol les arrête, et en les embrassant abrège leur souffrance,
Mais elle tombait et tombait encore, elle s’élançait,
Heurtait le sol, mourait et de nouveau tombait.
Samarin referma l’ouvrage, s’avança vers le bureau du bibliothécaire, appuya son oreille contre la porte en bois. Le wagon craquait dans le vent, si bruyamment qu’il n’entendait plus rien. Il n’arrivait pas à savoir si on chuchotait de l’autre côté, ou si c’était le vent qui hurlait dans les branches. Une rafale empoigna du sable et de la paille, qu’elle fit crépiter le long du châssis comme une nuée de rats jaillie d’entre les roues. Samarin s’écarta de la porte et entendit un cri de femme, dehors. Il bondit hors du wagon, dans la poussière, parcourut le quai du regard. Personne. Il entendit la cloche des pompiers, en ville. Puis, une nouvelle fois, la femme qui hurlait. Non pas de peur, de plaisir ou de colère, semblait-il, mais juste pour émettre un son, comme le loup, les corbeaux. Ça venait de loin. Une pierre frappa Samarin à l’épaule, une autre à la tête, et une en pleine joue, qui fit jaillir le sang. Se couvrant la tête de ses bras, il courut se réfugier sous le toit du quai. Le bruit du vent disparut dans le fracas de la grêle – boulets de canon qui bombardaient sans fin la ville depuis un bunker – et l’air devint blanc. L’orage dura deux minutes et quand il cessa des débris de feuilles pendaient aux branches des arbres comme des lambeaux de vêtements. On s’enfonçait jusqu’aux chevilles dans le sol recouvert de glace. Samarin vit la porte du wagon s’ouvrir et Katya en descendre avec son cartable sur le dos. Un objet lourd, à l’intérieur, le tirait vers le bas. Levant les yeux, elle l’aperçut. Samarin cria son nom mais elle se mit à courir le long de la voie ferrée. Il s’élança à sa poursuite. Elle glissa sur la grêle et s’écroula, il la rattrapa. Elle était étendue sur la glace, à moitié sur le dos, à moitié sur le côté. Samarin s’agenouilla et elle leva les yeux vers lui comme s’il venait la réveiller après des jours et des nuits de sommeil. Elle ef?eura sa joue coupée et retira lentement son doigt maculé de sang. Elle grelottait de froid. Elle demanda
à Samarin: “Vers où?” Vers où. Samarin lui saisit les mains et l’arracha à la grêle en train de fondre. Elle était trempée et frissonnait. Elle s’écarta pour ôter son cartable. Elle en vérifia le contenu, le serra contre sa poitrine et se mit à rire. Samarin lui dit: “Donnez-moi ça.” Tout en riant, elle se releva et s’enfuit sur les rails. Samarin lui courut après, l’attrapa par la taille et elle tomba tête la première. Elle fit rempart de son corps pour protéger le cartable. Elle avait de la force et Samarin luttait pour tenter de la retourner, les tibias baignant dans la glace, les genoux plaqués contre ses cuisses, les mains fouillant son ventre, là où se trouvait le cartable. Il sentit l’odeur de ses cheveux, le coton mouillé de sa robe, sa taille solide et douce qui frétillait comme un poisson entre ses mains. Il plongea la main droite dans le creux de ses jambes, posa la main gauche sur ses seins. Sans un cri, elle relâcha son étreinte, se retourna tout en souplesse et repoussa les mains de Samarin, posant ses paumes douces et fraîches sur les jointures de ses doigts. Il s’empara du cartable, roula sur le côté et bondit sur ses pieds.
– Rendez-le-moi, dit-elle, toujours allongée, les yeux levés sur lui.
Samarin ouvrit le cartable. Il y avait une bombe artisanale. Il s’en saisit et lança le cartable à Katya, qui se mit à trembler.
– Il vaut mieux que ce soit moi, dit Samarin.
– Romantique, répondit Katya d’une voix sans relief. Vous échouez avant même d’avoir commencé.
– Mon bras est plus fort, je lancerai plus loin.
– Vous la jetterez dans la rivière. Vous n’en ferez rien.
– Pourquoi pas? répliqua Samarin, un sourire aux lèvres, en contemplant le lourd colis qui pesait sur ses mains. Agir, c’est mieux que planifier.
Katya se leva. Le devant de sa jupe était froissé, strié de traînées sombres déposées par la glace fondue. Des fragments de grêlons pendaient à ses cheveux. Elle baissa les yeux, se recoiffa puis s’interrompit pour observer Samarin. Son visage changea d’expression. Il devint chaleureux, affamé, intéressé. Elle s’avança vers lui, pressa son corps contre le sien, lui passa les bras autour du cou, et l’embrassa sur les lèvres.
– Tu m’aimes à ce point? demanda-t-elle.
– Oui, répondit-il et il tendit les lèvres vers sa bouche. Katya arracha la bombe de sa main distraite, crocheta sa cheville pour lui faire perdre l’équilibre et s’enfuit en courant sans qu’il puisse l’attraper.
Deux semaines plus tard, elle était arrêtée et condamnée pour tentative d’acte terroriste.