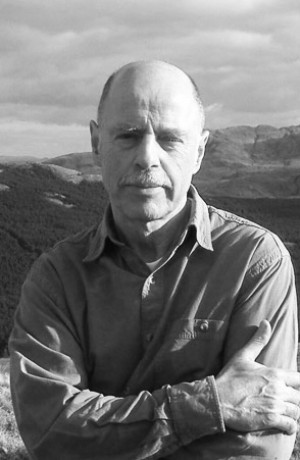Murdo Munro travaille dans les forêts de son île natale sur la côte ouest de l’Écosse. Il s’est depuis longtemps résigné à sa solitude et à l’hostilité froide de sa femme lorsque, le jour du mariage de sa fille, devant la perspective du face-à-face conjugal qui l’attend, il décide de brûler sa maison et de partir.
Munro marche dans cette forêt qu’il aime, monte dans un bateau et va rejoindre sa sœur. Après des semaines vécues dans la crainte d’être rattrapé il décide de faire face à ses responsabilités et de retourner chez lui, mais il reçoit une lettre de sa femme qui l’informe de son désir de le voir puni.
L’écriture est magnifique, aussi bien dans l’évocation puissante de la nature que dans le reflet du tourment intérieur qui ronge le personnage. Cooper écrit un livre magnifique sur l’errance, sur la difficulté d’être soi quand les autres ne vous connaissent pas tel que vous êtes et vous font exister à l’inverse de ce que vous voudriez vivre.
L’auteur du Cœur de l’hiver confirme sa profonde originalité et son talent d’écrivain en prise avec la nature.
-
A la fois tendre et cruel, âpre et sauvage, ce texte a la rudesse et la beauté des Highlands. Une très belle leçon de vie, à méditer. »
Sandrine Maliver-Perrin -
Mari et père mal aimé, Murdo incendie sa maison et disparaît au sens propre dans la nature. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans la fugue de cet homme, au soir d'une vie qu'il a le sentiment de n'avoir pas vécue. Tel Thoreau avec "Walden ou la vie dans les bois", Dominic Cooper, dans une langue fine et ciselée, suit pas à pas Murdo dans une nature qui devient la matrice de l'homme en quête de lui-même. Forêts, collines, mer et montagnes raisonnent de la multitude des vies animales et végétales qui font écho à l'existence sans lendemain de Murdo. Car le vieil homme n'a d'autre projet que de vivre sa disparition. La narration a ceci de particulier qu'on suit Murdo pas à pas sans jamais connaître ses intentions. La fuite seule occupe ses pensées. Avec une dernière énergie, Murdo s'applique à renoncer. Jusqu'à ce qu'ayant vécu enfin, il arrive au bout du chemin. Pathétique destinée ? Sans doute, mais Cooper sait aussi lui insuffler de la grandeur, celle que possède tout être vivant auquel son roman sait avec subtilité rendre hommage.
-
Le coeur de l’hiver, du même auteur, nous avait déjà subjugué par sa force et sa beauté austère. Avec Vers l’aube, Dominic Cooper explore à nouveau l’âme d’un personnage apparemment fruste mais souterrainement complexe qui, incapable de formuler ses angoisses, ne trouve de répit que dans une confrontation à la fois brutale et émerveillée avec la nature. Cette nature - des collines, des rocs, de la bruyère, des lacs scintillants, une mer omniprésente même quand on ne la voit pas -, il la décrit avec une acuité peu commune, attentif à la moindre variation de lumière, de perspective, au plus petit insecte, aux sensations diverses qu’éprouve le vagabond. Loin d’être un décor, elle est au contraire le véritable personnage central du livre : on pense à Giono et à Tarjei Vesaas, écrivains qui, tout comme Cooper, ont su frotter comme des silex le coeur de leurs personnages aux parois d’un monde fascinant, menaçant, enivrant, pour produire l’étincelle de la beauté. On n’est pas près d’oublier la trajectoire erratique de Murdo Munro, ni la beauté du spectacle sauvage qui entre en résonance avec ses espoirs, ses peurs et ses doutes.
Jean-Pierre Ohl -
« Troublant, admirablement écrit et tourmenté, ce petit chef d’œuvre venu d’Ecosse confronte un homme revenu de toutes ses illusions à une nature tour à tour imprévisible, hostile ou douce, qui l’accompagne dans sa fuite, après un acte de bravoure qu’il juge irréparable. Ayant coupé le cordon ombilical le reliant à sa famille et au village, que lui reste-t-il à espérer ? L’aube peut-être ? Pas sûr… (Page des libraires)
Claude AmstutzLibrairie Payot (Nyon (Suisse))
-
Plus d'infos ici.MIDOLA.FR
-
Marielle Lefebure-Sahkti
-
CRITIQUESLIBRES.COM
-
Alice Théaudière
-
-
LIVRESDEMALICE.COM
-
« Vers l’aube est un chant du cygne au cœur d’une nature impassible. Un texte somptueux et cruel, une fable sur la solitude et l’échec. »Adeline Bronner -
, le 17 novembre 2009
FRANCE 3 -
« […] Vers l’aube est l’un des plus beau roman étrangers parus cet automne, une petite cathédrale de souffrance et de beauté paysagiste. Nous faisons partie de ces supporters inconditionnels de l’économie poétique. »Benjamin BertonFLUCTUAT.NET
-
« Après Le Cœur de l'hiver, Cooper nous renverse de nouveau dans une histoire brutale et simplissime, au plus près de l'âpre nature écossaise. Implacable. »
Top 10 des livres 2009CHRONIC’ART.COM -
« Associée à cette nature très présente, les questions de l’errance et de la conscience de soi permettent de donner à ce roman une force et une dimension toute particulière. »
Marion RotrubinTEMPS LIBRE -
« Dans ce roman de l’errance et de la difficulté d’être soi, l’évocation puissante de la nature écossaise accompagne l’expression du tourment intérieur qui ronge le personnage. »
Arto ClercPROFIL -
« On avait rarement lu un auteur connaissant aussi bien les hommes et la nature. Et on ne peut qu’être fasciné par le style à la fois ample et simple de ce roman trentenaire, qui trouve toute sa place dans la "Bibliothèque écossaise" des Editions Métailié. »Olivier Van Vaerenbergh
FOCUS VIF -
« Apre, tendu, ce roman écossais mêle aves brio peinture sociale et portrait intimiste. Nouvel exemple avec l’histoire d’un homme qui fuit le mariage de sa fille. »
Alain FavargerLA LIBERTE -
« D’extraordinaires évocations des paysages d’Ecosse donnent à ce roman sa couleur et son atmosphère. »
Claude Amstutz24 HEURES -
« Qu’est donc un homme sous le regard d’un oiseau, interroge ce roman naturaliste et intimiste, le second de Dominic Cooper, publié par Métailié dans précieux domaine écossais. »
François MontpezatDNA -
« Roman de la solitude et de l’échec, Vers l’aube sonne comme un chant du cygne, celui d’un homme qui tente une dernière fois de prendre sa vie en main. Puissant, lyrique, ce Cooper-là valait bien un come-back. »
Julien BissonTECHNIKART -
« […] l’art magique d’unir l’insignifiant et le grandiose. »
Julie CoutuCHRONIC’ART -
« Un mélancolique chant du monde »Sophie PujasTRANSFUGE -
« Emouvant, Vers l’aube est une déchirante allégorie du passage de l’âge mûr à la vieillesse. »
Yves Le GallLE MATRICULE DES ANGES -
« Vers l’aube est l’histoire d’une fuite : celle de Murdo, vieil homme qui, sur un coup de folie, décide de changer de vie le jour du mariage de sa fille. […] La fin tragique de l’errance de Murdo renforce l’impression de conte absurde que procure ce puissant petit roman. Et sa noirceur sarcastique l’élève au rang de méditation sur la vanité de nos tentatives pour échapper à notre sort. »
Bernard Quiriny
LE MAGAZINE LITTERAIRE -
« Ecrit par un Ecossais de 65 ans, Vers l’aube est une odyssée sans Ithaque, le portrait déchirant d’un homme qui tourne le dos à sa propre vie, à ses rêves et à ses tourments, pour plonger dans l’abîme des forêts silencieuses. Comme dans ces paraboles bibliques où les déserts servent d’ultimes refuges aux âmes naufragées. »
André Clavel
LIRE -
« Vers l’aube, de Dominic Cooper, réussit l’exploit, à partir de personnages et de sentiments banals, de mettre à jour les instincts, désirs et peurs refoulés de nos vies. »
Luc Chatel
TEMOIGNAGE CHRETIEN -
« On ne peut qu’applaudir ce laconisme en s’enfonçant dans ce livre mouvant, dont chaque mot semble avoir été soupesé des années durant. »
Nicolas UngemuthLE FIGARO MAGAZINE -
« Comme dans Le cœur de l’hiver, Dominic Cooper tire le meilleur parti de son incroyable décor naturel entre terre et mer. Difficile de ne pas être ému par la volte-face et la dérive d’un homme qui cherche à quitter son île pour rejoindre la côte écossaise. »
Alexandre Fillon
LIVRES HEBDO -
« Nouveau petit bijou des lettres écossaises, avec cette fugue d’un bûcheron au centre de la Terre. »
Emily BarnettLES INROCKUPTIBLES -
« Un paysage, et, à l’intérieur du paysage, un bonhomme. Le paysage est écossais, insulaire, somptueux. Le bonhomme est disgracieux, mains "comme des rames", corps solide, façonné par le travail dans la forêt, sous une "petite tête ronde aux grandes oreilles molles", le visage tordu par un tic. Le paysage est animé d’une force autonome, qui se manifeste à travers le vent. Quant à Murdo Munro, puisque tel est son nom, il vient de faire quelque chose d’extraordinaire. »
Claire DevarrieuxLIBERATION
1
– Et maintenant, prions.
La brise légère qui tourbillonnait et balayait en douces rafales les petites hauteurs du Beinn an Eòin était venue d’au-delà du grand large. Ses mouvements semblaient fortuits et sans pertinence en comparaison des vies ordonnées que les habitants de l’île menaient dans les vallées en contrebas. Ses origines et ses intentions étaient obscures ; car elle était poussée par une force qui ne devait rien aux créations des hommes. Et c’était seulement la terre, avec ses joues balafrées de roche et de bruyères, de mousses charnues et d’herbes flexibles, seulement cette masse meurtrie et l’attention muette mais indéfectible du lointain soleil qui s’étendaient sous l’avancée du vent à travers les collines de l’île. Car les gens eux-mêmes, éloignés de leurs anciennes intuitions et de leurs passions inavouées par un monde nouveau et plus rationnel, avaient depuis longtemps détourné le regard et étaient maintenant absorbés par des choses plus proches de leurs vies.
La brise continua d’errer sur la colline, peignant et caressant la douce surface du sol, jusqu’à ce qu’elle atteignît le bord d’un escarpement. Là, à la frontière entre les deux mondes, elle se ramassa sur elle-même et bondit haut dans l’air rare et bleu pour rejoindre un courant qui portait les busards survolant cette côte intérieure en quête de nourriture.
Depuis ces hauteurs, la terre en contrebas offrait une perspective étrangement irréelle. Au sud, sur la droite, les méandres jumeaux d’une route à voie unique et d’une rivière sinueuse soulignaient la forme de la vallée, laquelle était fermée par un col bas caché à plusieurs kilomètres derrière les collines. Au nord s’étendait un petit bras de mer en forme de spatule, protégé de la houle de l’océan par l’étranglement boisé à travers lequel les marées se précipitaient inlassablement deux fois par jour. Avec sa rivière paresseuse, la vallée rencontrait le bras de mer dans un enchevêtrement de roseaux, de mares et d’eaux stagnantes ; et ici, à l’extrémité du lac, s’étendait le groupe éclaté de maisons qui formaient le village isolé d’Acheninver. De loin, on ne distinguait pour ainsi dire aucun motif dans la disposition des bâtiments et le seul trait proéminent était l’église avec son clocher trapu.
Rien ne bougeait. Seuls les tourbillons de la brise et parfois le cri d’un oiseau marquaient le passage implacable des heures. Loin au-dessous, le village semblait cloué au sol sous les rayons du soleil de la fin d’après-midi. Derrière
le voile de la distance, ce petit rassemblement humain demeurait immobile, un mulot tétanisé à la vue du faucon.
– Et maintenant, prions.
Les bruissements et les mouvements moururent, et dans le silence qui s’ensuivit, pendant que le pasteur se ressaisissait pour la prière à venir, le bêlement d’un mouton sur le flan d’une colline voisine entra par les portes ouvertes de l’église.
Au premier rang, Murdo Munro regarda sa femme du coin de l’œil. Il détourna vivement les yeux. Derrière eux, les gens du village se tenaient en rangs serrés, hommes et femmes sur leur trente et un pour le mariage. Bergers et laitiers, conducteurs de tracteur, gardes forestiers, chefs d’équipe, représentants de commerce, maçons et pêcheurs, le visage plissé et buriné, les yeux rendus brillants par l’alternance de soleil, de vent et de pluie au fil des saisons, se tortillaient tous dans leurs vêtements, mal à l’aise, et tendaient le cou pour assister au rituel qui resserrerait une fois de plus les liens qui les unissaient. Et les femmes, elles aussi endimanchées avec leurs manteaux et leurs chapeaux fleuris perchés sur la tête, ressemblaient à du ciment entre le dallage grossier formé par les hommes.
Murdo restait là, pensif, sa petite tête ronde aux grandes oreilles molles penchée en avant au sommet de la tige maigre de son cou. Lui aussi se sentait mal à l’aise dans son vieux costume bleu, avec le col de sa chemise trop grande qui lui flottait autour du cou à la manière d’un licol. Une de ses énormes mains, noueuses et entaillées, se leva spontanément pour tenter de rendre son col plus confortable. Derrière le voile humide de ses yeux, l’image de sa femme, Margaret, persistait. Il cligna des yeux et, devant lui, il vit la silhouette de sa fille, Flora, blanche et toute de blanc vêtue à l’exception du noir de ses cheveux. Et à côté d’elle, la robuste charpente de Hughie Morrison, l’homme que, devant Dieu, elle prenait pour époux.
C’était le 4 août. Et l’image de Flora se confondit avec celle de sa mère. Car cela faisait vingt-six ans, jour pour jour, que lui, Murdo Munro, s’était tenu là dans cette même église et avait pris la jeune Margaret pour épouse. Comment était-ce possible ? Était-ce vraiment la même femme qui se trouvait aujourd’hui à côté de lui ? La jeune Margaret des Borders. La jolie et jeune Margaret, avec ses yeux rieurs et son caractère riant.
Murdo fronça les sourcils.
Avec sa peau blanche, ses petites mains et son corps rond qu’elle gardait caché, dont il avait tenté de chasser l’image de ses pensées grâce à l’alcool quand, pendant ces longs mois, il avait craint de ne jamais la conquérir. Mois après mois, elle s’était montrée polie avec lui, mais sans plus ; et lui, désespéré, ne l’en avait désirée que davantage – avait désiré son corps et peut-être son âme, aussi. Mais, peu à peu, il s’était habitué à éprouver du désir pour elle et il avait fini par accepter sa défaite. C’est ainsi que tout s’était toujours passé pour lui. Alors, quand ils s’étaient croisés par hasard sur la route qui surplombait le village par une journée d’hiver terrible et qu’ils s’étaient abrités tous les deux de la tourmente sous une corniche de roche noire, il était resté à côté d’elle, maussade, sans vraiment penser à autre chose qu’à combien de temps la pluie allait durer. Puis, couvrant le bruit de la pluie, le rire léger de Margaret avait crevé la surface de leur silence et, lorsqu’il s’était tourné vers elle, Murdo l’avait vue lui sourire.
– Ah, Murdo Munro, toi et tes idées noires !
Elle avait ri et, submergé par une vague inexplicable de son ancienne passion, il l’avait saisie et embrassée avec fougue. Plus tard, dans le silence glacial et humide de sa maison, au village, il s’était assis à sa table près de la fenêtre, ses joues osseuses ruisselantes de larmes, et nul n’aurait pu dire si ce soudain effondrement puéril était dû à de la joie, à du soulagement ou à une tristesse désespérée profondément enracinée. Un mois plus tard, ils étaient fiancés, et ce même jour du mois d’août suivant ils étaient mari et femme.
Il était difficile pour Murdo de suivre le lien qui unissait la jeune fille souriante de sa jeunesse à la femme qui se tenait à côté de lui. Les larmes qui avaient perlé à ses yeux fixes en cet après-midi d’hiver étaient peut-être un avertissement monté du plus profond de lui pour lui dire que le baiser si impétueusement donné sur la colline avait déclenché le début de son lent déclin. Oui, et quel déclin ! Les premières semaines (les premiers mois, même) de son mariage s’étaient assez bien passées, portées par l’espoir de choses meilleures. Mais les choses meilleures n’étaient jamais arrivées. Murdo se sentait alors ouvert et de bonne volonté, docile et indulgent ; et pendant un temps, Margaret lui avait retourné ses sourires. Mais, sans drame, ils s’étaient éloignés. Il n’y avait pas eu de violente querelle, pas de franche dispute pour marquer le début de leur relation défaillante ; mais lentement un silence, lourd et froid comme de la tôle, s’était dressé entre eux. Murdo, qui n’avait nulle part où aller à part le bar de l’hôtel quand il voulait échapper à Margaret, avait pris l’habitude ancestrale de boire, et même s’il ne trouvait pas d’échappatoire dans les brumes de l’alcool il restait assis, les paupières plombées, devant les pintes de bière brune et les verres de whisky huileux, l’esprit enfermé dans son désespoir grandissant. Au début, cela avait été terrible, mais lorsqu’il eut enfin abandonné tout espoir de trouver le bonheur avec cette femme, Murdo découvrit que, d’une certaine façon, il était étrangement soulagé d’avoir retrouvé son ancien état de mélancolie.
Et qu’avait ressenti Margaret, qu’avait au juste attendu de lui cette femme ? Murdo n’en avait aucune idée. Mais, comme beaucoup de femmes au caractère bien trempé, elle avait tourné tout ceci à son avantage. Elle avait déplacé son existence vers le village et s’était rendue indispensable dans la vie locale, se liant d’amitié avec certains, s’insinuant dans les bonnes grâces des autres et méprisant les rares à s’élever contre elle – et cela sans cesser de parler amoureusement de son mari. Même quand elle réintégrait leur maison, avec ses deux pièces de plain-pied et ses chambres à l’étage, elle prenait rarement la peine d’injurier ou de houspiller Murdo mais anéantissait efficacement le dernier semblant de chaleur qui restait entre eux en l’ignorant d’un air tranquille. Tant qu’il lui rapportait son salaire de la semaine, elle tolérait sa présence.
Et puis, au cours de la deuxième année de leur mariage, elle obtint de Murdo la chose même qui allait devenir le symbole de leur division. Tard, un soir de mars, Margaret, au terme de sa grossesse, avait envoyé Murdo chercher la sage-femme. Tandis que ses pieds crissaient et dérapaient dans la rue, Murdo nourrissait l’espoir que l’enfant à naître allait remédier à la tristesse de son mariage. À son retour avec la sage-femme, il s’était assis devant le feu et avait écouté les bruits et les silences de la chambre au-dessus. Les heures étaient passées lentement mais enfin, au plus profond de la nuit immobile et glacée, Murdo avait été tiré de sa somnolence par un cri fluet et inégal. Un moment plus tard, la sage-femme était venue lui dire qu’il pouvait monter. Timidement, il s’était glissé dans la chambre où Margaret était couchée, un petit visage fripé serré contre sa poitrine. Et si le visage de Margaret avait reflété de la joie maternelle, il aurait pu y avoir une lueur de rédemption pour leur couple. Mais elle affichait un air de triomphe et celui-ci disait à Murdo que l’enfant n’allait pas être le leur mais uniquement le sien à elle.
À dater de ce jour, Margaret et lui n’avaient pratiquement pas échangé un mot à propos d’autre chose que des détails pratiques. Toute l’affection et tout l’amour de Margaret se reportaient sur sa fille, Flora. En la regardant sourire et embrasser l’enfant, Murdo pensait à ce qu’elle et lui auraient pu partager et à ce qu’ensemble ils auraient pu être pour Flora. L’enfant était choyée et maintenue avec un soin jaloux à l’écart de toute proximité éventuelle avec son père. Quand Murdo travaillait dans les bois, les voisins étaient invités à venir s’extasier sur le nourrisson innocent ; et les dimanches, quand Murdo était chez lui, Margaret exhibait sa petite Flora d’un bout à l’autre de la rue du village. Margaret parlait toujours de l’enfant comme de la sienne : Murdo et Flora n’étaient jamais mentionnés dans le même souffle.
Comme les années passaient, Murdo s’installa dans son rôle de spectateur. Et il buvait. Jamais tout à fait jusqu’à pénétrer dans l’antre de l’alcoolisme, mais dans son antichambre, déjà peuplée par tant d’autres habitants de l’île.
Flora devint une jolie fille pleine d’aplomb ayant hérité de la beauté de sa mère et dépourvue du tempérament sombre de son père. En fait, lorsqu’il buvait, Murdo se demandait parfois s’il était vraiment le père de cette enfant tant elle paraissait peu lui ressembler. Elle devint l’une des meneuses des enfants du village, prit la tête de l’école locale et, encouragée par sa mère, commença à se donner des airs alors qu’elle devenait une jeune femme. Cependant, c’était comme si Margaret avait donné à sa fille non seulement sa vie mais également son bien-être physique, car au fur et à mesure que Flora s’épanouissait, Margaret dégringolait la pente du déclin. Elle grossit au point de ne plus rentrer dans ses vêtements ; puis son visage suivit l’exemple de son corps, transformant ce regard vif et pétillant en petits yeux de cochon méchants enfoncés dans les coussins de ses joues ; elle perdit aussi ses cheveux, qui devinrent mous et sans vie.
À tout ceci, Murdo Munro avait assisté sans inquiétude ni chagrin. Son amour pour sa femme avait été enterré si profondément par la froideur de Margaret que tout cela se déroulait devant lui comme figé dans l’irréalité. Quant à Flora, il était difficile de dire quel genre de relation il avait, ou aurait pu avoir, avec elle. Sa mère lui avait appris non pas la haine mais le mépris vis-à-vis de son père : une chose qui avait fait sombrer Murdo plus profondément dans l’alcool. Car, pendant tout ce temps, il avait souffert d’un amour silencieux, étouffé, pour sa fille. Il l’aimait avec la générosité autodestructrice d’un secret inavoué et qui présentait une étrange ressemblance avec son ancien désir pour Margaret. Le seul exutoire à son amour était de s’épuiser au travail en sachant que l’argent gagné procurerait à l’enfant les choses matérielles dont elle avait besoin. Mais il aurait voulu pouvoir faire plus que cela ; et quand Margaret dépensait l’argent qu’il avait gagné à la sueur de son front pour acheter un cadeau à Flora et que la fillette se jetait au cou de sa mère, débordant de joie et de bonheur, Murdo les regardait depuis l’autre bout de la pièce, chaleureusement, mais l’âme pétrifiée par ce qui lui était refusé.
– Oh Seigneur, qui dans Ta grande miséricorde…
Comme la prière commençait Murdo pencha la tête. Il avait été élevé dans la tradition de l’église et était par nature un homme croyant, même s’il ne comprenait guère les mots du pasteur ni les doctrines religieuses. Comme toujours, le rythme irréel de l’office exerçait une certaine fascination sur son être intérieur, le maintenant en équilibre au bord du bonheur. Il avait un sentiment étrange, vaguement conscient du fait que ce rythme lui apportait tout ce que le monde lui avait refusé, un sentiment de chaleur, de crainte respectueuse et de désir.
Il leva les yeux et vit le regard du pasteur fixé sur lui. Les baissant à nouveau, il aperçut la silhouette de sa fille, blanche comme le cou d’une mouette, à côté de l’imposante carrure de son homme. Elle, l’unique source d’équilibre
de sa vie, s’en allait. Et avec la soudaineté d’un éclair de compréhension tardif, il comprit que ce jour, cette cérémonie, marquait la fin de sa vie.
Le 4 août ! Ce même jour, vingt-six ans plus tôt, il s’était tenu devant le révérend Alexander Donaldson et avait eu l’impression que sa vie commençait. Aujourd’hui, il était là une nouvelle fois, mais pour assister au départ de sa fille vers son nouveau monde. Flora partie, quelle place occuperait-il dans sa propre maison ? Lentement, les véritables dimensions de l’avenir dressèrent leurs formes sinistres devant lui. Des années de silence et de solitude inutiles sous le même toit que Margaret ? Et quand viendrait l’heure de la retraite et qu’il ne pourrait plus s’échapper quotidiennement au travail, que se passerait-il ? Les tressaillements sourds de la panique se manifestèrent dans le ventre de Murdo.
Dehors, sur les flancs du Beinn an Eòin, loin au-dessus de l’extrémité du lac, la brise miroita, souffla, et la terre s’agita.
Murdo regarda Hughie Morrison. C’était un bon garçon, c’est vrai, fort et digne de confiance, avec un emploi régulier au domaine de Dorusduan. Il subviendrait sans problème aux besoins de Flora, il n’y avait pas à s’inquiéter pour ça. Et avant l’arrivée des enfants Flora pourrait continuer de travailler au magasin. Non, ils ne manqueraient de rien. Tout irait bien pour la petite.
Il songea aux autres villageois alignés derrière lui dans l’église. Il les connaissait tous assez bien mais ils ne représentaient désormais plus rien pour lui, à présent que son esprit était absorbé par l’épanouissement d’un nouvel espoir. Seul le vieux Donnie MacGillivray, un célibataire de soixante-quinze ans qui était son compagnon de boisson, lui apparaissait comme une réalité. Enfin, on laissait toujours quelque chose derrière soi.
Les suppliques du pasteur et les répons de plus en plus fervents de la congrégation s’atténuèrent pour passer au second plan. Murdo se pencha et s’appuya sur le dossier du banc devant lui. Il regarda fixement le banc de bois dur.
Une fois encore, la brise se répandit dans un regain de puissance. Et une fois encore Murdo se souvint des paroles du pasteur, restées dans un coin de sa mémoire depuis un office dominical quelques semaines plus tôt :
“Si votre œil droit vous fait pécher, arrachez-le et jetez-le ; il vaut mieux perdre un de vos organes que condamner votre corps entier à être jeté en enfer. Et si votre main droite vous fait pécher, coupez-la et jetez-la ; mieux vaut perdre un de vos membres que condamner votre corps entier à l’enfer.” Seigneur, aie pitié de moi pauvre pécheur !
La famille, la vieille unité sacrée des vallées, était en danger. Flora partie, le corps se réduisait à l’homme et à sa femme qui devaient, dans la déchéance et les privations inévitables de la vieillesse, se porter mutuellement jusqu’en enfer. Tel était le jour sombre sous lequel les choses apparaissaient à Murdo Munro en cet après-midi d’août au mariage de sa fille.
Et, avec la gloire coupable des mélancoliques, il eut la certitude que lui seul était le membre honteux qu’il fallait couper du corps. Margaret s’était construit une vie (que celle-ci fût bonne ou mauvaise dépassait son entendement) et c’était lui l’obstacle. De cela il se rendait compte, et rien d’autre, aucune considération pratique, n’importait.
Sa bouche et son menton se tordirent violemment vers la gauche, et son cou s’étira en avant dans une série de spasmes ridicules, un réflexe nerveux qui transformait son visage déjà maigre et aux traits confus en un fouillis indescriptible – un tic que les gamins du village adoraient imiter. Murdo sentit que sa femme le dévisageait.
Le tic se répéta à plusieurs reprises, de plus en plus fort. Dehors, sur les rochers escarpés du Beinn an Eòin, une corneille mantelée ébouriffée fut catapultée vers le ciel par une nouvelle bourrasque.
Il y eut une brusque interruption dans l’office pendant que Hughie Morrison cherchait l’alliance. Dans le silence, Murdo dit doucement mais clairement :
– Oui, dit-il. Alors… c’est comme ça.
Et la brise cessa de souffler.
– Murdo ! lui siffla Margaret. Murdo !
Il se redressa lentement, extasié, et se tourna face à elle. Sous son chapeau bleu trapu, ses yeux, dénués d’affection, le menaçaient. La bouche de Margaret formait un rond serré plein de détermination au milieu de ses joues bouffies de graisse.
Murdo poussa un profond soupir et déclara :
– Faut que je sorte un petit moment.
– Murdo, tu ne peux pas partir maintenant. Pour l’amour du ciel, enfin !
– Quoi ? Faut que je sorte. Je serai pas long.
– Murdo Munro, je te dis d’attendre. Tu veux faire honte à tout le monde ?
Murdo marqua un temps d’arrêt et baissa ses yeux vitreux devant la menace de sa femme. Puis, doucement mais fermement, il dit :
– Je comprends parfaitement ce que tu dis, ma femme ; mais fiche-moi la paix. Faut que je sorte un moment.
Et alors que sa femme se préparait à riposter, Murdo Munro passa d’un pas résolu devant le corps massif de Margaret et émergea dans l’allée.
Il entrevit Flora qui se retournait ; il entrevit aussi Mairi Patterson et Jenny Melville qui fronçaient les sourcils sous leurs bonnets élégants ; il entendit de vagues murmures et sentit des regards le suivre depuis les bancs alignés de chaque côté. Mais, de sa démarche maladroite et tranquille, il descendit l’allée centrale, se taillant un chemin dans les convenances des villageois. Ses pas, raides et déterminés, marquaient la mesure de sa nouvelle résolu-tion. Les couleurs des habits de mariage flottèrent comme des bulles à côté de lui avant de disparaître, et il s’échappa en franchissant les portes en chêne sombre de l’église.
Juste avant de quitter l’église, il appartenait encore à la congrégation du village et ce qu’on apercevait de la route à l’extérieur était presque hors de sa portée. Sa résolution vacilla. Mais il fit encore un pas et fut dehors, désormais partie intégrante de la terre et de l’océan qui l’entourait, avec le voile bleu et les traînées des cirrus haut dans le ciel ; et les habitants d’Acheninver, témoins de ses années de défaite, se retrouvèrent, assez soudainement, derrière lui – des silhouettes irréelles du passé.
Murdo cligna des yeux et se frotta le menton avec le dos de sa main calleuse. Un hérisson gisait recroquevillé au bord de la route. Un hêtre, immobile et immensément fort, fut agité un instant par une bourrasque tardive des brises de l’après-midi.
Murdo monta la petite côte de la route et tourna pour entrer dans la rue principale. Hormis les quelques maisons éparpillées en périphérie, cette unique rue constituait le village d’Acheninver. Une centaine de mètres de chaussée flanquée de deux colonnes de bâtiments trapus blottis au ras du bitume pour plus de sécurité. Les maisons proprement dites étaient pour la plupart de plain-pied et percées d’une fenêtre ou deux dans le toit, bien qu’il y eût par endroits une habitation plus grande pourvue d’un véritable étage. Puisqu’il y avait si peu de différences dans la construction de ces maisons, les traits distinctifs tenaient aux détails de leur finition extérieure. Beaucoup étaient grises et austères dans leur habit de pierre ; certaines étaient couvertes d’une mince couche de chaux blanche, tandis que quelques autres – des maisons de vacances appartenant à des touristes venus du Sud – étaient habilement peintes, avec des boiseries soulignées en couleurs vives. Les maisons étaient assez plaisantes mais il y avait un air complexe de connivence, d’inceste, dans la façon dont elles étaient serrées les unes contre les autres tandis que dans toutes les directions, les collines, l’eau et le dôme du ciel s’étendaient à l’infini.
Murdo passa devant l’hôtel d’Acheninver qui se dressait telle une sentinelle à l’entrée de la rue du village. L’avant-cour au sol inégal, les cagettes de bouteilles vides, la porte verte sans fioriture qui donnait sur le bar – ces détails familiers ouvrirent les charnières de sa mémoire car c’était là qu’il avait cherché refuge à son mariage durant toutes ces longues années. Il eut une moue amère et se détourna, laissant derrière lui un sillage confus d’images.
Lorsqu’il arriva aux premières maisons, il s’arrêta au milieu de la route et regarda fixement devant lui. Pratiquement tout le monde se trouvait à l’église et le village se dressait, telle une coquille vide, maussade et insensible, attendant de voir comment cet homme allait tourner. Des toits d’ardoise soutenaient le poids inconnu du ciel ; une haute fenêtre en mansarde achevait de boire la lumière du soleil dans une explosion confinée ; une porte basse bâillait, humide et froide dans l’ombre de sa rivale d’en face ; un épais bosquet de sureaux, envahissant et pitoyable, poussait dans l’espace étroit qui séparait deux bâtiments. Sous cette surface paisible glissait l’image bien camouflée mais vorace de l’irrévocabilité.
Comment pouvait-il quitter tout cela ? Chaque pierre, chaque coin de rue, chaque détail éveillait un souvenir dans son esprit embrouillé. Ces souvenirs étaient pour la plupart mauvais, porteurs d’instants de tristesse et de douleur au fil des ans. Même les quelques bons moments, remontant aux premiers mois qu’il avait connus avec Margaret, même ces rares souvenirs de bonheur étaient diminués par ce qu’ils étaient devenus. Oui, Acheninver l’avait vu traverser des années noires. Et pourtant, c’était ce qu’il connaissait, ce qui constituait sa vie. Aussi terrible que cela avait pu être, comment pouvait-il, lui, un homme de plus de cinquante ans, mettre en pièces tout ce qui s’était passé avant et se lancer dans un avenir imprévisible ? Non, les gens ne faisaient pas cela. Les hommes grandissaient, avaient un travail, une maison, une femme, des enfants – et que cela leur plaise ou non, ceux-ci leur appartenaient jusqu’à leur mort. N’en était-il pas toujours ainsi ?
Murdo traînait les pieds sur le bitume inégal et, l’espace d’un instant, son cœur fléchit, tiré vers le bas par la peur. Il devait arrêter sa folie et retourner à l’église. Retourner à ce qui était réel : sa femme, sa maison, ses responsabilités et son avenir. Il avait survécu vingt-six ans comme cela. Il avait vu d’autres hommes finir leur vie dans des circonstances similaires, cédant devant les exigences des conventions et attendant passivement la libération de la mort. Ils trouvaient leurs petites compensations et distractions, d’une façon ou d’une autre… Alors, pourquoi lui, Murdo Munro, devrait-il se prendre pour l’homme capable de changer tout cela ?
Il regarda la rue en direction de sa maison, qui se dressait légèrement en retrait de la route à l’autre extrémité du village. Son visage se crispa, pris d’un spasme nerveux, tandis que ses mains, grandes comme des rames, pendaient mollement le long de son corps. Il resta ainsi un moment, parfaitement immobile à l’exception de ses yeux qui faisaient d’incessantes allées et venues en quête d’une décision.
Puis, haut dans le ciel, un goéland argenté fendit le silence en lançant une série ininterrompue de cris violents et perçants. La tête de Murdo bascula en arrière et il regarda l’oiseau qui décrivait des cercles, une croix blanche à mi-hauteur des profondeurs marines du ciel. L’oiseau vira et plana en silence, tournant la tête de façon sporadique pour regarder l’homme qui lui apparaissait comme une petite excroissance enracinée dans la gorge de la rue du village.
Puis à nouveau, comme rempli par quelque chose d’extérieur à lui, le cri de l’oiseau retentit, claironnant et plaintif, sans interruption, jusqu’à ce que le ciel entier fût couvert par la toile de ses échos, jusqu’à ce que tout ce qui était visible semblât devoir céder et attendre soumis par le respect qu’imposait le pouvoir de cette créature. Sans relâche l’oiseau criait, le rythme régulier de son vol détaché, imperturbable, le soleil embrasant son jabot blanc. Une fois encore, il observa un bref silence, puis, après deux derniers cris, il fit demi-tour et partit en direction du nord avant de disparaître derrière l’horizon.
L’immobilité nouvelle, délimitée par la chaleur du soleil et l’odeur de la terre, douce et piquante, berça l’esprit de Murdo, l’endormit, l’amena à un degré de paix et de clarté jusque-là inconnu de lui. Pendant quelques brèves secondes, tout ce qui se trouvait au-delà de sa conscience immédiate devint éloigné, un simple reflet du reste du monde, une chose complètement indépendante de son existence. Sa femme, sa fille, son travail – tous les composants matériels de sa vie conjugale – ne furent plus que des petits détails de ses vingt-six années de tristesse. Ce n’étaient plus des obligations incontournables mais de simples obstacles aux indestructibles espoirs de joie qu’il portait malgré tout en lui, qu’il porterait peut-être même jusqu’au bord du tombeau. Pas des espoirs de réussite, de richesse ni même de bonheur – des choses superficielles –, mais des espoirs de trouver de l’audace, une joie cachée, une paix au cœur même de son âme en conflit. Tout cela vint à Murdo sous la forme d’un instinct, apparemment dénué de signification, mais néanmoins vital. Et, avec l’obstination d’un animal suivant son instinct, il sortit de sa transe et continua de remonter la rue.
Il marchait entre les maisons, conscient de leur surveillance aveugle. Il poursuivit son chemin, écrasant le silence de verre sous ses pas, le visage crispé et tordu par moments, quand son esprit bataillait avec ses projets. Parfois, son allure ralentissait un instant. Il avançait comme s’il était perdu.
– Qui ça peut être ?
Une voix perçante jaillit, désincarnée, d’une maison dont la porte d’entrée était entrebâillée. Murdo sursauta.
– Ça doit être l’autre, là : ouais, c’est à peu près son heure et je reconnais le bruit de ses pas. Bon, fichez le camp ! Vous avez rien à faire ici !
La vieille Annie McPherson, une veuve grabataire retombée en enfance depuis ces huit dernières années, criait dans son charabia. Murdo était sur le point de lui répondre, de la calmer par quelques paroles, mais il se ravisa et hâta le pas en direction de sa maison.
Celle-ci se trouvait en retrait de la rangée principale, du côté est de la rue. Un court chemin de cendre menait de la route au petit bâtiment trapu avec sa porte grise et ses fenêtres brillantes. Margaret avait fait pousser des fleurs dans des jardinières et tout l’extérieur, récemment blanchi à la chaux, paraissait gai et accueillant. Les deux fenêtres du bas étaient encadrées de rideaux rouge vif tandis que, dans le toit, les rideaux jaune et bleu de la chambre de devant se détachaient nettement sur les ardoises. Murdo ouvrit la porte et entra.
L’aspect joyeux de la maison était pour lui l’ultime humiliation. C’était la cruauté de la simulation en public qui l’anéantissait. Les fleurs, les couleurs vives, la chaleur et l’ordre étaient un mensonge, une supercherie quotidienne quand tout ce qui remplissait son âme était les ténèbres. Pendant vingt-six ans, il avait porté cela dans un silence hébété, acceptant le fait que la décoration de la maison était le domaine de la femme, sans pour autant cesser de lutter pour apaiser la plaie toujours à vif qu’entretenait ce sarcasme muet. Flora l’avait détourné de semblables idées noires car il avait voulu que l’enfant grandît entourée de chaleur et de lumière dans l’espoir que de telles choses dissimuleraient les ombres qui flottaient entre ses parents. Mais à présent, avec son départ, un besoin frénétique de faire éclater la vérité s’enflammait dans l’esprit de Murdo. Cette journée, qui arrivait à la fin d’une si longue période de soumission, apportait à Murdo une détermination féroce. Le vent avait soufflé au tréfonds de son être.
Murdo se trouvait dans le petit salon. Les fauteuils lustrés rouge cerise faisaient face à la cheminée, vides. La collection de poupées et d’animaux en porcelaine exposée sur le manteau était couronnée par une estampe sur laquelle un chat paré d’un ruban fixait la pièce d’un air stupide. Un vase de fleurs en plastique était posé sur le rebord de la fenêtre. Les murs formaient une masse de motifs représentant des fleurs et des fruits. Cette horde de couleurs agressives jurait devant ses yeux, le tourmentait jusqu’à l’hébétude. Une vague sourde de rage déferla sur son âme et il s’effondra dans un fauteuil, cachant son visage dans ses mains.
Derrière ses paumes rugueuses, le panorama qu’il voyait depuis les hauteurs de la forêt se déroula. Car les vastes étendues des collines de l’île au sud d’Acheninver l’emplissaient toujours d’une étrange nostalgie. Et à présent ses yeux couverts suivaient les formes allongées, les bruyères sombres et enflées, les plateaux dégagés animés par une vie cachée, la terre qui se soulevait en buttes et en monticules d’herbe marqués de taches de roche violet-noir et sillonnés de coupures secrètes, bleu et charbon, où de petits ruisseaux dévalaient les pentes pour fuir la solitude des hautes collines. La terre s’élevait, retombait et s’élevait à nouveau dans le lointain ; et puis, enfin, elle avançait par bonds formidables. Elle avait pris de la vitesse et accéléré jusqu’à ce qu’on ne pût plus la contenir et, dans le vent violent qui toujours s’enroulait et soufflait sur cette première chaîne de collines hérissées, elle montait sous le soleil. Comme si rien ne pouvait arrêter son ascension
de plus en plus vertigineuse devant des rochers escarpés et de petits sommets, elle finissait par jaillir à la rencontre de la lumière dure et brûlante. Enfin, loin au-dessus des vallées et des petites fermes, elle déployait sa veste d’herbe duveteuse et explosait avec la lumière du soleil sur le piton rocheux connu sous le nom de l’A’Mhaighdean, la Vierge.
Murdo vit cela et son cœur se serra.
Tout au fond de la caverne de ses mains, il sentait aussi l’air, tantôt lourd de l’odeur de tourbe et de mousses suaves, tantôt froid et dur comme la roche mouillée, ou encore pétillant et piquant, inondé de bleu et de lumière. Il sentait le frôlement des fougères sur ses cuisses, le matelas souple d’herbes chaudes dans une clairière ; entendait les longues effusions déliées du courlis qui se mêlaient au cri rauque du héron dans la pureté de la côte détrempée dans le demi-jour… Tout ceci était bien loin de sa vie au village ; il y songeait uniquement en relation avec son travail, souvent solitaire, loin dans la forêt. Mais au fil de ses années de mariage, cela était devenu sa réalité.
Il trembla. Ses ongles grossièrement coupés s’enfoncèrent dans son front. Ses yeux et sa bouche devinrent des fentes. Ses grands pieds disgracieux dépassaient devant lui, aussi massifs et lourds que s’ils n’avaient pas fait partie du tumulte sévissant dans sa tête. À intervalles réguliers, il frottait ses paumes sur ses yeux, tentant d’apaiser la tension de son esprit déchiré. Les vagues esquisses d’un hymne lui parvinrent depuis l’église et chassèrent de ses pensées son dernier semblant de maîtrise. Il se sentait déchiré, écartelé par tous ces filins d’espoir et de désespoir, de peur et de courage. La complexité de la situation avait temporairement anéanti sa raison et sa lucidité, l’avait sorti de son existence étriquée jusqu’à ce que, lui assénant un dernier coup, il se retrouvât projeté dans le domaine du pur instinct.
D’un geste violent, il arracha les mains de ses yeux. Son champ de vision béant était voilé par des formes et des couleurs qui glissaient et plongeaient, des étoiles, des vipères et des excroissances amibiennes. Au milieu de tout cela, le chat le dévisageait.
– Ouais, nom de Dieu !
Les mots piétinèrent sauvagement le silence.
Il se leva rapidement et sortit de la pièce. On entendit des bruits à l’étage et un moment plus tard il redescendit dans ses vêtements de travail. Un épais chandail bleu, un jean taché et des chaussures à clous. Il jeta un nouveau regard dans le salon, ses yeux chassieux fixes et déterminés.
Dans la cuisine, il chargea sa musette de nourriture, prit l’argent qu’il trouva dans une boîte de conserve derrière le sucrier et sortit par la porte de derrière. Il revint avec un bidon d’essence. Il versa l’essence sur les fauteuils et le tapis du salon puis utilisa les dernières gouttes pour former une traînée en guise d’amorce. Depuis l’entrée, il jeta un dernier regard amer dans le salon, gratta une allumette et mit feu à l’amorce. Avec une légère explosion, la traînée d’essence s’embrasa et des flammes désordonnées se précipitèrent vers le salon. Murdo attrapa sa vieille veste de chasse en coton huilé et son chapeau sur la patère puis sortit de la maison par l’arrière en fermant la porte derrière lui. Il baissa la tête un instant et pénétra dans la jungle d’herbes, d’orties et de hautes digitales qui séparait le bâtiment de la rase campagne. Il détestait les orties, avec leur odeur âcre de décomposition, et il les piétina avec vigueur dans son impatience à s’éloigner du village. Il y avait en lui cette excitation nerveuse, ce cœur battant et cette gorge serrée qui font partie de la peur d’être pris en train de commettre un acte irresponsable.
Il bondit hors des orties, traversa en pataugeant un fossé putride et émergea au pied du coteau qui abritait le village en direction de l’est. Sans s’arrêter, il se mit à le gravir, coupant en diagonale en direction du nord-est. Déjà, son allure soutenue le faisait haleter mais jamais il ne ralentissait, levant simplement la tête de temps à autre pour évaluer la distance d’un bosquet de pins qui se dressait sur la chaîne de collines au-dessus de lui.
De plus en plus vite, il grimpait, sa démarche dégingandée de crabe raffermie par sa peur d’être repéré. Les pins perçaient le ciel tendre au-dessus de lui comme il atteignait la dernière côte escarpée qui menait à la crête. La sécurité était à sa portée.
À ce moment-là, un cri d’enfant résonna derrière lui, perçant et fluet dans l’air immobile et chaud. Poussant sur ses pieds, il s’agrippa aux touffes d’herbes qui dépassaient, tirant pour passer le sommet de la côte et entrer dans l’ombre des arbres. Les yeux écarquillés et la bouche sèche, hoquetant et étourdi, il s’effondra sur le lit d’aiguilles de pin. L’avait-on vu ? Il roula sur le ventre et rampa pour regarder par-dessus la crête.
En contrebas, le village d’Acheninver se dessinait en lignes nettes. Depuis sa maison, de la fumée montait et s’enroulait telle une immense vigne noire. Un jeune garçon descendait la rue en courant en direction de l’église, criant au feu. Un gros bâtard noir cabriolait et bondissait autour de lui, gagné par l’excitation soudaine. À l’église, la silhouette blanche de Flora se découpait avec celle de son mari devant l’entrée parmi un groupe d’amis.
Murdo enfouit son visage dans la terre. Au nom du ciel, qu’avait-il donc fait ?
Depuis l’église, une petite chaîne de personnes remontait la rue en courant vers le village.
La fumée s’épaissit. Pendant un moment, elle fut aplatie contre la maison par un souffle de vent et le bâtiment fut masqué. Comme le nuage de fumée se dissipait, Murdo vit le premier fruit de la vigne, une vrille cuivrée jaune orangé, bondir et s’enrouler vers le haut. Elle s’affaissa comme si elle manquait de force mais se remit aussitôt à serpenter, accompagnée d’une autre. L’incendie démarrait.
Murdo Munro se détourna de la scène et s’allongea sur le dos, fixant d’un air solennel les hachures des pins sur le ciel. Un fin sourire désespéré fendit son visage et il ferma les yeux un bref instant pour contempler un paysage sans horizons.