Dans la Sicile des années 40, tout minot qu’il est, Nenè s’interroge : que vont faire les hommes dans cette belle maison près du port, où habitent tant de femmes nues ? Bientôt, au fond d’un grenier, une cousine entreprenante l’éclairera sur le sujet. En grandissant, il deviendra familier de ces dames et bien vite découvrira chez elles, au-delà de la sensualité, des trésors de récits.
Autour de la table présidée par l’austère Signura, avec ses amis Jacolino et Ciccio, il perçoit le caractère étrangement sacré de ce bordel et les miracles qui s’y déroulent. La guerre gronde dans le ciel, les bombes américaines dévastent la ville, les armées allemandes quittent les lieux, mais à la Pension Eva, un vieux noble retrouve sa virilité, un ange descend nu en parachute, le portrait de Staline a des effets inattendus sur un résistant communiste, le saint patron local rend visite à l’une de ces dames. Et puis des couples fixes se forment avant de connaître une fin terrible ou bien heureuse.
Mêlant le dur récit documentaire et l’allégresse rêveuse du réalisme magique, ce roman d’apprentissage par temps d’apocalypse, que l’auteur lui-même présente comme un moment très spécial dans son œuvre, nous fait découvrir une nouvelle facette du grand romancier Andrea Camilleri.
Les particularités lexicales présentes dans le texte découlent d’un parti pris spécifique du traducteur, visant à restituer le plus fidèlement possible la langue si particulière employée par Andrea Camilleri. Les mêmes originalités sont présentes dans d’autres titres de cet auteur qui s’accompagnent parfois d’une préface ou d’une note du traducteur, Serge Quadruppani, qui explicite ses choix de traduction.
Voici un extrait d’une note de S. Quadruppani (in L’Opéra de Vigàta): « [Le] narrateur utilise pour l’essentiel une langue personnelle, élaborée à partir de l’italo-sicilien […]. Cette langue ‘camilleresque’, il s’agissait aussi et surtout de tenter d’en restituer la saveur. Truculence d’un parler populaire qu’en Sicile, les classes cultivées n’ont jamais rejeté, vocabulaire hérité des différentes civilisations qui ont occupé le sol de l’île (grecque, arabe, normande, française, castillane, catalane…), syntaxe particulière: les ingrédients de cette saveur, à quoi le lecteur italien est immédiatement sensible, sont inégalement difficiles à rendre auprès du lecteur français. »
-
, chronique de Mikael DemetsEVENE.FR
-
, chronique de Francisco CruzLES ROUTES DE L'IMAGINAIRE (Blog)
-
, Arnaud Wassmer, émission du 10 septembre 2007RADIO RCF ALPHA
-
, Patrick Van Langhenhoven, émission du 22 octobre 2007RADIO JEUNE REIMS
-
, Marie-Louise Bernasconi, émission du 29 décembre 2007"Fréquence livre"FREQUENCE PROTESTANTE
-
"[...] ce roman d'apprentissage par temps d'apocalypse que l'auteur présente comme un moment très spécial dans son œuvre, nous fait découvrir une facette nouvelle et particulièrement attachante de ce grand romancier. Un régal !"Robert QuiriconiASSOCIATED PRESS -
"A 82 ans, l'écrivain sicilien raconte avec malice cette éducation sexuelle et sentimentale en temps de guerre."Michel PaquotL'AVENIR -
"La langue de Camilleri, dont le traducteur essaie de restituer les traits dialectaux, est un véritable régal. L'écrivain sicilien n'en a pas fini de surprendre ses lecteurs."Christine BarbacciROUGE -
"[...] Andrea Camilleri est un auteur de romans extraordinaires qui puisent leurs ressources dans la culture et le passé de sa terre natale, la Sicile."Justine LacosteLES LETTRES FRANCAISES -
"Remarquablement traduit par Serge Quadruppani, La Pension Eva funambule avec une légèreté confondante entre tendresse et gravité. Une pièce rare que ce roman-là, court et limpide, que l'on voudrait protéger tant il paraît précieux."Michel GensonLE REPUBLICAIN LORRAIN -
"La Pension Eva, un petit livre "heureusement inqualifiable" mais parfaitement réjouissant, à la fois (faux) récit autobiographique et roman de mœurs (légères)."
Eric SteinerLA LIBERTE -
« Tous les émois de l’enfance et de l’adolescence sont là. Comme l’atmosphère des années 40. »Pierre MauryLE SOIR -
« Cette plongée dans la Sicile des années 1940 est irrésistible. Encore une fois, Camilleri prouve ses talents de conteur. »
Anthony DufraisseLE MAGAZINE DES LIVRES -
« […] ce dernier récit [est] présenté en postface comme des " vacances narratives que je me suis offertes au seuil de mes quatre-vingts ans". […] Une sous-maîtrese professeur de latin et de grec à ses heures perdues, des amoureux qui disparaissent dans une barque, un vieillard renouant avec sa virilité à chaque bombardement, quelques, quelques miracles, la nostalgie d’une jeunesse qui semble tout juste envolée en dépit de décennies traversées et Proust qu’il cite plusieurs fois… Camilleri devrait prendre des vacances plus souvent. »
Françoise MonfortLE MATRICULE DES ANGES
Gradus ad Parnassum
“Elle est très longue et nécessite un exercice quotidien,
la route qui au Parnasse conduit…” Muzio Clementi, Gradus ad Parnassum
Un peu avant ses douze ans, Nenè comprit enfin ce qui se passait dedans la Pension Eva entre les grands qui la fréquentaient et les femmes qui y habitaient.
Ce fut à partir du moment où sa mère fut d’accord pour qu’il s’en aille à trouver tout seul son père qui besognait au port, accord qu’il obtint quand il acommença de fréquenter le cours lémentaire, que Nenè fut pris d’une curiosité très grande pour la Pension Eva.
Nenè était bien obligé d’y passer, devant cette petite villa à trois étages presque collée au début du môle du levant, qu’on aurait dit toujours crépie de frais, avec les volets verts tenus fermés mais tellement resplendissants de couleur qu’ils donnaient l’impression d’avoir été peints tout juste à l’instant, sympathique, gracieuse, avec des fleurs sur le balcon unique du premier étage, qui lui aussi n’était jamais ouvert.
Souvent Nenè rêvait que là-dedans habitaient les gentilles petites fées, celles qui courent te sauver quand tu as fait un faux pas et que tu appelles terrorisé et désespéré.
“Petites fées, mes petites fées, aidez-moi !” et elles apparaissent, font un geste de la baguette magique et en un tourne-vire mettent en fuite le loup effaré, l’homme noir, le brigand de passage. La porte d’entrée était éternellement entrouverte et sur le mur à côté était collée une plaque de cuivre brillante qui semblait d’or, où il était gravé en italique :
Pension Eva
Nenè le savait, ce que c’était qu’une pension, il l’avait demandé à un de ses cousins, qui faisait l’université à Palerme : c’était querque chose de mieux qu’une auberge et querque chose de pire qu’un hôtel.
A Vigàta, par ezemple, il y avait un hôtel et trois auberges, des endroits fréquentés par les marins de passage, les commis voyageurs, les représentants d’armateurs, les cheminots, les camionneurs, et à travers ces quatre porches c’était tout un va-et-vient continu.
Mais alors pourquoi de jour, devant le porche de cette pension, il n’y avait vraiment aucun mouvement ? Il lui était jamais arrivé, en passant à la lumière diurne, de voir âme qui vive bouger l’huis entrouvert en entrant ou en sortant.
Une fois, justement le lendemain matin du jour où il avait atteint sa huitième année, la curiosité fut si forte qu’arrivé devant la grande porte un peu plus ouverte que d’habitude, Nenè regarda tout autour de lui et, vu que dans la rue personne passait, il fit un pas vers l’entrée et pencha le torse tout doucement en avant, assez pour pouvoir facilement regarder dedans. Mais soit passqu’il était aveuglé par le soleil, soit passqu’il avait le sang qui bouillait, au début, il ne vit rin de rin. Par contre, il entendit deux femmes qui riaient et parlaient à voix haute dans une chambre lointaine, mais ne comprit pas ce qu’elles disaient. Il fit un autre demi-pas, rentra un peu plus la tête, et ses narines furent assaillies d’une émanation de propre, de savon, de parfum comme celle qu’il y a dans le salon du barbier.
Il fut tenté de rentrer encore un peu.
Il leva la jambe et tout à coup une main s’abattit entre nuque et col, lui tira la tête en arrière. C’était un homme en uniforme de capitaine de la Marine que Nenè connaissait et qui le regardait d’un air bizarre, entre fureur et amusement. Il parlait talien.
– T’es précoce, hein ? A ton âge, tu aimes déjà le miel, gamin ? Va-t’en tout de suite d’ici !
Nenè ne comprit pas ce que l’homme disait, mais s’enfuit quand même en courant, plein de vergogne.
Quand il entra au cours complémentaire, à ses questions sur la mystérieuse pension, ses petits copains, pour la plus grande partie délinquants précoces ou fils de charretiers, débardeurs et marins, lui expliquèrent tout de suite et quasiment en chœur toute l’affaire, entrèrent dans les détails, racontèrent des particularités, expliquèrent usages et comportements comme s’ils avaient passé leur vie dedans la Pension Eva.
Et lui, il eut le petit sourire de qui a tout compris. En fait, il avait rien compris, il était perdu.
Comme ça, une fois qu’il se trouva à passer devant la Pension avec son paternel qui le tenait par la main, il rassembla tout son courage pour lui demander :
– Papa, vrai c’est, que dedans cette maison les hommes peuvent louer des femmes nues ?
C’était tout ce qu’il avait aréussi à saisir des explications de ses petits copains. A part qu’il avait aussi appris que la Pension Eva pouvait s’appeler aussi bordel ou boxon et que les femmes qui étaient là-dedans et qu’on pouvait louer étaient appelées putains. Mais bordel et putain, c’était des gros mots qu’un minot correct ne devait pas dire.
– Oui, arépondit, frais et tranquille, son père.
– Ils les louent à l’année ?
– Non, pour un quart d’heure, une demi-heure.
– Et qu’est-ce qu’ils en font ?
– Ils se les regardent, dit son papa.
Ça lui suffit. Pendant querque temps, il se contenta de l’explication, passque le Petit Jésus savait l’envie qui se le dévorait vivant de soulever la jupette de sa cousine Angela, qui avait dans les deux ans de plus que lui, et de voir comment elle était faite dessous.
A onze ans, sa mère lui donna enfin la permission espérée d’aller dans la soupente jouer avec les vieilles choses qui y étaient entassées. Avant, il avait toujours eu la même réponse : “Non, tu peux te faire mal, t’es trop pitchounet.”
Heureux, Nenè le dit à Angela, qui habitait sur le même palier, et elle fit tant et si bien qu’elle obtint aussi la permission.
Dedans le grenier, au milieu de dizaines de palombes qui, au bruit qui les dérangea, battirent des ailes en soulevant une poussiérasse qu’on manquait s’étouffer, il y avait un cache-cache, un tourne-vire, un cafarnao de vieux meubles, chaises bonnes ou défoncées, sacs de jute pleins de papiers, autres sacs de journaux, revues, livres, malles avec dedans vêtements pliés de grands-pères et d’arrière-grands-pères morts et enterrés, une autre malle remplie de parements de curé, un piano mécanique qui marchait encore, des poupées de porcelaine qu’à l’une il manquait un pied et à l’autre la main, des valises fermées avec une ficelle, des pissadous qu’on n’utilisait plus, des jarres, deux sabres, un fusil à chargement par la culasse, deux pistolets de duel, des miroirs, un appareil photo avec trépied et capuche, des vases, des lampes à pétrole et même un énorme téléphone mural et un gramophone cassé.
L’imagination de Nenè qui, ayant appris à lire à cinq ans, connaissait déjà les romans de Salgari, se déchaîna.
Avec quelques habits et quelques bouts de tissu coloré, il suffisait d’un rien pour transformer Angela en Perle de Labuan ou bien en fille du Corsaire noir alors que lui, il était, à son bon plaisir, Sandokan, Yanez et plus souvent Tremal-Naïk, le grand chasseur de tigres. En un instant, le grenier devenait un lieu dangereux et mystirieux comme Mompracem. Mais ce qui l’enivrait presque de plaisir était de savoir que le sabre ou le pistolet qu’il empoignait étaient des armes vraies qui avaient été utilisées autrefois dans une guerre ou une autre.
Jusqu’à ce jour où ils découvrirent une mallette noire qu’ils n’avaient pas remarquée jusque-là et qu’ils ouvrirent. Elle avait dû appartenir à l’oncle ’Ntoniu qui avait été médecin, parce qu’à l’intérieur ils trouvèrent, au milieu d’un tas de flacons de médicaments qui puaient, un stéthoscope de bois, de ceux en forme de trompette, et un thermomètre.
– On dirait que je serais le docteur, et toi tu serais la malade, et que moi je devrais t’examiner, dit Nenè dès qu’il vit les instruments.
– Oui, oui, accepta Angela, enthousiaste.
Et elle alla se coucher dessus un divan plein de poussière et bancal passqu’il lui manquait un pied. Pour le caler, ils mirent dessous quatre livres reliés.
Depuis lors, chaque fois qu’ils montèrent dans le grenier, ce fut seulement pour jouer au docteur.
Au troisième examen, Angela retira sa robe et sa culotte sans que Nenè le lui demande. Elle ne disait rien, n’ouvrait pas la bouche tandis qu’il la boustiguait en la faisant virer et tourner sur le dos et sur le ventre. Mais à la fin du dixième examen, pendant qu’elle remettait sa robe, Angela parla d’une voix ferme et décidée.
– Demain on fait le contraire, dit-elle.
– Et comment ça ?
– On fait que tu serais toi le malade et moi l’infirmière.
Le lendemain, à peine entré dans le grenier, Nenè courut se mettre dessus le divan, couché sur le dos.
– Déshabille-toi, dit Angela.
Lui, il se sentit mal, il adevint rouge de vergogne. Il ne bougea pas, il n’avait pas le même enthousiasme qu’Angela pour se déshabiller. Il essaya de trouver un accord, une voie intermédiaire.
– Tout ?
– Tout complètement, ordonna la cousine, impitoyable.
Angela ne le laissa plus jouer le rôle du docteur, depuis ce moment Nenè fut toujours le malade. Mais il s’aperçut qu’il avait gagné à l’échange de rôles, il aimait encore plus que ce soit Angela qui le touche, surtout quand elle lui mettait le thermomètre à l’aine et que donc, par nicissité, elle devait lui manier la partie basse.
Et puis, en juin, quand arriva une canicule qui transforma le grenier en un four rougi à blanc, au point que même les palombes s’enfuirent, l’infirmière prit l’habitude de s’enlever elle aussi ses vêtements et de se coucher dessus Nenè. Il arriva comme ça que leurs lèvres commencèrent d’abord par s’effleurer, comme par hasard, puis restèrent longuement collées.
Après quoi tout changea, le jeu devint presque une lutte désespérée. Ils s’embrassaient, se baisaient avec rage en se mordant au sang, se caressaient, se griffaient, se léchaient, tantôt entortillés l’un à l’autre très étroitement comme deux serpents, tantôt glissant comme des poissons, la peau comme savonnée de sueur.
“Est-il possible, se demandait Nenè quand ils s’arrêtaient un peu pour reprendre haleine, que les grands qui vont à la Pension Eva et ont à leur disposition les femmes nues s’acontentent juste de les mater ? Ou bien ils font ce qu’Angela et moi on fait ? Ou bien ils font querque chose que j’ai pas encore compris ?”
L’autre chose qu’il ne comprenait pas encore, il la comprit en grande partie parce que le curé le lui expliqua quand, pour la préparation à la première communion, on l’envoya aux choses-de-Dieu. La première communion, Nenè la faisait plus tard que ses autres petits camarades : sa mère avait mis beaucoup de temps à convaincre son papa qui ne voulait pas, il aimait pas les choses de la calotte.
L’explication du catéchisme était donnée par le père Nicolò dans la sacristie de l’église et Nenè y allait après la réunion fasciste du samedi après-midi, encore en uniforme de cadet de la Marine.
Quand le père Nicolò en vint au commandement qui disait de ne pas commettre d’actes impurs, ou de trucs cochons, qu’on pouvait faire seul ou en compagnie, tout de suite Nenè se convainquit que ce que sa cousine et lui s’amusaient à faire dans le grenier était justement ce que le commandement prohibait absolument. Sous peine d’enfer éternel avec les méchants démons, le feu, la poix bouillante. Il se prit une bonne frousse.
Ils commettaient un péché. Et un sale péché mortel, c’était pas un truc à rigoler. Lui, il ne le savait pas mais Angela, qui avait deux ans de plus que lui et qui l’avait déjà faite depuis un bail, la communion, comment ça se faisait qu’elle ne savait pas que c’était péché ? Et si elle le savait, pourquoi elle ne lui avait rin dit ?
Il s’en retourna à la maison tout troublé et tracassé.
Pour recevoir la communion, raisonnait-il, il devrait renoncer aux choses cochonnes avec Angela, mais lui, il n’avait aucune intention d’y renoncer, elles lui plaisaient beaucoup. Et puis, il se demandait pourquoi il devait aller raconter ses affaires au curé à confesse.
Le lendemain, qui était un dimanche, les deux familles, celle d’Angela et celle de Nenè, allèrent passer la journée à la maison de campagne du grand-père et, en début d’après-midi, alors que tout le monde était allé se coucher assommé de pâtes ’ncasciata*, de chevreau au four et de vin, Angela et lui sortirent de la maison et allèrent se glisser dans un fenil qui était bien pour parler seuls, mais pas pour jouer au docteur, étant donné que querque paysan risquait de passer à tout moment.
– Mais tu le sais que nous, dans le grenier, on fait des choses cochonnes et que c’est péché mortel ? attaqua Nenè.
– Qui te l’a dit ? lui rétorqua Angela sans paraître le moins du monde impressionnée.
– Le père Nicolò, à hier, aux choses-de-Dieu.
– Le père Nicolò se trompe, nous deux, dans le grenier, on joue. Les choses cochonnes, c’est seulement l’homme et la femme quand ils sont grands qui peuvent les faire.
Nenè réfléchit un peu et arriva à une conclusion.
– Alors, si c’est un jeu, pas besoin que je le lui dise, au curé, quand je vais me confesser ?
– Non, pas besoin. Au curé, tu peux lui raconter tout ce que tu veux, de toute façon, il en sait rien, si c’est vrai ou pas.
Tout à coup, il lui parut qu’Angela était devenue différente, plus experte, plus grande que lui, beaucoup plus que les deux années de différence qu’ils avaient.
– Demain, on y retourne, au grenier ?
– Bien sûr, dit Angela.
Le lendemain, quand il alla se mettre sur le divan et qu’Angela commença à s’enlever les vêtements, il éprouva un certain embarras. Il n’y arrivait pas, à se déshabiller, c’était comme la première fois. Qu’est-ce qui lui arrivait ? Pourquoi il avait honte ? Pourquoi il éprouvait de la vergogne aussi à regarder Angela qui, entre-temps, s’était déshabillée ? Tu veux voir que c’était tout de la faute de ce maudit curé qui lui avait mis le doute que ce jeu était péché ?
– Qu’est-ce que tu fais, tu deviens timide ? lui demanda Angela, impatiente.
Enfin, il se déshabilla et se laissa manipuler par sa cousine mais presque sans y prendre plaisir. Il avait la tête perdue derrière une question précise qu’il voulait poser à Angela, étant donné que celle-là, elle avait démontré qu’elle aconnaissait beaucoup plus de choses que lui.
A la première halte qu’ils firent, assis sur le divan l’un à côté de l’autre, Nenè pensa que c’était le bon moment et il demanda :
– Tu le sais ce que ça veut dire, forniquer?
Angela éclata d’un grand rire.
– Qu’est-ce qui te prend ? demanda, ébahi, Nenè.
– C’te mot, forniquer, il me donne envie de rire. C’est un mot qu’utilisent les curés ou qu’on trouve écrit dans les commandements, mais les grands disent pas comme ça.
– Comment ils disent ?
– C’est un gros mot.
– C’est quoi, c’te mot des grands ?
– Baiser. Mais il faut pas le dire à la maison, passque sinon ta mère te flanque une mornifle. Et si ça t’échappe, dis pas que c’est moi qui te l’ai dit.
Baiser lui parut vraiment un gros mot, un truc vilain et surtout très très cochon.
– Ça peut pas s’appeler autrement ?
– On peut dire aussi faire l’amour.
Faire l’amour lui sembla ce qu’il y avait de mieux, dans tous ces mots.
– Et comment on fait pour faire l’amour ? Tu le sais ?
Angela le regarda d’un air ennuyé.
– Je le sais, mais je n’ai pas envie de te le dire. Demande-le à un de tes copains.
– Tu es ma meilleure copine.
Du doigt, Angela montra l’entrejambe de Nenè et puis du même doigt son entrejambe à elle.
– Quand ça, là, entre dans ça, ici, ça veut dire qu’on fait l’amour, dit-elle à toute vitesse en avalant les mots.
Nenè la contempla, abasourdi. C’était quoi, ça, un jeu pour se dégourdir la langue ? Une devinette ? Ça là, ça ici… Il y avait rin compris.
– Tu me le réexpliques ?
– Non.
– Écoute, mais à quoi ça sert ?
– Ça sert à avoir du plaisir et à faire des enfants.
– Mais si ça sert à faire des enfants, pourquoi c’est un péché mortel ?
– Ça devient un péché quand c’est deux qui sont pas mariés qui le font, ou quand ils le font sans vouloir d’enfant.
Nenè resta pensif, il ne comprenait pas bien la différence entre quand c’était péché et quand ça ne l’était pas. Le seul moyen était d’essayer.
– Tu me montres comment on fait ?
Angela se remit à rire.
– Pas possible.
– Et pourquoi ? Passque c’est péché mortel ?
– Non, passque t’y arriveras pas.
– Alors que toi, oui ?
– Moi, oui.
– Et pourquoi moi non ?
– Passque tu l’as pitchounette.
Nenè fut atterré.
Dedans le grenier, le soleil disparut d’un coup, le grenier lui-même se retrouva près de la calotte polaire, une nuit profonde et froide descendit, un gel arctique s’abattit.
Voilà pourquoi il avait été exclu du premier coup de tous les concours qu’il avait faits avec ses petits camarades du cours élémentaire, tous avec le slip baissé dedans un vieil entrepôt de soufre abandonné, à se mesurer longueur et grossesse ! Ils n’avaient même jamais voulu la prendre en considération ! Sainte Mère, quel malheur ! Sainte Mère, quelle tragédie !
Pourquoi était-ce à lui, précisément à lui, qu’était arrivée cette très grande infortune ? Il n’aurait pas mieux valu qu’il naisse bossu, peut-être avec deux bosses, plutôt que de l’avoir si petite qu’il ne pouvait pas faire l’amour ?
Effondré, sans un muscle ou un nerf qui le soutienne encore, il se sentit fondre et glissa du divan à terre. Il avait du mal à se retenir d’éclater en sanglots.
– Qu’est-ce que tu as ? lui demanda Angela.
– Rin.
– Allez, va, parle.
– Si tu dis que je l’ai comme ça… ça signifie que moi, jamais…
Il n’y tint plus, des larmes grosses comme des pois chiches commencèrent à lui tremper le visage.
– Mais qu’est-ce que tu vas chercher, couillon ? Quand tu seras grand, tu l’auras comme tous les grands.
Si ça se trouvait, Angela disait la vérité. Qu’est-ce qu’elle y gagnerait, elle, à raconter des menteries ?
Dans le grenier, la lumière du soleil revint.
– Tu me le jures ?
– La prunelle de mes yeux et que je meure assassinée.
Nenè se sentit mieux. Angela avait prononcé un serment solennel. Il se leva et allait de nouveau s’asseoir quand lui arriva la révélation, ce fut vraiment comme un éclair dans sa coucourde. Il resta pétrifié au milieu de son mouvement, immobile, sans aréussir à bouger.
– Eh, oh ! l’appela Angela.
Il ne l’entendit pas. Voilà ce qu’ils y allaient faire, les hommes avec les femmes nues, à la Pension Eva !
Angela tomba soudain malade. Une nuit, la fièvre la prit et tout le monde pensa à une grippe qui passerait dans les trois ou quatre jours. Mais la maladie d’Angela ne fut pas une chose passagère, au point qu’on dut l’envoyer au ’pital de Montelusa. Il paraît qu’on lui avait trouvé querque chose aux poumons.
Au bout d’une petite semaine, l’absence d’Angela commença de peser lourdement à Nenè. Ce n’était pas tant parce qu’ils ne pouvaient plus se rencontrer au grenier – et puis cette histoire de grenier n’aurait plus été comme avant, bien sûr, à cause de ce que lui avait enseigné le curé – mais c’était parce qu’il avait besoin de parler avec elle, d’entendre sa voix, de la regarder dans les yeux. Ça le démangeait tant de la voir ne fût-ce que cinq minutes qu’il se décida à demander à sa mère si elle voulait bien l’emmener voir Angela au ’pital dès qu’elle pourrait. Mais sa mère lui répondit de s’ôter cette idée de la tête, elle ne l’emmènerait pas passque la maladie d’Angela était contagieuse.
Mais de ce qu’il s’était convaincu qui se passait dans la Pension Eva, Nenè avait absolument besoin d’avoir confirmation.
Avec Ciccio Bajo, ami de cœur et petit camarade de classe, ils avaient depuis longtemps pris l’habitude d’étudier ensemble, tantôt chez l’un tantôt chez l’autre. Mais ils n’avaient jamais parlé de cochonneries.
Un après-midi, deux mouches vinrent se poser sur le cahier de Ciccio et aussitôt l’une grimpa sur l’autre. Nenè leva un bras et du plat de la main écrasa les mouches. Ciccio s’énerva, lui lança un regard noir.
– Tu me dégueulassas le cahier !
– Excuse-moi, je vais te le nettoyer.
– Mais on peut savoir ce qu’elles te faisaient de mal, ces pôvres mouches qui voulaient baiser ?
Baiser! Ciccio avait dit le mot cochon. Alors, Nenè comprit qu’il pouvait poser ses questions à son ami.
– Écoute, lui demanda-t-il tandis qu’il nettoyait le cahier avec son mouchoir, tu sais ce que c’est la Pension Eva ?
– Bien sûr. C’est un bordel.
– Et tu le sais comment on fait pour se faire donner une femme ?
– On rentre, on se choisit la femme qui plaît, on va baiser et quand on a fini, on paie la passe. Mais, de toute façon, inutile d’y penser maintenant.
– Pourquoi ?
– Passqu’on a pas encore l’âge. Pour aller au bordel, il faut avoir au strict minimum dix-huit ans passés.
Sainte Mère, qu’est-ce qu’il fallait attendre encore ! Une éternité !
Angela revint à la maison au bout de huit mois. On l’avait emmenée dans un sanatorium de Palerme. Maigre et pâle, les yeux très grands, elle était fatiguée et mélancolique. Elle ne resta que deux jours et Nenè n’aréussit pas à lui parler seul, sans personne entre les pattes. Et aussi passqu’Angela ne fit rin pour se retrouver seule avec lui. Ensuite, elle s’en alla chez certains parents de son père à Cammarata, où les médecins avaient dit qu’il y avait du bon air qui lui ferait du bien à la poitrine. Elle serait partie au strict minimum un an.
L’année passa et Angela ne revint pas.
– Mais elle n’est pas encore guérie ?
– De sa maladie, oui. Elle est complètement remise. Mais comme elle fréquente l’école de Cammarata, il vaut mieux qu’elle passe l’examen là-bas. Et puis, c’tes parents, un mari et sa femme qui sont vieux, ils la considèrent maintenant comme ’ne fille…
Chaque matin, dès qu’il se levait du lit pour aller à la salle de bains, Nenè s’observait longuement dans le miroir en se passant tout doucement une main sur le visage. Mais il ne sentait pas de poils, il n’en voyait pas l’ombre. Il lui semblait que ses camarades d’école grandissaient en fait beaucoup plus que lui : Jacolino (son prénom était Enzo, mais tout le monde l’appelait seulement par son nom), par ezemple, avait déjà les moustaches. Bon, c’est vrai qu’il avait deux ans de plus et qu’il était redoublant, mais lui, dans deux ans, il en aurait des moustaches ? Il en doutait et se désolait.
Se pouvait-il que lui seul fût destiné à rester un minot toute la vie ? Se pouvait-il qu’Angela, ce jour-là dans le grenier, lui ait raconté des menteries pour le calmer ?
Pour se faire passer la mélancolie qui l’assaillait à cette pinsée, il entrait dans le cabinet de travail de son père et se prenait un livre. Son père lui avait donné la permission de lire tout ce qu’il voulait et parmi les romans, il y avait ceux qui lui plaisaient beaucoup, d’un type qui s’appelait Conrad, d’un autre ’nglais, Melville, et d’un autre encore, mais qui était français, Simenon.
Dedans les pages d’un roman, à un certain moment, il se perdait comme parmi les arbres d’une forêt, sa tête s’en allait dans une autre direction, il se la sentait à la fois légère comme un ballon et lourde comme une pierre, alors au milieu d’une lecture il devait s’arrêter passque les lignes devenaient toutes tordues et emmêlées et que ses yeux arrivaient plus à rien mater.
Ce n’était pas comme quand il jouait avec Angela, qu’il devenait suivant son bon plaisir Sandokan ou Tremal-Naïk, non, parce que ce qu’il lisait lui procurait une espèce de faiblesse, une langueur dedans le corps entier qui l’étourdissait comme un parfum très fort, oui, c’était une espèce d’étourdissement d’ivrogne, plaisant et douloureux à la fois.
Elle pouvait toujours l’appeler, sa mère, parce que c’était l’heure de manger ! Il ne l’entendait même pas. Et quand elle, furieuse, venait le secouer par une épaule ou lui donner une taloche derrière la nuque, Nenè la fixait comme une étrangère et regardait tout autour de lui, en reconnaissant avec peine l’endroit où il se trouvait.
Une fois qu’il avait grimpé sur une espèce de chaise pour arriver dans la partie haute de la bibliothèque, il se décida à prendre entre ses mains un gros livre relié de toile rouge et au titre inscrit en lettres d’or. Quand il le saisit, il faillit le laisser échapper tellement il pesait. Il l’ouvrit seulement pour y jeter un coup d’œil avant de le remettre en place. Et, tout de suite, il vit qu’il y avait un dessin représentant une femme nue, enchaînée à une espèce de rocher, qui chialait désespérément.
Sainte Mère, qu’elle était belle, cette femme ! Les cheveux très longs ne réussissaient pas à cacher les grandes cuisses ! Et quels nichons bien bien ronds qui lui pointaient sur la poitrine !
De ce moment, le Roland furieux de L’Arioste, avec les dessins d’un peintre qui s’appelait Gustave Doré, devint sa lecture quotidienne. Les pages de ce livre étaient épaisses et si lisses qu’elles brillaient dans la lumière. Et comme ça, à Nenè, en fermant les yeux et en passant un doigt léger pour suivre les contours d’un corps de femme nue, il semblait toucher la chair vivante.
Souvent, il gardait les yeux mi-clos, comme pour mieux viser, de façon à ce que la pulpe du doigt aille caresser un endroit précis, juste en bas sous le ventre nu d’une femme, là où entre les deux cuisses et sous le ventre se formait une espèce de V. Il y décrivait des cercles pitchounets, insistants, continus, jusqu’à ce qu’il lui vienne au-dessus de la lèvre un voile de sueur, comme s’il avait bu un vinaigre fort.
Surtout, à part les dessins qui étaient très beaux, et pas seulement ceux qui représentaient des femmes nues, le texte qui était écrit en poésie lui donnait de grandes satisfactions. Au point qu’il apprit par cœur plus d’une centaine des vers qui lui plaisaient le plus. Et chaque fois que dans l’histoire Angélique apparaissait, il pensait à Angela qui s’appelait quasi pareil.
Angela ! Quand elle reviendrait de Cammarata, pourraient-ils se voir encore au grenier ? Maintenant, il était sûr que si ça devait encore arriver, le jeu n’en serait plus un. Si ça se trouvait, les nichons lui étaient poussés. Et cette pensée le brûlait, avec son cœur qui se mettait à battre. Après, d’un coup, il devenait blême comme un mort et une autre idée surgissait : et si Angela, désormais devenue femme, lui disait qu’elle ne voulait plus rien avoir à faire avec un garçon comme lui qui n’avait pas grandi comme les autres ? Est-ce qu’Angela pouvait se mettre avec un garçon resté pitchounet ? Et en conséquence avec un truc très très pitchounet ? Avec une espèce de nain sans un poil qui soit un poil nulle part?
– Ciccio, mais tu penses que moi, je deviendrai grand comme toi ?
– Ouh, quel grandissime tracassin !
– Dis-le-moi, s’il te plaît.
– Mais tu te rends compte que tu me poses cette question un jour sur deux ?
– S’il te plaît, donne-moi une réponse !
Ciccio perdit son calme.
– Mais toi, gros crétin débile, au jour d’aujourd’hui, comment tu crois que tu es ?
– Très petit, presque un nain.
Sans mot dire, Ciccio se leva, le prit par une main, le conduisit devant le miroir de l’armuar et se mit à côté de lui.
– Tu le vois pas qu’on a la même taille, idiot ?
Nenè se mata. Y’avait pas à tortiller, ils étaient de la même taille, mais lui, il se sentait plus petit. Qu’est-ce qu’il y pouvait ?
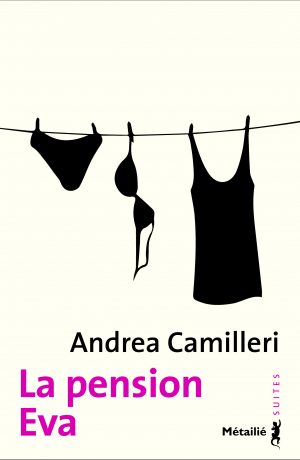







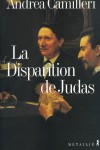
-100x150.jpg)
