Septembre 1887, Giovanni Bovara, fonctionnaire chargé de collecter un impôt sur les grains moulus, arrive à Vigàta. Né dans cette cité sicilienne, il a déménagé quand il avait trois mois avec sa famille à Gênes où il a grandi et étudié. Il pense donc en génois et peine à comprendre le dialecte sicilien. Ses deux prédécesseurs ont été tués, et très vite, il va se retrouver en butte aux tentatives de corruption et aux intimidations des puissants du lieu, l’intendant des finances, le chef de police, le chef mafieux, le grand propriétaire terrien, qui tous complotent pour s’enrichir sans verser un sou à l’État. Après être tombé dans les rets amoureux d’une veuve ardente, il est victime d’une machination et se voit accusé du meurtre d’un prêtre libidineux. Jeté en prison, il se met soudain à parler en sicilien et, refusant désormais de s’exprimer autrement, il se réapproprie le mode de penser de l’île, ce qui va lui permettre de reconquérir sa liberté, en utilisant une tactique tortueuse bien sicilienne qu’on peut comparer au "coup de cavalier" aux échecs.
Encore une fois, Camilleri se réapproprie un événement réel du passé de son île pour le transposer dans sa Vigàta imaginaire, cité emblématique de toute la Sicile. Encore une fois, l’habile scénariste agence une intrigue subtile, encore une fois l’écrivain humaniste nous offre une galerie de personnages hauts en couleur, encore une fois le passionné de la langue nous éblouit d’un feu d’artifice de vocables grotesques, graveleux, poétiques. Encore une fois, on en redemande.
Rendre en français les étincelles provoquées par le frottement d’univers mentaux et linguistiques si divers est un sacré pari pour le traducteur qui, cette fois, s’est fait aider par une spécialiste du génois. Mais on connaît les éloges que son travail sur les précédents titres lui a déjà valu dans la presse.
-
Protagoniste d'un exceptionnel phénomène éditorial en Italie, Andrea Camilleri, écrivain inconnu il y a seulement cinq ans, est aujourd'hui le plus lu des romanciers de la péninsule. Depuis deux ans, ses romans, qui se sont vendus à plus de deux millions d'exemplaires, occupent sans discontinuité les premières places des classements des meilleures ventes et ont été traduits dans de nombreux pays où ils ont toujours reçu un excellent accueil. Tous ses livres ont pour cadre une petite ville sicilienne appelée Vigàta, qui est la transfiguration littéraire de Porto Empedocle, la ville natale de l'écrivain. Certains de ses romans appartiennent au genre de l'énigme historique (un genre très cher à Sciascia) et explorent - sans renoncer à l'ironie - les malheurs de la Sicile du siècle passé ; les autres sont des romans policiers plus classiques dans lesquels le commissaire Montalbano - une sorte de Maigret sicilien des années quatre-vingt-dix - s'efforce de comprendre et de combattre la criminalité d'aujourd'hui. Dans les deux cas, Camilleri propose des histoires bien ficelées - avec parfois des procédés de construction assez originaux - qui, tout en utilisant de nombreuses références littéraires plus ou moins affichées, affrontent les problèmes de son pays, à commencer par la mafia et par la corruption des institutions et des hommes politiques, mais savent aussi évoquer la fierté et la richesse de l'identité sicilienne. Mais surtout, cet écrivain de soixante-quatorze ans, qui était metteur en scène et producteur pour le théâtre et la télévision, a su inventer, à partir d'un mélange d'italien et de sicilien, une langue savoureuse et efficace, qui convient parfaitement à ses histoires, mais qui a dû poser de nombreux problèmes à ses traducteurs. En France, où cinq de ses livres ont déjà été traduits, deux nouveaux romans sont attendus ce printemps dans les librairies : le troisième épisode des aventures de Montalbano, Le Voleur de goûters (Fleuve Noir), un récit qui croise les problèmes de l'immigration aux activités illicites des services secrets et aux crimes passionnels, et Le Coup du cavalier (éd. Métailié), où, dans la Sicile de la fin du XIXe siècle, un homme honnête voulant dénoncer l'illégalité et la corruption est victime d'une machination qui vise à lui attribuer la responsabilité d'un meurtre. Nous avons rencontré Andrea Camilleri dans sa villégiature du Monte Aviata, campagne toscane. Fabio Gambaro. Le public vous a découvert depuis quelques années seulement, grâce aux romans publiés au cours des années quatre-vingt-dix. L'écriture a-t-elle été pour vous une passion tardive ? Andrea Camilleri. Pas du tout. En réalité, j'ai commencé à écrire tout jeune, à douze ans. Ensuite, au lycée, pendant le fascisme, j'ai eu la chance d'avoir deux excellents professeurs qui m'ont fait connaître ce qu'il y avait de mieux dans la littérature italienne de l'époque - c'est-à-dire Montale, Ungaretti, Alvaro, etc. - mais aussi certains livres étrangers qui paradoxalement réussissaient à passer à travers les mailles de la censure. Par exemple, en 1942 j'ai pu lire La Condition humaine de Malraux : ce livre m'a fait beaucoup réfléchir et m'a ouvert les yeux sur la politique qui, pour moi jusqu'alors, se résumait exclusivement au fascisme, mon père étant un militant convaincu qui avait fait la marche sur Rome avec Mussolini. Tout de suite après la guerre, j'ai lu Conversation en Sicile de Vittorini et Par chez nous de Pavese, deux livres très importants qui nous ont sorti du fascisme. Les lectures m'ont donc permis de découvrir une autre façon de voir la réalité et m'ont poussé à écrire. De Porto Empedocle, ma petite ville natale près d'Agrigente, et de Palerme, où j'étais à la Faculté de Lettres, j'envoyais - comme autant de bouteilles à la mer - des poèmes, des nouvelles et des articles aux revues littéraires et aux journaux qui représentaient le renouveau culturel de l'après-guerre. Est-ce que ces premiers écrits reçurent un accueil favorable ? Oui. En 1947, en participant à un concours de poésie, dont le jury était composé des meilleurs critiques de l'époque (Gianfranco Contini, Carlo Bo et Giansiro Ferrata), je me suis retrouvé dans la sélection finale avec Pier Paolo Pasolini et Andrea Zanzotto. A la suite d'un autre prix, Giuseppe Ungaretti publia cinq de mes poèmes dans une anthologie de la plus prestigieuse collection de poésie italienne. Mais, la même année, j'ai également gagné un prix pour une comédie inédite : c'était un texte qui ne me satisfaisait pas - que j'ai d'ailleurs jeté par la fenêtre du train, en rentrant chez moi - mais qui a changé le cours de ma vie, puisque Silvio d'Amico, le président du jury, me proposa une bourse pour le cours de metteur en scène de l'Académie d'Art Dramatique de Rome. C'est à ce moment que votre parcours a changé de direction... En effet, de la poésie je suis passé au théâtre. Je suis resté à Rome et j'ai commencé à travailler dans différents théâtres, en essayant de renouveler le répertoire traditionnel grâce à Adamov ou Beckett. Par exemple, j'ai été le premier à monter Fin de partie de Beckett en Italie, tout en m'intéressant beaucoup à Pirandello. Ensuite, du théâtre je suis passé à la télévision, où j'ai longtemps travaillé. A quel moment êtes-vous revenu à l'écriture ? A la fin des années soixante. Après avoir autant travaillé sur les textes des autres, j'avais envie d'écrire moi-même quelque chose. Ainsi est né mon premier roman, Il corso delle cose (Le Cours des choses), dont le titre est tiré d'une phrase de Merleau-Ponty. Mais ce livre, qui raconte l'histoire d'une amitié difficile entre deux Siciliens, ne trouva pas d'éditeur pendant dix ans. C'est seulement en 1978, alors que j'en avais tiré une fiction pour la télévision, qu'un tout petit éditeur a accepté de le publier. Lorsque j'ai eu le livre entre les mains, j'ai tout de suite eu envie d'en écrire un autre, en me tournant cette fois vers le passé. Parmi les papiers de mon grand-père j'avais retrouvé un tract qui mettait en garde les marchands de soufre contre un autre commerçant de Licata considéré comme malhonnête. De là est née l'idée d'un nouveau roman, Un filo di fumo (Un Fil de fumée, publié en 1980), qui a été le premier de la série historique. La fascination pour l'histoire est demeurée un élément central de votre travail. Pourquoi vous attire-t-elle autant ? Je me tourne vers le passé parce que j'aime démêler des événements complexes et apparemment insaisissables. C'est l'enquête de l'historien qui m'intéresse, la recherche de la vérité et la reconstitution d'une séquence d'événements. J'ai peut-être une conception restrictive du roman, mais j'aime les livres où il y a une enquête, en particulier si elle se déroule dans le passé. Evidemment je me réfère à Sciascia, qui pour moi est surtout un modèle intellectuel car, sur le plan de l'écriture, sa langue et son style étant affilés comme des poignards sont très différents des miens. Sciascia m'a appris la curiosité vis-à-vis de l'histoire et sa façon de se projeter dans notre présent ; il m'a appris à utiliser les traces du passé, les documents, les papiers égarés ; il m'a appris à construire un roman, en prenant comme point de départ une trace trouvée dans des archives. Par exemple, La Saison de la chasse naît d'un dialogue cité dans la fameuse Enquête sur les conditions sociales et économique de la Sicile (1875-1876) demandée par le Parlement italien tout de suite après l'unification du pays. Le président de la commission demande au maire d'un petit village sicilien s'il y a eu des faits sanglants dans son village et l'incroyable réponse de celui-ci est : " Absolument pas, Votre Excellence, mis à part un pharmacien qui a tué sept personnes par amour. " En lisant cette page, après avoir beaucoup ri, j'ai eu l'idée du roman. De même, l'histoire à l'origine de L'Opéra de Vigàta - un préfet qui veut inaugurer un nouveau théâtre en imposant aux habitants un opéra inconnu - était également dans cette enquête parlementaire, qui pour moi s'est donc avérée être une véritable mine d'or. Les traces du passé et les documents d'archives sont-ils suffisants pour donner lieu à un roman ? Bien sûr que non. J'aime les données de l'histoire, mais j'ai besoin de les manipuler, de les transformer et de les réinventer. Il en résulte un roman qui n'a pas la prétention d'être objectif comme un essai. D'ailleurs, les vrais historiens risqueraient l'infarctus car si j'utilise des documents, j'invite néanmoins le lecteur à ne pas les considérer comme une vérité absolue. C'est pour cela que je brouille les cartes et que dans chaque roman je recherche une nouvelle solution sur le plan structurel. Dans La Concession du téléphone j'ai essayé d'effacer le narrateur, en proposant un roman composé exclusivement de documents et de dialogues, comme une sorte de dossier dans lequel je n'interviens pas, en laissant au lecteur la tâche de se construire son propre roman. Tout comme dans L'Opéra de Vigàta, où il est obligé de reconstituer la séquence chronologique du récit. La participation du lecteur est toujours fondamentale, puisqu'il doit collaborer à la construction du roman. J'ai appris cette leçon au théâtre : le théâtre n'est rien sans le spectateur, le livre n'est rien sans le lecteur. A côté des romans historiques, cette fascination pour l'histoire vous a également poussé à écrire de véritables essais historiques... C'est vrai. La strage dimenticata (Le Massacre oublié) est consacré à la mort de 114 prisonniers, en 1848, dans la prison de Porte Empedocle. Tout le monde a oublié ce massacre. J'ai voulu savoir ce qui était arrivé et j'ai donc accumulé beaucoup de matériel autour de cet événement historique oublié. Un jour j'ai tout montré à Sciascia, en lui disant qu'il pourrait en faire un excellent sujet pour un de ses livres. Il a gardé les documents quelque temps, mais ensuite il m'a conseillé de l'écrire moi-même. Je lui ai dit que je n'étais pas capable d'écrire comme lui, mais il m'a répondu : " tu ne dois pas l'écrire comme moi, tu dois l'écrire avec ton propre style ". C'est ce que j'ai fait. Après ce premier essai, qui date de 1984, j'en ai écrit un deuxième sur la " bolla di componenda ". C'est encore une histoire assez surprenante révélée par l'enquête parlementaire sur la Sicile de 1875. Cette bulle était une feuille vendue dans les églises entre Noël et l'Epiphanie, dans laquelle il y avait une liste de péchés suivie des différents prix à payer pour racheter son âme. Beaucoup de gens ont parlé de ce document mais personne ne l'avait jamais vu. Lorsque j'ai publié le livre, un lecteur m'a affirmé qu'il avait retrouvé une " bolla di componenda " du XVIIe siècle. Ce n'était donc pas une légende. Au début de votre tardive carrière d'écrivain, il y a donc la passion pour l'histoire et ses secrets. Mais dans les années quatre-vingt-dix vous avez commencé à écrire des romans policiers. Pourquoi ? Lorsque j'ai recommencé à écrire, je travaillais encore pour la télévision et le théâtre, j'avançais donc très lentement et il se passait beaucoup de temps entre un livre et l'autre, parfois même trois ou quatre ans. Plus tard, j'ai eu la possibilité d'écrire davantage et de tenter autre chose que le roman historique. Il faut savoir que je commence toujours par un élément ou un épisode qui, dans la rédaction finale, ne sera pas au début du roman, puisqu'au fur et à mesure j'ajoute beaucoup d'autres histoires à cette idée initiale. En général, donc, je n'écris pas de façon chronologique. Toutefois, pendant que j'étais en train d'écrire L'Opéra de Vigàta, je me suis demandé si j'étais capable d'écrire un roman du début à la fin, en suivant la chronologie du récit. J'ai décidé de faire un essai, en choisissant le genre policier. Encore une fois c'est Sciascia qui m'en a donné l'idée avec sa Brève histoire du roman policier, dans laquelle il y a des observations très intéressantes. Il parle par exemple de la structure du polar comme d'une sorte de contrainte pour l'écrivain, qui est obligé d'en suivre la logique, la temporalité et la chronologie. C'était donc le genre idéal pour ma tentative. Ainsi j'ai écrit La Forme de l'eau, le premier livre de la série du commissaire Montalbano. En effet, ensuite vous vous êtes pris au jeu et avez publié d'autres polars avec le même protagoniste... C'est vrai, mais c'est la faute de Montalbano. Dans ce premier roman, il n'avait qu'une simple fonction narrative, le personnage était incomplet, ses contours n'étant pas bien définis. Puisque j'ai une formation théâtrale pour laquelle un rôle doit toujours être complet, j'ai décidé d'écrire un deuxième polar, Un Chien de faïence, pour essayer d'améliorer Montalbano. Ainsi je pensais en avoir fini avec lui, mais il a eu beaucoup de succès et depuis revient vers moi régulièrement. Je suis actuellement en train d'écrire sa cinquième aventure et j'ai vraiment la tentation de le faire disparaître pour de bon. Mais je voudrais également ajouter que presque tout de suite j'ai eu besoin d'élargir le champ du roman policier, de sortir de la cage de sa structure et de rajouter une autre perspective. C'est pour cela que j'aime mêler plusieurs histoires dans le même livre, une histoire policière ou politique, une histoire d'amour, la mafia, etc. Sciascia a dit que le roman policier est la forme la plus honnête d'écriture. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai parce que dans un roman policier l'écrivain ne peut pas tricher. Il doit créer un puzzle millimétrique et en donner toutes les pièces au lecteur, avec qui il doit instaurer une relation d'honnêteté. En fait le lecteur doit avoir à sa disposition les mêmes connaissances que le détective, lequel peut éventuellement se montrer plus habile seulement sur le plan de la déduction. Dans le domaine du roman policier quels sont vos auteurs de référence ? Essentiellement des écrivains européens. Hammett et Chandler sont certainement de grands écrivains, mais nous ne sommes pas de la même école. Et encore moins les écrivains américains qui les ont suivis. Pour moi, la grande révélation c'est Simenon, que j'ai lu dans ma jeunesse. A l'époque la télévision n'existait pas et donc nous lisions beaucoup. Après Conrad et Melville, j'ai ainsi découvert Simenon, que je considère encore comme un modèle incontournable. Plus tard, d'autres écrivains m'ont appris beaucoup d'autres choses, par exemple Dürrenmatt, Gadda et naturellement Sciascia avec ses romans sur la mafia. Simenon toutefois reste le plus important. Dans les années soixante j'ai produit à la télévision une série d'enquêtes du Commissaire Maigret, ce qui m'a permis de bien comprendre le fonctionnement de ses romans, leur logique et leur équilibre. Le commissaire Maigret est-il donc l'ancêtre du commissaire Montalbano ? En partie oui. Tout comme Maigret, Montalbano s'intéresse plus à l'exploration d'un contexte qu'à la simple solution de l'enquête. Il y a toutefois une différence de taille : Montalbano évolue d'un roman à l'autre, tandis que Maigret reste toujours le même. Dans mes romans, les enquêtes marquent le protagoniste, qui vieillit. Ainsi, dans ce cinquième roman, il atteint la cinquantaine et se laisse aller à un bilan de sa vie où les déceptions et les désillusions ne manquent pas. Aujourd'hui mon commissaire est certainement plus amer. Pourtant il affiche toujours une attitude épicurienne : il aime la bonne table, le plaisir de la natation, etc. C'est vrai, mais comme tout le monde il commence à avoir des ennuis de santé, il a mal au dos. Je considère les plaisirs de la vie matérielle comme un aspect fondamental de l'existence, mais comme je suis âgé, Montalbano mange toutes les bonnes choses que je n'ai plus le droit de manger et risque donc de devenir obèse. Dans la littérature, beaucoup de policiers et d'investigateurs aiment la bonne table qui est pour eux une sorte de dédommagement pour leur souffrance quotidienne. Certains lecteurs disent que Montalbano est un homme trop gentil et trop sympathique pour être commissaire de police.. En effet, on m'a accusé d'être " buonista " (enclin à la bonté), pour utiliser un mot que je déteste, mais qui est à la mode en Italie. C'est probablement vrai, mais lorsque j'ai commencé à écrire les histoires de Montalbano j'étais déjà âgé. Il y a trente ans j'aurais probablement créé un personnage plus méchant. Dans la fiction, Montalbano a cinquante ans, mais en réalité il a mon âge. Et à soixante-quatorze ans on ne peut pas être méchant. En Italie, le polar a longtemps été considéré comme une sous-littérature. Aujourd'hui, en revanche, tout le monde en lit et l'on assiste même à un véritable triomphe de ce genre, au point que certains parlent d'impérialisme du polar vis-à-vis du reste de la littérature. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dans le passé on a fait l'erreur de condamner en bloc le polar, sans reconnaître que, comme dans tout genre littéraire, il y avait des bons et des mauvais livres, de la littérature de gare et des romans de très grande qualité. Malheureusement la critique ne voulait pas s'y intéresser et il a fallu attendre longtemps cette reconnaissance. Aujourd'hui heureusement tout le monde sait que Hammett est un très grand écrivain. En outre, on a longtemps pensé qu'on ne pouvait pas situer un roman policier dans un décor italien, le roman policier étant avant tout américain. C'est grâce à Scerbanenco, dans les années soixante, que l'Italie réelle - la ville de Milan en particulier - a conquis sa place dans le polar italien. A partir de ce moment le roman policier à l'italienne est devenu une réalité. L'Affreux pastis de la rue des merles de Gadda a également contribué à faire sortir le polar de son ghetto paralittéraire, ainsi que Sciascia avec Le Jour de la chouette ou Le Contexte. Les nouvelles générations d'écrivains ont donc pu se référer à des modèles qui n'étaient plus aux marges de la littérature. Et si aujourd'hui le polar a autant de succès dans mon pays, c'est aussi parce qu'il montre les réalités locales avec une grande acuité, par exemple la ville de Bologne de Carlo Lucarelli ou la Sardaigne de Marcello Fois. Ainsi la petite province sicilienne où travaille Montalbano peut devenir un miroir pour le reste de l'Italie. Au fond, dans le roman noir français, Jean-Claude Izzo fait la même chose. Tous vos livres ont pour cadre la Sicile et la culture sicilienne est sans cesse présente dans votre travail. Comment pouvez-vous définir votre relation avec la grande tradition littéraire sicilienne, dans laquelle figurent des écrivains comme Verga, Pirandello, De Roberto, Tomasi di Lampedusa, Sciascia, Consolo ou Bufalino ? J'appartiens totalement à cette culture et j'aime les auteurs que vous avez cités, auxquels j'ajouterais Vitaliano Brancati, l'auteur de Don Juan en Sicile et du Bel Antonio. Même si j'habite Rome depuis cinquante ans, je suis toujours proche de cette tradition qui est la mienne. Et notamment grâce au théâtre, où, dès que j'ai pu, j'ai monté la Cavalerie rusticane de Verga ou Les Princes des Francalanza de De Roberto. En tant qu'écrivain, je dois beaucoup à la littérature sicilienne. Par exemple, si je me suis passionné pour les dialectes, c'est parce qu'un jour j'ai lu la magnifique nouvelle de De Roberto, La Peur, où le récit mélange sans cesse les différents dialectes des soldats italiens engagés dans la Première Guerre mondiale. Je peux dire également que cette tradition littéraire a toujours guidé mon travail, même dans certains détails, comme les citations plus ou moins transparentes. Cela évidemment ne m'empêche pas de lire et d'aimer d'autres écrivains, qui parfois deviennent même des références. C'est le cas, dans la littérature étrangère, de Nikolaï Gogol ou de Laurence Sterne, dont je considère La Vie et les opinions de Tristram Shandy comme un véritable chef-d'œuvre. Dans la littérature italienne j'admire Alessandro Manzoni, l'auteur des Fiancés, pour son attitude face à l'histoire. D'ailleurs, tout comme Sciascia, j'ai toujours apprécié Histoire de la colonne infâme, le récit dans lequel Manzoni reconstitue un procès au XVIIe siècle contre un homme accusé à tort d'être un " untore ", un semeur de peste. C'est un texte fondamental qui montre l'attitude que l'écrivain doit avoir face à l'histoire et à l'injustice. Vous avez évoqué à plusieurs reprises Leonardo Sciascia et ses œuvres. Comment est née votre amitié ? Pendant les années soixante-dix, je l'avais contacté pour lui demander d'écrire une fiction sur un meurtre très connu de la mafia. Le projet n'a pas abouti, mais on est resté en contact et quelques années plus tard j'ai réalisé l'adaptation théâtrale du Jour de la chouette, son premier roman sur la mafia. Ensuite nous avons continué à nous fréquenter, même si je ne faisais pas partie du cercle restreint de ses amis les plus proches. On avait les mêmes préoccupations et on aimait les mêmes livres, ceux des grands écrivains, comme par exemple Stendhal, mais aussi certains textes moins connus, tel L'Aigle et le serpent, qui raconte l'histoire de la révolution mexicaine de Pancho Villa. Aujourd'hui, Sciascia me manque, même si parfois on a eu des discussions très vives lorsque nous n'étions pas d'accord sur certains sujets. Et surtout je regrette l'absence de sa rigueur intellectuelle dans le contexte culturel italien. Il y a eu une époque heureuse où nous avions Moravia, Pasolini et Sciascia, trois grandes personnalités, trois consciences exceptionnelles. Avec eux on pouvait être en désaccord, on pouvait discuter, mais leur présence était bénéfique et utile à notre culture. Aujourd'hui, il n'y a pas de personnalités aussi impliquées dans le débat et dans la réalité de notre pays, même un grand intellectuel comme Eco n'a pas le même intérêt pour la politique. Finalement nous manquons d'intellectuels avec le regard critique, lucide et rationnel de Sciascia. Pour vous la politique est-elle toujours importante ? Certainement. L'intellectuel doit s'intéresser à la réalité et à la politique. S'il le peut, il ne doit jamais se soustraire à cet engagement. Pour moi, c'est un devoir d'intervenir publiquement, en abordant dans la presse certaines questions concrètes et politiques. Dernièrement, par exemple, j'ai écrit un essai sur les relations entre la mafia et la Démocratie Chrétienne, c'est-à-dire le parti qui a été au pouvoir en Italie pendant tout l'après-guerre. Mais la littérature, le théâtre, l'art en général peuvent-ils contribuer à changer la réalité ou les consciences ? La réalité, je ne crois pas ; les consciences, probablement oui. Je l'ai vécu personnellement, comme je l'ai dit, en lisant La Condition humaine qui a changé ma façon de voir la réalité et la politique. Les livres nous aident à améliorer notre connaissance de la réalité et mes romans naissent, entre autres, de cette préoccupation. La Concession du téléphone montre comment une relation sentimentale est progressivement brouillée et transformée par la politique, les intérêts criminels et les actions hors la loi des représentants de l'Etat. Et Le Coup du cavalier n'est qu'une tentative d'expliquer les relations entre la politique, la mafia et un honnête citoyen. Malheureusement, en Italie les critiques n'ont pas saisi l'intention politique de ce roman, qui par ailleurs a été apprécié sur le plan littéraire. Le problème c'est que le public ne s'intéresse pas à mon discours politique. Lorsque, récemment, j'ai dénoncé le danger représenté par Berlusconi et ses télévisions, qui entraînent le pays vers une culture caractérisée par la vulgarité, beaucoup de mes lecteurs ont fait semblant ne pas m'entendre. En réalité les lecteurs s'amusent trop en lisant mes livres : personnellement j'aimerais qu'ils rient moins et réfléchissent plus. Dans vos romans historiques vous abordez des problématiques : la mafia, la corruption de l'Etat, l'omerta, etc. sont encore d'actualité. Est-ce que ça signifie que rien n'a changé et que Tomasi de Lampedusa avait raison de dire, dans Le Guépard, qu'il fallait que tout change afin que rien ne change. En d'autres termes, est-il toujours vrai que la Sicile est - comme vous l'avez écrit - écrasée entre l'Etat et la mafia ? Non, la situation a changé. Il y a eu des transformations réelles dans la mentalité des gens et donc dans la vie collective. La méfiance des Siciliens vis-à-vis de l'Etat et des étrangers - mais aussi des autres Siciliens - s'est considérablement réduite pendant les vingt dernières années. Ce changement des comportements a sans doute été favorisé par l'ouverture apportée par la communication dont la télévision est le symbole, et c'est - à mon sens - un des rares cas où l'on puisse dire du bien des effets de la télévision. Bien sûr, par moments on peut avoir l'impression que rien n'a changé en Sicile, mais c'est une impression superficielle. Le changement est bien là, même s'il n'est pas toujours visible. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde se sent concerné par le problème de la mafia et l'omerta s'est donc fissurée. L'univers de la mafia - un univers de faveurs, de chantage et de violences - est présent également dans vos romans policiers, sauf que là il est désormais déconnecté du code d'honneur auquel apparemment étaient liés les mafiosi d'autrefois... Dans la série de Montalbano je n'aborde pas directement la mafia, j'en parle seulement incidemment. Dans L'Opéra de Vigàta, où l'un des protagonistes est un mafioso, ou dans La Concession du téléphone je peux montrer clairement les agissements de la mafia du siècle passé parce que j'en connais les règles et les codes. En revanche, je ne connais pas les règles de la mafia d'aujourd'hui. Pire, à mes yeux cette mafia des années quatre-vingt-dix n'a plus de règles. Par conséquent, si l'on essaie d'écrire à propos d'un phénomène dont on ne connaît pas les règles, on risque de le sublimer. Et ça évidemment la mafia ne le mérite pas. C'est pour cela que dans les aventures de Montalbano elle n'est jamais au centre du récit, mais plutôt une présence insaisissable. Sur la mafia contemporaine je préfère écrire des articles dans les journaux pour essayer de comprendre sa transformation liée à la crise des liens familiaux. Dans le passé, en effet, son fonctionnement était basé sur la famille, tandis qu'aujourd'hui les mafiosi ne se connaissent plus entre eux. Dans Le Coup du cavalier, le protagoniste découvre une partie de la vérité, mais il n'a pas les preuves pour faire punir les coupables. Pourquoi cette vision pessimiste et fataliste ? Je ne suis pas fataliste ni pessimiste. D'ailleurs je termine le livre avec un catalogue des rêves pour indiquer justement la volonté de continuer ce combat. J'ai toutefois la conscience que les problèmes à résoudre sont encore nombreux et que la route à parcourir est encore longue. Il faut combattre sans croire aux miracles, ce qui compte est l'exercice têtu de la raison pour atteindre la vérité. Gramsci a parlé de " pessimisme de la raison et d'optimisme de la volonté ". Je suis tout à fait d'accord, il est bon d'avoir les deux attitudes à la fois. J'ai milité pendant longtemps au Parti Communiste italien et ce militantisme - que par ailleurs je n'ai jamais renié - a laissé en moi des traces importantes, dont - entres autres - cette devise gramscienne. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Manuel Vazquez Montalban qui apprécie Gramsci autant que moi. Est-il vrai que votre personnage s'appelle Montalbano en hommage à l'écrivain espagnol qui a inventé Pepe Carvalho ? C'est vrai. Montalbano est un nom sicilien très répandu, mais aussi un hommage à Vazquez Montalban, dont, à cette époque, je ne connaissais que les livres. J'avais aimé ses polars, mais aussi ses autres romans. En particulier Le Pianiste, qui m'a donné l'idée de la construction totalement déstructurée sur le plan chronologique de L'Opéra de Vigàta. Pour le remercier, même si je ne le connaissais pas personnellement, - j'ai donné son nom à mon personnage. Ensuite, il y a deux ans, je l'ai rencontré à l'occasion d'une table ronde où nous étions interviewés en public par Massimo D'Alema, l'actuel Premier ministre italien, qui, apparemment, aime beaucoup nos romans. Par la suite nous nous sommes revus à d'autres occasions, nous avons sympathisé et nous sommes actuellement en train d'écrire un livre ensemble sur nos parcours intellectuels, politiques et existentiels, qui se ressemblent beaucoup. C'est un livre de " formation " qui aura la forme d'un dialogue. - Vous créez dans vos romans une langue savoureuse où, en reproduisant le rythme du langage oral, l'italien et le dialecte sicilien se croisent en permanence. Pourquoi cette langue métissée ? Le choix de cette langue est le résultat d'une longue réflexion. Il y a cinquante ans, pour mes premières nouvelles et mes poèmes, j'utilisais une langue italienne très classique. C'était une langue un peu abstraite qui ne me correspondait pas. Je ne trouvais pas la bonne tonalité, le bon rythme. Lorsque vingt ans plus tard, j'ai recommencé à écrire, j'ai cherché une autre solution et l'ai trouvée dans la langue de la petite bourgeoisie sicilienne, qui est un mélange d'italien et de dialecte. C'est le même langage que j'utilise encore aujourd'hui avec les gens de mon âge dans mon village en Sicile. Pour expliquer l'origine de ce mélange il faut rappeler ce que Pirandello dit dans son essai " Langue et dialecte " : pour lui le dialecte exprime le sentiment d'une réalité, tandis que la langue italienne en exprime le concept. Ainsi dans ce mélange de dialecte et d'italien, coexistent ces deux composantes, le coté affectif et le coté rationnel. Dans mes premiers romans l'italien dominait mais d'un livre à l'autre le dialecte a pris de plus en plus de place. Entre-temps j'ai presque abandonné le langage de la petite bourgeoisie, en utilisant davantage le vocabulaire des paysans et des ouvriers siciliens. Comme toute autre langue, le sicilien n'est pas une langue homogène, mais formée par plusieurs couches stratifiées qui l'enrichissent. Ce qui donne des résultats très intéressants sur le plan littéraire. Ensuite, vous avez rajouté au sicilien d'autres dialectes, comme le milanais dans L'Opéra de Vigàta ou le génois dans Le Coup du cavalier. Pourquoi ? En effet, à partir de L'Opéra de Vigàta, j'ai commencé à jouer avec la pluralité des dialectes italiens pour montrer la richesse linguistique de l'Italie du XIXe, siècle, un pays qui, après l'unification politique, n'était pas du tout unifié sur le plan linguistique. Chez nous, la variété linguistique correspond à une véritable variété culturelle sur le plan régional, qui contribue à la richesse du pays. Ruzzante, Goldoni, Porta, Belli et beaucoup d'autres grands écrivains italiens représentent cette tradition des dialectes, qui malheureusement s'est quelque peu perdue au cours du XXe siècle. Je suis persuadé qu'il faut remettre cette tradition plurielle au centre de la culture italienne, afin de lutter - Pasolini nous invitait à le faire déjà il y a trente ans - contre l'homogénéisation produite par la télévision et la culture de masse. Aujourd'hui, en effet, tous les Italiens parlent la même langue, mais c'est une langue plate, uniforme et colonisée par le lexique technologique anglo-saxon. Dans le dialecte, au contraire, il y a encore une lymphe vitale pour notre langue et pour notre culture. Et avec cette lymphe linguistique vous obtenez également des effets humoristiques très réussis? C'est vrai, mais plus que l'ironie du langage, j'aimerais que les lecteurs cueillent l'ironie de certaines situations et réflexions. Cela dit, c'est bien de rire, parce que la littérature doit toujours donner du plaisir. Je n'aime pas la littérature conçue comme une punition pour le lecteur.Interview par Fabio GambaroLE MAGAZINE LITTERAIRE
-
[Le Coup du Cavalier, c'est] ce qu'il faut d'humour, de détachement critique, d'observation sociologique de nos vingt dernières années, mais aussi de lyrisme, d'émotion, de douleur et de colère. Ajoutez quelques personnages vraiment attachants - un intellectuel manipulateur, une avocate infidèle par devoir, un immigré kurde transformé en milliardaire des œuvres charitables -, des portraits trop précis pour n'être pas à clés - parmi lesquels un certain Robert Boulanger, journaliste au Monde - et un roman dans le roman, comme un conte oriental ou comme une rêverie de Cyrano de Bergerac dans laquelle Pierre Dac aurait glissé quelques petites annonces. Le tout comme entraîné par la désinvolture et les caprices de la liberté : l'un des plus sûrs mérites de ce roman est de sembler être parfaitement réussi sans qu'on ait jamais songé qu'il le soit.Pierre LepapeLE MONDE
-
« Dans la Sicile de la fin du XIXe siècle, les mésaventures d'un jeune inspecteur aux prises avec les puissants de l'île. Inspiré d'événements réels, un best-seller absolu en Italie. »LA QUINZAINE LITTERAIRE
-300x460.jpg)







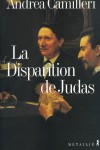
-100x150.jpg)
