Arianna, belle femme-enfant, est l’épouse de Giulio, qui est riche, plus âgé qu’elle, très amoureux et impuissant. Pour leur plus grande satisfaction à tous deux, il lui organise, sur une plage gérée par un mafieux, des rencontres avec des play-boys qu’elle choisit. Seule et impérative condition : chaque partenaire ne doit lui servir que deux fois. Mais un jour elle jette son dévolu sur Mario, un tout jeune homme qui s’éprend d’elle et exige de la revoir. La transgression du tabou va gripper la machine irrémédiablement et, tandis que nous découvrons le passé très étrange d’Arianna, la catastrophe approche.
Quelque part entre Bret Easton Ellis et Simenon, sur un territoire bien éloigné des truculences siciliennes, Camilleri explore la zone grise des dérèglements mentaux dans la banalité de la vie et nous surprend une fois encore par l’étendue de son talent. Et confirme s’il en était besoin qu’il n’est pas seulement un grand écrivain de romans noirs, mais un grand écrivain tout court
-
https://www.youtube.com/watch?v=t7QzdhTSegE&feature=share
Sophie Peugnez
-
"Le Toutamoi est l'histoire d'une mauvaise éducation, d'une enfance brisée jusqu'à devenir piège éternel, et d'une féminité perturbée jusqu'à la toxicité." Lire l'article iciElise LépineTransfuge
Giulio la réveille en lui effleurant une oreille du bout des lèvres et lui murmure :
– Ari, je te dis au revoir, je dois y aller.
Elle a entendu, elle a compris, mais n’est pas en condition de répondre.
Giulio répète, en pensant ne pas l’avoir réveillée :
– Ari, au revoir, je dois…
– Mais quelle heure est-il ? demande-t-elle d’une voix empâtée, en gardant les yeux obstinément fermés.
– Sept heures et demie.
– Mon Dieu !
Pendant un instant, elle continue à se refuser à la conscience, en se retranchant derrière l’écran d’une profonde obscurité.
Puis elle ouvre les yeux, relève un peu la tête.
Les volets sont entrouverts, laissant entrer un flot de lumière assassine.
Elle est obligée de battre des paupières pour distinguer l’image de la pièce.
Giulio est debout à côté du lit, il sent l’après-rasage. Il est habillé de pied en cap, prêt à sortir.
– Alors, comment on fait ? lui demande-t-il. Tu y vas toute seule en premier ou tu veux que je passe te prendre plus tard et on y va avec ma voiture ?
– Mais à quelle heure tu penses finir au bureau, toi ?
– Pas avant dix heures, dix heures et demie.
– Tu te rends compte ! Au plus tôt, tu te présenterais ici à onze heures. Non, on arriverait trop tard. Il vaut mieux que tu me rejoignes là-bas.
– Tu lui as dit de venir à quelle heure ?
– À onze heures. Tu as prévenu Franco ?
– Je vais lui téléphoner plus tard, vers neuf heures.
– Tu ne vas pas oublier ? Après, j’arrive à l’improviste et lui…
– Sois tranquille, je le préviens. Au revoir.
– Au revoir. Ah, s’il te plaît, dis à Elena…
– D’accord.
Arianna repose la tête sur l’oreiller, remonte les draps froissés sur son visage, ferme les yeux.
Elle retient un peu sa respiration pour continuer à s’imaginer morte dans le cercueil du sommeil. Mais c’est une tentative inutile, elle a été irrévocablement rappelée à la vie.
Et donc, elle doit faire comme font les vivants.
Elle inspire profondément, se remplit les poumons de l’odeur nocturne d’elle-même que le drap a retenue.
Elle a dû suer beaucoup sous l’effet de la chaleur, et elle aime sa sueur.
Elle a découvert qu’elle a deux sortes de transpiration, dont chacune a une odeur différente.
Celle due à la chaleur sent l’eau de Cologne aux herbes et a une couleur vert émeraude, celle due à l’amour a une odeur forte de musc et une couleur vert sombre.
Elle soulève un bras jusqu’à ce que son aisselle se trouve à la hauteur du nez, la maintient là un moment, pour la respirer.
Maintenant, elle est redevenue totalement vivante.
Elle sent que son cœur bat fort et en rythme – pomf- pomf-pomf –, et résonne dans ses oreilles comme la chau- dière d’une locomotive à l’arrêt.
Elle plie et redresse plusieurs fois les orteils du pied gauche.
– Salut, pied, comment ça va ? Elle fait de même avec l’autre.
– Et toi ?
Maintenant une main descend caresser son mollet gauche.
– Salut, mollet.
Adolescente, elle s’était mis en tête que ses mollets étaient trop gros, comme ceux de presque toutes les paysannes de par chez elle et chaque fois, à peine réveillée, elle passait au moins une demi-heure à se les lisser dans l’espoir de réussir à les amincir. Celui qui l’avait convaincue qu’elle avait des jambes splendides et des seins d’anthologie, c’était le professeur de philosophie, en première, celui qui avait un drôle de prénom, Adelchi, qui souvent interrompait le cours particulier pour la faire se dénuder devant le miroir.
Quand Elena frappe discrètement à la porte, elle est parvenue à donner le bonjour à son corps jusqu’à la gorge.
– Entre.
– Bien dormi, madame ?
Elle ne répond pas. Parler sans avoir bu son café lui est quasiment impossible. Déjà, répondre à Giulio lui a coûté de durs efforts.
Elena pose le plateau avec la tasse sur la table de chevet.
– Je vous ouvre un peu plus la fenêtre ?
– Non.
– Je vous prépare le bain ?
– Oui.
Dès qu’Elena est sortie, elle reprend la cérémonie des salutations.
– Salut, menton.
Quand elle a fini de saluer jusqu’à ses cheveux, elle s’assied dans le lit, arrange mieux les deux oreillers dans son dos, prend la petite tasse de café sans sucre, la porte à ses lèvres. Ensuite, elle allume sa première cigarette de la journée. Elle aspire lentement, en séparant bien les bouffées et en conservant le plus longtemps possible la fumée en elle.
– Le bain est prêt, madame.
Elle éteint la cigarette, descend du lit, traverse le dressing, entre dans la salle de bain où toutes les lumières sont allumées. Elle retire sa courte chemise de nuit transparente, se regarde dans le miroir grand comme une moitié de cloison. Pas mal, vraiment pas mal pour une femme qui vient, quatre jours plus tôt, d’avoir trente-trois ans. Elle fait jouer les muscles des jambes, opère des demi torsions, penche à plusieurs reprises le buste en avant et en arrière, mais il ne s’agit pas de gymnastique, elle n’en a jamais fait, c’est une sorte de contrôle général de son corps. Elle est satisfaite, elle se sent dénouée, souple, agile, un mécanisme de précision bien construit et bien entretenu, prêt à se mettre en marche à l’instant où elle le lui demande. Elle va s’asseoir sur le siège des toilettes. Toutes ses fonctions s’activent à la perfection. Elle chantonne.
Dans sa vie, elle n’a jamais su garder en mémoire l’air d’une chanson. Et dire qu’elle a passé des nuits entières à danser, à écouter et réécouter la même musique. Elle ne connaît qu’un air, elle l’a entendu une fois à la radio, elle devait avoir une douzaine d’années, et c’est celui qu’elle chantonne toujours à voix basse quand elle est seule, c’est son secret, elle l’accommode à toutes les sauces, même en version jazz, de toute façon, il s’y prête très bien, les paroles disent plus ou mois ça :
Dies irae, dies illa, solvet saeclum in favilla…
Puis elle va se glisser dans le jacuzzi. Elle s’y étend avec un soupir de bonheur. Pourquoi ne peut-on rester ainsi pendant des heures ? Les yeux fermés, avec l’eau qui vous caresse tout entière ? En se sentant seulement vivre ?
Comme cette fois où Marcello a voulu prendre le bain avec elle. Ils sont entrés dans la baignoire à neuf heures du matin et ils en sortis à midi passé. Leurs peaux étaient devenues blanchâtres et par endroits un peu plissées. Mais ils y seraient restés plus longtemps si Marcello n’avait pas été pris d’une frousse terrible.
Quel idiot !
De temps en temps, ils devaient ouvrir le robinet d’eau chaude pour ne pas prendre froid. Ce n’était pas un jacuzzi, mais une banale baignoire, sauf que dans cet hôtel de Fiesole les chambres étaient meublées à l’ancienne et que la baignoire elle aussi était d’autrefois et donc un peu plus large et longue que celles de maintenant. Quel idiot, ce Marcello !
Elle, la deuxième fois, lui avait dit qu’elle voulait se mettre sur lui et il s’était étendu, l’eau lui arrivant à mi-torse. Puis, à l’apogée, elle l’avait attrapé par surprise par les épaules et l’avait tiré vers l’intérieur de la baignoire. Marcello s’était retrouvé complètement sous l’eau. Il avait immédiatement essayé de se redresser mais elle, lui appuyant des deux mains sur le front, avec toute la force dont elle était capable, ne le lui avait pas permis. Alors Marcello s’était mis à donner des coups de pied, tentant de la désarçonner. Il n’était plus en elle, rendu impuissant par la peur. Mais elle avait continué à bouger encore un peu. Jusqu’à ce qu’elle se sente comblée. Marcello, sortant enfin de la baignoire, s’était laissé tomber à plat dos sur le carrelage, avec un halètement rauque de soufflet.
– Mais tu es folle ? Hein ? Tu es folle ? Tu voulais me noyer ?
Elle entre dans le garage. Elle a perdu un peu de temps dans le dressing. D’abord, elle avait mis un chemisier, un jean et des sandales mais elle a tout de suite compris que le jean la gênerait, il faisait trop chaud. À la fin, elle a choisi une espèce de petite tunique bleue très légère. Giulio a préféré prendre la Volvo, il a laissé là la Mercedes et la petite Toyota. Arianna monte dans cette dernière, jette sur le siège arrière son gros sac à main et le sac en plastique contenant l’eau minérale et les sandwichs préparés par Elena, carre sur son nez les lunettes noires, démarre, s’en va. Un jour où ils sont allés à Canneto, ils ont commis la bêtise de prendre la Mercedes décapotable, le grand chic argenté. Quand, au coucher du soleil, ils se sont décidés à rentrer, ils ont découvert que des crétins avaient réussi à pisser à l’intérieur par-dessus une vitre restée baissée de quelques centimètres pour faire circuler l’air. Canneto est un bout de plage perdu, fréquenté en majo- rité par des loubards et des petites frappes qui semblent s’autoparodier. La première fois qu’ils y sont allés, l’année précédente, Giulio, portefeuille à la main, s’est tout de suite mis d’accord avec Franco, le propriétaire du petit établissement balnéaire ; celui-là, rien qu’à voir sa manière de bouger, on devine quel genre de gibier de potence c’est. Et lui, il a dû faire passer le mot immédiatement, que personne ne s’approche de ce couple, sinon, ça va chauffer.
De fait, les quatre jeunes taureaux reproducteurs qui traînaient près de la rive se sont limités à s’étendre à distance de sécurité sans même oser les regarder. Elle a commencé à lire le polar qu’elle avait apporté. Giulio, étendu à ses côtés, a ouvert le journal. Mais de temps en temps elle levait les yeux et observait à la dérobée les quatre garçons. À un moment, l’un d’eux s’est levé en invitant un de ses camarades à en faire autant. Ils ont commencé à lutter, par jeu, mais surtout en espérant attirer son attention et s’exhiber devant elle. Au bout d’une dizaine de minutes, les corps agrippés luisaient de sueur, échappaient à la prise, anguilles hale- tantes, sculptures vivantes de gladiateurs, tandis que la lutte, de plaisanterie, était en train de se transformer en quelque chose de plus sérieux, maintenant, ils ne riaient plus, de leurs lèvres s’échappaient des mugissements, des gémissements, des plaintes, les mains féroces serraient avec tant de force la chair bronzée de l’adversaire qu’elles y laissaient une empreinte blanche, comme une lacération, une écorchure.
Et de temps en temps, dès qu’il y avait assez d’espace entre les corps, ils se donnaient de violents coups de tête, comme les taureaux qu’ils étaient. Ils tombaient sur le sable et se relevaient, ou bien y roulaient, fusionnés dans une étreinte qui parfois assumait toute l’obscénité d’un violent acte sexuel. Et les deux autres, dans le rôle de spectateurs, de les inciter à s’acharner sans trêve avec des cris et des voix rauques. Soudain, le maillot de l’un d’eux avait glissé, découvrant le sexe gonflé en érection, mais il ne s’en était même pas aperçu et avait continué à lutter. L’adversaire, au contraire, s’en était aperçu et, d’une main, lui avait agrippé les bourses en les tordant. Alors Arianna avait détourné le regard et fermé les yeux, tentant de contrôler sa respiration devenue haletante. Allongé à côté d’elle, Giulio s’était endormi. Mais dès leur deuxième venue au Canneto, elle s’était aperçue que son apparition déclenchait parmi les garçons de la plage des défis, des rixes, des compétitions. Ils se mettaient à jouer à une espèce de volley jusqu’à tomber sur le sable, ou bien engageaient de féroces batailles à coups de seau d’eau. Pour se mettre en valeur, se faire remarquer. Ils connaissaient certainement le motif de leur présence. Ils les faisaient lutter, courir, sauter, et puis ils achetaient les plus résistants, les plus musclés. Bon, il n’est pas dit que les plus musclés…
Elle sourit.
La première fois qu’elle avait vu Angelo, il était en train de revenir sur le rivage et elle était restée littéralement paralysée, le souffle coupé. Un coup de poing en pleine poitrine. Immobile au bord de l’eau, il y avait un garçon de vingt-cinq ans d’une beauté surnaturelle, grand, blond, il avait même le nez grec. Et puis un faisceau de muscles qui se mouvaient sous sa peau comme des serpents. Un tableau anatomique qui se serait animé comme par magie. Il était allé s’asseoir sur la chaise longue. Même Giulio le regardait, comme hypnotisé. Puis, à la demande de ses amis, le jeune homme avait commencé à s’exhiber en adoptant les poses classiques des culturistes. Arianna, en suivant avec fascination ses mouvements, s’était sentie profondément remuée.
– Félicitations ! lui avait crié Giulio à la fin. Elle avait tapé des mains.
Le garçon avait remercié d’une courbette et s’était approché d’eux sans se presser.
– Asseyez-vous là, avait dit Giulio en indiquant sa chaise longue.
Mais le garçon avait préféré se laisser tomber sur le sable.
– Je m’appelle Angelo.
Puis, dans la cabine, quand il avait retiré son mini-slip, patatras ! Il avait un petit machin, disons carrément un pois chiche, un gracieux bouton de fleur à peine visible dansl’amas de muscles qui l’entouraient. Arianna avait été secouée par un tel fou rire* qu’il lui avait été impossible de se reprendre. Elle est distraite, elle ne s’est pas rendu compte qu’elle fonçait si vite et que le chemin pour Canneto est maintenant à quelques mètres. Elle braque sans ralentir.
De la voiture derrière elle lui parvient un coup de klaxon rageur. Un grand crissement, mais les pneus tiennent la route, ils réussissent à prendre le virage. Puis quelque chose heurte le pare-brise avec une extrême violence. “Un caillou”, pense-t-elle. Et elle pile. Par chance, aucune voiture ne la suit. La pression de la ceinture lui a fait mal au sein, elle la détache, glisse une main dans son décolleté, se masse doucement. Non, ce n’était pas un caillou, sinon le pare-brise serait abîmé. Sur la vitre, il y a des petites taches rouges. Elle ouvre la portière, descend. C’est un gros oiseau noir, un corbeau, une corneille, va savoir, qui est venu se cogner contre le véhicule et qui maintenant agonise au bord de la route. Pourquoi volait-il si bas ? Peut-être qu’il poursuivait une proie et ça ne lui a pas réussi, il ne s’est pas aperçu à temps que l’auto arrivait. Arianna s’accroupit devant lui, l’observe. L’oiseau gît sur le flanc, il ouvre et referme sans arrêt son bec souillé de sang, comme s’il voulait dire quelque chose, il doit avoir les ailes et les pattes brisées, il halète, les plumes sur sa poitrine bougent en continu. Est-ce que les animaux souffrent comme les hommes ? Et est-ce qu’ils meurent de la même manière ? Elle aimerait le voir mourir, mais l’oiseau risque d’agoniser encore un bon moment et elle finirait par perdre trop de temps. Il lui vient une idée. Elle se relève ; du bout du pied, elle déplace délicatement l’oiseau pour le placer devant la voiture. Elle se remet au volant, fait une dizaine de mètres, s’arrête, repart lentement. Puis elle regarde dans le rétroviseur. Maintenant, il n’y a plus qu’une grosse tache noire sur l’asphalte.








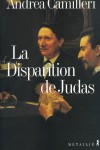
-100x150.jpg)
