Il est cuisinier dans un cabaret-restaurant à Paris, elle y est chanteuse et danseuse. Il est espagnol et fils de communiste, elle est roumaine et son père était persécuté par Ceaucescu. Tous ceux qui les entourent et travaillent avec eux viennent d’ailleurs. Tout au long d’une nuit, où se déclenche une guerre, à mesure qu’il prépare les plats d’une clientèle multiculturelle, il nous raconte leur amour et ce qui l’a amené dans cette cuisine où il est heureux. A partir des repas qui ont marqué sa vie, il reconstitue son itinéraire de marin devenu cuisinier : le repas d’huîtres à la sortie de prison de son père, le poulet à la bière de la mort de sa mère, la préparation du guacamole sensuel de la séduction à Guadalajara… Depuis l’enfance dans les Asturies à Paris, en passant par le Mexique et la plate-forme pétrolière où il découvre sa vocation de cuisinier, Omar (comme Omar Sharif dans le Docteur Jivago) Mesa évoque les bonheurs sensuels et cet amour de la vie dont la gastronomie n’est que la métaphore.En entourant ses protagonistes de personnages forts et attachants, José Manuel Fajardo écrit un roman qui ouvre l’appétit de vivre et se déguste de bout en bout comme un espace pour la passion et le plaisir en face d’un monde hostile.
-
"Belle recette existentielle que celle de ce livre à croquer: on apprend plus sur un peuple en le regardant dîner que dans un livre d'histoire." Lire l'article iciJuliette EInhornAlternatives internationales
-
« Le héros du roman, marin devenu cuisinier, rembobine les péripéties qui l'ont conduit jusqu'à la belle Marina. L'esprit d'un Luis Sepúlveda et d'un Jean-Claude Izzo [...] flotte sur cette marmite romanesque épicée que touille une humanité nomade dotée d'un féroce appétit de vivre. »Véronique RossignolLIVRES HEBDO
Rencontre à la librairie Mollat (Bordeaux) en partenariat avec l'Arpel Aquitaine (2007)
http://./video/dewplayer.swfDécouvrez le boléro Ayer dont il est question dans le livre L'Eau à la bouche (Musique : José Reinhardt, Paroles : Jose Manuel Fajardo et Voix : Laure Préchac)
http://./video/dewplayer.swfI
Mise en bouche
Les premiers mots de mon père en sortant de prison furent pour nous inviter à manger des huîtres. Devant notre silence déconcerté – nous l’attendions devant le commissariat –, il ajouta solennellement: “La liberté, ça s’arrose toujours.” J’adorais les formules de mon père. Elles brillaient comme des pierres humides au soleil. Quand j’en entendais une, mon cœur rayonnait de joie, ou bien il frémissait de rage. Car mon père s’enthousiasmait pour les choses les plus banales de l’existence, mais il s’indignait aussi à la moindre injustice. Dans les deux cas, les mots qui sortaient de sa bouche étaient étincelants.
Je le regardais avec une admiration éperdue, du haut de mes douze ans à peine révolus. Il était pour moi une sorte de John Wayne, un homme capable de sortir de ce sinistre bâtiment en plein centre de Gijón, dans lequel, je le savais, les policiers frappaient les détenus, et de proposer joyeusement d’aller manger des huîtres dans une cidrerie, car c’était sa passion. Une passion dont j’ai hérité. Je ne peux pas en voir sans penser à lui, comme en ce moment où je jette à la poubelle ces coquilles d’huîtres pour mettre un peu d’ordre dans la cuisine avant de partir. À vrai dire, Paris aurait été un paradis pour lui. Cette ville sent l’huître. Il y en a partout. Entassées dans les bourriches comme les pièces d’un trésor enterré dans le sable. Rugueuses, coupantes. Ou impudique ment ouvertes, étalant leur chair frémissante sur le blanc éblouissant de la coquille, attendant la bouche anxieuse qui s’enivrera au goût antique de leur jus. Elles sont aussi là, à quelques pas de la maison. À côté de la bouche de métro. Les consoles métalliques du Congrès débordent de gambas, de langoustines et d’huîtres, et elles répandent sur le trottoir une intense odeur de mer, que je sens avant même d’avoir traversé la rue. C’est une odeur qui vient de très loin, d’un autre pays auquel je dois mon passeport, d’un autre temps que je conserve en moi. Si je fermais les yeux, je jurerais que je suis sur le front de mer de Gijón.
Ma mère nous avait mis les habits du dimanche, nos plus beaux atours, pour aller attendre mon père à la sortie du commissariat. “Il faut que vous soyez tout beaux quand il vous verra.” Pendant que nous nous préparions, elle mit des œufs à bouillir. Cela signifiait qu’il y aurait de la salade. Mon père adorait la salade de tomates, avec oignons et œufs durs. La reine de la table, disait-il. Moi aussi, j’aimais bien, mais Suso détestait les œufs durs, aussi prit-il un air dégoûté en voyant ma mère les plonger dans l’eau. Maintenant que papa revenait à la maison reviendraient aussi les poissons au four et les galettes de maïs au chorizo. La semaine précédente, nous n’avions eu que des lentilles à l’étouffée et des saucisses, car ma mère, qui adorait cuisiner, s’était mise en grève, service minimum, son dernier recours quand la méchanceté des hommes l’exaspérait. En général, quand elle s’indignait, elle se bornait à déclarer qu’“un de ces jours on va boucler les valises et s’exiler au Mexique, comme mes cousins”! Je me voyais déjà, dans un manteau râpé, une casquette sur le crâne, à bord d’un bateau à vapeur en route pour l’Amérique, car j’avais vu des photos des oncles et des cousins de ma mère embarquant à Valence à la fin de la guerre civile et j’avais deviné la tristesse de ce monde en noir et blanc. Deux autres fois, j’en avais conservé le souvenir, elle avait boudé ses casseroles, ce qui nous avait contraints à réchauffer les restes, et chaque fois c’était au moment d’une arrestation de mon père. Pourtant, il avait souvent été arrêté sans que ma mère sombre dans le désespoir. Aujourd’hui, je me demande encore ce que ces trois circonstances avaient de spécial pour qu’elle jette l’éponge, elle qui semblait capable d’affronter toutes les douleurs, toutes les adversités. Je suppose que d’une certaine façon elles étaient les gouttes qui avaient fait déborder le vase de son abnégation. En particulier cette dernière fois, car Franco était mort depuis deux mois et pourtant tout restait pareil, comme une malédiction. La même peur, la même mesquinerie, les mêmes mensonges. Et toujours les disparitions de mon père, vaines tentatives d’échapper aux griffes de la police.
Nos caractères ont tous des dettes vis-à-vis de ceux qui nous ont mis au monde. Je dois à mon père un solide appétit et quelques idées fixes: aucun homme n’est vraiment indépendant s’il est seul; le pire des fléaux naturels, c’est nous, l’espèce humaine; compter sur la chance, c’est compter sur les cormorans, autrement dit se comporter en parfait imbécile; et avec une bonne assiettée d’huîtres on trouve toujours une solution. Par ailleurs, je dois à ma mère cette infinie curiosité que, j’en suis sûr, je n’arriverai jamais à satisfaire en une seule vie. Une curiosité qui m’a mené jusqu’à Paris, jusqu’à ce vieil immeuble sans ascenseur, jusqu’à ce petit appartement en éternel désordre. Il y a des heures que la ville déborde d’activité, et pour beau coup de gens c’est le moment de rentrer chez soi. Pas pour moi. Mon temps est inversé. Je me lève quand la lumière agonise et je me couche aux premières clartés du jour. Ma ville est une ville vampire, qui se réveille à l’appel de la lune et tord le cou alcoolique de la nuit. Une ville à point d’heure, propice aux plaisirs. C’est là, au milieu des rêves des autres, que je travaille. Mais j’ai pris du retard. Je prends le sac-poubelle et je referme la porte de l’appartement en essayant de ne pas faire de bruit, pour ne pas déranger Marina. C’est son jour de liberté et je n’ai pas voulu la réveiller. En outre, après ce qui s’est passé, je redoute ce qu’elle va me dire. Bien sûr, c’est encore pire de rester dans cet état, dans cette attente. Mais le temps m’est compté. Je descends les escaliers quatre à quatre. Dans la rue, comme chaque soir, je vois les fruits et les légumes sales de poussière, rebuts que le restaurant du coin entasse sur le trottoir en guise de publicité. Une décoration naturelle qui prétend convaincre les passants que cette grotte de voleurs propose une authentique cuisine française de tradition. Comment aurait réagi mon père s’il avait vu cela? Sûrement par une formule bien trempée. Ma mère, naturellement, aurait été furieuse. Elle détestait le gaspillage. Peut-être parce qu’elle savait le prix des choses les plus élémentaires. Je relève le col de ma gabardine et j’ajuste mon écharpe. Il fait frisquet à Paris, heureuse ment le métro est à deux pas. Le printemps joue à cache-cache et, de temps en temps, un vent frais traverse la rue comme une aiguille. C’est ce que disait ma mère: “Un vent frais comme une aiguille.” Ses mots, comme ceux de mon père, m’habitent. Ils me reviennent régulièrement à l’esprit, spontanément, comme un chien fidèle, pour nommer le monde. Leurs voix me hantent et parfois, en marchant, je dialogue avec eux dans le silence de ma mémoire. C’est le cas en ce moment, sur le chemin du métro, l’estomac noué et, une fois de plus, le temps compté. Mon destin s’est mijoté au feu de leur évocation et je pourrais difficilement parler de moi sans parler d’elles. Bien entendu, pour y parvenir, il faudrait voyager dans le temps, remonter le fleuve de la vie jusqu’à ses premiers torrents. Loin de France. Jusqu’à ce soir de janvier 1976, devant le commissariat. Une nuit glacée, comme celle qui s’annonce aujourd’hui à Paris, au cours de laquelle mes frères – Ramón et Suso –, ma mère et moi attendions avec impatience que l’on relâche notre père, en compagnie d’un avocat du Parti, tandis que l’humidité de la mer s’infiltrait sous les manteaux et nous faisait grelotter.
J’introduis mon ticket dans l’appareil qui contrôle l’accès au métro. Au moment de m’engager dans le tunnel, je vois qu’il est bloqué par un groupe de vigiles, une rangée d’hommes et de femmes en uniforme qui demandent aux voyageurs leur carte ou leur ticket et qui poussent les resquilleurs contre le mur. Ils ont déjà coincé trois jeunes maghrébins qui ont l’air plutôt inquiets. Mon père s’est sûrement retrouvé plus d’une fois dans cette situation, plaqué contre un mur. Un type de haute taille, le teint blafard, l’air athlétique et le verbe méprisant, leur ordonne de rester tranquille, pendant qu’une contrôleuse noire discute avec la police par talkie-walkie interposé. Les interpellés doivent payer une amende de trois cents francs chacun, mais même un aveugle verrait qu’ils n’ont pas les moyens de verser une telle somme. Le contrôleur me rend mon ticket et je traverse le bar rage, je suis de l’autre côté du problème, partagé entre l’irritation et le soulagement. Je n’aime pas la police, aucune police, y compris ces vigiles assermentés, campés dans leurs uniformes avec une satisfaction provocante qui doit compenser dans leur esprit les avanies et les complexes de leur passé. Toujours dans le tunnel, j’approche du quai et je me dis que j’ai vraiment hérité de mes parents une certaine animosité contre l’autorité. Bien sûr, j’ai eu de bonnes raisons, au cours de mon existence, de la cultiver. Cette dernière disparition de mon père dura presque un mois. Il avait quitté la maison juste avant les fêtes de Noël, ce qui était déjà arrivé. La période préférée de la police. “Parce qu’ils s’imaginent que ce jour-là je vais être chez moi”, nous avait-il expliqué la première fois qu’il avait renoncé à passer les fêtes avec nous. Et il avait vu juste, car la police était venu le chercher le jour de Noël, en plein dîner, alors que nous finissions les restes du déjeuner. Ma mère leur ouvrit, leur dit qu’ils pouvaient fouiller mais qu’il n’était pas à la maison et elle revint s’asseoir, imperturbable. Nous mangions en silence. Je la regardais éplucher les gambas et les tremper dans la mayonnaise. Ses mains tremblaient légère ment et je priais pour que les policiers ne s’en aperçoivent pas, car j’enrageais à l’idée qu’ils puissent croire que nous avions peur. Mais en réalité nous avions vraiment peur. Je suçai méthodique ment une tête de gamba et la reposai, vide et brillante. Tandis que son goût amer et salé m’emplis sait le palais, je suivais des yeux les allées et venues des policiers. Un des inspecteurs, qui portait un long manteau vert et avait des cheveux gominés, donna un coup de poing sur la table, j’en lâchai ma gamba, les verres tremblèrent et nous eûmes tous une frousse bleue: “Dites à votre mari que nous lui souhaitons une bonne année et que nous avons un cadeau de Noël pour lui. Quand il reviendra, il peut passer le prendre au commissariat.”
Il avait le sourire mauvais du méchant dans les films. Dans les films nuls. Ma mère ne lui accorda pas un regard. Elle prit une autre gamba dans le plat et lui arracha lente ment la tête. Ses mains avaient cessé de trembler et j’étais sûr qu’elle était en train d’imaginer, comme moi-même, que c’était la tête de l’inspecteur qu’elle venait de couper. Cette idée amena un sourire involontaire sur mes lèvres. L’inspecteur devina sans doute ma pensée, car il darda sur moi ses yeux aussi froids et luisants que du métal, et il me lança: “Et merde, qu’est-ce qui te fait rire, morveux?” Je sentis le sol se dérober sous mes pieds.
“Vous avez fini votre travail, inspecteur?” Ma mère s’était levée et elle regardait le policier droit dans les yeux. Elle était plus petite que lui, mais elle avait un air tellement résolu qu’elle imposait le respect. L’inspecteur recula de quelques pas et répondit:
– Oui, madame, je vous souhaite de bonnes fêtes et prenez soin de vos enfants, ce serait dommage qu’ils tournent aussi mal que leur père.
La réplique de ma mère fut immédiate, comme si elle avait attendu toute sa vie le moment de la placer:
–Mes enfants vont vivre dans un monde où il n’y aura pas de place pour des gens comme vous, inspecteur.
Le policier ne parut nullement impressionné. Il fit signe aux autres de quitter la maison et, avant de leur emboîter le pas, il lança à ma mère:
–Les gens comme moi sont toujours nécessaires, madame, et quand viendra cette démocratie qui semble tellement vous plaire, vous aurez encore besoin de personnel pour que l’ordre règne. En attendant, tâchez de ne pas faire de bêtises, quelqu’un pourrait vous voir. Nous traversons une période troublée et un accident est si vite arrivé!
Lorsque la porte se referma, ma mère serra les poings et revint s’asseoir à la table. “Connard!” Sa voix était à peine un murmure, mais elle vibrait de fureur. Elle poussa un profond soupir, prit une gamba avec les doigts et nous dit: “Si l’un d’entre vous décide un jour d’être policier, je le tue.” Et elle arracha la tête de sa gamba d’un coup sec.
Quant à moi, la peur née de cette dernière perquisition m’était restée chevillée au corps et je sentais encore sa présence, mêlée aux frissons de froid, deux semaines plus tard, au moment où mon père allait enfin sortir du commissariat dans lequel il était enfermé depuis trois jours, après son arrestation chez un ami qui l’avait caché.
Son ami avait été relâché la veille et ma mère avait longue ment discuté avec lui dans notre salon, toutes portes closes et à voix basse. J’entendais les chuchotements et mon imagination prenait le relais. Je me rappelais ce que l’on avait infligé au héros d’un de mes romans préférés, Michel Strogoff, le courrier du Tsar, on lui avait brûlé les yeux avec une lame chauffée à blanc, et j’imaginais déjà mon père aveugle et gravement blessé, que nous récupérions dans la neige avant qu’il ne meure gelé. Bien entendu, il ne neige presque jamais à Gijón, ou alors la couche est si fine qu’elle tient rarement une journée. Deux à la rigueur. Mais à la fin Michel Strogoff retrouvait la vue et mon père sortit du commissariat sur ses jambes, avec un clin d’œil en guise de salut, et il nous invita aussitôt à la cidrerie la plus proche.
Mes parents ouvraient la marche, bras dessus bras dessous, comme tous ces couples qu’on voit le soir à Gijón, et nous, les enfants, nous suivions, curieux. Ce soir-là, ils formaient un joli tableau, mais ce n’était pas toujours le cas. Parfois ils se disputaient et leurs cris me faisaient mal, plus que tout. Plus que les punitions à l’école, et même plus que le chagrin de voir mon père derrière les grilles de la prison quand nous lui rendions visite, apportant des parts de tourte à la viande pré parée par ma mère. Parfois, ma mère y glissait des mes sages. C’étaient des messages très courts dont je ne comprenais pas toujours le sens. Car c’était à moi de les écrire. Ma mère avait une mauvaise vue et une écriture encore pire, c’était donc à moi de m’arracher les yeux en écrivant ces phrases en caractères minuscules sur des bouts de papier qu’elle enveloppait dans du plastique et dissimulait à l’intérieur d’un morceau de viande. Une véritable œuvre d’art: les surveillants de la prison ne les avaient jamais découverts, et pourtant ils ne s’étaient pas privés d’ouvrir ces tourtes pour en vérifier le contenu. Ces filigranes me servirent des années plus tard, dans mes dernières années de lycée, pour confectionner des antisèches microscopiques qui me valurent plus d’une fois un succès immérité.
La cidrerie était très enfumée, les relents acides saturaient l’atmosphère de la salle et se mêlaient aux odeurs de la sciure qui recouvrait le sol. Les serveurs nous saluèrent avec sympathie, surtout mon père qui bénéficia de quelques démonstrations d’amitié. La première bouteille fut offerte par la maison. Les enfants avaient le droit de vider les fonds de verre. J’aimais ce goût de pomme et le chatouillement amer du liquide trouble dans la bouche. Votre heure viendra de boire du bon vin, aimait à dire mon père, mais pour être un homme digne de ce nom, il faut d’abord apprendre à boire le cidre.
Ensuite, on nous apporta un plateau d’huîtres. Ni mes frères ni moi ne les aimions, mais je feignais de les apprécier. Si mon père les mangeait avec une telle délectation, il fallait bien qu’elles aient du bon. L’ennui, c’est que je leur trouvais toujours un goût aussi infect. Autant avaler une gorgée d’eau de mer. De plus, elles étaient baveuses. Très baveuses. Mais je persistais. J’en mangeais toujours deux ou trois, faisant contre mauvaise fortune bon cœur. Mon père incitait mes frères à prendre exemple sur moi, qui ne faisais pas tant de simagrées, mais ils protestaient en prétendant que moi non plus je n’aimais pas les huîtres. Je niais, bien entendu, et la nuit venue c’était la bagarre dans la chambre. Ils m’accusaient d’être un menteur, mais ce n’était pas vrai. Je refusais simplement l’idée que les huîtres puissent ne pas me plaire. C’était une question de volonté. Et de curiosité.
Ce soir-là, mon père en mangea trois douzaines. Il les mangea posément, buvant aussi le liquide assaisonné de citron du fond de la coquille. Ma mère le regardait, mais elle n’avala pour ainsi dire rien. C’était toujours pareil, elle adorait cuisiner pour les autres, les regarder manger, mais elle était tout de suite rassasiée. Elle construisait le bonheur des autres.
À minuit, mon père était à demi soûl et, il faut le dire, nous aussi. Tous ces fonds de verre finissaient par représenter une quantité considérable. J’avais la tête qui tournait et la fumée du tabac, comme une brume en suspension dans la salle, me piquait la gorge et les yeux. Depuis un moment mon père chantait avec quelques habitués de la cidrerie. C’étaient des chansons de la guerre civile, qui parlaient de grèves et de mineurs héroïques. Je les connaissais par cœur, car je les entendais depuis mon enfance, toujours avec cette sensation de fruit interdit dans la bouche. C’étaient des chansons qui piquaient le palais, inquiétantes, téméraires, pleines de mots qui ne pouvaient être prononcés à haute voix dans la rue. Des chansons qui donnaient du courage au cœur, même si on n’en comprenait pas vraiment le sens. Mon père chantait, ses amis de la cidrerie reprenaient en chœur et nous battions des mains: qui aurait cru que, quelques heures plus tôt, ma mère pleurait dans sa cuisine, maudissant notre sort et la police – ma mère maudissait toujours la police – et qui aurait pu imaginer que nous avions ensuite grelotté de froid devant le commissariat, parce que cette dictature horrible dont on ne cessait de me rebattre les oreilles était toujours en vie, telle une bête nuisible cherchant obstinément à mordre. Non, personne n’aurait pu croire que tout cela existait quatre heures auparavant, car une seule réalité s’imposait désormais: les chansons sur les mineurs courageux et les révolutionnaires en route pour les barricades et autres remparts pendant que mon père trinquait avec ses amis et que mes frères et moi vidions les fonds de cidre.
Sur le chemin du retour, ma mère s’en prit à mon père, parce que les enfants étaient soûls. “C’est même pas vrai.” Mais mes protestations ivres ne servirent à rien, bien au contraire. Chaque fois que j’ouvrais la bouche, ma mère redoublait de colère. Suso tenait à peine debout et Ramón tanguait en silence, comme toujours. Je n’ai jamais connu une personne plus silencieuse que mon frère. Moi, j’essayais d’avoir l’air normal. Je mobilisais mes cinq sens pour y parvenir. Je marchais, raide comme un hussard. Le problème était la parole, car je m’empêtrais dans les mots qui sortaient pêle-mêle, en dépit de mes efforts pour les contrôler. Quelle saloperie, les mots, toujours aussi capricieux: envahissants quand on les veut hors de portée, absents quand on en a besoin.
Arrivés à la maison, nous allâmes au lit sans rechigner. Bien sûr, je dis que je n’avais pas sommeil, mais en pure perte. Les murs de la maison, fins comme du papier, révélaient tous les secrets, les échos des disputes de mes parents, les gémissements de plaisir ou de douleur – comment savoir? – qui furent les premiers hérauts du sexe dans mon enfance. Je me mis au lit et restai vigilant, mais cette nuit-là il n’y eut ni disputes ni soupirs, seulement des mots prononcés sous l’empire de l’alcool. Des mots qui sont restés gravés dans ma mémoire, comme si le cidre, au lieu d’être une boisson, avait été un fixateur. Je pourrais encore les crier aujourd’hui, après tant d’années, en attendant l’arrivée du métro, comme tous ces fous innombrables qui peuplent les entrailles de Paris, ces êtres hallucinés qui discutent inlassablement avec leurs fantômes au milieu de la solitude collective. Ma mère répétait qu’elle ne supportait plus les arrestations, les attentes. Elle ne cessait de le dire, comme une litanie, comme si elle parlait par la bouche de quelqu’un d’autre. “Je n’en peux plus, Agustín, je n’en peux plus, si on te remet en prison je deviens folle.” Et mon père répondait par un silence qui me faisait mal. Pourquoi ne parlait-il pas? Pourquoi ne disait-il pas que cela ne se reproduirait plus, que tout irait bien, n’importe quoi…? Soudain, il interrompit le monologue de ma mère par une formule bien à lui, redoutable, belle, terrible: “Tout ça, c’est fini, Tina. Maintenant je reste, si la mort ne m’emporte pas. Je te le jure.” Et c’est ce qui arriva.
Dix mois plus tard, en rentrant de son travail dans les bureaux du port de Gijón, mon père s’effondra devant le café Dindurra, foudroyé par un infarctus. Il y avait une semaine que nous avions reçu une lettre du ministère de l’Intérieur lui annonçant qu’il bénéficiait de l’amnistie, comme tant d’autres condamnés pour délits politiques, et il avait promis de nous emmener déjeuner le dimanche suivant à Llanes pour fêter l’événement. Quand ma mère apprit sa mort, elle éclata d’un rire terrifiant, car ce rire résonnait comme un cri d’oiseau, comme une vitre cassée. Il n’avait rien d’humain. Puis elle s’enferma dans sa chambre et pendant des heures il régna sur la maison un silence encore pire, un silence noir, comme si elle aussi était morte. L’ami de mon père qui était venu la prévenir ne savait que faire. Il marchait de long en large dans le salon et ne cessait de téléphoner pour essayer de joindre une de mes tantes et lui demander de venir s’occuper de nous. En attendant, il n’avait qu’une obsession: nous ne devions surtout pas déranger ma mère. Suso et Ramón s’assirent sur le canapé, devant la télévision, mais en réalité ils ne regardaient que lui. Je me levai et me dirigeai vers la chambre de mes parents, mais l’homme me retint par le bras et me conseilla d’attendre; ma mère avait besoin d’un peu de solitude.
– Et si elle était morte, elle aussi?
– Ne dis pas de bêtises, gamin. Ta mère a du chagrin, mais tu vas voir qu’elle va bientôt sortir.
Je retournai sur le canapé. Lui, il alla frapper doucement à la porte de la chambre.
– Tina, tu vas bien?
Je décrétai que c’était l’homme le plus bête du monde. Comment ma mère pouvait-elle aller bien, alors que mon père venait de mourir? À ma grande surprise, la voix de ma mère résonna haut et fort derrière la porte: “Oui, Chano, ne t’inquiète pas. Donne à manger aux enfants, j’arrive tout de suite.” Mais elle n’arriva pas et Chano nous prépara des sandwichs au jambon que nous avalâmes devant la télévision, mâchant sur un rythme fatigué, car il n’y a rien de plus triste au monde que de manger un sandwich quand on a du chagrin. La première décision de la grand-mère Inés quand enfin elle arriva, ce fut de nous envoyer immédiatement au lit et de nous dire que les hommes ne pleuraient pas. Aucun de nous trois n’avait pleuré jusqu’alors, mais en l’entendant je sentis mes yeux se remplir de larmes et je courus me réfugier sous les draps pour qu’elle ne me voie pas. La porte de notre chambre était restée entrouverte et la lumière du couloir dessinait une épaisse frange jaune sur le mur. Quelques minutes plus tard, Suso me rejoignit dans mon lit et me demanda s’il pouvait dormir avec moi. Je dis oui, et j’ajoutai qu’il pouvait pleurer s’il en avait envie, parce qu’il était encore un enfant et que je ne le raconterais à personne. Ramón n’avait pas quitté son lit, mais je l’entendais renifler entre deux sanglots. Suso s’endormit aussitôt; moi, je guettai les bruits de la maison, où les voix se multipliaient. Je ne sais combien de temps s’écoula mais, au moment où j’allais demander à Ramón s’il dormait, ma mère entra dans la chambre et me regarda.
–Tu ne dors toujours pas? dit-elle.
Elle se pencha sur Ramón et constata que lui, au moins, il dormait. Alors elle s’assit au bord de mon lit et caressa la tête de Suso, puis la mienne, très lentement.
–Tu es l’aîné, Omar, et tu es courageux comme ton père, mais il faut que tu dormes. Moi aussi, je vais dormir. Nous en avons besoin, n’est-ce pas?
Je dis oui de la tête et elle m’embrassa et pressa mon visage contre sa poitrine et se leva et sortit de la chambre et me laissa tout seul avec ma respiration et avec la peur absurde que mon père se relève comme un mort-vivant pour venir aussi nous dire au revoir au cœur de cette nuit.
Nous passâmes le dimanche à Llanes, bien obligés, car notre mère tint absolument à fêter l’amnistie comme l’avait projeté mon père. J’avais les yeux bouffis d’avoir pleuré. Depuis quatre jours, Suso ne râlait plus à tout bout de champ et Ramón avait sombré dans un silence encore plus insondable que d’habitude. Aucun d’entre nous n’avait la tête à rire, mais ma mère fut inflexible. Elle passa tout son samedi entre nos jérémiades et ses casseroles. Elle changea plusieurs fois de menu. Invita des amis, des parents, et se disputa avec eux tous, car ils trouvaient insensé d’organiser une fête alors que mon père était enterré depuis trois jours à peine. Finalement, la sœur préférée de ma mère, ma tante Clara, vint à la maison pour tenter de la dissuader, envoyée par ses frères et sœurs qui connaissaient et redoutaient le caractère de ma mère. On pardonnait tout à la tante Clara. Son penchant pour le whisky, ses liaisons extravagantes et ses impertinences. On lui permettait les transgressions. Je crois qu’elle était comme ces idiots du village que tout le monde accepte et supporte. Mais cette fois on lui avait confié une mission impossible. Elle s’en ferma à la cuisine avec ma mère et au milieu des bruits d’assiettes et de marmites je les entendis se disputer de plus en plus aigre ment, jusqu’au moment où ma mère lui lança une formule dont mon père aurait été très fier, j’en suis sûr: “Quand la vie nous apporte des chagrins, il faut les inviter à manger.”
À Llanes se retrouvèrent une grande partie de la famille et de nombreux amis de papa, mais la grand-mère Inés refusa tout net de venir parce que, avait-elle déclaré à la tante Clara, elle n’avait pas l’intention de cautionner la folie de sa fille. Il y eut des drapeaux rouges, du cidre à gogo, et on réentendit les chansons de la guerre civile, puis celles d’un Cubain qui tuait les canailles avec un canon d’avenir, et celles d’un chanteur chilien assassiné par les militaires de son pays, ses chansons parlaient d’enfants noirs qui n’arrivaient pas à s’endormir et de femmes qui cou raient chercher leur mari à l’usine. Je les trouvais toutes très tristes. Ma mère fit un poulet à la bière qui me fit venir les larmes aux yeux, parce que j’aimais beaucoup ce plat, et aussi parce que c’était celui qu’elle avait préparé le jour de ma première communion. Nous mangeâmes dans une guinguette, près de la plage, sous la pluie, mais personne ne parut s’en soucier.
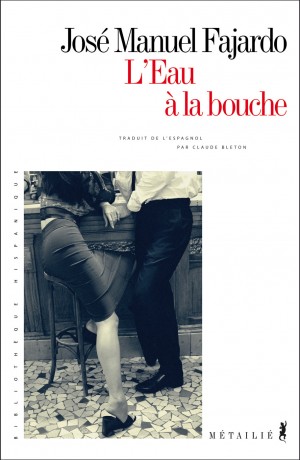


-100x150.jpg)
-100x150.jpg)


