L’auteur, un jeune ethnologue, est envoyé à Berkeley dans les années 1980 pour enquêter sur l’“écologie humaine”.
À la suite de Henry David Thoreau et de Henry Miller, il vit dans une communauté de Big Sur des aventures tendres et cocasses que le regard aigu de l’ethnologue et son écriture curieuse et amusée transforment en une sorte de fable écologique.
On se laisse emporter avec bonheur par cette relecture de nous-mêmes où l’on retrouve à la fois nos inquiétudes, notre modernité et nos espoirs. Sortant de cet ouvrage éminemment humain et politique, on se demande surtout pourquoi on n’a pas écouté ni pris au sérieux ces “rêveurs d’avenir” qui, il y a quarante ans de cela, nous avertissaient déjà de l’état catastrophique dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui.
Un récit candide et vif sur un essai de construction d’un monde plus vivable et respectueux de la nature, un texte en résonance avec les débats actuels.
-
Ecouter le podcast iciFrédéric KosterBretagne5
-
"Ce California Dream des années 80 est revigorant et rafraîchissant."François MontpezatDNA
-
"En se remémorant ses années de jeunesse, Pascal Dibie captive sans relâche au fil des pages, avec optimisme et bonne humeur, à la recherche de l’authenticité. California Dream met en garde, et conserve, malgré tout, une lueur d’espoir sur la prise de conscience qui n’arrive malheureusement que petit à petit malgré l’urgence, sur des sujets, aujourd’hui encore non résolus." Lire la chronique iciSite Encres vagabondes
À la mémoire d’Allan Lonnberg
qui m’a ouvert si chaleureusement
sa Californie.
Acceptez que je sois le lecteur de ma vie,
mais un lecteur qui témoigne de sa relecture
en écrivant.
C’est ici et pas ailleurs, que j’ai vu des hommes réformer leurs jugements et vivre selon leurs idées nouvelles. Et c’est ici, plus que partout ailleurs, que j’ai entendu proférer les plus grosses absurdités aussi bien que les paroles les plus sages.
Henry Miller,
Big Sur ou les oranges de Jérôme Bosch
Ne soyez pas trop moral.
Vous pourriez vous priver de beaucoup de vie.
Henry David Thoreau,
La Moelle de la vie
Le monde a changé, moi non. On vieillit souvent parce qu’on garde les mêmes idées dans un monde où elles ne sont plus autant appréciées. Je veux croire pourtant qu’on peut jusqu’à la fin avoir l’esprit neuf de sa jeunesse, à condition d’y croire. Logiquement, ce qui était neuf en 1980 aurait dû être vieux quarante-deux ans plus tard, or c’est l’exact contraire : ce que nous disions, vivions et constations est de plus en plus vrai dans notre actualité contemporaine de fin du monde. Reste à savoir pourquoi personne ne nous a crus plus tôt ?
À relire mes carnets de voyage aux États-Unis, je peux revivre ce temps enchanté et enchanteur dans lequel je m’étais glissé, croyant à tout et plus particulièrement à l’amitié, au bonheur et à l’écologie. Mes études d’histoire et d’ethnologie me fournissaient, en plus d’un matelas confortable de culture, un alibi parfait pour oser nommer mes voyages, à ceux qui me posaient la question du pourquoi : “missions”. Quelles missions, en effet ! Je n’en ai pas fait beaucoup d’officielles, sinon une dizaine de “mandarinades” ici et là dans le monde, qui ne correspondaient qu’à des déplacements universitaires un peu secs et rapides, il faut le dire. Mes plus beaux voyages sont ceux qui se sont inventés avec et malgré moi ; ces voyages qui m’apprendront vite que tout déplacement n’est jamais qu’une tentative de mise au point qui à chaque fois se brouille pour se réajuster aussi vite ailleurs en fonction des visions que chacun nous renvoie et que nous rectifions depuis notre regard et notre corps.
Fin avril 1980, je décidai de partir pour plusieurs mois de l’autre côté de l’Atlantique, où j’avais séjourné pour la première fois en 1978 parmi les Indiens Hopi en Arizona. Dans mon esprit, plus qu’à voir le monde, un voyage consiste surtout à se faire des amis pousseurs de portes. À commencer par les leurs qui, en s’ouvrant, vous font traverser de facto et vous aident à comprendre comment “tout cela” (la culture ?) s’agence.
Officiellement, j’avais touché un petit pécule pour partir en Californie, plus précisément à Berkeley, dans le but d’y travailler à la préparation d’un livre sur l’“écologie humaine”. J’avais surtout décidé de m’enfuir de France et de faire la côte jusqu’au Mexique, aller et retour, avec San Francisco et Los Angeles à la clef. Comment allais-je pouvoir conjuguer et organiser voyage et étude ? Je décidai de n’opposer aucune résistance à toute invitation ni de faire aucun programme de travail avant que les choses ne s’imposent et s’équilibrent… ou pas. En bon apprenti taoïste, j’avais retenu que ce qui nous arrive est histoire de circonstances plus que de volonté. Suivre le courant, ne pas m’opposer pour mieux sentir et découvrir n’était pas neuf pour moi ; j’y œuvrais avec conviction depuis quelques années et j’avais compris qu’il ne fallait rien hiérarchiser, les plus petits détails étant autant et même quelquefois plus parlants que ce que l’on pouvait prendre pour de vraies découvertes. Mieux même : on ne peut bien voyager qu’à découvert, une des plus belles manières d’être à la fois transparent et vraiment présent. Pour moi le voyage réussi, et mes carnets en font foi, est un vagabondage sur place. Sonder un peu des mondes était mon ambition. Voyager en vérité n’avait aucun sens, je ne me suis jamais imaginé aller vérifier quoi que ce soit de l’existence d’un monument ou d’un rituel, certain que toute image préconçue disparaît devant la réalité. Quoi de moins ressemblant que ce qu’on vous a promis que vous verriez, que vous goûteriez ou que vous sentiriez à tel et tel endroit une fois que vous y êtes. Non, pas de guide, pas ça, pas d’obligation de descendre une rue qui monte ou de monter un boulevard qui descend, ni de ressentir un climat que quelqu’un a déclaré difficile ou de goûter à une source aux eaux sulfureuses et âcres mais tellement vivifiante… Évidemment qu’il faut suivre le courant des lieux et ne pas s’opposer à la relation de chacun à son propre univers, c’est même cela, la vraie curiosité, c’est accepter de ne pas comprendre avec application ; entrer en une posture poétique toutes antennes déployées en un ailleurs où ce que vous pensez avoir compris est l’inverse exact de la réalité, où ce que vous croyez autorisé est interdit, où ce qu’on vous apprend de pureté est la plus abominable des pollutions, etc.
Je n’ai pas pris des notes pour écrire un livre, savais-je même en les griffonnant que je vivrais encore en ce xxie siècle bien entamé ? L’extraordinaire est de me relire et de me souvenir que “cela s’est passé au siècle dernier”. Je me sentais à tel point moderne et détaché du temps que je n’avais pas conscience d’être dans un siècle. Les premières notes en sont la preuve, tant elles sont minimes, avec des horaires d’avion, de train, de bus, le prix de “madame pipi” dans telle gare – cela me coûta 5 dollars, je n’étais pas un Américain, moi ! Et puis le lendemain ce furent trois lignes pour dire que le sauvignon que j’avais tenté de déguster la veille avait tourné – crime sûrement pour un Bourguignon, broutille pour un Californien. Ne parlons pas du premier hamburger acheté en cachette à Capitola pour savoir s’il avait le même goût qu’à Montparnasse. Un, deux, trois, quatre, peut-être six jours à se suivre aussi plats que mon aveuglement ou plutôt mon incompréhension d’un espace et d’un monde où je venais de débarquer. Le rythme des jours qui n’était plus le mien, comme celui du sommeil, le goût du pain qui n’était définitivement pas le même, ont commencé d’entrer dans mon panorama. Petit à petit, je me détachais d’un univers connu pour entrer dans le récit de ma nouvelle vie. Chaque pas portait mon regard plus loin et attentif au tout proche. Je commençais à m’arrêter un peu, à construire mon terrier et à me rassembler, m’aménageant là dans un coin d’une cuisine chaleureuse un petit bureau que je pouvais utiliser en dehors des heures de repas. Je reconnaissais dans la rue les amis de mes amis qui me faisaient des “Hi” complices, connaissais des adresses capitales pour survivre. J’avançais, je m’aventurais jusqu’à la plage pour guetter les orques et admirer les surfeurs. J’entendais parler de Carmel, de la baie de Monterey magnifiée par Steinbeck que je lisais pour la première fois dans sa langue. Je voyais l’agilité du type qui tape à la caisse du supermarché, la conscience professionnelle et le talent du jeune “emballeur de courses” à la sortie, bref, je découvrais les petits bonheurs et la fluidité de cette minuscule ville organisée pour y vivre le mieux possible. Mon écriture aussi se répandait de plus en plus ; ce qui n’était que notes lapidaires, tout comme ma vie, prenait de la chair et du sens.
C’est sur un vieux carnet allemand horriblement plastifié mais costaud comme un blindé, oublié au fond d’un sac embarqué depuis Paris, que je notai “voyage usa” à la date du 28 avril 1980. “Noirci” sur une bonne cinquantaine de pages avant que je ne m’y relivre plusieurs années plus tard, ce carnet avait déjà sa vie avant que je lui confie un peu de la mienne au jour le jour.
Calée depuis longtemps sous la couverture mais débordant un peu, une feuille rose saumon que je déplie aujourd’hui avec précaution et curiosité contient une confession folklorique de ma conversion au zen, rédigée Diessen en Bavière et datée du “9 avril 1977 – samedi de Pâques”. J’y écrivais : “Je n’ai pas peur de ne rien savoir. Je suis disposé à apprendre de la vie par la vie. Par où se manifeste-t-elle, cette vie ? Où peut-elle se loger quand elle n’est pas dans la tête ? N’est-elle pas imaginaire ? N’est-ce pas nous qui à chaque instant la créons ? La vie n’existe pas réellement, elle n’est que parce que nous la faisons autant qu’elle nous fait. Peut-on vraiment s’extraire du monde totalement ? C’est laisser trop de chance à ce monde de nous empêcher de vivre, de nous limiter à tout prix. Nous limiter, nous enfermer, juger, imaginer que l’autre vous juge. Alors qu’il ne faut qu’être là, n’attendant rien d’autre que le plaisir d’être dans ce moment. C’est pour cela qu’on peut agir sans crainte et provoquer ce monde puisqu’on ne sait pas et qu’on n’a rien à proposer. Parlons lentement, taisons-nous un temps, laissons monter ce sentiment que nous n’arrivons nulle part. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à trouver comment.”
Dans ce même carnet, il y a en ouverture des références à Winnicot sur “l’espace potentiel, le jeu et la réalité”. Il y parle de l’agonie primitive et de l’effondrement, appelé breakdown, toujours redouté, “vide nécessaire à qui recherche son lien psychique qui n’est déposé nulle part”, dit le maître, le tout écrit bien serré à l’encre verte. Trois pages plus loin, je quitte “… un terrain de jeu, aux frontières mouvantes, qui fait notre réalité” pour des listes où se bousculent noms de savants et amis proches, un projet titanesque et très personnel jamais abouti. Il ne s’agit rien moins que de l’Alphabétisation du monde : bruit, image, son, international (non daté). Ce devait être un jour faste, car sur la page en regard c’était d’une encyclopédie sur l’“Homme imaginaire” que je rêvais. Et puis mon projet actuel se profile, voilà que page après page des réflexions sur l’écologie s’imposent. (En 1976, j’adhérai aux Amis de la Terre et me rapprochai de Serge Moscovici.) Dans ces “brèves” (qu’est-ce d’autre quand il s’agit de trois ou quatre mots ou d’une phrase lapidaire notés là pour m’inciter à nourrir mes propos ?), il est aussi question de la “société de l’auditif” et de la “conservation des énergies”. Dans une autre, de la “moquettisation du monde” – tout ce qui relève de l’isolement et de notre américanisation dont je voulais faire un livre. De la tribu des jeunes, de la lutte contre le capitalisme… Tous, propos d’un jeune intellectuel qui cherche ses engagements dans le fouillis joyeux des influences et des propositions qui traversent son ciel parisien. Et de l’amour aussi, comme “produit consommable à l’intérieur d’un libéralisme économique dont les microrégions du corps qu’on se prépare à explorer auraient été isolées pour mieux en tirer profit”. L’idée était osée et bien peu poétique. Heureusement je ne l’ai pas poursuivie. Me revoilà sur terre à tenter de cerner “le grain et le puceron”, nouvelle méthode pour traiter de l’agriculture et explorer les temps nouveaux de la production biologique. Juste avant, je me proposais de faire un voyage musical aux sonorités ferrailleuses jusqu’à Laroche-Migennes, intitulé La France en Autoreille. Et me voilà à Dijon “où s’oppose la démesure des cathédrales au long silence des culs-de-sac”, écrivais-je en introduction à un petit texte bien senti sur la ville. J’étais parti là-bas pour étudier l’industrie des nourrices morvandelles. Deux pages encore et je suis au Creusot à visiter l’écomusée et à réfléchir sur la notion de “bien culturel” avec le poète Bernard Noël. Deux tranches de vie plus loin, j’élabore une “anthropologie de la découpe” – que je réaliserai en effet un peu plus tard, à travers une exposition intitulée “Tendres Boucheries”. Par contre, je ne développerai jamais mon “anthropologie de l’urgence”, issue d’un arrêt prolongé devant une bibliothèque fermée, ni mon “ethnologie de la brume”, née un jour où j’étais perdu dans le brouillard avec ma 2cv à Saint-Gengoux-le-National. Il y eut bien d’autres inventions encore, comme cette idée poétique d’un film où je proposai de tourner deux films à la fois : L’Un et l’Autre, réflexion godardienne où j’expliquais qu’il y a toujours du cinéma qui sort d’un film et qu’un film ne tient pas toujours au cinéma. On ne sait jamais, le génie peut tenir en trois mots dans un carnet… Hélas, il n’y eut pas de suite. Dommage. Encore quelques réflexions sur “communauté et convivialité comme détour nécessaire pour un retour à la vie naturelle…” Maintenant ce sont trois mots, bien détachés, tracés d’une plume à l’encre mordorée (c’était la mode des encres de couleur) : “Émile, Mensuel, Revue”, un projet de revue écologique, je me souviens, qui a bien failli voir le jour. Qu’avais-je encore envisagé ? Un film pop sur la nature dont le scénario était le suivant : “On pourrait imaginer un corps qui roule sur le sol et rencontre toutes les formes, les épouse, se heurte, fraye, avance. Stevenson en symphonie.” Était-ce de Robert Louis Stevenson que je m’inspirais ? Pas sûr. Enfin, la page ultime qui me sépare de mon premier carnet d’Amérique, et c’est véridique comme tout ce que je viens de citer, et cela servira de fermeture involontaire à ces propos en même temps que d’ouverture à mon premier voyage américain, était un extrait du Tao te king :
xlvii
Sans franchir sa porte
on connaît l’Univers ;
sans regarder par la fenêtre
on perçoit la voie du ciel.
Plus on va loin,
moins on connaît.
L’homme véritable
connaît sans voyager,
comprend sans regarder.
Maintenant, comment remodeler et donner vie à mes aventures où sans cesse s’entremêlent idées et actions, réflexions et travail de recherche dont sont émaillés mes carnets de terrain ? Ce dernier mot est un peu fort, mais il me permet de prendre plus au sérieux ce que, au-delà de mes impressions brutes jetées en urgence dans ces petites pages, j’ai emmagasiné – le carnet n’est jamais qu’un sous-cahier qui participe grandement de la maçonnerie de mon écriture. Il tient sa force à la fois de la maltraitance physique dont il est l’objet. Cet objet, à être toujours sorti et rempoché à la va-vite, s’aplatit et est souvent un peu sale, et sort bien abîmé de nos voyages. À les revisiter plus de quarante ans plus tard, malgré la vénération que je leur voue, je constate que mes carnets furent tous bel et bien victimes de l’indifférence que je leur accordais. Ils devaient tout supporter : mauvaise écriture, renseignements, noms écorchés, horaires précis, numéros de téléphone pris au vol, croquis vite expédiés, mauvais copiages, etc., pense-bêtes en effet notant tout ce que j’estimais remarquable. Le choix même de cet outil tient au besoin que j’ai qu’il soit tout-terrain en même temps qu’il est important pour moi qu’il soit l’expression d’une certaine préciosité : la beauté de sa forme, sa reliure, son gabarit, ses lignes ont été largement pesés, discutés et enfin choisis. Je ne peux oublier que chaque carnet va me tenir compagnie jusqu’à épuisement de lui-même et devenir le confident de mes étonnements face à la sur-réalité dans laquelle je ne vais pas manquer d’entrer. Journal du regard pour l’ethnologue, il est mon troisième œil voué à être archivé dès mon retour jusqu’à… jusqu’à ce que quarante ans plus tard, allez savoir pourquoi, je tire les portes de mon vieux placard en bois où tous mes carnets rassemblés et plus ou moins ficelés, lisiblement datés sur le dos, attendent en pile, à l’imitation de ma cave à vin, que le temps les bonifie. Il suffisait que je me baisse un peu pour les ramasser et les entrouvrir afin de réactiver ma mémoire – et quelle mémoire écrite !
Ma première rencontre
Je notai ainsi dans mon méchant carnet gris plastique, au lundi 5 mai 1980, mon premier rendez-vous professionnel en Amérique du Nord, si je puis dire, en ce qu’il s’agissait de la rencontre avec un ethnologue de Santa Cruz qui m’avait été recommandé par des collègues à Paris. Allan Lonnberg m’avait donné rendez-vous à dix heures du matin au 54 Rigg Street à Santa Cruz, où il vivait en coloc, à deux pas de la station d’essence Bacon, m’avait-il précisé au téléphone. Je m’y rendis à pied. Assis sur les marches d’une belle maison californienne en bois, un grand type blond, les bras appuyés sur ses jambes, de toute évidence attendait. Me voyant, il se déplia et me toisa du haut de ses presque deux mètres : “Pascal ?” “Allan ?” Nos deux “yes” se rencontrèrent. Il était tel qu’on me l’avait dit, peut-être pensa-t-il la même chose de son côté – mais que lui avait-on dit de moi ? Il me proposa immédiatement d’aller prendre un café sur King Street. Là, il me raconta qu’il menait une archéologie locale des Indiens de la région au sein d’une agence. Il me dit la difficulté encore à ce jour de faire comprendre aux Américains qu’avant les Blancs, il y avait déjà des habitants ; les preuves ne manquent pas, mais la ruée vers l’Ouest et la folie qui la déclencha marquent toujours ceux qu’il appelait les “récents arrivants”. Il me recommanda avec insistance le volume 8 du Handbook of North American Indians sur la Californie, qui venait d’être publié en 1978 par la Smithsonian Institution à Washington, estimant qu’avec cet ouvrage j’aurais une vision plutôt juste de ce que furent les Indiens californiens. Je me le procurerais en effet, mieux même, publications peu coûteuses éditées par le gouvernement (Library of Congress), je m’abonnai pour l’ensemble de la collection. Rien moins qu’une vingtaine de volumes de quelque 800 pages chacun que je me fis directement envoyer à Paris et qui, après avoir mis plusieurs années à me rejoindre, servent de socle à ma bibliothèque assez étendue sur les Indiens d’Amérique.
Après un très mauvais café américain – dont nous bûmes une cafetière entière –, c’est autour d’un sandwich au chou accompagné d’un jus de carotte que je fis ripaille avec ce nouvel ami. Je crois qu’il me jaugeait un peu et se demandait jusqu’où pouvait aller mon apparente souplesse ; qualité nécessaire à qui veut devenir ethnologue, notre vie consistant à nous plier pour un temps à des cultures parfois très éloignées de la nôtre sur tous les plans. Après deux heures passées ainsi à chercher des points qui pouvaient nous rassembler, aucun doute, le courant passait, et nous conclûmes qu’il était normal que mes amis soient ses amis et vice versa – surtout sa petite amie qui était pour moi une grande amie ! La confiance instaurée et content de savoir que nous faisions le même métier, je lui dévoilai la raison première de notre rencontre, à savoir que je cherchais à obtenir une recommandation pour pouvoir utiliser les bibliothèques universitaires et leurs ressources, aussi bien à Santa Cruz qu’à Berkeley et ailleurs si besoin. Allan me recommanda sans hésiter un professeur sympa et ouvert de l’université de Santa Cruz, qui enseignait au département d’anthropologie et dont il était certain qu’il me procurerait une attestation correspondant à ma demande. Ça ne traîna pas, sachant qu’il avait cours ce jour même et qu’il serait à la fac, il me conseilla vivement d’y aller sur-le-champ.
Pour me rendre à l’université, le plus simple était de faire du stop, comme beaucoup – tous les étudiants en font et les gens prennent volontiers les jeunes, me précisa Allan. Il me recommanda d’aller au garage Bacon, sur Mission Street à trois blocs de là, et de demander aux clients se ravitaillant s’ils n’allaient pas dans la direction de l’université. Ma première tentative fut la bonne. Une femme me prit sans hésiter une seconde. Plein fait, elle dégagea son sac du siège avant, m’invita à monter et nous partîmes en direction de l’université. Elle y était enseignante et, coup de chance, anthropologue. Très volubile, elle m’expliqua qu’elle travaillait actuellement sur “la sœur des filles-mères” (sic) au sein d’un laboratoire sur les women’s studies – une spécialité qui n’avait pas encore atteint la France. Elle me questionna pour savoir justement où nous en étions dans ce domaine. Sans doute bredouillai-je que ça commençait à peine et avec beaucoup de difficulté dans notre univers encore parfaitement académicomacho malgré… malgré tout. J’aurais aimé pousser la réflexion, mais le trajet fut court et mon vocabulaire me limitait sérieusement pour décrire correctement les années 1970 en France où, entre Le torchon brûle, Sorcières et la vitalité des éditions Des femmes, le féminisme français remuait les consciences en profondeur – en tout cas celles de ma génération. Kathleen, ainsi qu’elle se présenta en même temps que nous nous quittions – preuve de sympathie en Amérique que de sortir de l’anonymat face à une personne inconnue –, m’indiqua le bâtiment où se trouvait le bureau du professeur Tri Loki Pandey que je devais rencontrer.
Dans les couloirs, les portes des enseignants étaient presque toutes ouvertes et souvent recouvertes d’affiches, d’horaires de réception, de mots punaisés, de photos entourant le nom ici gravé en noir sur une plaque vert foncé. Chose incongrue pour moi, le professeur Tri Loki Pandey avait dans son bureau un divan en cuir un peu élimé faisant face à deux fauteuils surchargés de livres et de revues. Au-dessus d’une armoire vitrée et quelque peu ventrue d’imprimés, une série de katchinas semblait veiller sur ce domaine aux tons bois foncé qu’il avait repris ou plutôt conquis certainement de haute et silencieuse lutte dans un monde académique très blanc… Je savais qu’il était spécialiste des Zuni en Arizona, mais sentant qu’il était pressé, je lui dis juste que j’avais été chez les Hopi à Hottavila il y a quelques années. Il leva un œil intéressé souligné d’un “ah” interrogateur, me dit qu’on en reparlerait mais qu’il devait faire cours. Il avait juste le temps de me rédiger une lettre de recommandation comme le lui avait demandé son ami Allan par téléphone. Sur du papier à en-tête, il écrivit à la main “à qui de droit” pour la bibliothèque de Santa Cruz et une autre pour celle de Berkeley où j’irais très certainement. Il s’excusa. Moi plus encore pour l’avoir dérangé, et on promit de se revoir bientôt pour échanger plus avant et aussi plus savant.
Suivant les conseils d’Allan, je me dirigeai vers la sortie du campus pour refaire du stop dans l’autre sens. Je n’étais pas seul mais le jeu était rodé et, après deux ou trois voitures, j’étais pris. Assis dans un petit coupé rouge d’où s’échappait un “run run run” du Velvet Underground à fond qui allait si bien avec le moteur rugissant et son conducteur les mains accrochées au volant, le rythme dans la peau ou plutôt dans les épaules, on quitta l’ucsc et sa jolie devise – “Let there be light (Que la lumière soit)” – en trombe. On passa alors à Spargo, avec son fameux “You and Me”, plus cool mais qui se chantait à deux en décalé. Moi j’ânonnais, lui connaissait vraiment les paroles. “Qué lindas las canciones. Me encanta esta canción, la bailé un millón de veces…” Et nous voilà rendus à la station Bacon. Pas eu besoin de présentations, comme ça roulait tout seul, ça balançait tout seul. J’étais en Amérique ! Un “Ciao” pour brouiller les langues et se quitter comme on s’était connus et, porté dans le courant de cette belle effusion musicale, j’étais à nouveau au pied du 54 Rigg Street.
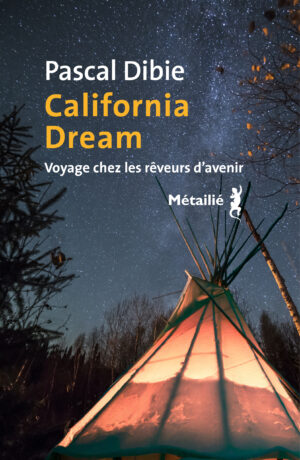





-100x150.jpg)

