À l’université de Leipzig, le professeur Ringeling est vénéré par ses étudiants. En société il est toujours parfaitement poli et correct.
Sa retenue a été forgée dans son adolescence par un père pratiquant une morale catholique répressive et violente. Les châtiments corporels s’enchaînant, d’autant plus que le père a découvert l’orientation sexuelle de son fils qu’il qualifie de sodomite, « un péché mortel ».
Dressé à la résignation, Ringeling vit une existence de déchirement et de refoulement, solidement cachée derrière une façade sociale lisse. Il est guetté par un triple ennemi : son père d’abord, la RDA ensuite, qui voit et sait tout, et saura exploiter sa « petite particularité », enfin la société tout entière. Sous la pression de la Stasi, il trahira.
Et la chute du Mur ne signifiera pas pour lui une libération mais une oppression supplémentaire.
Le récit de cette existence broyée est touchant et l’auteur mêle avec maestria le destin d’un individu et le devenir d’un pays, la RDA.
Un roman impressionnant et fort.
-
"L’œuvre imposante de Christoph Hein fait partie de celles, trop rares, qui passent la frontière allemande pour rejoindre la francophonie et cela depuis trente ans grâce aux Éditions Métailié et à la traductrice Nicole Bary."Boris SenffLa Tribune de Genève et 24 Heures Lausanne
-
"Ancré dans l'histoire du XXe siècle, Désarrois est pourtant d'une grande modernité: l'auteur y évoque même la bisexualité et le polyamour avec un naturel désarmant, mais surtout, il montre que l'apparente ouverture d'esprit de la société contemporaine n'est globalement qu'une fiction." Lire l'article iciThomas MessiasSite Slate
-
"Désarrois est un livre aussi puissant que bouleversant. Un roman-fable qui souligne la difficulté de l’homme à être libre ou simplement lui-même dans un monde bridé par les idéologies et la religion. […] Fort de son style sobre et précis, l’écrivain allemand ferre très vite le lecteur. Christoph Hein brosse un portrait sans complaisance de ses personnages, entre dans leur psyché et nous fait revivre en creux, avec une louable économie de moyens les soubresauts d’une époque, de la fin du nazisme à la chute du mur de Berlin. […] Sous ses allures de roman "vintage" hanté par les fantômes de Robert Musil et de Thomas Mann, Désarrois est un brûlot moderne contre l’intolérance d’une société moraliste et rétrograde qui pousse les hommes et les femmes à s’enfermer dans des prisons à perpétuité quand ils n’arrivent pas à vivre leur différence."Philippe ChevilleyLes Echos
-
Lire l'article iciSite En attendant Nadeau
-
Lire l'article iciLe Soir (Belgique)
-
"Désarrois de Christoph Hein développe un thème moins exploré que d’autres sur la société est-allemande. Sans lyrisme, comme on raconte après coup et de façon assez factuelle une histoire, il déploie la vie empêchée de Friedeward, ses espoirs, son envol, ses illusions perdues. C’est un roman qui baigne aussi dans le culte de la litté rature germanique"Frédérique FanchetteLibération
-
"Un grand roman absolument déchirant qui rend brillamment hommage aux amours sacrifiées."David Lelait-HeloFemme actuelle
Friedeward Ringeling était un original, – et sur ce point même ses amis les plus intimes étaient d’accord – il était un reliquat précieux du monde de nos grands-mères, des calèches, des concerts à domicile, une époque où le mot toilette ne désignait pas un cabinet d’aisance, il ne passait pas inaperçu et suscitait plus ou moins d’admiration.
En toutes circonstances il était correctement vêtu, aucun de ses amis, ils devaient en convenir, ne pouvait se souvenir de l’avoir jamais vu non rasé ou même sans cravate. Même chez lui, personne ne l’avait jamais rencontré en vêtements négligés, même à la maison il portait une cravate manifestement choisie en harmonie avec la couleur de sa veste et ses amis disaient en plaisantant qu’il allait certainement se coucher avec un pyjama digne d’une tenue de ville pour être vêtu de façon convenable en cas d’incendie ou de cambriolage.
Lorsque, en société, il quittait son veston, il sollicitait l’accord des femmes présentes avant de prendre place à table en tenue décontractée. Ce comportement désuet en amusait certaines, d’autres au contraire se sentaient honorées et faisaient l’éloge des manières raffinées de Friedeward à leur partenaire. Mais de temps à autres son comportement déconcertait l’une des convives, car toutes les femmes n’étaient pas habituées aux coutumes héritées des générations précédentes. Sa façon d’être les gênait plutôt, suscitait régulièrement des malentendus que Friedeward et ses amis tentaient de dissiper avec des explications pénibles et lassantes, la plupart du temps en vain.
Mais Friedeward était convaincu que renoncer à certaines règles de bienséance conduisait à une décadence culturelle et pour finir à une régression vers une barbarie antérieure à la civilisation, et pour cette raison, il tenait à elles avec une détermination farouche. Décidé et résolu il s’engageait pour elles partout où il les voyait sacrifiées de façon inconsidérée, et aussi suivies avec négligence. Il lui semblait incomber à la génération des aînés de montrer le bon exemple à leurs cadets, et de les inciter à respecter le bon usage dans leurs relations sociales.
C’était un être d’une grande noblesse. Cette façon de le qualifier tombée en désuétude lui convenait parfaitement. Mais il était aussi un homme en lutte contre son destin et contre lui-même.
Friedeward Ringeling était né six ans jour pour jour avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le 1er septembre 1933, à Heiligenstadt, une petite ville du district de l’Eichsfeld, il était le fils d’un professeur d’anglais et d’une infirmière. Il fréquenta le lycée d’Etat catholique qui peu de temps avant, par décret des autorités nationales-socialistes avait été rebaptisé Ecole supérieure d’Etat, réservée aux seuls garçons. Dans certaines matières comme l’allemand et l’anglais, son père était son professeur.
Pius Ringeling était un vétéran de la Première Guerre mondiale, à dix-sept ans, en janvier 1918, il s’était porté volontaire pour servir dans l’armée allemande et avait été déclaré inapte au service deux mois plus tard, car lors de l’offensive de printemps en mars 1918, et précisément pendant la bataille de Péronne, une petite ville du département de la Somme, il avait été gazé par ses propres camarades alors qu’ils utilisaient de l’anhydride sulfureux, un gaz de combat appelé aussi gaz moutarde.
Après la fin de la guerre, soutenu par l’ancien chef de sa compagnie, il déposa une requête pour obtenir la décoration réservée aux blessés, créée peu de temps auparavant, et il reçut, non pas la croix noire, à laquelle son unique blessure lui donnait droit, mais la croix d’argent, pourtant réservée à ceux qui avaient été blessés cinq fois. Pius, profondément catholique, qui avait après la guerre réussi son habilitation pour enseigner l’allemand, le latin et l’anglais, porta cette médaille chaque jour jusqu’à la fin de sa vie, toutefois sous le revers de son veston pendant les régimes qui suivirent la guerre. Il resta, jusqu’à la fin, monarchiste, méprisant la constitution démocratique de la République, tout autant que les régimes qui suivirent, des nationaux-socialistes et des communistes.
Deux ans avant la fin de la guerre, l’enseignement du latin fut réduit à l’Ecole supérieure de garçons comme dans tout le département, et, complètement supprimé six mois plus tard, si bien que le professeur de lycée Pius Ringeling – ce titre honorifique, il ne le porta que peu de temps, car on ne l’employa plus, lui substituant le terme administratif de Studienrat – acquit une habilitation restreinte pour enseigner la chimie, de façon à conserver un poste à temps complet.
En raison de son invalidité il ne fut pas incorporé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais recruté d’office fin janvier 1945 dans la seconde sélection du Volkssturm et chaque week-end il dut se présenter pour recevoir une formation dans un des bataillons. En mars 1945 les cours furent complètement suspendus, et Pius fut convoqué chaque matin au Volkssturm pour creuser des tranchées et sous la conduite d’un horloger âgé, amputé d’une jambe, remettre en état pour le bataillon les armes saisies par les troupes de la Wehrmacht.
Trois semaines après son incorporation deux envoyés de la police militaire firent leur apparition, ils étaient chargés de débusquer les déserteurs et les planqués. Ils découvrirent que l’amputé, au terme d’un séjour dans un lazaret avait quitté son unité sans autorisation et était rentré chez lui. En raison des compétences acquises au front le maire l’avait nommé chef du groupe de combat local, ce qui n’empêcha nullement la police militaire de l’arrêter et de l’enfermer dans les sous-sols de la mairie. Pius Ringeling exhorta ses camarades du Volkssturm à se rendre avec lui à la mairie pour exiger la mise en liberté de l’horloger ; sans lui ils étaient tout simplement incapables de remettre en état les armes saisies. Cette action aboutit à l’arrestation immédiate de Ringeling, car le maire n’osa pas remettre l’horloger en liberté, et chercha de l’aide auprès de la police militaire qui vit en Ringeling le meneur, l’arrêta et l’enferma aussi au cachot. Cependant la police militaire se volatilisa pendant la nuit, car la contre-offensive de la Wehrmacht près de Struth avait échoué provoquant de grosses pertes, et les soldats dispersés des différentes unités participant au combat fuyaient en débandade, contrairement aux ordres. Pour cette raison le maire décida de libérer les deux prisonniers et de les renvoyer dans leur unité, non sans avoir auparavant rédigé un compte-rendu des plus détaillé des faits.
Dans la période d’après-guerre Pius Ringeling reçut l’autorisation de continuer à enseigner, car les collègues et les voisins purent attester de son opposition au national-socialisme auprès des nouvelles autorités scolaires, et les dossiers archivés à la mairie parlèrent également en ce sens. Il est vrai que sa religion et sa foi ouvertement affichée hérissaient les nouveaux responsables de l’enseignement, mais comme on avait un besoin urgent d’enseignants non compromis avec les nazis, comme la majorité de la population du district de Eichsfeld était catholique, et donc aussi les enseignants de formation universitaire, la direction pédagogique accepta aussi le croyant Pius Ringeling, tout en l’avertissant par écrit, qu’il devait s’abstenir de toute propagande religieuse, sinon il serait immédiatement renvoyé. Comme il manquait des enseignants dans toutes les écoles, la direction pédagogique du district lui accorda sans autre forme de procès l’habilitation pour la chimie et, donc l’autorisation d’enseigner cette matière aussi dans les classes préparant au baccalauréat.
Lors de sa réouverture le lycée avait été hébergé dans un bâtiment provisoire, car l’Armée rouge occupait l’ensemble des locaux scolaires où elle avait établi un camp de transit pour les centaines de milliers de prisonniers de guerre libérés et pour les réfugiés. Pius Ringeling s’abstint, comme on le lui avait ordonné, d’aborder tout thème religieux dans ses cours. Comme les enseignants âgés, de formation universitaire, étaient croyants, et les nouveaux maîtres qui, recrutés dans des métiers sans rapport avec l’enseignement, avaient reçu en quelques mois les rudiments des matières à enseigner, s’avéraient être des athées radicaux et conscients de leur devoir, on évitait aussi d’aborder des sujets indésirables même dans la salle des professeurs, mais on continuait à fréquenter les offices religieux comme d’habitude, on vivait sa foi librement.
Le professeur certifié Pius Ringeling était un homme aux principes solides et non seulement ses élèves devaient s’y conformer, mais aussi sa famille ; il aimait à désigner ses règles de vie sévères comme un « commandement moral ». Sa femme et ses trois enfants – deux fils et une fille – devaient s’y conformer, à savoir, disait-il, où était leur place. La mère de Friedeward enseignait aux futures sages-femmes à l’école d’infirmières de l’hôpital local et chantait dans les deux chorales de l’église. C’était une femme vigoureuse et déterminée qui n’avait pas sa langue dans sa poche et savait s’imposer auprès des collègues et des patients, et pourtant à la maison elle se soumettait à son mari sans se plaindre. Elle ne le contredisait jamais, ne s’opposait pas non plus à lui lorsqu’il s’en prenait aux enfants avec une trop grande dureté.
Pour Pius Ringeling le dressage corporel était l’élément nécessaire d’une pédagogie bourgeoise, la seule capable de former des adolescents à la vie, sans ces principes on ne pouvait pas implanter dans la génération suivante le civisme, l’ambition, la volonté de réussir, encore moins les fixer durablement. Il punissait son aînée, une fille prénommée Magdalena, en lui donnait une claque sur les fesses ou un coup sur la tête. Au cours de ses premières années d’exercice, et jusqu’à ce qu’après la fin de la Seconde guerre mondiale les lois sur l’enseignement du nouveau gouvernement interdisent strictement dans les écoles est-allemandes toute forme de châtiment corporel, il avait eu recours avec prédilection à ce genre de punition. Devant ses collègues Pius Ringeling qualifiait cette interdiction de fiasco pédagogique, ordonné par des bureaucrates qui ne comprenaient rien à la pédagogie, en particulier à la manière d’éduquer des jeunes gens, et ignoraient tout d’une journée scolaire. Chez lui et entre amis, il parlait d’idiotie communiste, d’un décret absolument criminel et prophétisait un naufrage imminent au second Etat allemand qui n’en était encore qu’à sa fondation. En fin de compte, on ne pouvait pas bâtir un Etat avec des enfants qui ne connaissaient pas le châtiment et étaient en conséquence mal élevés.
En classe il ne recourut désormais qu’à des mesures compatibles d’après lui avec les nouveaux règlements scolaires. C’est ainsi qu’il avait l’habitude d’attraper les élèves récalcitrants ou indisciplinés par l’oreille ou par les cheveux, ce que les garçons et les filles ressentaient comme une punition tout à fait douloureuse, mais n’était pour Pius Ringeling rien d’autre qu’un avertissement affectueux. Tout au long de sa carrière, il n’eut plus à craindre que les parents se plaignent car, à Heiligenstatd, ils trouvaient presque tous l’interdiction, annoncée en grande pompe des punitions corporelles à l’école, tout aussi absurde que lui-même. Ils étaient majoritairement d’avis qu’une tape donnée à un enfant au bon moment n’avait jamais nui et qu’un avertissement indolore ôtait aux maîtres et aux parents la possibilité de faire de leurs gamins des êtres convenables.
Tandis que Pius se contentait de punitions légères pour sa fille Magdalena, les châtiments pour ses deux garçons, le cadet Hartwig et le benjamin Friedeward, étaient plus durs. Ils étaient dressés à coups de fouet, de martinet, ce court manche en bois auquel étaient fixées sept lanières de cuir de quatre-vingts centimètres chacune. Le fouet n’était pas seulement le moyen adéquat pour éduquer, ce châtiment jouissait aussi d’une reconnaissance absolue dans la bourgeoisie de la classe moyenne. Les couches sociales plus humbles et plus pauvres recouraient pour dresser leurs enfants à la baguette de saule ou à tout autre objet approprié.
Une fois le châtiment infligé, les enfants de Pius devaient se placer devant lui et répondre à chaque fois à la même question : pour qui la punition avait-elle été la plus douloureuse ? Pleurant à chaudes larmes ou complètement muet, mais le visage ravagé de douleur, l’enfant parvenait à articuler les mots qu’on attendait de lui : Pour toi, mon cher père, pour toi.
Pius Ringeling était aussi respecté que redouté de ses élèves. Ils reconnaissaient, il est vrai, sa vaste culture, mais ils le haïssaient à cause de sa brutalité. Tous savaient dans la cour de l’école qu’il brisait ses propres enfants à coups de martinet, car Hartwig le racontait ouvertement. Pour Friedeward les questions de ses camarades d’école sur le sujet étaient plutôt désagréables. Mais Hartwig ne parlait pas seulement de la torture avec une grande liberté, il en parlait même volontiers, car depuis des mois, il s’employait à modifier le martinet. A peu près une fois par mois, quand les parents s’absentaient pour longtemps, il le prenait et raccourcissait les lanières de cuir de quelques millimètres à l’aide du rasoir paternel. Il taillait les sept lanières de façon identique, pour ensuite rendre leur aspect initial à l’extrémité des lanières à l’aide de salive et d’un reste de cendres du fourneau de la cuisine.
Friedeward était horrifié par l’entreprise de son frère aîné et le suppliait à chaque fois d’arrêter. Il redoutait que leur père découvre un jour ou l’autre ses agissements et que s’abatte alors sur eux deux un orage terrible et une rencontre en bonne et due forme avec le fouet. Cependant il n’aurait jamais osé trahir son frère, Hartwig l’avait menacé, si c’était le cas, d’une punition bien plus dure, en comparaison de laquelle les coups du martinet n’était qu’une joyeuse partie de glissades.
En fait il n’avait pas échappé à Pius qu’on avait trafiqué son fouet. A peu près six mois après que Hartwig avait commencé ses manipulations, Pius convoqua ses deux fils dans son bureau et les pria de prendre place autour de la table à laquelle il recevait ses visiteurs. Le martinet tant redouté, accroché d’ordinaire au-dessus d’une photo en noir et blanc de Pius en uniforme, était posé sur la table, à côté du cendrier en fonte. Pius se plaça derrière ses deux fils et leur demanda s’ils n’avaient pas quelque chose à lui dire. Ils se turent tous les deux, Hartwig, avec une obstination provocante, Friedeward tendu par l’angoisse. Alors le père empoigna les deux garçons au collet et les secoua.
Je pense que vous avez quelque chose à me dire.
Ils continuèrent de se taire. Le père desserra sa pression, finit par les lâcher et s’assit à son bureau. Il eut un sourire méchant.
C’est bon, alors c’est moi qui ai quelque chose à vous dire. Les lanières de cuir ne mesurent plus que soixante et onze centimètres, il manque donc neuf centimètres qui ont été victimes de votre rage destructrice. Je l’ai très bien remarqué, depuis le début. Espèce d’idiots, vous n’avez pas été attentifs au cours de physique. Que provoque un fouet plus court ? Alors ? Je vais vous le dire : les coups deviennent plus rapides et plus douloureux. Et si vous continuez à vous en prendre à mon martinet, un jour vous allez faire connaissance avec le manche en bois. Je vais bien réussir à vous faire passer l’envie de faire des bêtises. Réjouissez-vous déjà en pensant à la prochaine raclée. Et maintenant dehors !
Deux ans après la fin de la guerre, les deux aînés quittèrent la maison familiale. Magdalena avait terminé ses études d’infirmière avec succès et elle épousa en mai Karl Lehmann, un commerçant de retour de captivité qui avait perdu trois doigts de la main droite en combattant au front. Il avait douze ans de plus que Magdalena, dirigeait la librairie-papeterie de son défunt père et avait perdu sa première femme à la naissance de sa fille. Au début il s’était occupé du nouveau-né avec l’aide de sa mère et de sa belle-mère, mais ensuite, en octobre 1943, sa dispense d’incorporation avait été suspendue et après trois semaines de formation militaire il avait été envoyé dans le Groupe d’armées du Nord sur le front de l’Est. La fillette resta sous la garde de ses grands-mères.
Karl était au front depuis trois jours lorsque les éclats d’une grenade à fragmentation lui arrachèrent trois doigts. Il fut envoyé dans un lazaret de campagne en Courlande, et deux mois plus tard, renvoyé dans son unité, bien que, blessé de guerre, il ne pût même pas être employé aux écritures. En mars son unité qui faisait partie du Groupe des Armées de Courlande fut encerclée par une division blindée de l’Armée rouge. On capitula sans combattre et les soldats allemands furent acheminés vers le camp de prisonniers 317 à Riga. A l’hôpital du camp on lui façonna une prothèse de la main, un crochet en fonte qu’il pouvait fixer à l’aide d’un brassard en étoffe. A cause de sa blessure de guerre il ne fut que partiellement apte au travail au camp et on le libéra au bout de huit mois.
A la fin de l’année 1945, quatre jours avant Noël, il retrouva à Worbis sa mère et Gundula, sa fillette de deux ans. La première semaine de janvier il reçut de la mairie l’autorisation de reprendre son commerce de librairie-papeterie et le dernier lundi du même mois il put rouvrir son magasin. En plus des livres brochés autorisés par l’administration militaire, il proposait des cahiers, des imprimés, des stylos et des crayons provenant de ses anciens stocks dont il s’était scrupuleusement assuré qu’ils ne présentaient pas d’emblèmes ni de marques du régime nazi disparu.
En juin il fit la connaissance de Magdalena qui n’avait que dix-sept ans, lorsque, au terme d’un séjour de trois semaines à l’hôpital universitaire de Göttingen où on lui avait placé une nouvelle prothèse de la main plus adaptée, ce fut cette infirmière, en dernière année d’études, qui le soigna et s’occupa de sa rééducation à l’hôpital de Heiligenstadt. Ils se plurent. Karl Lehmann admirait la façon sérieuse et décidée de la jeune fille qui savait s’occuper des patients douillets et têtus, et la façon tout aussi amicale que résolue dont elle s’assurait que tous se conformaient aux décisions des médecins. De son côté Magdalena était impressionnée par la façon dont Karl Lehmann acceptait son destin, serein et résigné, dont il s’interdisait toute pitié, car d’autres camarades de son unité avaient été bien plus sévèrement blessés que lui, ou même n’avaient pas survécu.
Lehmann venait chaque semaine à Heiligenstadt pour rencontrer Magdalena qui une fois par mois leur rendait visite à Worbis, à lui et à sa fillette. Gundula avait eu du mal à accepter comme père l’homme de retour de la guerre et de captivité et à l’aimer sans réserve, elle était habituée à ses grands-mères et l’infirme au crochet de fer lui fit longtemps peur. Mais elle fit immédiatement une place dans son cœur à Magdalena et ne la quittait pas d’une semelle quand la jeune femme leur rendait visite. Et ce fut la fillette âgée de trois ans qui parla de mariage pour la première fois. Elle n’arrêtait pas de susurrer à son père et à Magdalena qu’elle voulait à cette occasion répandre des fleurs sur le sol et l’enfant savourait la confusion qu’elle suscitait chez les adultes.
Un jour Karl répondit à sa fille : c’est à Magdalena que tu dois poser la question. Moi, je l’épouserais immédiatement. Le plus tôt possible. Mais peut-être suis-je trop vieux pour elle, ou bien veut-elle un mari avec deux mains valides.
Magdalena secoua énergiquement la tête, dit qu’elle aimait Karl et Gundula, mais elle venait seulement d’avoir dix-huit ans, et se sentait trop jeune pour se lier pour toujours.
Je ne veux pas d’une vieille maman, déclara Gundula, quand tu auras cent ans, tu pourras être ma grand-mère, et des grands-mères j’en ai déjà deux.
Ils se marièrent un an plus tard. Magdalena ne savait pas si elle aimait réellement Karl, si elle voulait passer toute sa vie à ses côtés et elle était angoissée à l’idée de devenir la belle-mère d’une fillette de quinze ans plus jeune qu’elle. Mais elle voulait, elle devait quitter la maison paternelle, elle voulait son indépendance, elle ne voulait pas continuer, comme sa mère et ses frères, à être exposée chaque jour aux principes de son père, à devoir supporter sa sévérité autoritaire et sa violence. Et elle avait encore une raison de vouloir épouser Karl : il ne frappait jamais son enfant, car pour lui Gundula était un ange, il s’exprimait ainsi, et il ne voulait pas s’exposer à la damnation éternelle pour avoir levé la main sur un ange.
Une semaine après le départ de Magdalena, Hartwig disparut à son tour. Il avait seize ans lorsqu’il quitta en cachette la maison de ses parents avec toutes ses affaires. Il choisit le moment de sa fuite avec circonspection, et partit pendant les vacances scolaires, alors que son père se trouvait avec d’autres pédagogues de Thuringe à Weimar, l’ancienne capitale du Land, pour y suivre une formation. Il raconta à sa mère qu’il voulait rendre visite à sa sœur à Worbis. Trois jours plus tard elle reçut une lettre dans laquelle il lui annonçait qu’il s’était enrôlé à Hambourg sur un cargo frigorifique avec lequel il partait pour les Etats-Unis avec l’intention de s’y établir. Dans un postscriptum il faisait remarquer que sur le bateau il n’y avait pas de martinet et que les châtiments corporels avaient été abolis cent ans plus tôt.
Lorsque le père de Hartwig rentra de Weimar, sa mère affolée, complètement bouleversée, lui donna la lettre alors qu’il était encore sur le pas de la porte. Au milieu de ses larmes, elle lui avoua qu’elle avait le sentiment d’avoir perdu, après Magdalena, le deuxième de ses enfants. Elle comprenait son fils, comprenait pourquoi Hartwig s’était enfui de la maison paternelle. Pour elle aussi les heures passées en dehors de la maison étaient les plus heureuses. Elle attendait avec impatience les répétitions de la chorale, les conversations qu’elle pouvait y avoir avec ses meilleures amies, et toute l’année elle se réjouissait en pensant au séminaire que le Cantor organisait chaque année dans un lieu différent pendant une semaine. Elle passait huit jours avec les choristes dans un coin perdu, dans un couvent, dans un vieux château transformé en hôtel, ou une auberge de jeunesse. C’était cette unique semaine qui lui donnait la force de supporter le reste de l’année aux côtés de son mari.
Mais Pius Ringeling se contenta de faire une moue méprisante, roula en boule la lettre qu’il jeta à la corbeille en disant : Tiens donc ! Il n’appréciait pas le martinet !
Il se refusa à prononcer une parole supplémentaire sur Hartwig. A chaque fois que sa femme parlait de lui, il gardait un silence agacé ou quittait la pièce. A l’école, il annonça que son fils était parti à Berlin où il continuerait sa scolarité. Ni sa femme, ni lui ne cherchèrent à retrouver Hartwig, ils ne se demandèrent pas non plus s’il avait réellement émigré. Aux autorités ils dirent que leur fils les avait quittés, fâché, et que jusqu’ici il n’avait pas donné de nouvelles, en espérant qu’on ne leur poserait pas de questions supplémentaires, car quitter sans raison valable et sans autorisation la zone d’occupation n’était pas souhaité et ils étaient soucieux de ne pas éveiller des soupçons inutiles.
Friedeward, alors âgé de quatorze ans, fut très peiné du mariage de Magdalena et de son installation à Worbis ainsi que de la disparition de Hartwig, ses frère et sœur aînés lui manquaient. Il était désormais le seul enfant à la maison et se sentait constamment contrôlé, surveillé. L’attention des parents se concentra effectivement davantage sur leur benjamin, d’autant plus que son père supposait qu’il avait été au courant des projets de son frère, ou nourrissait en secret l’idée de se sauver lui aussi. Comme Friedeward n’échappait à la surveillance de son père ni à la maison, ni à l’école – il était son professeur d’allemand et d’anglais – il se sentait constamment sous pression. La peur de son père qui ne le quittait jamais, l’empêchait de respirer. A la différence de son frère, il n’osait pas penser à s’enfuir. Nulle part au monde il n’échapperait à la dure emprise de son père, partout son regard méprisant le poursuivrait, le rappellerait à l’ordre, le punirait. La seule chose qui permettait à Friedeward de se révolter, oui, d’oser, était son souhait le plus cher exprimé chaque soir dans sa prière au Seigneur : que son père meure enfin !
Pius Ringeling continuait d’utiliser le martinet dans l’éducation de son fils. Au moins une fois par trimestre il fouettait Friedeward et le sommait ensuite de lui assurer que c’était son père qui souffrait le plus de la punition. Friedeward devint prisonnier d’un cercle vicieux : la peur du martinet le paralysait, il lui semblait de plus en plus difficile de se concentrer à l’école sur les cours, ce qui lui valait des blâmes et des mauvaises notes. A la maison il faisait preuve d’obstination – bien qu’inconsciemment – ce qui provoquait son père et l’incitait à le punir une fois de plus. Chaque nuit avant de s’endormir il répétait à mi-voix sa prière, que Dieu fasse mourir mon père, bien qu’il sût que Dieu ne l’exaucerait pas, et que c’était un péché, même un péché mortel dont il aurait dû demander pardon.
Il avait quinze ans lorsqu’il se rebella pour la première fois et contredit son père. Un vendredi de novembre, son père lui avait à nouveau infligé des coups de fouet. Il avait supporté la torture, les dents serrées et sans verser la moindre larme, et lorsque son père après le dernier coup replaça le martinet contre le mur derrière son bureau et posa la question d’usage à son fils, Friedeward le regarda en lui disant : Moi, mon cher père, moi. Seulement moi.
Il fallut un moment à Pius Ringeling pour comprendre les paroles de Friedeward. Il fixa son fils, cligna des yeux jusqu’à qu’ils ne soient plus que deux fentes étroites et d’un geste rapide décrocha le fouet du clou, fit un pas en direction du garçon. Mais ensuite il arrêta son geste.
Tu as peut-être raison, dit-il, tu es peut-être devenu tellement raisonnable que nous pouvons désormais nous passer de cet instrument pédagogique. Qu’en penses-tu ?
D’un signe de tête Friedeward approuva vivement.
Bien, dit son père, essayons.
Il ouvrit la porte de droite de sa table de travail, tira le tiroir du bas, enroula les lanières de cuir autour du manche de bois et fourra le martinet dans le tiroir. Il le poussa tout au fond.
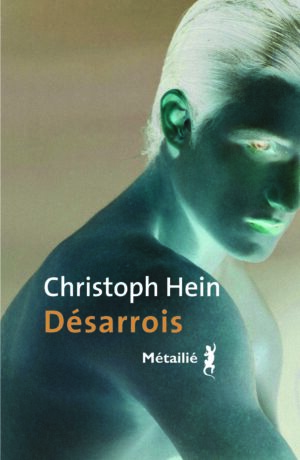

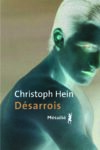



-100x150.jpg)






