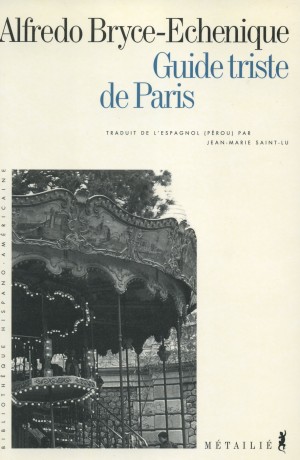« Il y a des guides pratiques, des bons, des mauvais, mais que je sache il
n’y a pas de guides tristes, et encore moins de Paris. »
Alfredo Bryce-Echenique
Pourquoi triste? Il désirait un titre pour dire que le Paris où il avait vécu, le Paris des années 70 n’existait plus, ce Paris tant aimé qu’il trouve maintenant refroidi.
« je montre ce qu’il ne faut pas faire dans cette ville: se croire plus savant, plus rapide, plus malin qu’elle, parce que Paris ne vous rate pas, c’est ce que vivent mes personnages. »
Dans ces histoires, A. Bryce-Echenique supprime simplement les barrières entre ce qui a été, ce qui aurait pu être et ce qui a dû être. Il le fait avec un naturel parfait car il laisse toujours « l’imagination entrer et circuler où elle en a envie, dans toutes les circonstances, à tout moment, même en dormant. »
Des histoires qui toutes portent la marque d’un écrivain qui a fait de l’amour et de l’amitié le centre de sa vie.
-
5 Raisons d'être aussi parisien qu'Alfredo Bryce-Echenique 1.Comment faire autrement ? On était évidemment tombé en pâmoison devant l'écrivain péruvien Alfredo Bryce-Echenique lorsqu'il avait publié un roman intitulé Noctambulisme aggravé, en 1999. Pas le choix. 2.Son nouveau livre est un Guide triste de Paris (Métailié). On se dit qu'on va avoir affaire à la jolie déambulation mélancolique d'un exilé dans les faubourgs de Paris by night. 3.Rien de tel: il s'agit d'un recueil de nouvelles et d'articles de journaux n'ayant parfois qu'un lien approximatif avec la Ville lumière. Inutile d'y chercher les bonnes adresses saturniennes de la capitale (sauf "l'Escale" du 15, rue Monsieur-le-Prince, et le bois de Boulogne, merci bien) 4. Malgré la publicité mensongère, on est heureux de retrouver le Don Quichotte de Lima aux prises avec ses obsessions usuelles : le ridicule des latin lovers (en vérité "machos caducs et lamentables"), leur mal du pays, leur optimisme alcoolisé, leurs déceptions aussi cruelles que les riches femmes françaises... 5.Un texte, Lola Beltran in concert, est un chef d'œuvre, la plus belle nouvelles que j'ai lue cette année (comme du grand John Fante). Conclusion : les écrivains parisiens feraient mieux d'être plus souvent péruviens !Frédéric BeigbederVOICI
-
"La Ville lumière telle qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à travers le regard tendre, triste mais plein d'humour d'un exilé péruvien. Telle est la balade à laquelle nous convie Afredo Bryce-Echenique. Dans les années 60 et 70, pour un Latino-Américain fauché qui a fondé son existence sur l'amour et l'amitié, Paris est la ville de tous les possibles mais aussi de toutes les désillusions. A preuve Roberto : il s'éteint dans un hôpital niçois en murmurant le prénom de la jolie Françoise qui a ensoleillé sa jeunesse mais qu'il n'a su garder. Quant à M. Ojeda, Péruvien noir de cent treize ans, seuls les souvenirs croisés de la si parfaite Mme Salomon et de la fragile Debbie le maintiennent encore en vie. Le Paris de ces années mortes a autant donné que pris à ces personnages de même qu'à leur auteur - dont les éditions Métailié rééditent parallèlement le fabuleux premier roman Un monde pour Julius. Il leur a appris à rêver, à aimer, à souffrir et à observer. Ainsi de Juan, le cœur à gauche -comme "tous les Latino-Américains" de Paris - qui apprend néanmoins d'un ami " Politisé à l'excès " ce que chaque être humain devrait prendre pour devise : "Il est mauvais de croire à outrance à une idée, surtout quand on n'en a qu'une !"Alexie LorcaLIRE
-
"Le Guide triste de Paris rassemble quatorze histoires ou portraits, individuels ou de groupes, évoquant la ville de ces émigrants, personnages de sa jeunesse ou inventions de sa vieillesse. Il y a un peintre méconnu dont les os se brisent car il ne mange pas, préférant "dormir ses repas". Il y a un couple qui manque de rompre à cause d'un chat noir. Il y a l'homme qui "passe sa vie à essayer d'être quelque chose ou quelqu'un qu'il ne serait jamais", écrivain, puis Che Guevara, puis supporter du PSG, ce qui est une belle fin. [...]En évoquant Paris, il garde la simplicité, et sans doute le souvenir de Vallejo, mourant seul, sans argent, sans rien, comme un jeune homme. Celui-ci écrivait : " Je mourrai à Paris sous l'averse,/ un jour dont j'ai déjà le souvenir./ Je mourrai à Paris/ et je ne m'avance pas/ peut-être un jeudi, comme aujourd'hui, en automne. " Il meurt bien à Paris, mais un vendredi saint, le 15 avril 1938. Aragon l'enterre à Montrouge. Ses cendres sont transférées eu cimetière du Montparnasse en 1970 : à l'époque où Bryce-Echenique profite du Paris qu'il va, trente ans plus tard, réinventer.Philippe LançonLIBERATION
-
"Nouveau Louis Sébastien Mercier, Bryce-Echenique évoque, dans son " Guide triste de Paris ", les séducteurs sans femmes et les romanciers sans romans, les rues à crottes de chien et les immeubles à concierges terrorisantes. Dans sa mémoire en forme de plan du métropolitain, il descend à la station Gaétan-Picon, le grand critique qui habitait boulevard de Port-Royal, et donnait ses conférences avant d'aller monter à cheval. Il cite Michel Constantin et " la Fiancée du pirate ", le grand film de 1968, Reggiani, Brassens et Petrucciani. Il boit sans fin, au goulot du souvenir, les beautés du Paris évanoui.Didier JacobLE NOUVEL OBSERVATEUR
-
« Bryce-Echenique est un déraciné volontaire, un révolté plein d'humour [...] dans l'exaltation, la passion, la dérision et, au fond, la douleur. [...] Chez lui, comme chez Chaplin ou chez Buster Keaton, la tragédie parvient à nous faire rire. Aux larmes. »Michèle GazierTELERAMA
Machos caducs et lamentables
À Micheline et Jean-Marie Saint-Lu
Le père de
Remigio González lui avait dit, quand il lui avait fait ses adieux, là-bas, dans sa Lima natale, de ne pas faire de bêtises à Paris, de tirer un énorme profit de sa bourse pour étudier le coopératisme et, surtout, attention, hein, vraiment, attention à ne pas choper de gonorrhée en hiver. « Mon fils », avait conclu son père en lui parlant d’homme à homme et en le prenant dans ses bras, mi-paternel et mi-brutal, et même larmoyant car les hommes pleurent eux aussi, devant la porte d’embarquement numéro 5 de l’aéroport de Lima. « N’oublie pas, mon cher petit, enfant de mon cœur, que je suis la voix de l’expérience et que j’ai moi aussi vécu mon Paris de célibataire, dans les années 25. Et crois-moi, un hiver à Paris, c’est du sérieux, et avec une gonorrhée, ça devient quelque chose de tout à fait mortel. Et rappelle-toi que même quand c’est une sacrée pute de belle fille (sauf le respect de madame ta mère ici présente), au fond de son âme une petite Française n’est jamais qu’une
p… Et n’oublie jamais que la plus belle nana du Quartier latin a fini dans la peau d’une madame
Yvonne, à Buenos Aires, à ce que chante un tango de l’immortel Carlitos Gardel, qui en savait presque autant que Dieu sur les petites Françaises, parce qu’en plus il est né
à Toulouse, en France. Avec toutes, mon petit, déception et gonorrhée assurées. Et elles sont toutes, ce qui s’appelle toutes, comme cette Brigitte Bardot, hein, mignon petit accent et corps de rêve et à croquer, mais plutôt que la BB c’est la PP qu’il faudrait l’appeler. »
Après quoi le père de Remigio Gonzalez avait cédé la parole, la dernière étreinte, le baiser prolongé à en pleurer et les pleurs à n’en plus finir, à ta sainte mère ici présente, qui devant la porte d’embarquement et le dernier appel numéro 5 de l’aéroport de Lima n’avait réussi qu’à se déchirer encore plus, mais en parvenant malgré tout à exhaler un pitoyable et dernier soupir de Liménienne. Ce dernier consista en la promesse éternelle de porter l’habit violet du Seigneur des Miracles, tous les mois d’octobre, parce que c’était en octobre que partait son petit enfant chéri, et parce que le Seigneur des Miracles n’abandonnait jamais personne et que c’était aussi le Seigneur Christ brun, le patron de la ville de Lima, mon petit enfant de mon cœur, au revoir, au revoir mon petit, au revoir.
Il soufflait des vents d’automne de 1964 et de Charles Aznavour chantant La Bohème et Que c’est triste Venise, quand parmi plusieurs dizaines de Latino-Américains des deux sexes et offrant le plus large éventail de spécimens question allure (métis courts sur pattes, multiformes et tout-terrain, mulâtres joyeux au début, mais qui se révélaient les plus nuls ensuite pour supporter des hivers de repas sans nourriture relevée et l’éloignement sans rythmes du pays, une minorité noire, à la fois sereine, très vice-royauté et tout à fait à sa place, à savoir tout juste au-dessus de l’Indien, aucun Indien de m…, un rouquin digne de ce nom, des aryens suspects et un véritable millionnaire, qui voulait commencer à zéro, comme avait commencé son père), Remigio González prit pour la première fois sa place dans la queue de l’immeuble du Châtelet où filles et garçons
espagnols et latino-américains touchaient tous les mois leur bourse du gouvernement français.
Le vrai rouquin, c’était lui. Et il était si grand et si roux et si costaud qu’il n’avait pratiquement pas l’air d’un
Latino Américain mais d’un acteur d’Hollywood type années 50 interprétant le rôle de Un Américain à Paris. Mais non, allons donc. En dépit de la gonorrhée mortelle de son père et de l’habit d’un violet déchirant de madame sa mère, du tréfonds de ses entrailles Remigio González se montra le grand séducteur made in Pérou qu’il était, tout à fait années 60, c’est-à-dire quasiment
XIXe siècle, au moment précis où il arriva au guichet des paiements et où la fonctionnaire de service – qui n’était pas mal du tout pour une fonctionnaire de service et parce que en temps de guerre le moindre trou fait tranchée et La
Bohème, la bohème… de Charles Aznavour -, pour pouvoir localiser l’enveloppe contenant ses misérables quatre cent quatre-vingts francs mensuels, lui demanda son nom, sa nationalité et la spécialité universitaire qui l’avait amené en France. Ressentant et fredonnant la fierté et le bonheur d’être péruvien, d’être né dans ce beau pays du soleil, où l’Inca indompté, préférant la mort, légua à ma race le grand héritage de son courage, et cetera, et avec son meilleur esprit de footballeur péruvien revêtu du maillot national dans un stade étranger, Remigio González enduisit sa voix de miel d’abeille et de nectar des dieux, et se
présenta :
– La bohème, la bohème, mamasel mamacita. My name is Rémi, mais seulement pour toi, je suis made in Pérou, de la tête aux pieds, et ma spécialité dans le savoir est celle de latin lover, mais latin, en plus, ce qui est, comme qui dirait, une première valeur ajoutée…
Et il allait en ajouter encore, beaucoup plus, l’ineffable, caduc et lamentable Remigio González, il allait lui demander à quelle heure elle finissait, mamasel mamacita, quand la fonctionnaire lui déchira au nez l’enveloppe contenant ses
quatre cent quatre-vingts francs de son âme et de son mois, elle la déchira en criant, par-dessus le marché, en appelant son chef et celui-ci la police, à toutes fins utiles, pendant que dans la queue les Espagnols devenaient furieux parce que ça suffisait comme ça de poireauter à cause de ce rouquin de
putain.
Parmi les Latino-Américains, en revanche, naquit à l’unisson la plus joyeuse des solidarités anti-Remigio González quand une Panaméenne décontractée, pas mal du tout et plus que pas mal dans sa peau, cria, pleine d’une autorité de leader: « Que le suivant touche son enveloppe et vive le mambo de Pérez Prado. Et vous, l’ami made in Pérou, tout ce que vous allez trouver ce mois-ci pour dormir et pour manger c’est un quai de la Seine by night, alors attention aux clochards, hein, parce qu’il y en a aussi qui sont de l’autre trottoir ! » Sûr que Simon Bolívar lui-même aurait profité de ce moment de totale concorde latino-américaine pour créer un grand État fort et uni au sud du Rio Grande.
« Saravia », pensai-je, le moins bolivariennement possible et profondément triste en observant l’allure honteuse et solitaire, tête basse, avec laquelle Remigio González sortait de l’immeuble du Châtelet. « Saravia », me répétai-je en quittant aussitôt ma place dans la queue pour rejoindre le rouquin le plus défait que j’aie vu de ma vie, et ce jusqu’à aujourd’hui.
Mais il y a des gens qui jusqu’à la mort sont comme Remigio González, voilà ce que j’appris à cette occasion, quand en m’approchant de lui et en me présentant je pus constater l’existence réelle d’individus qui, pour dire ça comme ça, grandissent dans l’adversité quand ils se trouvent en face d’un plus grand imbécile qu’eux. Non seulement Remigio González me laissa avec ma main tendue mais il lança un crachat qui frôla ma chaussure, oublia complètement et à tout jamais qu’il venait de se conduire comme un imbécile et, récupérant la totalité de son mètre quatre-vingt-cinq
et la rouge splendeur de ses cheveux gominés, il traversa la rue comme quelqu’un qui traverserait un bal liménien très 1960 pour tomber une petite nana rien que par sa façon de marcher vers elle et de la regarder, et partit pour un million de conquêtes amoureuses.
Je rentrai dans l’immeuble et je m’apprêtais à me mettre au bout de la queue quand je fus hélé par un Espagnol qui me dit qu’il m’avait gardé ma place, devant lui, dans ladite queue.
– Je m’appelle Ramón Torres, me dit-il, et je viens de Madrid pour faire des études de sociologie. Je dois t’avouer que ça fait un bon moment que je t’observe et que tu es le seul ici qui n’ait pas passé son temps à regarder le cul des femmes. Comment t’appelles-tu ?
Saravia… Juan Carlos Saravia… Merci beaucoup de
m’avoir gardé ma place.
De rien, vieux… Péruvien ?
De Lima, oui. Je suis venu étudier la littérature française.
Ramón Torres
fut mon premier ami à Paris. Et ce fut aussi mon maître. Et bien que le type se soit politisé à l’excès avec le temps et n’ait plus vécu que pour sa cause, il fit toujours une souriante exception pour moi, comme si mon échec avec ce crétin de Remigio
González avait ouvert une petite brèche dans le cœur de béton qui régnait à l’intérieur de la gauche de cette époque. Je fais allusion, bien sûr, aux hispanophones, aux Espagnols, et surtout aux Latino-Américains. Mêlé à eux, et en même temps sans jamais me sentir mêlé à quoi que ce soit, j’appris que c’étaient des gens dangereux, pour une raison fondamentale: il est mauvais de croire à outrance à une idée, surtout quand on n’en a qu’une.
Bref, comme l’hebdomadaire que nous lisions tous en ce temps-là, je me découvris bien vite converti en une espèce de nouvel observateur, souvent condamné à des échecs comme
celui que j’avais connu simplement pour avoir pris Remigio
González en pitié. Et alors j’avais l’air d’un amateur de corrida qui, juste quand le travail du matador est à son apothéose, découvre qu’il manque un point de piqûre à la rouge et grave muleta de ce dernier et qu’en revanche sa cape est d’une joyeuse et belle perfection qui lui permet d’exercer pleinement la personnification de son art, c’est-à-dire ce que Joselito a appelé le style et qui selon lui n’était pas autre chose que la grâce avec laquelle on vient au monde.
Pour toutes ces raisons, je peux dire aujourd’hui qu’il manqua toujours un point de piqûre à l’ineffable matador de petites nanas parisiennes qu’était Remigio González et que jamais je ne me lassai de l’observer. En automne, il portait toujours un imperméable genre Albert Camus et Humphrey Bogart, et se postait à tous les coins de rues du Quartier latin pour se mettre en marche, et comment, sitôt que venait à passer une mamasel mamacita digne de lui faire appliquer la très étudiée, la très prétentieuse science de la conquête amoureuse qui, là-bas, dans sa Lima de quartier minable et de courte vue, s’était révélée aussi exacte qu’infaillible. Je connaissais ses itinéraires préférés et passais mon temps à l’observer avec autant de curiosité que de pitié. Quelle était son erreur ?
Quelle était la raison pour laquelle, à chaque fois, tous les après-midi et tous les soirs, il quittait le Quartier latin sans la moindre proie ?
Je crois que c’était que les filles de ce moment parisien et cosmopolite ne le comprenaient même pas. Et que le temps passant, le rouquin hautain ressemblait de plus en plus à un Indien désemparé descendu à Lima de ses hauteurs andines et qui veut désespérément vous demander quelque chose dans une langue qui lui est étrangère. On a dit, et c’est vrai, qu’on peut croiser à Lima un homme qui vient de débarquer, par exemple, du
XVIe siècle. Eh bien c’est ce qui arrivait, selon moi, à ce pauvre garçon, mais à Paris.
Car lorsque l’hiver fut là et que Remigio González – qui, soit dit en passant, ne mit jamais les pieds au cours de coopératisme pour lequel il avait reçu une bourse – étrenna un manteau tout simplement inénarrable et gomina plus que jamais sa rousse et raide chevelure en répétant plus que jamais mamasel et mamacita et voulez-vous un café avec un Péruvien comme moi à Paris la bohème ?, sans la moindre petite chance de succès, lui et sa réputation déchue de don Juanito – tel était son surnom, depuis la moitié de l’hiver, plus ou moins – n’eurent d’autre solution que de transférer leurs points d’observation du devenir féminin dans le monde des petites nanas arabes. Et là, non seulement il échoua, mais en plus le soir vint où une bande estudiantine arabe agit en groupe et lui flanqua une formidable raclée pour le seul fait d’avoir mis les pieds dans un territoire maghrébin.
Et la raison de tout cela, bien entendu, est qu’un Maghrébin est une sorte de Latino-Américain revu et augmenté, pour tout ce qui concerne l’éternel féminin. Les Maghrébins respectent votre terrain en vertu des lois de la pègre donjuanesque et vont même jusqu’à se contenter de faire un petit salut sérieux et respectueux à votre petite amie, aussi belle et sublime soit-elle. Et alors, malheur à vous, par conséquent, malheur à vous si vous vous occupez d’une jupe qui leur appartient. Ils vous appliquent la loi du plus macho, nocturnement, fourbement et méchamment, ce qui revient à dire qu’ils vous tombent dessus en tas maghrébin et vous laissent par terre, archipiétiné et transformé en chair à ambulance.
Et c’est cette raclée souveraine qui fut la cause de la disparition prolongée du Quartier latin, de ses coins de rues et de ses rues elles-mêmes, du désormais pauvre Remigio González, ainsi que de sa boiteuse et tardive réapparition printanière sur le boulevard Saint-Michel… Il paraît que le génial dramaturge Ramón del Valle-Inclán fascinait les femmes en leur racontant les mille et une versions de la perte de son bras.
Contentons-nous de dire que, décidément, Remigio González n’a pas écrit Divines paroles ni Tirano Banderas ni rien qui y ressemble, il s’en faut et de beaucoup. Et que, avec l’arrivée du printemps et après un échec dans l’entourage des Latino-Américaines il réduisit au maximum son champ d’action et ne tenta plus sa chance, sans chance aucune, que parmi ses compatriotes péruviennes. Et qu’il quitta Paris sans savoir absolument rien de Paris et qu’à Lima il devint si rapidement chauve que, en lui parlant vraiment d’homme à homme, son père lui demanda si par hasard il n’avait pas survécu de justesse à une gonorrhée du printemps ou de l’été, parce que la gonorrhée, dans le Paris de 1925 de M. Gonzalez père était généralement moins maligne et moins mortelle lors de ces deux saisons qu’en hiver.
J’aurais payé pour assister à cette conversation d’homme à homme entre un père de 1925 et un fils qui était rentré du front, en 1966, sans la moindre décoration et sans avoir absolument rien appris sur le coopératisme. Mais je n’étais pas à Lima quand Remigio
González revint de guerre et perdit lamentablement ses cheveux roux et raides, très probablement à cause du climat déprimant et gris qui devait lui rappeler un par un les mille moments où il n’avait pas réussi à tirer un seul coup de feu à Paris. Et pourtant il était têtu comme une mule, ce lamentable et caduc Remigio. Ça, j’en suis sûr, parce qu’un jour, alors qu’on était entré dans les fortes chaleurs de l’été, il fit une ultime apparition donjuanesque du côté de la rue des Écoles.
J’eus le triste privilège de le croiser sur mon chemin et je
m’arrêtai pour le voir avancer en direction du Panthéon, rien de moins, avec un pantalon que même un torero n’aurait pas supporté, tant il était serré, et une très ample chemise hawaïenne à manches super courtes et dont les pans très longs pendaient par devant et par derrière. Il défiait comme jamais l’asphalte peuplé de femelles avec sa démarche de
torero-gros-bras dans un bordel bon marché ou de sbire de dictature banana republic en vacances. C’est là que je le laissai, en route vers le Panthéon, sans qu’une seule fille daigne jeter ne fût-ce qu’un bref regard à ce grand macho du
XIXe siècle.
Et je continuai ma promenade dans ce Quartier latin peuplé de Latino-Américains, où déjà on lisait un Miguel Ángel Asturias, un Julio Cortázar, un Mario Vargas Llosa. Et où tous les Latino-Américains étaient de gauche. Oui, ils étaient tous de gauche. Jusqu’à ceux de droite en vacances qui l’étaient. Tous, absolument tous étaient de gauche dans ce quartier encore étudiant à l’époque où je continuai ma promenade en fredonnant une chanson qui, quelques années plus tôt, avait je crois fait le tour du monde:
Pauvres pauvres Parisiens
Ils ont vraiment une vie de chien…