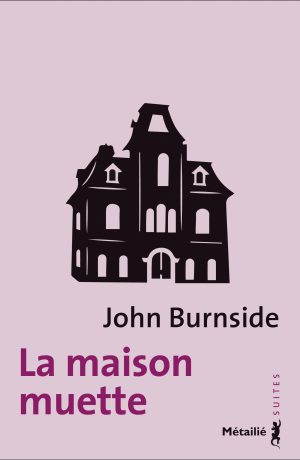« Nul ne pourrait dire que ce fut un choix de ma part de tuer les jumeaux, pas plus qu’une décision de les mettre au monde. Ces événements s’imposèrent l’un et l’autre comme une nécessité inéluctable, un des fils dont est tissée la toile de ce que l’on pourrait appeler destin, faute de mot plus approprié… un fil que ni moi ni personne n’aurait pu ôter sans dénaturer le motif entier. »
Premier roman d’un auteur reconnu comme un grand poète, ce texte d’une violence clinique exceptionnelle est le récit d’une « expérimentation » sur deux enfants jumeaux élevés sans contact avec la parole humaine. La violence s’infiltre peu à peu dans le récit amoral conduit sur un ton détaché, sans recherche d’effet spectaculaire, d’une écriture précise et ciselée de poète.
Plongée dans les méandres les plus noirs de l’esprit humain, réflexion sur la perversion du pouvoir paternel, vertige du désir de la connaissance, réflexion sur le langage, un roman troublant.
« Le haut niveau de folie, le détachement clinique du style. la lente montée de l’horreur font que ce livre glacera votre sang dans vos veines «
Sunday Times
« L ‘un des premiers romans les plus beaux et troublants parus depuis
longtemps.., brillant. »
The Guardian
-
"Un texte puissant et froidement violent, qui pousse à s’interroger sur l’âme et l’humanité." Lire la chronique iciBlog Voyages au fil des pages
-
"Laissez-vous donc tenter par cette réédition du premier roman de John Burnside, paru initialement en 1997, pour l’habileté de l’auteur à manier si joliment les mots, même s’il nous dépeint les pires atrocités et déviances humaines." Lire la chronique iciSite Le Suricate
-
"« Pervers, morbide et poétique : l'écossais John Burnside signe un roman magnifique sur la limite trouble entre bien et mal, à travers un personnage à la folie froide. »"Fabrice GabrielLES INROCKUPTIBLES
-
"Roman d'apprentissage d'une redoutable perversité, réflexion sur le langage, plongée dans les abysses de l'esprit humain, ce premier roman d'un poète écossais, John Burnside, est un des textes les plus troublants qu'on ait lu depuis longtemps."Michel AbescatTELERAMA
-
"L'écrivain amène peu à peu à s'avancer dans une histoire épouvantable dont le lecteur aurait préféré ne rien savoir, une histoire dont la cruauté est parfois racontée avec une précision si détachée qu'elle en devient glaçante et qu'on ne parvient cependant pas à quitter, comme si ces tortures psychologiques et physiques étaient moins éloignées de soi qu'il ne nous semblait au premier abord. Y-a-t'il qui que ce soit pour qui le langage n'ait jamais été un instrument de torture, infligée ou subie ?"Mathieu LindonLIBÉRATION
-
"Le premier roman de John Burnside, poète reconnu, qu'il qualifie de " roman de chambre ", se lit comme un thriller. Le style très particulier qui associe le constat froidement clinique et le cheminement au sein du délire suscite un véritable malaise et met en évidence une autre question délicate : si la frontière entre le corps et l'âme n'est pas facile à repérer, que dire de celle qui sépare la raison de la folie ?"Gérard MeudalLE MONDE DES LIVRES
I. Karen
Nul ne pourrait dire que ce fut un choix de ma part de tuer les jumeaux, pas plus qu’une décision de les mettre au monde. Ces événements s’imposèrent l’un et l’autre comme une nécessité inéluctable, un des fils dont est tissée la toile de ce que l’on pourrait appeler le destin, faute d’un mot plus approprié… un fil que ni moi ni personne n’aurait pu ôter sans dénaturer le motif entier. En revanche je décidai de procéder aux laryngotomies, ne serait-ce que pour mettre un terme à leur chant continuel (si tant est qu’on puisse appeler cela un chant), ce hululement qui saturait mes journées et pénétrait mon sommeil par la moindre fissure de mes rêves. Sur le moment, toutefois, j’aurais dit qu’il s’agissait d’un acte logique, d’une étape de plus dans la recherche que j’avais entreprise presque quatre ans auparavant.., la seule expérience éminemment importante que puisse mener un être humain: trouver le siège de l’âme, ce don unique qui nous différencie des animaux ;
le trouver en instaurant tout d’abord une carence et ensuite, plus tard, en procédant à une destruction logique et nécessaire. Je fus surpris de la facilité avec laquelle je pus opérer sur
ces deux êtres à demi dégrossis. Ils existèrent dans un autre monde : celui des rats de laboratoire, ou l’espace mouvant et dénué de fonction du véritable autisme.
Cette expérience est maintenant terminée. Elle a pris fin, uniquement pour pouvoir recommencer sous une autre forme. Je sais, si tant est que je sache quoi que ce soit, que c’est là le véritable schéma de notre vie: un enchaînement d’incessantes répétitions, ponctué de variations infimes quoique significatives, qui se déroule au fil des ans. L’expérience avec les jumeaux n’était qu’une simple variation sur le thème d’une existence entière. S’il s’était agi d’un travail conventionnel, je serais en train d’en consigner les résultats, de décrire, dans un langage abstrait, un problème initial, une série d’hypothèses et vérifications, l’issue finale. Tout serait clairement énoncé, en termes scientifiques. Mais il ne s’agissait pas d’un travail conventionnel. Il n’existe aucun moyen de dépeindre cette expérience sans dépeindre aussi tout ce qui s’est passé depuis le matin où je prononçai mon premier mot, voilà trente ans, jusqu’au moment où j’ai fermé à clé la porte du sous-sol en laissant les jumeaux à l’intérieur, désormais réduits au silence, se scrutant l’un l’autre avec cet air de chagrin égaré qui, en fin de compte, rendit l’expérience impossible à continuer. Je branchai la musique avant de quitter la pièce, mais je n’avais toujours aucun moyen de savoir ce qu’elle avait signifié pour eux durant leurs années d’isolement. Une fois dehors, j’approchai l’œil de l’ouverture grillagée pour jeter un dernier regard: ils ne semblaient pas avoir remarqué mon départ. Sans bruit, je les abandonnai à la digestion de leur repas empoisonné, montai voir si Karen allait bien, puis préparai du café et attendis.
Cela fait un drôle d’effet à présent, ce silence. Peut-être était-ce ce que j’attendais depuis le début, ce que je voulais. C’est plus qu’une absence de bruit. C’est quelque chose que j’ai mérité: à présent je comprends que sans cela, je n’aurais pu envisager le présent récit. Je devais en connaître la fin avant de l’entreprendre. À présent, je peux commencer par le commencement, quand mère, avec ses belles toilettes, vient tous les soirs dans ma chambre me lire des histoires, mère avec ses perles et ses robes somptueuses, tel un de ces parasites exquis qui contaminent et envahissent leur hôte, sans jamais aller jusqu’à le détruire tout à fait… et qui même, en l’occurrence, créent l’illusion d’une symbiose naturelle, d’une réciprocité nourricière. On ne peut se retenir d’admirer une telle élégance.
Non que je l’en blâme, d’ailleurs. Je l’aimais autant qu’il est possible d’aimer quiconque. Rétrospectivement, j’arrive à voir ses défauts. J’arrive à être détaché, clinique même, dans l’analyse que je fais de notre vie commune ;
pourtant, même à présent, je continue de l’aimer. Enfant, j’étais ébloui par la présence de cet être merveilleux, cette femme qui avait fait de sa personne un si bel objet qu’elle-même s’arrêtait parfois pour admirer son
propre reflet dans un miroir ou une vitre voilée d’obscurité. Enfant, on aime qui on peut. Mon père était timide envers moi, mal à l’aise, retranché dans un cocon, craignant toujours que je m’immisce on ne sait comment et que je le touche. Je crois qu’il avait davantage peur de moi que de mère: il était obsédé par une possible violation, par l’idée de passer pour celui qui s’ingérait entre nous, aussi endossa-t-il le rôle que mère lui avait assigné, celui du mari invisible.
À un certain niveau, je compris sans doute toujours à quel point mère était distante, même envers moi. Elle travaillait sans cesse, tel un architecte, à bâtir un édifice d’histoires, à traiter sa vie et la mienne comme un ouvrage de fiction. Je compris qu’elle était absorbée par un exercice, une invention au sens ancien du terme: tout ce qu’elle faisait était contrôlé, chacune des histoires qu’elle racontait était un rituel. Rien ne variait jamais, et j’admirais cela. Notre relation ressemblait à celle du prêtre et de l’enfant de chœur à la messe: elle était le célébrant, moi j’assistais ;
nos rôles et offices étaient divinement distribués, par conséquent immuables. À présent encore, je soupçonne qu’elle avait raison: grâce à ses stratagèmes, notre vie était ordonnée. Nous pouvions éviter l’intimité sans nous terrer dans nos chambres comme le faisait mon père ;
en usant de rituels et d’histoires, elle créait un terrain neutre où nous pouvions nous retrouver, où tout pouvait être contrôlé, où rien ne débordait jamais les frontières que nous nous fixions.
En présence d’autres personnes, nous étions guindés, peut-être même froids. C’était mon père qui entretenait la conversation avec les invités, en leur racontant des anecdotes sur ses débuts dans les affaires, l’époque où il était en Palestine, la cour maladroite qu’il avait faite à ma mère, en engageant ses interlocuteurs à participer d’une certaine façon, cependant qu’elle l’observait d’un air lointain, presque méprisant. L’anecdote préférée de mon père était celle de leur première rencontre:
comment, alors qu’il se promenait sur une route de campagne, en été à l’heure du couchant, il se retrouva en face d’une belle jeune femme aux boucles châtains, qui traînait un colis le long de Blackness Lane. Lui était en uniforme, à l’époque. Il s’arrêta,
proposa son aide, et ce fut ainsi qu’ils firent connaissance: un homme en uniforme, rentré au pays le temps d’une permission, partant rendre visite à un ami d’un village voisin, et la jolie fille qui voulut bien le laisser porter son paquet, mais ne lui adressa pratiquement plus un mot pendant tout le trajet qui la ramenait chez elle. Mère écoutait le récit qu’il en faisait, puis l’interrompait, vers la fin.
Ça ne s’est pas du tout passé comme cela, lançait-elle aux invités, puis elle se tournait vers mon père et lui disait, avec un agacement qui semblait feint: j’aimerais que tu t’abstiennes de raconter des histoires aussi ridicules.
Mère insistait pour que je prenne part à ces réunions: elle avait besoin de quelqu’un qui soit témoin de la conduite de mon père. Je remplissais donc cet office de mon mieux, ce qui ne faisait qu’accroître la gêne de mon père à mon égard après coup, une fois les invités partis. À l’époque, je soupçonnais que ses histoires étaient vraies (je comprenais même son désarroi) seulement elles ne parvenaient pas à cadrer avec les exigences de mère, non pas d’exactitude, mais de justesse, exigences qui pourraient s’appliquer à une œuvre de fiction ou un portrait. Je constate à présent à quel point je ressemble à ma mère. Parfois, debout dans la cuisine, je contemple l’obscurité, dehors, et je vois son visage qui retourne mon regard, depuis le bosquet d’arbustes. Ce n’est que mon propre visage, mais il suffit d’un infime artifice de lumière et je la vois en moi: les mêmes yeux, la même bouche. Cette ressemblance n’est pas difficile à déceler, en revanche je constate aujourd’hui seulement que je ressemble également à mon père: que je suis tout aussi faible que lui, et que ce fut cette faiblesse qui mena à l’échec l’expérience avec les jumeaux. Quelque chose, dans mon esprit, reste indécis. Il faudrait tout prendre au sérieux, mais dans un esprit de jeu ;
j’aurais dû mener l’expérience avec cette même concentration indéfectible qu’exige un puzzle ou une bonne histoire. C’est là l’essence de la démarche scientifique. Mon problème vint de ce que je ne sus pas jouer: je restai solennel, plutôt que sérieux. Je ne réfléchis pas assez. Je ne sus pas traduire l’intention dans l’acte.
Plus tard, quand je redescendis au sous-sol, les jumeaux étaient morts. Ils gisaient par terre, près d’un des haut-parleurs:
ils se tenaient pelotonnés, enlacés dans les bras l’un de l’autre en une posture qui me rappela les jeunes singes, cette façon qu’ils ont de s’agripper à n’importe quoi lorsqu’ils ont peur. J’attendis un long moment avant d’ouvrir la porte. Je crois que, même alors, j’avais peur d’eux, peur qu’ils soient en train de me jouer un tour de quelque inexplicable manière, peur qu’ils ne soient pas vraiment morts mais feignent de l’être, en espérant me prendre au dépourvu. Et pourtant, quel mal auraient-ils pu me faire ? Ce n’étaient que de petits enfants, après tout. J’ouvris la porte et m’avançai jusqu’à l’endroit où ils gisaient: ils étaient morts, bien sûr, et apparemment sans trop souffrir. Leur douleur avait certes dû être minime, comparée au calvaire enduré par Lillian durant les quelques jours qui suivirent leur naissance. J’en fus heureux. Il semblait juste et normal de les ensevelir à côté d’elle, dans le jardin d’iris ;
ce fut donc ce que je fis. Je travaillai tout l’après-midi à préparer la tombe, puis les transportai hors de la maison l’un après l’autre, dans la lumière du couchant, et les installai l’un à côté de l’autre, face à face dans la terre humide. Il est maintenant minuit. Karen Olerud est à l’étage, toujours endormie dans sa douce prison. Je suis seul, à tous points de vue. À présent, enfin, je peux recommencer.
À dater de l’instant où je parlai pour la première fois, j’eus le sentiment que l’on m’attirait dans un piège. Je me rappelle encore, le souvenir est net et indiscutable: je suis dans le jardin, et mère prononce le mot rose, le répète maintes et maintes fois, le récite telle une incantation magique en montrant du doigt les fleurs qui ornent le treillage, rose tendre et légèrement soufflées… et moi j’écoute, je regarde ses lèvres bouger, en tâchant encore de dissocier la fleur du son. J’avais déjà dépassé l’âge d’apprendre à parler (deux ans, ou peut-être bientôt trois). Pendant longtemps, je refusai de
parler… ce fut en tout cas ce que me raconta mère. J’avais beau sembler intelligent à d’autres égards, le langage me posait des problèmes. Elle était même allée chez le médecin à ce propos, mais il lui avait expliqué
que ce genre de choses arrivait, que c’était tout à fait normal. Tôt ou tard, j’apprendrais à parler, à mon heure, et je rattraperais très vite le temps perdu. Il avait raison. Lorsque effectivement, je me mis à parler, ce fut un genre de capitulation, comme si quelque tension de mon corps s’était rompue, et je prononçai mon premier mot cet après-midi-là, le mot rose, pour désigner cette chose délicatement colorée, charnue, qui fusa tout à coup hors de l’indescriptible continuum de mon monde et devint un objet.
Le leurre et la beauté du langage résident dans le fait qu’il semble ordonner l’univers entier, nous poussant à croire, à tort, que nous vivons à portée de vue d’un espace rationnel, d’une possible harmonie. Mais si les mots nous éloignent du présent, de sorte que nous n’appréhendons jamais vraiment la réalité des choses, ils font du passé une complète fiction. Aujourd’hui, quand je regarde en arrière, je me souviens d’un monde différent: ce qui devait paraître arbitraire et anarchique sur le moment semble parfaitement logique à mesure que je l’expose et pénétré d’une limpidité qui va jusqu’à supposer un but, un sens à la vie. Je me souviens de la campagne qui environnait notre maison avant que ne soient construits les nouveaux lotissements: une obscurité dense, infinie, emplie d’oiseaux à couvert et de houx, gorgée de l’atmosphère des années 50. J e me souviens du vieux village: des enfants passant de maison en maison, vêtus de draps blancs, chantant et riant dans le noir, agitant les bras au passage de notre voiture. Je me souviens de ces mois que je passai ici, seul, après que mère mourut. Le soir, une fois la campagne plongée dans le silence et le calme, j’ôtais mes vêtements et allais, nu, d’une pièce à l’autre, puis sortais dans la fraîcheur du clair de lune pour errer parmi les plates-bandes tel un animal ou quelque envoyé des fées comme il en existait dans les contes de mère. Le jardin est clos de murs: nul ne pouvait me voir, et la maison était si éloignée du village que je n’entendais rien d’autre que les chouettes dans le bois ou le jappement occasionnel des renards loin dans les prés. Je me demandais parfois si j’existais réellement: mon corps semblait autre, nimbé de sa propre odeur pénétrante et suave, une odeur
pareille au sommeil, mêlée de Chanci Nº 19 trouvé sur la coiffeuse de mère.
Lorsque j’étais enfant, mère venait dans ma chambre pour me raconter des histoires. C’était un rituel qu’elle orchestrait sans variation: je devais monter me coucher, puis elle me rejoignait au bout de cinq minutes. J’entendais l’horloge sonner neuf heures pendant qu’elle montait l’escalier. Parfois elle apportait un livre, mais bien souvent, elle racontait de mémoire. Je ne saurais dire si elle inventait ces histoires ou les apprenait par cœur, mais pas une seule fois elle n’hésita ni ne se trompa. A l’époque, j’avais l’impression qu’elle connaissait toutes celles qui furent un jour racontées et qu’il lui suffisait de réfléchir un instant à une histoire donnée pour qu’aussitôt tous les détails affluent à son esprit. Ce fut mère qui me raconta l’histoire d’Akbar: comment il fit bâtir la Maison muette, non par goût du lucre, ni même pour vérifier une hypothèse, mais par pure curiosité. Nul ne sait combien de temps la Maison muette resta debout ni ce qu’il advint des enfants qui y vécurent enfermés avec leurs serviteurs muets. Nul ne le sait parce que l’histoire de la Maison muette n’était guère qu’un épisode au sein d’une autre histoire beaucoup plus longue, une anecdote ajoutée, citée en passant pour illustrer la personnalité d’Akbar le Moghol, l’empereur dyslexique dont la collection de manuscrits fut la plus riche que l’on connaisse au monde. Plus tard, je compris que la majeure partie des détails de l’histoire étaient des embellissements que mère ajouta de son propre chef, pour donner de l’ampleur à ce passage précis que j’aimais tant. En fait, la version initiale de la Maison muette était simple et fugace. Les conseillers du Moghol y débattaient de la question suivante: un enfant vient-il au monde doué de l’aptitude innée, divine, à la parole ?
Ils s’accordaient sur le fait que, d’une certaine façon, ce don est l’équivalent de l’âme, unique caractéristique qui distingue l’humain de l’animal. Mais Akbar, lui, déclara que le langage est acquis, pour la simple et bonne raison que l’âme est innée et que l’âme ne se caractérise par aucune faculté particulière, que ce soit l’aptitude à parler, à rêver ou à raisonner. Car certes, poursuivit-il, si le langage émanait de l’âme, alors il
n’existerait qu’une langue et non une multiplicité. Mais les conseillers ne furent pas d’accord. S’il existait, il est vrai, une multiplicité de langues, celles-ci n’étaient guère que des altérations du don initial ancré dans l’âme par Dieu. Ils avaient eu vent de cas d’enfants laissés à l’abandon pendant des années ou élevés par des animaux: en de telles circonstances, ces enfants avaient créé leur langue à eux, que personne d’autre ne comprenait et qu’ils ne pouvaient avoir apprise de quiconque.
Akbar écouta. Quand les conseillers eurent fini de parler, il leur annonça qu’il allait vérifier leur hypothèse. Il fit construire une demeure par ses artisans, loin de la ville: une grande maison, bien aménagée, dotée de ses propres jardins et fontaines. Là, Akbar installa une cour de muets où il amena un certain nombre de nouveau-nés rassemblés des quatre coins de l’Empire. Les enfants étaient bien traités et on leur apportait tout ce dont ils pouvaient avoir besoin, mais du fait du mutisme de leurs gardiens, ils n’entendaient jamais le langage humain si bien qu’en grandissant ils se révélèrent incapables de parler, comme Akbar l’avait prédit. Les gens venaient de partout dans le royaume pour voir la maison. Ils passaient
des heures devant le mur d’enceinte des jardins, à écouter le silence, et à partir de ce moment-là, la demeure devint célèbre sous le nom de Gang Mahal, ou Maison muette.
Le soir, mère venait dans ma chambre et me racontait cette histoire. Naturellement, sa version à elle était différente: elle mentionnait à peine la controverse à propos du caractère inné du langage ou de la nature de l’âme. Au lieu de quoi elle décrivait le Gang Mahal avec un luxe de détails: les orangers dans les pots de terre cuite, les murs incrustés de pierreries, le silence fantomatique. Couché dans mon lit, j’écoutais, je regardais bouger ses lèvres, enivré par son parfum. Je me demandais ce qui s’était passé une fois ces enfants devenus grands: comment ils pensaient, pour peu que penser soit possible, s’il leur arrivait de conserver le moindre souvenir d’une seconde à l’autre. Il y a des gens qui affirment que le langage est magique. Pour eux, les mots ont le pouvoir de créer et de détruire. À force d’écouter les histoires que me racontait mère, je
me retrouvai pris dans les rets d’une certaine vision du monde:
une attente, une peur secrète. Même à présent, rien ne me semble plus beau que le langage lorsqu’il crée une sensation d’ordre: l’attribution d’un nom aux choses en fonction de leur véritable nature, l’activité de classification, la création de règnes et genres, espèces et sous-espèces, la désignation de ce qui est animal, végétal ou minéral, des plantes monocotylédones, poissons d’eau douce, oiseaux de proie, la classification périodique des éléments. Voilà pourquoi le passé semble parfait, une époque de mesure et d’ordre: parce qu’il est immergé dans le langage. Pour les animaux, il se peut que le souvenir consiste en une sensation, une résonance le long des nerfs ou dans la moelle épinière. Mais pour les humains, le passé ne peut être décrit autrement qu’à l’aide de mots. Il n’existe nulle part ailleurs. Ce qui me tracasse à présent, c’est l’idée que le langage puisse faillir:
l’expérience s’étant achevée de façon si peu concluante, je ne peux m’empêcher d’imaginer que l’ordre qui semble inhérent aux choses n’est qu’un concept, que tout risque de sombrer dans l’anarchie, quelque part dans les longues étendues blanches de l’oubli. C’est pourquoi il est impératif pour moi de recommencer, et c’est pourquoi Karen fut envoyée ici, bien longtemps après, afin de remplir son véritable but.