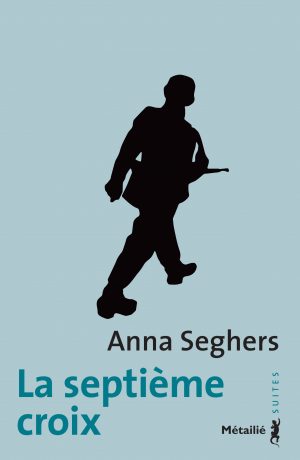Dans les années 30, sept opposants au nazisme s’enfuient d’un camp. Un formidable appareil policier est mis en branle pour les retrouver et sept croix sont dressées. Aidés par la solidarité ouvrière ou bien trahis par des voisins ou des inconnus, combien des fugitifs seront capturés ?
Anna Seghers, qui, pour écrire son récit, a longuement écouté et recueilli les témoignages d’exilés, trace le portrait d’une humanité proche de nous : « Nous avons tous ressenti comment les événements extérieurs peuvent changer l’âme d’un être humain, de manière profonde et terrible. Mais nous avons également ressenti qu’au plus profond de nous il y avait aussi quelque chose d’insaisissable et d’inviolable. »
Ce roman, publié pour la première fois aux États-Unis en 1942, a connu un immense succès international : il a même été envoyé aux soldats américains partis libérer l’Europe.
-
"Aucun artifice littéraire dans ce roman tendu, haletant; et une construction au cordeau, où la vie tient à un regard, à une rencontre, dans ces plaines brumeuses du Rhin et du Main, peuplées de gens ordinaires, de héros et de salauds. Le lecteur est saisi jusqu'à la dernière ligne."Grégoire PinsonChallenges
-
"Bouleversant de précision, le style de Seghers hisse ce roman au niveau d’une méditation universelle sur l’amitié comme élan indestructible, la solidarité comme lâcheté surmontée." Lire l'article iciJean BirnbaumLe Monde des Livres
-
"La septième croix offre une remarquable image de l’Allemagne se préparant à la guerre" Lire la chronique iciSite En attendant Nadeau
-
"C’est le roman des débuts du nazisme que cette Septième croix, fresque sociale de l’Allemagne écrite dans les années trente par Anna Seghers. Une réédition et nouvelle traduction rend à ce chef-d’oeuvre sa vitalité."Oriane Jeancourt GalignaniTransfuge
-
« Un style superbe, un sens aigu du détail, une construction subtile et une tension de tous les instants, tel est ce chef-d’œuvre traduit remarquablement qui raconte sans manichéisme la tragédie de l’Histoire au milieu de la vie ordinaire. »Aline SirbaEtudes
-
« Conduit comme un thriller, ce roman fait immanquablement chambre d’écho avec un présent qui se transforme en champ de mines à "la vitesse inouïe des catastrophes" »Alain DreyfusLe Nouveau Magazine Littéraire
-
« La Septième Croix est un exemple de ce que peut la littérature lorsqu’elle n’oublie pas qu’elle fait partie intégrante du monde réel. Il faut lui souhaiter de nouveau un grand succès. »Jean GuéganEurope
-
"Superbe roman choral sur l’opiniâtre et tacite résistance de l’être ici, d’une communauté saisie dans son ensemble, de sa consistance dédoublée de rêves et de dure réalité." Lire la chronique iciSite La Viduité
-
"La Septième Croix est un roman indispensable" Lire la chronique iciSite Le suricate
-
"La nouvelle traduction (de Françoise Toraille) rend à merveille une prose imagée, colorée, rythmée. C’est magnifique et bouleversant."La Dépêche du midi
-
"Voici une nouvelle traduction, éblouissante."Yasmine YoussiTélérama
-
Lire l'article iciMarc GadmerFemme Actuelle
-
"L'immense roman d’Anna Seghers montre comment une certaine Europe cultivée a rallié le nazisme et sa barbarie." Lire l'article iciSébastien LapaqueLe Figaro Littéraire
-
"Seghers a imaginé une multitude de rencontres avec différents types de personnages,signant une saisissante galerie de portraits où courage et bassesse, solidarité et trahison se côtoient." Lire l'article iciSylvie TanetteLes Inrockuptibles
-
"Un chef-d'oeuvre réédité" Lire l'article iciJean-Claude LebrunLL'Humanité
-
"Une nouvelle traduction donne tout son souffle à ce roman magistral." Lire l'article iciLe Temps
-
"Son style bouleversant de précision, cette écriture de la fraternité qui est alors la sienne, hisse La Septième Croix au niveau d’une méditation universelle sur l’amitié comme élan indestructible, la solidarité comme lâcheté surmontée." Lire l'article iciJean BirnbaumLe Monde des Livres
-
Lire l'entretien avec Nicole Bary iciNicolas WeillLe Monde des Livres
-
"Superbe lecture, prenante." Lire l'article iciBlog Zazymut
Chapitre Un
Jamais peut-être n’ont été abattus en notre pays des arbres aussi étranges que les sept platanes plantés sur le côté de la baraque iii. Auparavant, ils avaient déjà été décapités pour une raison que l’on apprendra plus loin. À hauteur d’épaule, des planches avaient été clouées en travers des troncs, faisant de loin ressembler ces platanes à sept croix.
Le nouveau commandant du camp – il s’appelait Sommerfeld – les fit immédiatement réduire en petit bois. Il était d’une tout autre trempe que Fahrenberg, son prédécesseur, le vieux guerrier, le “vainqueur de Seeligenstadt” – où son père possède de nos jours encore une plomberie sur la place du marché. Officier colonial avant la guerre, le nouveau commandant du camp avait fait partie des Corps africains, et après la guerre, il avait marché sur Hambourg la rouge en compagnie de son vieux major Lettow-Vorbeck. Tout cela, nous ne l’avons appris que bien plus tard. Si le premier chef du camp était un fou, capable d’accès de cruauté terribles et imprévisibles, le nouveau était un esprit terre à terre dont chaque réaction était prévisible. Fahrenberg était capable de nous faire tabasser tous sans préavis, Sommerfeld de nous faire comparaître en rangs bien ordonnés, de désigner un homme sur quatre et de le faire tabasser. À cette époque-là, cela, nous ne le savions pas non plus. Et même si nous l’avions su ! Quelle importance face au sentiment qui s’empara de nous quand les six arbres furent abattus, suivis du septième ! Un triomphe modeste, certes, mesuré à notre impuissance, à nos tenues de prisonniers. Mais un triomphe tout de même qui permit à chacun de ressentir soudain sa propre force après si longtemps, elle qui avait bien assez, même par nous, été considérée comme l’une des nombreuses forces banales de ce monde, de celles que l’on mesure, que l’on exprime par des chiffres alors que nulle autre ne saurait ainsi atteindre soudain la démesure, devenir imprévisible.
Ce soir-là, pour la première fois, nos baraquements furent eux aussi chauffés. Le temps venait de tourner. Aujourd’hui, je ne suis plus tout à fait certain que les quelques bûches qui vinrent alimenter notre poêle en fonte provenaient véritablement de ce bois-là. À l’époque, nous en étions convaincus.
Nous nous pressions autour du petit poêle pour sécher nos loques et parce que le spectacle inhabituel du feu bouleversait nos cœurs. Le sa de faction nous tournait le dos, regardant comme malgré lui au-dehors par la fenêtre grillagée. La bruine grise et fine, guère plus qu’un brouillard, s’était soudain transformée en une pluie battante que de violentes bourrasques précipitaient contre la baraque. En fin de compte, un sa, un dur à cuire, n’entend, ne voit lui aussi qu’une fois l’an l’entrée en scène de l’automne.
Les bûches crépitaient. Deux petites flammes bleues nous montraient que le charbon était lui aussi incandescent. Nous avions droit à cinq pelletées qui ne permettaient de réchauffer la baraque pleine de courants d’air que pour quelques minutes, sans même parvenir à sécher nos effets. Mais nous n’y pensions pas encore. Nous pensions seulement au bois qui se consumait sous nos yeux. Hans dit doucement, sans remuer les lèvres, jetant un regard en coin vers la sentinelle : “Quelle flambée !” Erwin ajouta : “Le septième.” Tous les visages s’éclairèrent d’un sourire faible, étrange, mêlant des sentiments antagonistes, espoir et ironie, impuissance et hardiesse. Nous retenions notre souffle. La pluie frappait tantôt les planches, tantôt le toit en tôle. Le plus jeune d’entre nous, Erich, dit avec un regard de côté, un bref regard rassemblant tout ce qu’il portait en lui et en même temps tout ce qui se trouvait au plus profond de nous tous : “Où peut-il être en ce moment ?”
i
Au début du mois d’octobre, un certain Franz Marnet quittait à bicyclette, quelques minutes plus tôt que d’habitude, la ferme tenue par des parents à lui située sur la commune de Schmiedtheim, dans les contreforts du Taunus. De taille moyenne, trapu, la trentaine, il avait des traits calmes, presque endormis quand il se retrouvait parmi les gens. Mais en ce moment, sur la partie qu’il préférait de son trajet, le raidillon bordé de champs qui menait jusqu’à la chaussée, son visage exprimait une joie de vivre simple et vigoureuse.
Peut-être se demandera-t-on par la suite comment Franz pouvait se réjouir étant donné l’histoire qui était la sienne. Or, justement, il était content, il poussa même un petit cri joyeux quand sa bicyclette cahota sur deux accidents de terrain.
Le lendemain, le troupeau de moutons qui depuis la veille engraissait de son fumier le champ voisin, celui des Mangold, serait conduit jusqu’au grand verger appartenant à ses proches. Aussi prévoyaient-ils de finir aujourd’hui de récolter les pommes. Trente-cinq silhouettes d’arbres, dont les branchages noueux se tordaient en orbes vigoureux dans l’air bleuté, lourdement chargés de pommes reinettes. Toutes si luisantes, si mûres que maintenant, aux premiers rayons du soleil, elles resplendissaient comme d’innombrables petits soleils ronds.
Mais Franz ne regrettait pas de manquer la cueillette. Il avait assez longtemps bricolé à droite et à gauche avec les paysans pour un salaire de misère. Même si au bout de tant d’années de chômage, il ne pouvait que s’en réjouir, et si la ferme de son oncle – un homme tranquille, un type bien – avait été cent fois mieux qu’un camp de travail. Depuis le 1er septembre, il allait enfin à l’usine. Il s’en réjouissait à tous égards, et cela convenait bien aussi à sa famille, car il continuerait à habiter chez eux tout l’hiver comme hôte payant.
Quand Franz longea la ferme voisine, celle des Mangold, ils étaient justement en train d’installer échelles, perches et paniers contre leur imposant poirier mouille-bouche. Sophie, leur aînée, une jeune fille vigoureuse, presque forte sans être pataude, aux attaches délicates, bondit la première sur l’échelle et interpella Franz. Sans comprendre ce qu’elle disait, il jeta un coup d’œil en arrière, rit. Il fut submergé par le sentiment d’avoir sa place dans tout cela. Les gens dont les sentiments, les actions sont marqués de faiblesse auront peine à le comprendre. Pour eux, avoir sa place fait référence à une certaine famille ou à une communauté donnée, ou encore évoque une relation amoureuse. Pour Franz, cela signifiait seulement avoir sa place en cet endroit, avec ses habitants et l’équipe du matin qui se rendait à Höchst, et avant tout, être au nombre des vivants.
Après avoir contourné la ferme des Marnet, il découvrit, par-delà le paysage en pente douce et dégagé, le brouillard à ses pieds. Un peu en dessous, en contrebas de la route, le berger ouvrait tout juste l’enclos. Le troupeau en sortit en se bousculant, épousant aussitôt les contours de la pente, silencieux et dense comme un petit nuage qui tantôt se subdivise en nuages plus petits, tantôt se regroupe, se gonfle. Le berger lui aussi, un gars de Schmiedtheim, cria quelque chose à Franz Marnet. Franz sourit. Avec son cache-col rouge vif, Ernst était un joyeux luron et ressemblait à tout sauf à un berger. Par les fraîches nuits d’automne, des filles de paysans compatissantes venaient des villages voisins le rejoindre dans sa cabane sur roues. Dans son dos, le paysage se déployait en vagues amples et paisibles. Même si de là non plus on ne distingue pas le Rhin, car il est encore à près d’une heure de train de distance, il est pourtant évident que ces vastes pentes vallonnées avec leurs champs, leurs arbres fruitiers et plus bas leurs vignes, la fumée des usines dont on sent l’odeur jusqu’ici, la courbe orientée sud-ouest des voies de chemin de fer et des routes, les endroits qui scintillent et luisent dans le brouillard, et même le berger et son cache-col rouge vif, un bras campé sur la hanche, une jambe en avant comme s’il contemplait non pas des moutons mais une armée – que tout cela indique déjà le fleuve.
On dit de ce pays que la mitraille de la dernière guerre fait toujours ressortir de terre celle de la précédente. Ici, ce sont des collines, pas des montagnes. Chaque enfant peut le dimanche rendre visite à ses proches dans le village situé de l’autre côté pour boire le café accompagné de gâteaux à la pâte sablée, les Streuselkuchen, et être de retour pour l’angélus du soir. Pourtant cette succession de collines fut longtemps le bout du monde – de l’autre côté commençaient les terres indomptées, le pays inconnu. Au long de ces collines les Romains tracèrent le Limes. Tant de générations y avaient versé leur sang depuis qu’ils avaient incendié les autels au soleil édifiés par les Celtes, tant de combats s’y étaient déroulés qu’ils purent alors croire qu’était borné, défriché à tout jamais le monde accessible à leur conquête. Dans son blason la ville située en contrebas n’a conservé ni l’aigle ni la croix, elle arbore la roue celtique, la roue de ce soleil qui fait mûrir les pommes des Marnet. Ici campèrent les légions et avec elles toutes les divinités du monde, celles des villes et celles des campagnes, Dieu des Juifs et Dieu des Chrétiens, Astarté et Isis, Mithra et Orphée. Ici s’ouvrait béant le monde indompté, à l’endroit où en ce moment Ernst, de Schmiedtheim, se campe auprès de ses moutons, une jambe en avant, le poing sur la hanche, et le bout de son écharpe vole comme si le vent soufflait en permanence. Dans la plaine derrière lui, dans le soleil doux et vaporeux, les peuples ont été réduits en charpie. Le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest se sont entremêlés en bouillonnant, mais aucun n’a marqué de sa seule empreinte ce pays qui cependant a gardé quelque chose de chacun. Des empires, telles des bulles colorées, se sont élevés, montant du pays qui s’étend dans le dos du berger Ernst, éclatant presque aussitôt. Ils n’ont laissé ni Limes ni arcs de triomphe ou voies guerrières, seuls quelques anneaux dorés arrachés aux chevilles de leurs femmes. Ils étaient pourtant résistants et indestructibles comme les rêves. Le berger est campé là, si fier, si parfaitement indifférent, comme s’il savait tout cela et ne se tenait ainsi en ce lieu que pour cette raison, peut-être d’ailleurs, alors qu’il ignore tout, en est-il vraiment ainsi. Là où la chaussée débouche sur l’autoroute se rassembla l’armée des Francs quand elle chercha où traverser le Main. Par là passa le moine sur sa monture, gravissant la pente entre la ferme des Mangold et celle des Marnet pour entrer dans le désert absolu et que nul encore venant de là n’avait pénétré, homme frêle sur son petit âne, protégé par la cuirasse de la foi, ceint de l’épée du salut, il apportait les Évangiles et l’art de greffer les pommiers.
Ernst le berger se retourna sur le passage du cycliste. Déjà, il a trop chaud avec son cache-col, il l’arrache et le jette sur le chaume comme un étendard. On pourrait croire qu’il accomplit ce geste devant un millier de paires d’yeux. Mais seule Nelli sa petite chienne le regarde faire. Il reprend sa pose inimitable, ironie et orgueil mêlés, mais cette fois dos à la route, le visage vers la plaine, vers l’endroit où le Main se jette dans le Rhin. Près du confluent se trouve Mayence. Elle fournissait au Saint Empire ses archichanceliers. Et le plat pays entre Mayence et Worms, tout au long de la rive, était lors de l’élection des empereurs envahi par les campements. Tous les ans se déroulaient de nouveaux événements dans ce pays, tous les ans revenaient les mêmes : les pommes mûrissaient et les raisins sous un soleil doucement voilé parmi les soucis et les peines des hommes. Car tous avaient besoin du vin en toutes circonstances, évêques et seigneurs propriétaires terriens pour élire leur empereur, moines et chevaliers pour fonder leurs ordres, les Croisés pour brûler les Juifs, quatre cents d’un coup sur la place de Mayence dont le nom aujourd’hui encore évoque l’incendie, le Brand, princes électeurs membres du clergé ou non, puis après l’effondrement du Saint Empire, alors que les fêtes des puissants étaient devenues joyeuses comme jamais, ce furent les Jacobins pour danser autour des arbres de la Liberté.
Vingt ans plus tard, sur le pont flottant de Mayence, un vieux soldat montait la garde. Quand passèrent près de lui les derniers rescapés de la Grande Armée, en haillons, sombres, lui revint le moment où il faisait de même à leur entrée dans la ville, apportant le drapeau tricolore et les droits de l’homme, et il éclata en sanglots. Cette sentinelle aussi fut retirée. Le calme se fit, même en ce pays. Jusqu’ici vinrent aussi les années 1833 et 1848, ténues, amères, deux filets de sang coagulé. Revint un empire, qu’aujourd’hui on appelle le Deuxième. Bismarck fit dresser ses bornes frontalières non pas autour du pays, mais au beau milieu, afin que les Prussiens y trouvent leur compte. Car les habitants n’étaient pas vraiment d’un naturel rebelle, ils étaient seulement trop indifférents, tels des gens qui ont vécu et vivront encore toutes sortes d’aventures.
Quand les gamins s’allongeaient sur le sol derrière Zahlbach, entendaient-ils vraiment les combats de Verdun, ou seulement les incessantes vibrations agitant le sol sous les roues des wagons de chemin de fer et le pas cadencé des armées ? Plus d’un parmi eux se retrouva par la suite devant les tribunaux. Les uns pour avoir fraternisé avec les soldats de l’armée d’occupation, d’autres pour avoir posé des mèches sous les rails. Sur les bâtiments du tribunal flottaient les drapeaux de la commission interalliée.
Depuis moins de dix ans, ces drapeaux ont été amenés, remplacés par les drapeaux noir, rouge, or qui en ce temps-là étaient encore ceux du Reich. Même les enfants s’en sont récemment souvenus, lorsque le 144e régiment d’infanterie a pour la première fois retraversé le pont aux accents de la fanfare. Quel feu d’artifice le soir venu ! Ernst put le contempler de là-haut. Ville enflammée, hurlant d’enthousiasme, par-delà le fleuve ! Des milliers de petites croix gammées dessinant des volutes dans l’eau ! Comme elles filaient au-dessus, les flammèches ensorcelées ! Au matin, le fleuve abandonnant la ville derrière le pont du chemin de fer avait conservé son calme gris bleuté, demeuré pur et sans mélange. Il en a emporté, des étendards, des drapeaux ! Ernst siffle sa petite chienne qui lui rapporte son cache-col entre ses dents.
Maintenant, c’est nous qui sommes ici. Ce qui survient nous concerne.